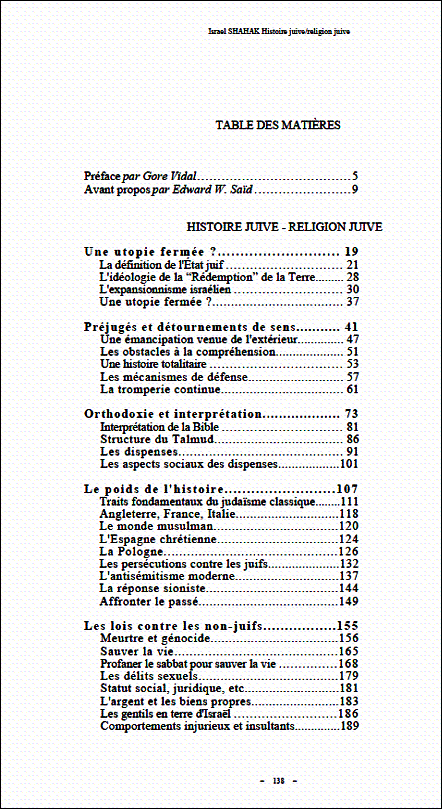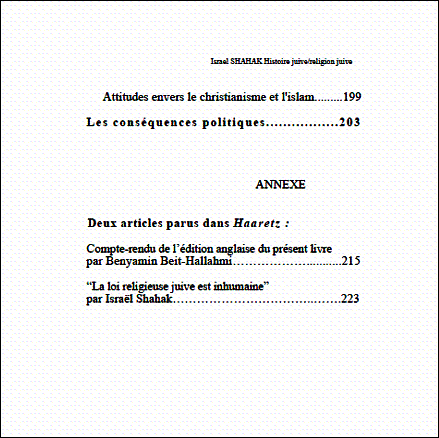HISTOIRE JUIVE - RELIGION JUIVE
Israël SHAHAK
La définition de l’État juif
Il faut parler
des attitudes adoptées couramment par les juifs vis-à-vis des non-juifs :
sans cela, il n’est même pas possible de comprendre l’idée d’Israël comme
« État juif », selon la définition qu’Israël s’est donnée
officiellement. Le malentendu général qui — indépendamment même du régime en
vigueur dans les Territoires occupés — fait d’Israël une véritable démocratie,
provient du refus de voir en face ce que l’expression « État juif »
signifie pour les non-juifs. À mon avis, Israël en tant qu’État juif, constitue
un danger non seulement pour lui-même et pour ses habitants, mais aussi pour
tous les juifs et pour tous les autres peuples et États du Moyen- Orient et
d’ailleurs. Je considère comme tout aussi dangereux d’autres États ou entités
politiques de la région qui, pour leur part, se définissent comme
« arabes » ou « islamiques ». Je suis bien loin d’être le
seul à évoquer ces risques. En revanche, personne ne parle du danger inhérent
au caractère juif de l’État d’Israël.
Le principe faisant d’Israël
« un État juif » fut dès le début d’une importance capitale pour les
politiciens israéliens, et il a été inculqué à la population juive par tous les
moyens imaginables. Au début des années 80 s’est formée, parmi les juifs
israéliens, une toute petite minorité s’opposant à ce concept : la Knesset
a alors (en 1985) adopté, à une écrasante majorité, une Loi constitutionnelle
(c’est-à-dire prévalant sur des dispositions d’autres textes de loi, qui sinon
ne pourraient être abrogées que par une procédure spéciale et compliquée) qui
exclut de la participation aux élections parlementaires tout parti dont le
programme s’oppose explicitement au principe d’un « État juif », ou
propose de le modifier par des moyens démocratiques. Étant moi-même
vigoureusement opposé à ce principe constitutionnel, il m’est légalement
impossible, dans cet État dont je suis citoyen, d’appartenir à un parti qui,
tout en ayant des principes avec lesquels je sois d’accord, serait admis à
concourir aux élections à la Knesset. Cet exemple à lui seul montre que l’État
d’Israël n’est pas une démocratie, du fait que cet État applique une idéologie
juive à l’encontre de tous les non-juifs, et à l’encontre des juifs qui
s’opposent à cette idéologie. Mais le danger représenté par cette idéologie
dominante ne se limite pas aux affaires internes ; elle influence aussi la
politique étrangère d’Israël. Et ce danger ira croissant, tant que l’on
continuera de renforcer deux ordres de facteurs opérant dans le même
sens : le caractère juif d’Israël et le développement de sa puissance,
notamment de sa force nucléaire. À cela s’ajoute un autre facteur
inquiétant : l’accroissement de l’influence israélienne sur les milieux
dirigeants des États- Unis. Il est donc aujourd’hui non seulement important,
mais vital, politiquement, de fournir des informations exactes et précises sur
le judaïsme et, en particulier, sur la façon dont les non-juifs sont traités
par Israël.
Je commencerai par la
définition israélienne officielle du terme « juif », qui est
révélatrice de la différence décisive entre Israël en tant qu’« État
juif » et la plupart des autres États. Israël, en effet,
« appartient » (c’est le terme officiel) aux personnes définies comme
« juives » par les autorités israéliennes et à elles seules, et ce,
quel que soit leur lieu de résidence. Inversement, Israël n’« appartient »
pas officiellement à ses habitants non juifs, dont le statut est considéré,
même officiellement, comme inférieur. Cela signifie en pratique que si les
membres d’une tribu péruvienne sont convertis au judaïsme et sont donc
considérés comme juifs, ils ont aussitôt le droit de devenir des citoyens
israéliens et de participer à l’exploitation d’environ 70 % des terres de
Cisjordanie (et de 92 % du domaine d’Israël proprement dit), assignées
officiellement au bénéfice exclusif des juifs. En revanche, il est interdit à
tout non-juif (et non seulement à tous les Palestiniens) de profiter de ces
terres. (Interdiction qui s’applique même aux arabes israéliens qui ont servi
dans l’armée israélienne, même à ceux qui ont atteint un rang élevé.) —
L’exemple que je donnais s’est effectivement produit : il y a quelques
années, un groupe de Péruviens convertis au judaïsme a pu s’établir près de
Naplouse (Cisjordanie) sur des terres dont les non-juifs sont officiellement
exclus. Tous les gouvernements israéliens ont pris et continuent de prendre des
risques politiques énormes, y compris celui de la guerre, pour que ce genre
d’implantations, constituées exclusivement de personnes définies comme
« juives » (et non « israéliennnes », comme l’affirment
mensongèrement la plupart des médiats) relèvent de la seule autorité
« juive ».
Les juifs des États-Unis et
de Grande-Bretagne ne crieraient-ils pas à l’antisémitisme, si l’on proposait
de décréter leurs pays « États chrétiens », « appartenant »
aux seuls citoyens officiellement reconnus comme chrétiens ? La
conséquence d’une telle doctrine serait que les juifs se convertissant au
christianisme deviendraient par là-même des citoyens à part entière… Les juifs
n’ont pas manqué d’occasions d’apprendre, au long de leur histoire, les
bienfaits de la conversion. La discrimination, exercée à maintes époques par
les États chrétiens et musulmans à l’encontre des juifs et de toutes les
personnes n’appartenant pas à la religion officielle, cessait dès qu’on se
convertissait. Mais n’en va-t-il pas de même, aujourd’hui, en Israël, pour un
non-juif ? Qu’il se convertisse au judaïsme, et il ne sera plus victime de
la discrimination officielle. Ainsi, le même type d’exclusive que la majorité
des juifs de la diaspora dénoncent [dans le premier cas] comme antisémite est
considérée [dans le second] comme juive par la majorité de tous les juifs. Mais
s’opposer à la fois à l’antisémitisme et au chauvinisme juif est une attitude
que beaucoup de juifs traitent de « haine de soi », notion que je
considère comme absurde.
On comprendra donc que dans
le contexte de la politique israélienne, la signification du terme « juif »
et des mots apparentés (notamment « judaïsme ») ait autant
d’importance que la signification de « islamique » pour l’État
iranien, ou que celle de « communiste » lorsque ce terme était
utilisé par les autorités de l’ex-URSS. Or, le sens du mot « juif » »,
dans son usage courant, n’est pas précis, que ce soit en hébreu ou dans les
autres langues ; aussi a-t-il fallu en donner une définition officielle.
Selon le droit israélien,
une personne est considérée comme « juive » si sa mère, sa
grand-mère, son arrière-grand-mère et sa trisaïeule étaient de confession
juive ; ou bien, si cette personne s’est convertie au judaïsme d’une façon
jugée satisfaisante par les autorités israéliennes ; et à condition, bien
sûr, que la personne en question ne se soit pas convertie du judaïsme à une
autre religion — auquel cas Israël cesse de la considérer comme
« juive ». La première de ces conditions correspond à la définition
donnée par le Talmud et reprise par l’orthodoxie juive. Le droit rabbinique
talmudique et post-talmudique reconnaît aussi la conversion d’une personne au
judaïsme (ainsi que l’achat, suivi d’une autre sorte de conversion, d’un
esclave non juif par un juif) comme un moyen de devenir juif, pourvu que la
conversion soit accomplie dans les formes par des rabbins dûment habilités. Ces
« formes » comportent, pour les femmes, leur inspection par trois
rabbins lors d’un « bain lustral » ; rituel bien connu de tous
les lecteurs de la presse hébraïque, mais qui n’est pas souvent évoqué par les
médiats anglophones ou autres, en dépit de l’intérêt qu’y prendrait
certainement une partie du public. Espérons que ce livre contribuera à réduire
cette inégalité.
Mais une autre raison
impérieuse exige de définir officiellement qui est « juif » et qui ne
l’est pas. L’État d’Israël, en effet, privilégie officiellement les juifs par
rapport aux non-juifs dans de nombreux aspects de l’existence. Je citerai les
trois qui me semblent les plus importants : le droit de résidence, le
droit au travail et le droit à l’égalité devant la loi. Les mesures
discriminatoires concernant la résidence se fondent sur le fait qu’environ 92 %
du territoire d’Israël est propriété de l’État, administrée par le Domaine
israélien (Israel Land Authority), selon des règlements fixés par le Fonds national
juif (FNJ — Jewish National Fund), filiale de l’Organisation sioniste mondiale.
Ces règlements dénient le droit de résider, d’ouvrir un commerce et souvent
aussi de travailler à quiconque n’est pas juif, et pour ce seul motif ; en
revanche, rien n’interdit aux juifs de s’établir ou de fonder des entreprises
n’importe où en Israël. Appliquées dans un autre État à l’encontre des juifs,
de telles pratiques seraient immédiatement et à juste titre taxées
d’antisémitisme et soulèveraient un tollé général. Appliquées par Israël au nom
de son « idéologie juive », elles sont en général soigneusement
ignorées — ou excusées dans les rares cas où on en fait état.
Le déni du droit au travail
signifie qu’il est interdit officiellement aux non- juifs de travailler sur les
territoires administrés par le Domaine israélien conformément aux règlements du
FNJ. Il est clair que ces règlements ne sont pas toujours, ni même souvent
respectés, mais ils existent. De temps à autres les autorités lancent des
campagnes pour les faire appliquer ; par exemple, le ministère de
l’Agriculture part soudain en guerre contre « cette plaie » [qu’est]
« l’embauche de journaliers arabes pour la récolte des fruits dans des
plantations appartenant à des juifs et situées sur la Terre nationale [c’est-à-dire
propriété de l’État d’Israël] » — même si les ouvriers agricoles en
question sont des citoyens israéliens. D’autre part, Israël interdit
formellement aux juifs installés sur la « Terre nationale » de
sous-affermer ne fut-ce qu’une partie de leurs terres à des arabes, même pour
un bref laps de temps ; les contrevenants sont punis, en général, d’une
forte amende. En revanche, rien n’empêche les non-juifs de louer leurs terrains
aux juifs. Ainsi, étant moi-même juif, j’ai le droit de prendre à ferme à un
autre juif un verger pour en récolter les fruits, mais ce droit est dénié à un
non-juif, qu’il soit citoyen israélien ou résident étranger.
Les citoyens non-juifs
d’Israël ne jouissent pas du droit à l’égalité devant la loi. Cette
discrimination s’exprime dans de nombreuses lois, même si — sans doute pour
éviter des « problèmes » — elles évitent d’employer explicitement les
termes « juif » et « non-juif », comme le fait, au
contraire, la loi fondamentale dite du Retour. Selon cette loi, les personnes
reconnues officiellement comme « juives » ont de ce fait même le
droit d’entrer en Israël et de s’y établir. Elles reçoivent automatiquement un
« certificat d’immigration » qui, à leur arrivée, leur donne
« la citoyenneté en vertu de leur retour dans la patrie juive »,
ainsi que le droit à de nombreux avantages financiers. Ceux-ci varient selon le
pays de provenance. Par exemple, les juifs provenant des États de l’ex-URSS
reçoivent une « allocation d’intégration » de plus de 20 000 dollars
par famille. Aux termes de cette loi, tout juif qui s’établit en Israël
acquiert aussitôt le droit de vote et celui d’être élu à la Knesset [le
Parlement] — même s’il ne sait pas un mot d’hébreu.
Les autres lois israéliennes
recourent à ces périphrases pudiques : « toute personne pouvant
immigrer conformément à la loi du Retour », « toute personne non
habilitée à immigrer conformément à la loi du Retour ». Selon la loi
considérée, tel ou tel avantage est garanti à la première catégorie de
personnes et systématiquement refusé à la seconde. Le moyen le plus simple
d’imposer la discrimination dans la vie quotidienne est la carte d’identité,
que chaque Israélien est tenu d’avoir toujours sur soi. La carte d’identité
indique en effet la « nationalité » officielle de son détenteur :
« Juif », « Arabe », « Druze », etc. — bref,
toutes les « nationalités » imaginables, à une exception près, qui
est de taille : il n’a jamais été possible d’obtenir du ministère de
l’Intérieur de se définir comme « Israélien », voire « juif
israélien » sur sa carte d’identité. Depuis des années, tous ceux qui
auraient opté pour une telle définition reçoivent du ministère de l’Intérieur
une lettre les informant qu’ » il a été décidé de ne pas reconnaître
une nationalité israélienne ». Décidé quand, et par qui ? La
circulaire ne le précise pas.
L’inégalité instituée en
faveur des citoyens définis comme « pouvant immigrer conformément à la loi
du Retour » se reflète dans une énorme quantité de lois et de règlements,
et c’est un sujet qui ne peut être traité qu’à part. Je citerai ici un seul
cas, dérisoire, apparemment, auprès des restrictions de résidence par exemple,
et néanmoins tout à fait révélateur des intentions réelles du législateur
israélien : les citoyens israéliens qui quittent le pays pendant un
certain temps mais relèvent de la première catégorie, ont droit à leur retour à
de généreuses franchises douanières, peuvent obtenir, sur simple demande, des
bourses d’études universitaires pour leurs enfants, une aide ou un prêt très
favorable pour l’acquisition d’un logement, ainsi que d’autres avantages. Les
citoyens ne relevant pas de cette catégorie, autrement dit les citoyens non
juifs d’Israël n’ont droit à rien de tel. L’intention évidente de ces mesures
discriminatoires est de réduire la proportion des citoyens non juifs, afin de
faire d’Israël un État plus « juif ».
(…)
CHAPITRE VI
Les
conséquences politiques
La persistance
des attitudes du judaïsme classique envers les non-juifs exerce une profonde influence
sur ses adeptes, non seulement sur les juifs orthodoxes, mais aussi sur ceux
que l’on peut considérer comme ses épigones : les sionistes. Et à travers
ces derniers, ces attitudes influencent aussi les orientations politiques de
l’État d’Israël. Depuis 1967 Israël, devenant de plus en plus
« juif », suit une politique dictée davantage par des considérations
relevant de l’« idéologie juive » que par une froide appréciation de
ses intérêts impériaux. Le poids de cette idéologie n’est pas perçu, en général,
par les observateurs étrangers, qui ont tendance à ignorer ou à minimiser
l’emprise de la religion juive sur la politique israélienne. Ceci explique
pourquoi ils se trompent si souvent dans leurs prévisions.
Or, ce sont des
questions religieuses, souvent dérisoires, qui plus que tout autre type de
cause, provoquent la plupart des crises gouvernementales israéliennes. Sauf en
temps de guerre ou de tensions menaçant la sécurité, la presse hébraïque fait
une part énorme aux querelles perpétuelles entre les divers groupes religieux,
ou entre les religieux et les laïcs. À l’heure où j’écris, début
d’août 1993, voici quelques-uns des sujets qui, manifestement, passionnent
les lecteurs de la presse hébraïque : les soldats tués au combat, nés de mère
non juive, doivent-ils être inhumés dans une division séparée des cimetières
militaires israéliens ? Les pompes funèbres religieuses juives, qui ont
monopole de sépulture pour tous les juifs (sauf les membres des kibboutz)
seront-elles autorisées à continuer, comme elles l’ont toujours fait (sans
consulter les familles), de circoncire les cadavres de juifs non circoncis
avant de les enterrer ?
L’importation de
viande non casher, frappée d’une prohibition de fait depuis l’instauration de
l’État, va-t-elle être autorisée ou interdite par la loi ? Ces questions,
et bien d’autres de la même veine, intéressent beaucoup plus le public
juif-israélien que, disons, les négociations avec les Palestiniens et la Syrie.
Quelques dirigeants israéliens ont parfois tenté de passer outre aux facteurs
relevant de l’« idéologie juive » pour mettre en avant les intérêts
purement stratégiques de l’État : ces initiatives ont eu invariablement
des conséquences désastreuses. Ainsi, au début de 1974, après sa défaite partielle
dans la guerre de Yom Kippour, il était essentiel, pour Israël, d’enrayer le
regain d’influence de l’OLP — laquelle n’était pas encore reconnue par la Ligue
arabe comme l’unique représentant légitime des Palestiniens. Le gouvernement
israélien eut donc l’idée d’un plan visant à renforcer l’emprise jordanienne en
Cisjordanie, emprise qui était alors considérable. Le roi Hussein, sollicité,
exigea des signes visibles de réciprocité. Ainsi, les deux parties convinrent
que son principal partisan en Cisjordanie, le cheikh Jabri d’Hébron, qui
dirigeait d’une main de fer tout le sud de la Cisjordanie avec la bénédiction
de Moshé Dayan, alors ministre de la Défense, inviterait les notables de la
région à une grande réception dans les jardins de son fabuleux palais. La fête
serait donnée pour l’anniversaire du roi, avec grand pavoisement aux couleurs
de son pays, et marquerait le début de la campagne pro-jordanienne. Mais les
colons religieux de Kiryat-Arba, dans les environs d’Hébron, qui n’étaient
qu’une poignée à l’époque, eurent vent de ces projets ; ils rappelèrent à
Golda Meir et à Dayan que hisser le drapeau d’un « État non juif »
sur la Terre d’Israël est contraire au principe sacro-saint, selon lequel cette
terre n’« appartient » qu’aux juifs — et ils prédirent de violentes
manifestations. Ce principe étant reconnu par tous les sionistes, le
gouvernement dut s’incliner, et il ordonna au cheikh Jabri de ne pas déployer
le moindre drapeau jordanien. Sur quoi Jabri, gravement offensé, annula les
réjouissances, et peu après, à la conférence de Fez de la Ligue arabe, le roi
Hussein vota la reconnaissance de l’OLP comme unique représentant des
Palestiniens. De même, aujourd’hui, ce genre de préoccupations idéologiques
l’emportent largement sur toutes les autres dans l’attitude de la masse du
public juif-israélien face aux négociations en cours sur
l’« autonomie » palestinienne.
Nous avons été
amenés à considérer la politique israélienne à la lumière d’une étude du
judaïsme classique ; il en ressort que toute analyse des mécanismes de
décision politique en Israël qui néglige l’importance primordiale de son
caractère unique d’« État juif » ne peut qu’aboutir à de fausses
conclusions. En particulier, les nombreuses comparaisons qui ont été faites
entre Israël et d’autres exemples d’impérialisme occidental ou d’État de
colons, passent à côté du sujet. À l’époque de l’apartheid, le territoire de
l’Afrique du Sud était officiellement divisé en deux parties : 87 %
« appartenant » aux blancs, et 13 % « appartenant » en
principe aux noirs. De plus on y a établi des États officiellement souverains,
nantis de tous les symboles de la souveraineté, les « Bantoustans ».
Mais l’« idéologie juive » interdit de reconnaître
l’« appartenance » à des non-juifs de la moindre parcelle de la Terre
d’Israël — ou d’y autoriser officiellement le déploiement de drapeaux
jordaniens ou autres signes d’une souveraineté non juive. Le principe de la
Rédemption de la Terre exige que dans l’idéal toute cette terre, et non quelque
87 %, soit finalement « rachetée », c’est-à-dire devienne
propriété exclusive des Juifs. L’« idéologie juive » exclut ce
principe de domination très commode, déjà connu des Romains et appliqué par
tant d’empires séculiers, que résume à la perfection le mot de Lord
Cromer : « Nous ne gouvernons pas l’Égypte, nous gouvernons les
gouverneurs d’Égypte ». L’idéologie juive interdit de telles
reconnaissances ; elle interdit aussi jusqu’au moindre semblant de respect
envers tout « gouverneur non juif » d’un bout de la Terre d’Israël.
Le système si pratique du « clientélisme », qui transforme rois,
sultans, maharadjahs, grands chefs et, à une époque plus moderne, des
dictateurs fantoches en autant d’instruments d’une hégémonie impériale, est
inapplicable à l’intérieur des régions considérées comme partie intégrante de
la Terre d’Israël. Aussi la crainte, couramment exprimée par les Palestiniens,
de se voir proposer un « Bantoustan » est-elle dénuée de tout
fondement. Israël ne peut faire marche arrière que dans un seul cas : si
un conflit entraîne de nombreuses pertes en vies juives, comme cela s’est
produit aussi bien en 1973 qu’en 1983-1985, lors des séquelles de la
guerre du Liban ; alors, en effet, un repli peut être justifié, au nom du
principe que le caractère sacré de toute vie juive l’emporte sur toute autre
considération. Tant qu’Israël demeurera un « État juif », il est
exclu qu’il octroie, pour des raisons purement politiques, une souveraineté
truquée mais comportant nécessairement des symboles réels, ou ne serait-ce
qu’une autonomie effective, aux non-juifs vivant sur la Terre de Israël. Israël
n’est pas le seul État exclusiviste de la planète, mais son exclusivisme est
sui generis.
Outre la
politique israélienne, il est permis de conjecturer que l’« idéologie
juive » influence aussi des secteurs importants, sinon la majorité des
juifs de la diaspora. Si la mise en oeuvre effective de l’idéologie juive
dépend de la force relative d’Israël, celle-ci dépend à son tour, dans une
mesure considérable, de l’appui donné à Israël par les juifs de la diaspora, et
en particulier des États-Unis. L’image des juifs de la diaspora et de leurs
attitudes envers les non-juifs diffère complètement des attitudes du judaïsme
classique, tel que décrites ci-dessus. Ce hiatus est le plus évident dans les
pays anglophones, où sont produites régulièrement les plus grandes
falsifications du judaïsme. C’est aux États-Unis et au Canada que la situation
est la pire : dans les deux États qui soutiennent de la façon la plus
décisive la politique israélienne, même lorsque celle-ci est en contradiction
éclatante avec les droits de l’homme fondamentaux de personnes non juives.
Le soutien des
États-Unis à Israël, si on le considère non dans l’abstrait mais dans ses
aspects concrets, ne peut être ramené à un simple corollaire des intérêts
impérialistes de ce pays. La forte influence exercée par la communauté juive
organisée des États-Unis en faveur de toute politique israélienne est un
facteur qu’il convient aussi de prendre en compte pour expliquer les stratégies
moyen-orientales des diverses administrations américaines. Ce phénomène est
encore plus visible dans le cas du Canada, dont les intérêts au Moyen-Orient ne
peuvent être considérés comme importants, et dont néanmoins l’attachement à la
cause d’Israël est encore plus absolu que celui des États-Unis. Dans les deux
pays (et aussi en France, en Grande-Bretagne et dans bien d’autres États) les
organisations juives soutiennent Israël avec le même genre de fidélité
indéfectible que les partis communistes accordèrent si longtemps à l’URSS. Bien
plus, de nombreux juifs engagés dans la défense des droits de l’homme, et qui
sur d’autres questions adoptent des vues non conformistes, révèlent, dans les
affaires qui mettent en cause Israël, une forme d’esprit remarquablement
totalitaire et sont parmi les premiers à venir à la rescousse de cet État,
quelle que soit sa politique. Il est bien connu en Israël que le chauvinisme et
le fanatisme pro-israélien étalés par les juifs organisés de la diaspora
(surtout depuis 1967) dépassent de loin le chauvinisme du juif israélien
moyen. Ce fanatisme est particulièrement marqué au Canada et aux
États-Unis ; je m’attacherai au cas de ce dernier pays, vu son importance
politique fondamentale. Mais il y a aussi beaucoup de juifs — il faut le
signaler — qui sur la politique israélienne, ont le même genre d’opinions que
le reste de la société (opinions variant selon le pays, la position sociale, le
revenu et les autres facteurs à prendre en considération).
Donc, pourquoi
ce chauvinisme, parfois extrême, exprimé par une partie des juifs américains,
et pas par les autres ? Il faut tenir compte de l’importance
sociale-mondaine et par conséquent politique des organisations juives de type
« fermé » [exclusive] : elles n’admettent par principe aucun
membre non juif. (Cet exclusivisme fait un contraste amusant avec leur
acharnement à condamner le moindre club qui refusent d’admettre des juifs.)
Ceux qu’on peut appeler « juifs organisés », qui en dehors de leurs
heures de travail passent la plupart de leur temps en compagnie d’autres juifs,
continuent, je peux le supposer, d’entretenir l’exclusivisme juif et les
positions du judaïsme classique à l’égard des non-juifs. Ils ne peuvent certes
pas laisser libre cours à de telles attitudes, dans ces États-Unis où les non-juifs
constituent plus de 97 % de la population. Mais leurs sentiments réels
s’expriment quand même, par « compensation », dans leur soutien à
l’« État juif » et au traitement qu’il inflige aux non-juifs du
Moyen-Orient.
Comment
expliquer autrement que tant de rabbins américains aient soutenu, avec une
telle ardeur, des causes comme celle de Martin Luther King, alors qu’ils n’ont
rien fait en faveur des droits des Palestiniens, ne serait-ce que de leurs
droits individuels fondamentaux ? Comment expliquer autrement la
contradiction flagrante entre les attitudes du judaïsme classique envers les
non-juifs, dont notamment la règle interdisant de leur sauver la vie, sinon
dans l’intérêt des juifs — et le soutien que les rabbins et les juifs organisés
des États-Unis ont apporté à la lutte pour les droits des noirs ? Martin
Luther King, après tout, n’était pas juif, pas plus que la majorité des noirs
américains. Même si l’on considère que ces opinions sur les non-juifs ne sont
partagées que par les juifs conservateurs et orthodoxes, qui aux États-Unis
constituent quand même la majorité des juifs organisés — le fait est que
l’autre partie, les réformés, ne se sont jamais opposés à eux, voire, à mon
avis, se montrent complètement influencés par eux. En fait, il s’agit d’une
contradiction apparente, qu’il est facile d’expliquer. Rappelons encore une
fois que le judaïsme, surtout dans sa forme classique, est de nature
totalitaire. Le comportement des tenants des autres idéologies totalitaires de
notre époque n’a pas été différent de celui des juifs organisés des États-Unis.
Staline et ses suppôts ne se sont jamais lassés de condamner la discrimination
contre les noirs américains ou sud-africains, surtout au moment des plus grands
crimes commis en URSS. Le régime d’apartheid sud-africain — et ses partisans
dans d’autres pays — ne se sont jamais lassé de dénoncer les violations des
droits de l’homme commises par les communistes ou par d’autres régimes
africains. L’on pourrait citer beaucoup d’exemples semblables. La défense de la
démocratie ou des droits de l’homme est donc dénuée de sens, ou même nuisible
et trompeuse lorsqu’elle ne commence pas par la critique de soi, et la défense
des droits de l’homme violés par le groupe auquel on appartient. Toute défense
des droits de l’homme en général, de la part d’un juif, qui ne comporte pas la
défense des droits de l’homme des non-juifs dont les droits sont bafoués par
l’« État juif », est aussi trompeuse que la défense des droits de
l’homme par les staliniens. Le bel enthousiasme avec lequel, dans les années 50
et 60, les rabbins américains et les organisations juives des États-Unis
ont embrassé la cause des noirs du Sud n’avait qu’un seul mobile, l’intérêt
propre des juifs. De même que pour les communistes qui appuyaient ces mêmes noirs,
l’objectif était une « récupération » politique de la communauté
afro-américaine ; dans le cas des Juifs, il s’agissait d’obtenir un
soutien de principe et aveugle à la politique d’Israël au Moyen-Orient.
Donc, l’épreuve
réelle qui s’impose aux Juifs, aussi bien d’Israël que de la diaspora, est
celle de leur capacité de faire leur propre critique, ce qui implique la
critique du passé juif. L’aspect le plus important d’une telle critique doit
être un examen circonstancié et honnête de l’attitude des juifs à l’égard des
non-juifs. C’est ce que beaucoup de juifs exigent à juste titre des
non-juifs : de faire face à leur propre passé pour prendre ainsi
conscience de la discrimination et des persécutions infligées aux juifs.
Pendant les quarante dernières années, le nombre de non-juifs tués par des
juifs dépasse largement le nombre des victimes juives. Les persécutions et la
discrimination imposées par l’« État juif » avec le soutien des juifs
organisés de la diaspora sont énormément plus graves que les souffrances
infligées aux juifs par les régimes qui leur sont hostiles. La lutte contre
l’antisémitisme (et toute autre forme de racisme) ne doit certes jamais cesser,
mais la lutte contre le chauvinisme et l’exclusivisme juifs, qui passe
nécessairement par une critique du judaïsme classique, est aujourd’hui aussi
importante, sinon plus.
Israël Shahak
HISTOIRE JUIVE - RELIGION JUIVE
Le poids de trois millénaires
avec une préface de Gore Vidal et un
avant propos de Edward W. Saïd
Traduit de l'anglais par Denis Authier
I.S.B.N. :
2-903279-18-7
© La Vieille Taupe (Pierre Guillaume), 1996
Préface
Gore Vidal
Un jour, vers
la fin des années 50, ce bavard de classe internationale, historien à ses
heures, qu’était John Kennedy me racontait les débuts de la campagne
présidentielle de Truman en 1948 : cela s’annonçait mal, tout le
monde ou presque l’avait lâché ; c’est alors qu’un sioniste américain lui
apporta une valise bourrée de deux millions de dollars, directement dans son
train électoral. « Voilà pourquoi nous avons reconnu Israël avec une telle
vitesse ! » Je n’étais pas plus que Kennedy un antisémite (à la
différence de son père et de mon aïeul) : pour nous, ce n’était qu’une boutade
de plus sur Truman et sur la sérénissime corruption du monde politique
américain.
Malheureusement,
la reconnaissance précipitée de l’État d’Israël a eu pour conséquence
quarante-cinq années de tohu-bohu meurtrier, et l’anéantissement de l’espérance
des compagnons de route du sionisme : l’avènement d’un État pluraliste,
qui tout en demeurant la patrie de sa population indigène de musulmans,
chrétiens et juifs, serait devenue aussi la patrie d’immigrants juifs
pacifiques d’Europe et d’Amérique, y compris la patrie de ceux qui affectaient
de croire que le grand agent immobilier des cieux leur avait attribué à
perpétuité les terres de Judée et de Samarie. La plupart des immigrants étant
de bons socialistes d’Europe, nous supposions qu’ils n’admettraient pas la
transformation du nouvel État en une théocratie, et que les natifs de Palestine
pourraient vivre avec eux en égaux. Il ne devait pas en être ainsi. Je ne
reviendrai pas sur les guerres et les affres de cette malheureuse région du
monde. Ce que je tiens à dire, c’est que la vie politique et intellectuelle des
États-Unis d’Amérique a été empoisonnée par la création précipitée d’Israël.
Qui se serait
attendu que notre pays en devienne le grand protecteur ? Jamais, dans
l’histoire des États-Unis, une minorité n’a soutiré autant d’argent au
contribuable américain pour l’investir dans son « foyer national ».
C’est comme si nous avions dû financer une reconquête par le pape de ses
anciens États, sous prétexte qu’un tiers de l’électorat américain est
catholique. Une telle idée aurait évidemment déchaîné une tempête de
protestations et le Congrès aurait dit non. Or, le fait est qu’une petite
minorité religieuse (moins de 2 %) a acheté ou intimidé 70 sénateurs,
soit les deux tiers requis pour invalider un (très éventuel) veto présidentiel,
et ce avec le soutien entier des médiats*.
Dans un sens, j’admire la façon dont ce lobby a obtenu qu’au fil des années, des milliards de dollars soient détournés pour faire d’Israël un « rempart contre le communisme » — alors que ni celui-ci, ni l’URSS, ne se sont jamais vraiment affirmés dans la région. Mais l’ancienne amitié qui nous liait au monde arabe a été brisée, et il s’est retourné contre nous. Voilà tout le résultat auquel les États-Unis, quant à eux, sont parvenus. Parallèlement, les fausses informations, voire les mensonges impudents sur ce qui se passe au Moyen-Orient, se sont multipliés et enracinés ; et la principale victime en est — outre le contribuable américain — l’ensemble des juifs des États-Unis, constamment bousculés par les Begin, les Shamir et autres terroristes professionnels. Pis encore, à quelques honorables exceptions près, les intellectuels juifs des États-Unis ont abandonné leurs positions libérales en faveur d’alliances démentielles avec la droite chrétienne (antisémite, qui plus est) et le « complexe militaro-industriel ». L’un d’eux a carrément écrit en 1985 que si les juifs, lors de leur arrivée sur la scène américaine, « ont trouvé dans l’opinion publique libérale et chez les hommes politiques libéraux plus de sympathie, plus de compréhension pour leurs préoccupations », désormais il est dans leur intérêt de s’allier avec les protestants intégristes. En effet, « à quoi servirait aux juifs de s’accrocher dogmatiquement, hypocritement, à leurs opinions des premières années ? » La gauche américaine s’est alors divisée, et ceux d’entre nous qui critiquaient nos anciens camarades juifs pour leur opportunisme mal inspiré se sont vus sans tarder affublés des épithètes rituelles d’« antisémite » ou de « juif animé par la haine de soi ». Heureusement, la voix de la raison est bien vivante, notamment en Israël. À Jérusalem, Israël Shahak ne cesse d’analyser non seulement la sinistre politique d’Israël aujourd’hui, mais le Talmud lui-même et l’influence de toute la tradition rabbinique sur un petit État, que la droite religieuse compte transformer en une théocratie réservée aux seuls juifs. Cela fait des années que j’apprécie Shahak : son esprit satirique face aux absurdités où s’empêtre toute religion qui cherche à rationaliser l’irrationnel ; la sagacité avec laquelle il décèle les contradictions textuelles. C’est un plaisir de lire ses pages sur Maimonide, grand médecin et philosophe, et grand pourfendeur de gentils.
Inutile de le
dire, les autorités israéliennes, quant à elles, n’apprécient pas du tout
Shahak. Mais que faire contre un docteur, professeur de chimie à la retraite,
né à Varsovie en 1933, qui a passé son enfance dans le camp de
concentration de Belsen, est arrivé en Israël en 1945, a servi dans
l’armée, et n’est même pas devenu marxiste quand c’était à la mode ?
Shahak est
toujours resté un humaniste, un adversaire irréductible de l’impérialisme,
qu’il soit imposé au nom du Dieu d’Abraham ou de George Bush. Il s’attaque également,
avec beaucoup d’humour et d’érudition, à la veine totalitaire du judaïsme. Tel
un Thomas Paine d’une haute culture, Shahak illustre à la fois la perspective
qui s’ouvre à nous et notre long passé. Entre les deux, année après année, il
poursuit son raisonnement. Ceux qui l’écoutent en deviennent certainement plus
avisés et — oserai-je le dire ? — meilleurs.
Shahak est le
dernier en date, sinon le dernier tout court, des grands prophètes
Avant propos
Edward W. Saïd
Israël Shahak,
professeur émérite de chimie organique à l’université hébraïque de Jérusalem,
est l’un des hommes les plus remarquables du Moyen-Orient contemporain. Je l’ai
rencontré pour la première fois, et j’ai commencé à correspondre régulièrement
avec lui depuis près de vingt-cinq ans. C’était dans le sillage de la guerre
de 1967, puis dans celui de la guerre de 1973. Né en Pologne, il
avait survécu à son internement dans plusieurs camps de concentration nazi,
puis avait gagné la Palestine immédiatement après la Seconde guerre mondiale.
Comme tous les
jeunes Israéliens de l’époque il a fait son service militaire et il a
régulièrement accompli ses devoirs de réserviste, comme l’exige la loi
israélienne. Doté d’une intelligence implacable, inlassablement curieuse et
acharnée à prouver, Shahak poursuivait sa carrière d’enseignant et de chercheur
universitaire reconnu — il se voyait souvent distingué comme le meilleur
professeur par ses étudiants et recevait des prix en récompense de la qualité
de son travail — et en même temps il commençait à percevoir in petto les
souffrances et les privations que provoquaient le sionisme et les pratiques de
l’État d’Israël, non seulement à l’égard des Palestiniens de la bande de Gaza
et de Cisjordanie, mais aussi à l’encontre de l’importante minorité
« non-juive » (c’est-à-dire palestinienne) constituée de ceux qui
n’étaient pas partis lors de l’expulsion de 1948, qui était restés sur place,
et sont devenus depuis citoyens israéliens. Ces réflexions l’ont amené à une
enquête systématique sur la nature de l’État d’Israël, sur son histoire, et sur
les discours idéologiques et politiques qui, comme il l’a vite compris, étaient
méconnus de la plupart des étrangers, et surtout des juifs de la diaspora pour
qui Israël était un état merveilleux, démocratique et miraculeux, méritant
soutien et défense inconditionnels.
Plus tard, il a
fondé et, pendant plusieurs années, présidé, la Ligue israélienne des Droits de
l’Homme, un groupe relativement restreint, constitué de gens qui, comme lui,
croyaient que les droits devraient être les mêmes pour tous, et donc pas
seulement pour les juifs. C’est dans ce cadre précis que j’ai pris connaissance
de son travail pour la première fois. La particularité qui l’a distingué
immédiatement, à mes yeux, de la plupart des « colombes » juives,
israéliennes et non-israéliennes, c’est qu’il était le seul à affirmer la
vérité sans ornement, sans se demander si cette vérité, dite simplement,
pourrait ne pas être « bonne » pour Israël ou pour les juifs.
Il était
profondément et, dirais-je, agressivement et radicalement non- raciste et
antiraciste dans ses écrits comme dans ses déclarations publiques ; il y
avait une norme, et une norme seulement…, pour considérer les infractions
contre les droits de l’homme. Peu importait donc si, la plupart du temps, il
était question de signaler des agressions commises par des juifs contre des
Palestiniens. Car pour lui, en tant qu’intellectuel, il devait témoigner contre
ces agressions.
Il n’est pas
exagéré de dire qu’il adoptait si strictement cette attitude qu’il devint
bientôt extrêmement impopulaire en Israël. Je me souviens, il y a environ
quinze ans, il avait été déclaré mort, alors qu’il était, bien entendu,
parfaitement vivant. Le Washington Post avait annoncé sa « mort » dans
un article qui, même après une visite qu’il a effectuée au bureau de ce
journal, comme il l’a joyeusement raconté à ses amis, pour montrer qu’il
n’était pas mort, n’a jamais fait l’objet d’une correction! Ainsi pour
certaines personnes, il est toujours « mort », un vœu — fantasme qui
révèle combien il met mal à l’aise certains des « amis d’Israël ».
Il faudrait
aussi remarquer que sa façon de dire la vérité a toujours été rigoureuse et
sans compromis. Elle ne doit rien aux charmes du séducteur. Aucun effort n’est
fait pour l’exprimer plus « gentiment », ni pour la rendre plus
acceptable ou explicable.
Pour Shahak la
tuerie égale le meurtre, égale la tuerie, égale le meurtre : sa manière à
lui, c’est de répéter, de choquer, de secouer les paresseux ou les indifférents,
afin qu’ils prennent conscience, une conscience galvanisée par la souffrance
humaine dont ils pourraient être responsables. Il a parfois offusqué et fâché
des gens, mais cela faisait partie de sa personnalité et, on doit le dire, du
sens de la mission qui est la sienne. Avec feu le professeur Yéhoshoua
Leibovitch — un homme qu’il admirait profondément et avec qui il avait souvent
collaboré — Shahak a approuvé l’expression « judéo-nazi » pour
qualifier les méthodes employées par les Israéliens afin d’assujettir et
d’opprimer les palestiniens. Pourtant il n’a jamais rien dit ni écrit qu’il
n’ait observé lui même, vu de ses propres yeux, connu directement. Ce qui l’a
démarqué de la plupart des autres israéliens, c’est qu’il a fait le rapport
entre le sionisme, le judaïsme, et les actions répressives prises à l’égard des
« non-juifs », et bien entendu, il en a tiré les conclusions.
Une grande
partie de ce qu’il écrit a pour objectif de dévoiler la propagande et ses
mensonges. Israël est un cas unique au monde si l’on considère les excuses
qu’on lui accorde : les journalistes ne voient pas, ou n’écrivent pas ce
qu’ils savent être vrai, de peur qu’on les mette sur la liste noire, ou parce
qu’ils craignent des éventuelles représailles. Des personnalités politiques,
culturelles, et intellectuelles, surtout en Europe et aux États-Unis, se
donnent grand-peine pour louer Israël et lui faire pleuvoir des largesses
telles qu’aucun autre pays de la terre n’en a connues, bien que beaucoup de ces
personnalités soient conscientes de ces injustices. De celles-ci elles ne
disent rien. Le résultat en est un écran de fumée idéologique que Shahak, plus
que tout autre, a tâché de dissiper. Lui même, victime et survivant de
l’holocauste* , il sait ce qu’est l’antisémitisme. Pourtant à la différence de
beaucoup d’autres il ne permet pas aux horreurs de l’holocauste de manipuler la
vérité de ce que, au nom du peuple juif, Israël a fait aux Palestiniens. Pour
lui, la souffrance n’est pas l’apanage exclusif d’un groupe de victimes. Elle
devrait plutôt être — mais l’est rarement — une base pour servir à
l’humanisation des victimes, à qui il incomberait de ne pas faire subir à
autrui des souffrances semblables à celles qu’ils ont subies. Shahak a conjuré
ses compatriotes de ne pas oublier que le fait d’avoir enduré une affreuse
histoire d’antisémitisme ne leur donne pas le droit de faire ce qu’ils veulent,
du simple fait d’avoir souffert. Il n’est pas étonnant donc qu’il ait été si
impopulaire, puisqu’en disant de telles choses, Shahak discréditait moralement
les lois et les pratiques politiques d’Israël envers les Palestiniens.
* Holocauste : n. m. (gr. holos, tout, et kalein, brûler). Sacrifice en usage chez les juifs, et dans lequel la victime était entièrement consumée par le feu. // La victime ainsi sacrifiée. // Sacrifice, immolation de soi-même : l’holocauste du Christ sur la croix. // Offrande entière et généreuse, sacrifice : s’offrir en holocauste à la patrie. Larousse Universel, 2 vol., Paris 1969, p. 772 — L’utilisation de ce terme pour nommer les persécutions et le sort dont furent victimes les juifs au cours de la deuxième guerre mondiale, dont Élie Wiesel revendique l’initiative et qui fut popularisée par un film hollywoodien, ne semble pas pertinent, ni pour nommer le sort des juifs en général, ni celui d’Israël Shahak en particulier. (Note de la Vieille Taupe).
Il va encore
plus loin : Shahak est absolument et infatigablement laïque en ce qui
concerne l’histoire humaine. Par cela je ne veux pas dire qu’il soit contre la
religion, mais plutôt qu’il est contre l’utilisation de la religion pour
expliquer des événements, justifier des politiques irrationnelles et cruelles,
favoriser son propre groupe de « croyants » au détriment des autres.
Ce qui est également surprenant c’est que Shahak n’est pas, à proprement
parler, un homme de gauche. A de nombreux égards il est très critique du
marxisme, et fait remonter la source de ses principes aux libres-penseurs et
libéraux européens et à de courageux intellectuels célèbres comme Voltaire et
Orwell. Ce qui rend Shahak encore plus redoutable en tant que défenseur des
droits des Palestiniens est le fait qu’il ne succombe pas à l’idée sentimentale
selon laquelle, parce qu’ils ont souffert sous Israël, les Palestiniens doivent
être excusés de leurs âneries. Loin de là : Shahak a toujours été trés
critique de l’inconstance de l’O.L.P., de sa méconnaissance d’Israël, de son
incapacité à s’y opposer résolument, de ses compromis miteux, de son culte de
la personnalité, et plus généralement de son manque de sérieux. Il s’est
toujours élevé avec force contre la vengeance, et les assassinats « pour
l’honneur » de femmes palestiniennes, et il a toujours été un partisan
déterminé de la libération féministe.
Pendant les
années quatre-vingts, lorsqu’il devint à la mode pour les intellectuels
palestiniens et quelques responsables de l’O.L.P. de rechercher le
« dialogue » avec les colombes israéliennes de « La Paix
Maintenant », du parti travailliste et du Méretz, Shahak en était exclu
d’office. D’une part, il était extrêmement critique à l’égard du camp pacifiste
israélien à cause de ses compromissions, de son habitude honteuse de faire
pression sur les Palestiniens plutôt que sur le gouvernement pour obtenir des
changements politiques, et à cause de sa mauvaise volonté à se libérer de
l’obligation de « protéger » Israël en ne disant jamais rien de
critique à son sujet à des non- juifs. D’autre part, il ne fut jamais un
politicien : il ne croyait tout simplement pas aux poses et aux circonlocutions
dont les gens imbus d’ambition politique sont toujours friands. Il se battait
pour l’égalité, la vérité, une vraie paix et un véritable dialogue avec les
Palestiniens. Les colombes officielles luttaient pour des arrangements qui
permettraient le genre de paix qu’on apporté les accords d’Oslo, et que Shahak
fut l’un des premiers à dénoncer. Mais, parlant en tant que Palestinien,
j’avais toujours honte de ce que les activistes palestiniens, si avides de
dialogues en secret ou en public avec des travaillistes ou avec le Méretz,
refusent tout contact avec Shahak. Pour eux, il était trop radical, trop
direct, trop marginal vis-à-vis du pouvoir officiel. Je pense qu’en secret, ils
craignaient aussi qu’il ne soit critique à l’égard de la politique
palestinienne. Et il l’eût certainement été.
Outre son
exemple d’intellectuel toujours fidèle à sa vocation, n’admettant pas de
compromis en regard de la vérité telle qu’il la perçoit, Shahak a rendu un
immense service, pendant des années, à ses amis et sympathisants à l’étranger.
Partant de l’idée juste selon laquelle la presse israélienne était
paradoxalement plus près de la vérité et plus informative que les médiats
arabes ou occidentaux, il a traduit sans relâche, annoté, puis reproduit et
expédié, des milliers d’articles de la presse en langue hébraïque. Un tel
service ne saurait être surestimé. En ce qui me concerne, en tant qu’auteur qui
a parlé et écrit sur la Palestine, je n’aurais pas pu faire ce que j’ai fait
sans ses papiers et bien sûr son exemple de chercheur de la vérité, de la
connaissance, et de la justice. C’est aussi simple que cela. J’ai envers lui
une immense dette de reconnaissance. Il accomplissait ce travail à ses propres
frais le plus souvent, et pendant ses heures libres. Les notes qu’il ajoutait
et les petites introductions qu’il composait pour ses sélections mensuelles de
la presse étaient d’une valeur incalculable pour leur esprit cinglant, leur
perspicacité informative, leur patience inlassablement pédagogique. Pendant
tout ce temps, bien entendu, Shahak continuait ses recherches scientifiques et
son enseignement, qui n’avaient rien à voir avec ses annotations et ses
traductions.
D’une façon ou
de l’autre il trouvait aussi le temps de devenir le plus grand érudit que j’aie
jamais connu. L’étendue de ses connaissances en musique, en littérature,
sociologie, et surtout en histoire — d’Europe, d’Asie et d’ailleurs — est,
d’après mon expérience, sans rivale. Mais c’est en tant que spécialiste du
judaïsme qu’il dépasse tant d’autres, puisque c’est le judaïsme qui a occupé
son énergie de savant et d’activiste depuis le début. Depuis quelques années,
il avait commencé d’éclairer ses traductions de commentaires qui devinrent
bientôt des documents mensuels de plusieurs milliers de mots sur un seul sujet
— par exemple le véritable arrière-fond rabbinique de l’assassinat de Rabin, ou
encore pourquoi Israël devait faire la paix avec la Syrie (curieusement parce
que la Syrie est le seul pays arabe qui puisse réellement lui faire du mal
militairement) — et ainsi de suite. Ceux-ci constituaient d’inestimables
sommaires de la presse mais aussi des analyses extrêmement perspicaces, souvent
dynamiques, des tendances, des courants et des questions actuelles que les
grands médiats embrouillent ou passent sous silence la plupart du temps.
J’ai toujours
connu Sahak comme un historien prodigieux, un intellectuel brillant, un esprit
universel, un érudit, et un activiste politique ; mais comme je l’ai
suggéré précédemment je me suis finalement rendu compte que son
« hobby » principal avait été l’étude du judaïsme, des traditions
rabbiniques et talmudiques, et des travaux sur le sujet. Le présent livre est
donc une puissante contribution à ces choses-là. Il n’est rien de moins qu’une
histoire concise du judaïsme « classique » aussi bien que de sa
manifestation plus récente, en ce que ceux-ci ont une importance pour la bonne
compréhension du moderne Israël. Shahak montre que les obscures mesures,
étroitement chauvines, prises contre divers Autres indésirables se trouvent
bien dans le judaïsme (comme dans d’autres traditions monothéistes bien sûr)
mais il en vient à démontrer la continuité entre celles-ci et la manière dont
Israël traite les Palestiniens, les Chrétiens et autre non-juifs. Il en ressort
un tableau dévastateur de préjugés, d’hypocrisie et d’intolérance religieuse.
Mais ce qui en
est important à cet égard, c’est que la description qu’en donne Shahak inflige
un démenti non seulement aux fictions qui abondent dans les médiats occidentaux
sur la démocratie israélienne, mais aussi qu’elle stigmatise implicitement des
hommes politiques et des intellectuels arabes pour leur conception
scandaleusement ignorante au sujet de cet État, surtout quand ils prétendent
pompeusement devant leur peuple qu’Israël a vraiment changé et maintenant veut
vraiment la paix avec les Palestiniens et les autres Arabes.
Shahak est un homme très courageux qui mériterait d’être honoré pour les services qu’il a rendu à l’humanité. Mais dans le monde d’aujourd’hui l’exemple du travail inlassable, de l’énergie morale sans relâche et de l’éclat intellectuel qu’il a donné constitue un embarras pour le « statu-quo » et pour tous ceux pour qui le mot « controverse » signifie « fâcheux » et « déconcertant ». Je suis ravi que pour la première fois un grand ouvrage de sa main paraisse en langue arabe. Je suis certain, cependant, que ce qu’il dit dans Histoire juive, Religion juive sera une source de perturbation pour ses lecteurs arabes tout autant. Je suis sûr qu’il s’en dirait ravi.
E.W.S. New-York, janvier.1996
POUR INFORMATION :
Relevé dans Le
Monde, vendredi 11 octobre 1996, p. 4
Protestation
contre la censure palestinienne de l’écrivain Edward Saïd
NEW YORK. Le Pen
American Center a protesté contre l’interdiction par l’Autorité
palestinienne de la mise en vente des ouvrages de l’écrivain américain
d’origine palestinienne Edward Saïd. Dans une lettre adressée à Yasser Arafat,
président de l’Autorité palestinienne, le Pen Américan Center estime que cette
nouvelle est « particulièrement alarmante à un moment où ceux qui à
travers le monde soutiennent les aspirations du peuple palestinien »
s’attendent que « toute entité palestinienne qui verrait le jour »
serait établie « sur la base de principes démocratiques et plus
spécifiquement sur celui de la liberté d’expression et de la différence »
M. Saïd étant « l’un des critiques culturels les plus influents et
les plus admirés » et ayant largement contribué à la défense de la cause
palestinienne, les signataires, dont des hommes de lettres prestigieux arabes,
demandent à M. Arafat de revenir sur sa décision.