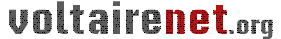Talal Salman : Ne
craignez-vous pas que votre victoire se perde dans les limbes de la politique
intérieure libanaise ? Quelle évaluation en faites-vous, en tenant compte
de ses coûts sur les plans humain, social, économique et matériel ?
Hassan Nasrallah : En ce qui concerne
la situation libanaise et le point de vue libanais, le problème principal tient
aux enseignements que nous retirons de ce qui s’est passé et du point où ont
abouti les choses : considérons-nous qu’il s’agit d’une victoire ou bien,
au contraire, d’une défaite ? Si nous considérons qu’il s’agit bien d’une
victoire, nous devons déterminer quelles en sont les limites, quelle en est la
valeur, afin que nous soyons à même d’avoir une évaluation réelle de la
victoire, en tenant compte des sacrifices que nous avons faits. Par conséquent,
nous pouvons certes dire que cette victoire a été assombrie par des sacrifices,
mais nous pouvons tout aussi bien affirmer que les sacrifices consentis ne
l’ont en rien entamée. Si les sacrifices l’ont en partie assombrie, alors,
examinons de quelle manière ils l’ont assombrie, car c’est en cela que réside
la clé de l’ensemble de cette question. S’il est une chose angoissante, c’est
bien les dissensions au sujet de l’évaluation des résultats de la guerre. De
mon point de vue, elles n’ont pas de fondement objectif ; elles résultent,
ni plus ni moins, des divers contextes politiques, religieux et communautaires.
A ceux qui, nombreux, formulent des opinions divergentes à ce sujet, [je
dirai] : si nous allons dans le monde arabe et musulman et que nous
interrogeons nombre d’experts ès stratégie qui étudient les résultats de la
guerre et son déroulement de manière objective, nous constaterons qu’il sont
unanimes à affirmer la victoire du Liban et celle de la Résistance. Même si
nous allions interroger l’entité israélienne elle-même – et c’est un terrain
que j’ai personnellement suivi jour après jour – nous constaterions qu’il y a
unanimité, en Israël, sur l’échec d’Israël au Liban. [Je traduis :] sur la
défaite d’Israël au Liban, par conséquent. Dan Halutz lui-même, le chef
d’état-major des armées israéliennes, tentant de se défendre lui-même, a parlé
de « faiblesses dans l’institution militaire » et il a éludé la
question des manquements. Parler de ‘faiblesses’, c’est une manière de
justifier l’échec. Cependant, malgré cela, nous trouvons, au Liban, d’autres
lectures des événements : cela suscite des sentiments d’inquiétude, que
votre question traduit assurément. Il peut s’agir là, déjà en soi, d’une
intention délibérée de porter atteinte à l’image de la victoire, en la
déformant progressivement et de pousser autrui à des réactions épidermiques, et
parfois même à la provocation, afin d’entraîner la perte définitive de cette
victoire.
A ce propos, je dirai
qu’il est de la responsabilité du Liban – qui, de mon point de vue, est
ressorti vainqueur – et pour être encore plus précis, je parle ici du Liban
vainqueur, et de la responsabilité des Libanais qui sont convaincus que le
Liban a vaincu – donc, il est de la responsabilité des Libanais qui se
considèrent partenaires dans l’obtention de cette victoire – qu’ils soient
musulmans ou chrétiens, quelles que soient les orientations et les communautés,
quels que soient les courants politiques dans lesquels ils se reconnaissent – d’œuvrer
à préserver cette victoire et à ne pas permettre qu’elle soit galvaudée dans
les impasses confessionnelles, politiques et communautaires. C’est là une
grande responsabilité et, comme on dit : conserver la victoire est parfois
plus difficile que la conquérir… Je puis affirmer qu’il est effectivement plus
difficile de préserver la victoire que de la conquérir, où que ce soit dans le
monde, et qu’a fortiori, au Liban, c’est infiniment plus difficile. Je m’en
tiendrai là, dans ma réponse à cette question, pour le moment…
TS : Voyons,
maintenant, du côté israélien, quelles sont les répercussions [de sa défaite]
sur la position stratégique d’Israël au Moyen-Orient ? L’Israël d’après le
12 juillet est-il aujourd’hui le même Israël qu’avant cette date
fatidique ?
Hassan Nasrallah : Là encore, cela
dépend de l’évaluation que nous faisons de ce qui s’est passé : c’est de
la manière dont nous comprenons ce qui s’est passé que nous pouvons en
escompter les conséquences et les répercussions. A ce sujet, je peux vous donner
un résumé du volet israélien [de la question], et je précise d’emblée que cette
victoire, en résumé, est à la fois stratégique et historique. A mon avis, elle
aura des répercussions extrêmement importantes sur le plan des relations
israélo-palestiniennes, sur celui de l’ensemble du monde arabe, et aussi dans
l’ensemble de la région. Je pense qu’il est encore trop tôt pour répertorier et
pour intégrer les résultats stratégiques et les répercussions gigantesques de
notre victoire. [Considérez « seulement »] la Palestine, l’Irak et
l’Iran, pour ne pas parler du monde arabe !…
Pour répondre à votre
question, j’insisterai plus particulièrement sur le conflit
israélo-palestinien. La bataille contre Israël a eu pour effet d’atteindre les
fondements du projet israélien ainsi que l’entité israélienne : c’est là
un constat que beaucoup d’observateurs ont fait. Quand on dit que tous les pays
ont leur armée, sauf Israël, qui est une armée, qui, elle, a un pays, [c’est la
réalité] : l’entité israélienne, c’est une armée ! C’est un camp
militaire ; c’est une grande, une immense caserne. En Israël, l’élément
essentiel – à savoir la sécurité, la tranquillité, la stabilité, la quiétude,
la sérénité, l’espérance – est incarné par l’armée ; ce qui importe par-dessus
tout, c’est la confiance du peuple israélien en son armée et la confiance de
l’armée israélienne en elle-même. Cette confiance découle de la puissance de
l’armée, qu’il s’agisse de sa force objective, réelle, ou de sa force
artificiellement inculquée dans les esprits des ennemis d’Israël. Parfois,
cette force objective, réelle, n’existe pas, mais Israël a réussi à inculquer à
l’adversaire qu’il serait lui-même faible, battu d’avance et qu’on ne saurait
s’attaquer à une armée « invincible » [comme le serait prétendument
l’armée israélienne]. Les guerres arabo-israéliennes n’ont fait que renforcer
la confiance en elle-même de l’armée israélienne ainsi que la confiance que
place en elle le peuple israélien. Par exemple, nous sommes en train de
procéder, là, au moment où je vous parle, à une comparaison entre les effectifs
(membres actifs et sympathisants) de la Résistance, d’un côté et Israël et son
armée, de l’autre… Mais, eux [les Israéliens], ils avaient depuis toujours
veillé à ce qu’on comparât Israël à l’ensemble de la nation arabe et des
peuples arabes, et ils avaient réussir à faire de cette comparaison se voulant
édifiante une véritable légende !
En 2000 [retrait de
l’armée israélienne du Sud-Liban, sous les coups du Hezbollah, ndt], la légende
avait déjà été ébranlée. Mais Israël pensait qu’il avait besoin d’une occasion
pour restaurer l’image de son armée et, d’une manière ou d’une autre, en l’an
2000 les Israéliens ont réussi à faire douter de la réalité de notre victoire.
Il y a eu un doute, aussi, arabe et même un doute libanais. Certains dirigeants
arabes ont même affirmé qu’Israël n’était pas parti du Liban la queue entre les
jambes, en 2000, mais tout simplement qu’il avait été séduit par la résolution
425 de l’Onu ! D’autres ont évoqué je ne sais trop quel marché
libano-irano-syro-israélien. D’autres sont même allés encore plus loin dans le
délire. Mais on peut dire également, et plus pertinemment, à propos de la
victoire de l’an 2000, que la Résistance, qui menait une guerre incessante
depuis dix-huit ans – une guerre de harcèlement, sur la longue durée, contre
une armée régulière – a pu, en fin de compte, imposer à cette armée régulière
de se retirer. C’est donc bien une victoire, comme en 2000, mais cette victoire
a ses limites, qui sont celles que j’ai évoquées. Mais ce qui vient de se
produire, dans les derniers affrontements, a démontré l’erreur de ce qui se
disait, lors des débats sur les stratégies défensives, et ce qui s’est dit lors
des premiers jours de la guerre : on disait alors que la résistance
populaire pouvait libérer la terre au moyen d’une guerre de harcèlement de
longue durée, mais qu’une telle résistance ne pourrait pas tenir face à une
incursion massive. Qu’elle serait incapable d’empêcher que notre pays soit
occupé et tombe sous la coupe de l’armée israélienne…
En 2000, il y avait débat.
Aujourd’hui, plus personne ne tergiverse sur ce résultat-là. Il est certes
possible que la Résistance ait joui d’un grand prestige, durant dix-huit ans,
dans le monde arabe, mais elle n’avait pas réussi à devenir une véritable
légende. Trente-trois jours ont suffi à inverser totalement les
positions : l’armée [israélienne], qui était une véritable légende, est
devenue l’incarnation de l’échec, de la sidération et de la perte de repères.
Au contraire, la Résistance, dont beaucoup pariaient sur le fait qu’elle
s’effondrerait en quarante-huit heures, est devenue, quant à elle, à son tour,
une légende. Or, cette légende, c’était l’élément fondamental, sur lequel
reposait l’entité [sioniste]. Cela, Shimon Peres l’a bien compris, avec son
expertise et sa longue expérience, quand il a dit qu’il s’agissait, avec cette
guerre, d’une question de vie ou de mort. C’est ce dont on discute tellement
aujourd’hui dans l’entité sioniste. Et si on ne parvenait pas à régler cette
question, c’est-à-dire à convaincre les foules israéliennes d’une manière qui
leur redonne confiance et qui les rassure, je suis persuadé que la société
israélienne sera confrontée à des répercussions extrêmement dangereuses sur les
plans sécuritaire, moral, économique, politique, et même démographique. Je
m’explique : si le peuple de cette entité perd la confiance en son armée
protectrice, qui incarne la forteresse imprenable de l’entité, beaucoup
d’investissements vont quitter ce pays et de plus en plus de fissures
politiques vont apparaître à l’intérieur de l’entité.
Aujourd’hui, l’avenir
d’Olmert est en jeu. L’avenir de Péretz est en jeu, ainsi que celui de
plusieurs dirigeants de partis, et il y a même des partis politiques dont
l’avenir est lui-même compromis, au premier rang desquels « Kadima »,
qui ne passera sans doute pas l’hiver. Ces conséquences suffiraient, à elles
seules, sans que j’aie besoin d’invoquer d’autres aspects [de la défaite
israélienne], et afin de faire bref, à démontrer que notre victoire est une
victoire stratégique et historique. Aujourd’hui, en Israël, on parle des
conséquences [de la défaite israélienne] sur le plan intérieur ; il y a
même des stratégistes qui ont évoqué cet aspect. C’est aussi le cas de certains
gouvernants arabes. Eh oui : Israël, qui terrorisait les régimes arabes,
et dont on disait que la Résistance pouvait libérer quelques territoires qu’il
occupait, mais certainement pas tenir tête à une armée aussi forte que la
sienne… Quant à la Résistance, qu’est-ce qui la caractérise aujourd’hui ?
Je vais vous le dire : ce n’est pas le fait qu’elle ait tenu bon, qu’elle
ait conservé le terrain – non : c’est le fait qu’elle a infligé des pertes
extrêmement importantes – humiliantes – à la soldatesque israélienne. C’est là
quelque chose qu’il est impossible de celer aux yeux du peuple israélien, ni de
dissimuler à ceux du monde entier, en dépit de l’occultation médiatique
hermétique qui a été imposée aux informations sur le déroulement des combats.
Par conséquent, fondamentalement,
tant il est vrai que la bataille, profondément, est une bataille de la volonté,
je puis vous affirmer que notre volonté de résistance a tenu le coup et que la
volonté israélienne, en revanche, a été ébranlée. J’en veux pour preuve le fait
qu’Israël a été contraint à arrêter sa guerre. Celui qui penserait que c’est la
pression internationale qui aurait mis un terme à l’offensive israélienne se
tromperait gravement ; permettez-moi de lui dire qu’il ne connaît pas la
réalité de la situation politique dans le monde, aujourd’hui, et de quelle
façon ça fonctionne… L’élément principal qui a arrêté leur guerre, c’est
l’échec retentissant de leur opération terrestre dans les derniers jours, et
l’importance de leurs pertes, ainsi que la crainte des dirigeants politiques et
militaires israéliens d’être entraînés vers une situation encore pire et encore
plus dangereuse, encore plus catastrophique pour l’armée et [par conséquent]
pour l’entité elle-même. Ce à quoi s’est surajoutée une voix internationale, qui
s’est élevée, obtenant la fin de la guerre. Mais avant tout, si
l’administration Bush & Olmert avait été assurée qu’en poursuivant sa
guerre une semaine, ou deux semaines supplémentaire(s), il aurait pu se
produire un tournant qualitatif dans l’issue des combats, la guerre aurait
continué, et elle ne se serait pas arrêtée ce lundi-là, comme elle l’a fait…
Voilà qui approfondit encore l’impact stratégique de la bataille et, partant,
la confiance du peuple israélien en son armée et en son entité régresse, tandis
que la confiance mise par les peuples arabes et en particulier le peuple
palestinien dans le fait que le choix de résister peut apporter la victoire,
surtout une victoire d’une telle ampleur, ne pourra que se renforcer. A mon
avis, cela aura assurément des conséquences sur le fondement même de
l’existence de l’entité [sioniste] à longue, voire à moyenne échéance. Bien
entendu, je ne prétends pas (personne d’ailleurs ne prétend) que cela aura des
répercussions existentielles prochainement ou rapidement [pour l’entité
sioniste].
Bien sûr, nous parlons ici
de l’existence de l’entité et de son devenir, ainsi que de notre propre avenir.
Mais demeure, dans le volet palestinien, la motivation essentielle : les
Palestiniens ont l’idée de résister, ils en ont le projet, ils en ont la
conviction et la volonté, et il faut que cela leur permette de maîtriser tous
les autres éléments qui ont été réunis dans l’expérience de cette guerre, afin
que le peuple palestinien soit en mesure d’obtenir, lui aussi, sa victoire.
Quant au blocus imposé aux Palestiniens – et ce blocus est pour partie imposé,
hélas, par certains régimes arabes – il limite terriblement la possibilité de
mobiliser notre victoire au service du champ de bataille palestinien.
TS : Pensez-vous
qu’Israël relancera sa guerre, après avoir arrangé son désordre interne – soit,
derechef, contre le Liban ; soit, en choisissant de s’orienter vers un
conflit plus facile, contre la Syrie ?
Hassan Nasrallah : Tout d’abord, je
confirme la nature intrinsèquement agressive d’Israël. Par conséquent, quand je
dit : « c’est possible », « c’est peu vraisemblable »,
ou « on ne peut l’écarter », cela n’est pas lié à la nature
essentiellement agressive d’Israël, ni à ses intentions sincères : il
s’agit bien des circonstances, et des possibilités qui sont les siennes.
Revenons, si vous le voulez bien, à cette guerre : cela nous aidera pour
évaluer la situation… Quel était l’objectif de la guerre ? « Liquider
le Hezbollah ». Rien que cela !… C’était l’objectif principal et
direct, dont la réalisation débouchait sur la soumission définitive du Liban à
la volonté états-unienne, laquelle, dans notre région (dois-je le
rappeler ?), n’est autre que la volonté israélienne. Cet objectif, les
États-uniens et les Israéliens l’ont annoncé, dès les premiers jours de la
guerre. Ici, je n’analyse pas ; je n’extrapole pas. C’est ce qu’ils disent
carrément ; leurs textes sont très clairs et n’appellent aucune
interprétation. Seulement voilà : non seulement Israël a été incapable de
« liquider le Hezbollah », ce qui était son objectif suprême, mais il
a même été incapable de réaliser l’un quelconque de ses objectifs de guerre
annoncés : « liquidation définitive du Hezbollah », liquidation
définitive de son infrastructure militaire, destruction totale des missiles du
« Hezbollah », expulsion du « Hezbollah » du Sud Liban,
puis au-delà du Litani, sans oublier la récupération inconditionnelle des deux
soldats israéliens capturés… Israël n’a réalisé aucun de ces objectifs
proclamés. Les dernières réalisations prétendues d’Olmert – car Olmert,
voyez-vous, prétend avoir obtenu quelque chose… – c’est, dit-il, de m’avoir
confiné dans un abri… Voilà à quoi se sont réduits les objectifs de guerre
israélien : contraindre Hassan Nasrallah à rester à l’abri ! Chapeau !
Belle performance ! Une guerre totale, prolongée, généralisée, a abouti à
cet objectif-là… Tout ça, pour ça ? Dans cette guerre, Israël a mobilisé –
je ne veux certes pas dire « toutes ses forces », mais bien la plus
grande partie – la partie essentielle – de sa puissance militaire.
Qualitativement, la seule chose qu’ils n’aient pas employée, c’est l’arme
nucléaire. Tous les types d’avions ont été employés. Les tanks les plus
modernes, des bataillons d’élite les ont amenés sur le champ de bataille :
les « Golanis » et les « Giv’atis » les ont retirés de Gaza
et les ont amenés au Sud Liban. Même chose pour les unités de parachutistes.
Ils ont amené 40 000 fantassins. Trois compagnies de réservistes. Concernant la
puissance de feu déployée : ils ont effectué 9 000 raids aériens ;
les survols sans bombardement, je vous en fais cadeau… Ils ont évoqué le
chiffre de 175 000 projectiles, en trente-trois jours ! Ils ont employé
une puissance de feu absolument démentielle. Ils ont épuisé leur stock stratégique
de missiles air-sol, si bien qu’ils ont même utilisé leurs missiles mis au
rebut, désamorcés et promis à la casse : ils les ont chargés dans leurs
avions, et ils les ont balancés sur le Liban !… Israël est allé pleurer
dans les jupes de Condoleezza non seulement pour lui quémander des bombes
« intelligentes », mais tous les types de fusées et de missiles
air-sol…
Ce qui est important, dans
ces données de détail, c’est qu’Israël a employé une grande partie de son
potentiel. Ceci signifie qu’il y avait des centaines d’avions de guerre
israéliens qui survolaient et qui bombardaient le Liban, en même temps :
ils ne pouvaient pas en utiliser plus… Ils ne pouvaient pas envoyer toute leur
armada en même temps dans le ciel du Liban, cela serait devenu très dangereux pour
eux [ils se seraient gênés mutuellement] ! Ils ne savaient plus quoi
bombarder… Il est important de comprendre que le Liban est un petit pays, qu’il
n’est pas assez grand pour que l’aviation de guerre israélienne, au grand
complet, vienne le survoler et y bombarder des objectifs… Oui, c’est bien
d’Israël, dont je parle... D’Israël, avec son énorme puissance militaire, avec
ses capacités effrayantes, avec le soutien états-unien et international dont il
bénéficie, avec l’infamante trahison du Liban par les régimes arabes, dont il
bénéficie aussi… Malgré tout ça (excusez du « peu » !), Israël a
perdu cette guerre, et des pertes lui ont été infligées qui ont porté atteinte
à l’image de marque de son armée et à son efficacité – en particulier à l’image
et à l’efficacité de ses tanks et de ses hommes. Si bien que plusieurs pays,
qui étaient en négociations avec Israël pour lui acheter le dernier cri des
blindés, le tank Merkava de quatrième génération, se sont retirés et ont rompu
les contrats. Dans une guerre contre une résistance populaire, un tank blindé
se transforme en cercueil. Israël, avec la giffle qu’il a reçue au Liban, va
aller se lancer dans une nouvelle guerre ? A mon avis, cela ne sera pas
avant longtemps, même si je n’écarte pas totalement cette possibilité.
Mais : une guerre contre le Liban ? Assurément, quand les Israéliens
voudront se lancer dans une nouvelle guerre contre le Liban, ils devront
réfléchir plus de deux fois, en particulier si la situation libanaise évolue
vers une situation intérieure raisonnable, après le déploiement de l’armée
libanaise et des forces de la Finul, et si la Résistance n’est pas désarmée.
Par conséquent, si la Résistance demeure, si elle conserve ses armes, et si,
donc, demeure la force qui a infligé la défaite à Israël dans cette guerre…
tant que cette force existera, Israël devra réfléchir mille fois, et
longuement, avant de se lancer à nouveau dans une guerre contre le Liban…
Quant à une guerre lancée
par Israël contre un autre pays… Je ne pense pas. Quant à ceux qui
imagineraient qu’une guerre contre la Syrie serait moins hasardeuse, je leur
dis qu’ils font erreur. Permettez-moi de leur dire que tandis qu’Israël
attaquait le Liban, et alors qu’il était supposé faire peu de cas de la Syrie
(comme d’aucuns tentent de le faire ailleurs qu’en Israël, aussi…) et qu’il
déclarait que les roquettes qui avaient frappé Haïfa, Al-Khudeïra et Afoula
étaient des roquettes de fabrication syrienne, dans la même période, le
ministre israélien de la Défense, Amir Péretz, affirmait, plusieurs jours
durant, qu’Israël n’avait nullement l’intention de viser la Syrie ou d’ouvrir
un front actif avec elle. C’est là une claire indication, mais il y a un autre
indice, extrêmement important : la Syrie a déclaré qu’elle entrerait dans le
conflit, au cas où l’armée israélienne se rapprocherait de sa frontière
terrestre. On a pu remarquer, au cours des dernières guerres déclenchées par
Israël, que les Israéliens ne se sont jamais approchés vraiment de la frontière
syrienne. De plus, il faut savoir que l’axe des fermes de Shebaa est
extrêmement important, dans un paysage ouvert : les Israéliens pouvaient
donc s’y mouvoir aisément, avec des forces importantes, afin de prendre la
résistance à rebours dans la région située sur la rive Sud du Litani. Et,
néanmoins, Israël n’a pas bougé du tout dans cette région, et il a
soigneusement évité de s’approcher de la frontière syrienne. Ceci signifie que
les Israéliens étaient très circonspects et pesaient les dangers d’une
confrontation avec la Syrie, ou de l’entrée de la Syrie dans le conflit. Ce
point mériterait une évaluation plus générale et plus approfondie, mais
personnellement, j’ai tendance à penser que les Israéliens auront besoin de
beaucoup de temps avant d’envisager une nouvelle guerre. Non seulement contre
le Liban, mais, y compris, contre la Syrie. Je pense que le seul point faible
sur lequel Israël va se concentrer et tenter non seulement de récupérer son
image de marque dissuasive, mais aussi de s’opposer à l’exploitation de la
victoire libanaise dans la situation palestinienne, c’est précisément la
Palestine. Cette récupération de son image, Israël en sera malheureusement
capable, les Palestiniens étant assiégés et fractionnés, coupés de tout
contact ; leur situation est très dure, même s’ils ont une volonté de fer
et un moral très élevé, et l’effort israélien portera de plus en plus sur les
territoires palestiniens.
TS : … et que
dites-vous, au sujet des armes de la Résistance et de la question de savoir si
l’opération [du Hezbollah] aurait eu lieu malgré tout, si une évaluation des
conséquences qu’elle a manifestement entraînées avait été faite… et aussi au
sujet de la manière dont Olmert a exploité la défaite israélienne sur le plan
intérieur ?
Hassan Nasrallah : Je répète ce que
j’ai déclaré à la chaîne News TV : c’est la confirmation de ce que j’ai
déclaré durant la guerre. C’est une question dont j’ai traité en détail. Quant
aux propos sur le fait que si nous avions su, ou si nous avions escompté…, ils
ont été tenus au cours de cette interview. Mais, malheureusement, ce passage a
été extrait de son contexte de manière malveillante et, ce, afin de susciter
artificiellement des prises de position politiques oiseuses et de fonder des
analyses biaisées sur la base de cette citation extraite de son contexte.
De plus, au cas où je
désirerais reformuler ce que j’ai déjà dit, je répèterais que j’ai dit très
clairement que l’opération des deux prisonniers a poussé Israël à déclencher au
mois de juillet [le 12, précisément, ndt] une guerre qu’il aurait de toutes les
manières déclenchées au mois d’octobre, auquel cas la catastrophe aurait été
très très très destructrice. L’opération [de capture] des deux prisonniers
[israéliens], pour une raison que nous ignorons (et j’ai été très transparent,
sur ce point-là), a fait échouer un plan déjà ourdi, et ourdi avec un soin
extrême. Mais la mise en actes de ce projet était prévu pour le début de
l’automne, car il nécessitait de compléter certains préparatifs et de réunir
certaines données, et pour d’autres motifs encore. C’est d’ailleurs la raison
pour laquelle j’ai été très clair, et j’ai dit que la guerre n’avait pas eu
pour facteur déclenchant la capture des deux soldats.
La guerre relève d’une
décision états-uno—israélienne, avec la couverture de certains partenaires
[arabes] qui y étaient préparés. Ses préparatifs, en cours depuis longtemps, se
poursuivaient, et le moment de son déclenchement avait été fixé. Elle reposait
essentiellement sur un effet de surprise, et le scénario en avait été ficelé
depuis pas mal de temps, même si le scénario suivi durant la guerre réelle,
celle qui vient d’avoir lieu, n’était pas celui qui avait été initialement
prévu pour plus tard… Quand l’opération des deux soldats a eu lieu, et qu’un si
grand nombre de soldats israéliens sont tombés [huit, ndt], les Israéliens ont
été sidérés, et ils se sont trouvés placés devant la réalité suivante :
soit ils encaissaient le choc de ce qui venait de se produire, soit ils se
lançaient sans plus tarder dans la guerre prévue pour le mois d’octobre
prochain. Nous savons qu’après consultation avec les États-uniens, dès le
lendemain de l’opération des deux soldats, les Israéliens ont décidé de se
lancer dans la guerre qu’ils avaient prévu de lancer au début de l’automne.
Nous leur avons fait perdre l’avantage de la surprise. Nous leur avons imposé
un calendrier qui n’était pas celui qu’ils avaient préparé avec grand soin, et
c’est la raison pour laquelle la bataille est arrivée tandis que nous étions en
alerte et sur nos gardes, tandis que les Israéliens, eux, en face, n’étaient
pas prêts. Alors que si la guerre avait eu lieu en octobre, la bataille aurait
commencé sans motif, car un motif quelconque, une provocation quelconque, cela
aurait équivalu, de notre part, à attirer l’attention [de l’ennemi]. Si, au
mois d’octobre, des gens étaient venus dans le Sud du Liban afin d’y installer
des missiles incognito et si ces gens avaient tiré ces missiles sur la
Palestine occupée, le Hezbollah aurait été mis en alerte, naturellement, car il
se serait attendu à ce qu’Israël réplique d’une façon ou d’une autre. La guerre
qui devait commencer en Octobre était prévue pour commencer d’une manière très
brutale, avec un effet de surprise totale, sans aucun prétexte, et Israël
n’avait pas besoin d’un mobile, étant donné qu’il jouit du soutien absolu des
États-Unis. Cette guerre, en Octobre, aurait été considérée comme une guerre
contre le terrorisme, et donc comme une guerre totalement légitime, sans même
qu’il fût besoin d’un motif ni d’une quelconque nécessité de se justifier, ni
de quoi que ce soit d’autre…
Oui, j’étais sincère et
transparent, quand j’ai dit qu’au moment où nous avons décidé de procéder à
l’opération des deux prisonniers, nous n’avions pas l’intention d’entraîner
Israël dans un conflit rapproché au mois de juillet, sans attendre jusqu’au
mois d’octobre. Bien entendu, tel n’était pas notre objectif. Nous savions
qu’un jour, le jour venu, choisi par eux, les Israéliens et les États-uniens
nous feraient une guerre totale, visant à en finir avec nous militairement et à
nous exterminer, physiquement. Mais, bien entendu, nous ne savions pas quand
cela adviendrait, et nous nous contentions de suivre le plus attentivement
possible la conjoncture et les développements politiques. Quand on demande de
revenir au 11 juillet et que j’entends dire que l’opération de capture de
soldats israéliens allait nécessairement entraîner une guerre qui causerait
toutes ces destructions et la mort de tant de martyrs, etc., si je répondais
que « oui », c’est-à-dire que, même si nous avions anticipé tout
cela, si nous avions su que la capture de deux Israéliens allait entraîner
cette guerre à une échelle tellement incroyable, si je répondais que oui ;
nous aurions, malgré tout, procédé à cette opération, à ces enlèvements, je mentirais.
Des gens mal intentionnés à notre égard ne manqueraient pas de dire,
alors : « Regardez-les ! Peu leur importent le pays et le sang
des braves gens !… »
Très simplement ;
j’aurais pu me défiler, esquiver cette question. Je pourrais le faire, aussi,
là, maintenant, et affirmer qu’en tous les cas, la guerre n’a rien à voir avec
la capture de deux soldats israéliens. Mais, parce que je sais que cette
question taraude les gens et qu’elle a été soulevée fortement tout au long de
la guerre, je considère qu’il est de ma responsabilité sincère d’y répondre. Si
nous avions, lorsque nous avons procédé à l’opération des deux prisonniers, au
moment où nous l’avons effectuée, escompté comme conséquence la guerre, alors
je l’aurais dit, j’aurais répondu à la question par l’affirmative.
Mais ces propos, dans quel
contexte ont-ils été tenus ? Ils ont été tenus dans un contexte dans
lequel cette supposition étant totalement inconcevable, dans un contexte où
personne, où que ce soit dans le monde entier, ayant étudié, évalué et analysé
la situation prévalant à l’époque n’aurait pu supposer que la capture de deux
soldats aurait entraîné une guerre d’une telle intensité, pour la simple
raison, encore une fois, que la guerre n’avait strictement rien à voir avec la
capture de ces deux soldats… Cette guerre échappe à toute logique, à toute
mesure, à toute loi, à tout critère. On n’a jamais vu, dans toutes les
expériences tirées des guerres arabo-israéliennes et de la résistance, dans son
combat contre Israël, dans toutes les expériences des conflits enregistrés par
l’histoire, où que ce soit dans le monde, que la capture de deux soldat
entraîne un quelconque conflit. Certes, l’opération a été mise à profit pour
avancer le déclenchement d’une guerre programmée. Mais, de notre point de vue,
cela nous a été profitable, et cela s’est avéré dans l’intérêt du Liban.
L’enlèvement des deux soldats israéliens a précipité une guerre qui, de toute
manière, aurait eu lieu, un peu plus tard ; il a avancé le déclenchement
d’une guerre inévitable, absolument certaine.
C’est pourquoi, si je
voulais utiliser des expressions insécables et impossibles à tronquer, je
dirais que nous n’avons pas commis d’erreur d’appréciation et que nos calculs
étaient précis et exacts, et aussi que nous ne regrettons rien, que je n’ai
d’ailleurs tenu aucun discours contrit ni défaitiste, comme l’ont inventé
certains Israéliens. Au contraire, mon discours était un discours de victoire,
dès le premier jour de la guerre. Le premier jour, alors que le ciel était obscurci
de nuages noirs, j’étais confiant en la victoire ; la victoire allait
venir. Là-dessus, tous les experts un tant soit peu objectifs sont aujourd’hui
unanimes, quand ils procèdent à l’évaluation de ce qui s’est passé durant cette
guerre et je pense – cela, je l’ai dit à plusieurs reprises – que ce qui s’est
produit, tant en matière du moment où la décision de procéder à l’opération a
été prise, que de ses conséquences, résulte d’une volonté divine que nous
réussissions, et d’une faveur de la bonté divine et que, si nous n’avions pas
fait cette opération, si nous étions restés inactifs et inattentifs jusqu’au
mois d’octobre, le Liban ne serait plus le Liban, et d’une manière ou d’une
autre, comme l’a dit le Dr. Talal Salman (mais dans un sens tout à fait opposé
à celui qui prévaut aujourd’hui) Israël ne serait plus non plus Israël (mais,
là encore, dans des termes entièrement opposés)… Dans cette hypothèse, en
octobre, grâce à l’élément de surprise et grâce à la possibilité qui aurait été
sienne de tirer avantage de bien d’autres facteurs, Israël aurait pu parier sur
la destruction de la résistance au Liban et cela aurait entraîné au final la
soumission du Liban à Israël et aux États-Unis ; cela aurait conduit à un
horizon impitoyable et dangereux pour la Résistance palestinienne, cela aurait
gravement menacé la position de la Syrie, et cela aurait remis en question tout
possibilité d’une résistance quelconque, dans l’ensemble du monde arabe. C’est
pourquoi, je le répète : nous ne regrettons rien ; nous n’avons
commis aucune erreur et nos estimations étaient fondées et exactes. Ce qui
s’est produit est beaucoup plus important que les estimations des conséquences
de nos intentions. Oui, je l’affirme : si nous avions fait l’impasse sur
tous ces projets, sur tous ces aspects fondamentaux pour notre cause, si nous
étions restés planqués dans notre coin et si nous disions que si nous avions
escompté de telles conséquences, nous aurions fait l’opération ou que nous ne
l’aurions pas faite, évidemment la réponse logique aurait été de ne pas la
faire… Si nous cantonnons le sujet à la seule opération de l’enlèvement des
deux soldats, et à la réaction à cette opération, ce qui s’est réellement passé
au Liban au mois de juillet se retrouverait totalement à l’extérieur de ce contexte
et de cette logique.
TS : Il se dit qu’il
y aurait eu une réaction israélienne disproportionnée à l’enlèvement, par des
Palestiniens, d’un soldat israélien, à Gaza, avant le 12 juillet. Vous n’avez
pas été averti ?
Hassan Nasrallah : Nous étions prêts…
Nous étions suffisamment préparés, et ce qui s’est passé est ce à quoi nous
nous attendions. Nous nous attendions à une réaction de représailles limitées…
Ce qui s’est passé est resté dans les limites prévues. Les Israéliens n’ont pas
envahi, ni détruit la bande de Gaza ; ils n’ont pas fait, à Gaza, ce
qu’ils ont fait au Liban. De plus, il faut tenir compte du fait que
l’enlèvement du soldat israélien à Gaza était beaucoup plus humiliant, pour les
Israéliens, que la détention de leurs deux soldats, au Liban.
En tenant compte [toutes
proportions gardées] des possibilités existantes chez les Palestiniens, en
comparaison à celles de la Résistance au Liban, les représailles à Gaza n’ont
pas été… [démesurées]. Nous nous attendions à ce que la réaction israélienne
soit au Liban comparable, voire totalement identique, à ce qu’elle avait été à
Gaza, ou, à la rigueur, un peu plus intense. Mais ce à quoi ont procédé les
Israéliens au Liban ne fut pas une réaction, mais bien une action préméditée et
arrêtée dont on a simplement avancé le déclenchement. En ce qui concerne les
martyrs, une étude statistique effectuée avant la capture [de Gilad Shalit,
ndt] a montré que, chaque mois, de trente à quarante Palestiniens tombaient en
martyrs. Et rien, en la matière, n’a été modifié [après la capture]. A ce
propos, je dirai que je comprend à la rigueur pourquoi Israël s’arroge le
monopole sur ce fief, pour qu’Olmert, par exemple, puisse en profiter pour
tenter de réengager des négociations, ce qui pourrait l’aider à se débarrasser
de la commission d’enquête israélienne [sur les dysfonctionnement de
l’offensive au Liban, ndt] ou de ses nombreux problèmes… Bien entendu, quand je
me suis exprimé publiquement, je ne parlais pas de cela ; je parlais avec
la sincérité et avec la transparence dont les gens avaient besoin, auxquelles
les gens aspiraient. Mais, résultat : on m’a dit, et j’ai lu dans la
presse qu’Olmert essayait d’exploiter cette phrase à son avantage, et peu
m’importe : qu’Olmert en profite, je n’ai rien contre !… En effet, si
on nous donne le choix entre le fait que ce soit un chef de gouvernement
cinglé, stupide et faible qui continue à gouverner l’entité et entre un autre
Premier ministre à sa place, fort et capable… bien entendu, nous préférons
garder le chef de gouvernement cinglé et stupide !…
Si Olmert peut tirer
profit de citations tronquées de mon discours, je n’ai rien contre. Mais je
regrette que ceux qui comprennent très bien l’arabe et qui comprennent que
cette phrase s’insérait dans le contexte d’un exposé cohérent et qu’il n’était
pas convenable de l’extraire de son contexte naturel aient pu extraire cette
phrase et la mettre au service de leur lecture erronée des événements au Liban,
c’est regrettable – tout simplement regrettable. Sans plus.
TS : Après l’adoption
de la résolution 1701, le paysage politique se
caractérise par de nombreuses ambiguïtés. Résolution ambiguë et paysage
politique ambigu. Ne vous coupez-vous pas de toute possibilité d’étudier
l’après-1701 lorsque vous insistez sur la priorité, pour la Résistance, de
conserver ses armes ?
Hassan Nasrallah : Il y a deux
volets. Le premier a trait à la situation à laquelle peut aboutir une
stabilisation de la situation dans le Sud. A mon avis, les choses sont
claires : l’armée libanaise poursuit son déploiement dans la région
frontalière, et on suppose qu’alors les forces israéliennes se retireront et
que celles de la Finul renforcée prendront leurs quartiers dans les sites
choisis d’un commun accord avec l’armée libanaise et aussi avec le gouvernement
libanais. Au Sud du Litani, jusqu’à la frontière internationale, il y aura
l’armée libanaise et des forces de la Finul. Quant à la Résistance, sa
politique consiste fondamentalement à éviter toutes les manifestations et
défilés armés. Désormais, l’engagement implicite et la politique publique ne
suffisent plus : il faut qu’il y ait un engagement personnel et implicite
envers l’armée libanaise et envers l’État libanais.
Ceci signifie que nous aurons
une situation dans le Sud du Liban, c’est-à-dire au Sud du Litani, semblable à
celle prévalant au Nord du Litani. Avant le 12 juillet, il y avait, au Nord du
Litani, une armée libanaise et un État libanais étendant sa souveraineté dans
tous les domaines. Et la Résistance était aussi présente, mais de façon
implicite. On aura désormais la même situation au Sud : la Résistance
restera présente, de manière implicite et par conséquent l’armée libanaise –
donc, l’État libanais – de par sa présence au contact immédiat des frontières
sera, par définition, responsable : elle devra s’opposer à toutes les
violations israéliennes. J’ai dit, et je répète, que la Résistance aura
désormais pour rôle essentiel de soutenir l’armée libanaise, qui sera
désormais, conformément à la résolution, présente au long des frontières du
pays. Mais, assurément, si les Israéliens arrivent, comme cela s’est produit
par exemple à Budaï, pour procéder à un parachutage dans telle ou telle
localité du Sud ou de la Bekaa, la Résistance est présente, et bien présente,
même si sa présence est secrète… La Résistance, ce sont les enfants de cette
localité du Sud ou de la Bekaa, qui s’opposeront au parachutage israélien. Et
la Résistance n’attendra pas, pour relever ce genre de défi, l’autorisation de
quiconque, car il s’agit de légitime défense. Mais, d’une manière générale,
c’est l’armée qui est chargée de s’opposer aux violations, par sa présence sur
les frontières. La Résistance devient dès lors une force auxiliaire de soutien,
pour l’armée. Je ne pense pas qu’il y aura de problème, car la Résistance est
sincère dans se ses engagements, d’une part, et disciplinée dans sa manière de
servir, d’autre part. Il peut exister une résistance dont la direction soit
engagée, mais dont l’encadrement et les hommes seraient indisciplinés. Cela
peut provoquer des problèmes sur le terrain, aux conséquences redoutables. Mais
en ce qui concerne notre résistance, cette question est résolue. La décision
émanant du conseil des ministres, après un débat approfondi, est une décision
claire, qui définit la mission de l’armée libanaise dans le Sud du Liban. Or le
désarmement de la Résistance ne fait pas partie de cette mission impartie à
cette armée, de même que sa mission ne comporte pas l’espionnage de la
Résistance, ni de fouilles à la recherche de ses dépôts d’armes.
Il n’y a donc aucune
raison pour qu’il y ait un quelconque problème : l’état-major de l’armée
est engagé vis-à-vis de cette décision, tant en ce qui concerne son niveau
idéologique que sa discipline en tant qu’institution officielle. La mission de
l’armée, dans le Sud, c’est de défendre la patrie et de protéger les citoyens,
leurs biens, leurs moyens de subsistance et leur sécurité. Il n’existe donc pas
de points de frottement [avec nous, qui seraient] susceptibles de créer des
problèmes. L’a Finul renforcée, d’après ce qu’a déclaré le Secrétaire général
de l’Onu – sauf nouvelle résolution – n’a pas pour mission de désarmer le
Hezbollah. Sa mission consiste à épauler l’État libanais, à l’aider à étendre sa
souveraineté et à soutenir l’armée libanaise. Il n’y a donc aucun problème. Je
pose comme principe qu’il n’existe aucune cause d’un quelconque problème ou
d’un quelconque dysfonctionnement. Par conséquent, la situation intérieure au
Sud Liban retrouvera sa stabilité des six années écoulées, avec comme
changement, le fait que sera présent sur la frontière l’armée chargée de
s’opposer aux violations, et cela n’incombera pas à la Résistance, qui, elle,
n’est pas directement chargée de s’opposer aux violations de la frontière.
C’est la raison pour laquelle je suis serein, et absolument pas inquiet.
Le deuxième volet a trait
à l’armement de la Résistance, après la guerre, comme avant la guerre. Nous ne
disons pas que cet armement ne puisse faire l’objet de discussions ; cela
reste un objet de dialogue. Le président [du Parlement], Nabih Berri, a annoncé
dans son dernier discours, en son nom personnel et aussi en notre nom, qu’au
nombre des priorités de l’étape qui s’ouvre devant nous, il y a les discussions
en vue de parvenir à un accord, sur le plan national, sur une stratégie
nationale de défense tirant profit de la très importante expérience que
représente la guerre que nous venons de mener. Par conséquent, il faut
poursuivre la discussion de cette question, et avancer. Reste à déterminer les
modalités de cette discussion… Mais quant à l’essence, quant au principe, il
faut poursuivre l’étude de cette question au moyen de la discussion. Nous
n’avons jamais écarté quiconque de ce débat. Même au cours de ma dernière
interview avec la presse, j’ai dit que nous ne voulions pas conserver cet
armement jusqu’à la Saint-Glinglin. La Résistance est venue remplir le vide
laissé par la carence de l’État libanais. Alors : allez-y ;
allez-y : inventez-nous cet État fort, puissant et résistant, capable de
rassurer le peuple et de le protéger ! Voilà qui pourrait servir d’entrée
en matière à un débat sur le devenir des armes de la Résistance… Il est
possible de trancher la question du devenir de ces armes. Donc : nous
sommes toujours ouverts à toute formule sur laquelle on puisse tomber d’accord
sur le plan national, en vue de discuter cette question et de la régler.
Nous n’avons absolument
pas fermé la porte au nez de qui que ce soit, et nous sommes prêts pour ce
débat, non seulement d’un simple point de vue théorique – comme avant la guerre
– [mais] en nous fondant sur l’expérience acquise par la Résistance [à
l’occasion de sa victoire] et aussi, déjà, en l’an 2000… De plus, je suis
convaincu que la dernière guerre nous a apporté une expérience très importante
– expérience que le Liban doit mettre à profit pour formuler sa stratégie
défensive. Bien plus : le Liban doit aussi mettre à profit cette
expérience [acquise par la Résistance] dans sa méthodologie de reconstruction
de l’arme libanaise et de renforcement de cette armée, ainsi que de son
équipement et de son armement, si nous voulons rendre cette armée suffisamment
forte pour pouvoir tenir face à Israël, afin que nous ne dépensions pas des
sommes folles, d’une manière anarchique, et en pure perte.
TS : Que deviendront
les armes, je veux parler, en particulier, des missiles et des roquettes ?
Cette question est-elle actuellement à l’étude ?
Hassan Nasrallah : En tout cas,
depuis 1996 – après l’agression israélienne déclenchée au mois d’avril de cette
année-là –, ces fusées étaient présentes au Liban, et elles n’ont pas été
employées avant 2006 : ceci signifie que, pendant dix ans, elles ne l’ont
pas été. Fondamentalement, ces fusées n’étaient pas destinées à une utilisation
opérationnelle quotidienne, jusqu’au jour où il y a eu des opérations
quotidiennes… Ces fusées sont [normalement] utilisées au moment de l’éclatement
d’un conflit, comme cela avait été le cas en 1993, en 1996 et, enfin, en 2006
[au début de la guerre]. La résistance avait donc un principe : ne
recourir à ces fusées qu’en cas d’agression israélienne et de lancement, par
Israël, d’une guerre contre le Liban.
Voilà qui résout, dans une
large mesure, notre « problème » du moment : que faire de ces
fusées ? Qu’en faisons-nous ? C’est très simple : nous les
gardons, comme nous les avons conservées, de 1996 à 2006, sans les utiliser
pour autant… Nous conservons ces fusées, parce qu’elles sont destinées à n’être
utilisées qu’en cas d’agression militaire [israélienne] massive contre le
Liban. S’il se produit une nouvelle agression contre le Liban, bien entendu, il
est de la responsabilité de l’armée libanaise de défendre le Liban, et la
Résistance a, elle aussi, pour mission de défendre le pays, en tant que
résistance populaire. Mais c’est l’armée qui décide de cela. Nous préférons, en
tout état de cause, que cette question ne soit pas examinée dans ses moindres
détails ; nous préférons ne pas nous lancer dans cette discussion… Nous ne
souhaitons pas nous entendre dire : « Ces fusées, là : qu’en
faisons-nous ? » ; « Ces jeunes combattants, ici :
qu’en faisons-nous ? » ; « Tel ou tel type d’armes :
qu’en faisons-nous ? »… Une discussion en détail de cette question
serait une discussion oiseuse, éloignée de la pratique, du réel… bref :
une discussion inutile.
Il est préférable
d’entamer une discussion globale. De dire, à la lumière de ce qui s’est passé
et de toutes les expériences accumulées, que le Liban est concerné par son
existence, par sa structure [démographique et communautaire, ndt], par son
indépendance, par sa souveraineté, par sa sécurité… face à toute guerre
qu’Israël pourrait à nouveau provoquer, à l’avenir. La nouveauté, c’est que,
désormais, l’armée libanaise est présente au long des frontières. Cela n’était pas
le cas, avant le 12 juillet. D’après l’expérience acquise, comment le Liban
pourra-t-il se défendre, avec les [maigres] moyens à sa disposition ? Nous
poursuivrons le débat déjà engagé à ce sujet. Je pense qu’un débat général
permettra de meilleurs résultats, et de servir les intérêts du Liban, sans pour
autant nous plier aux exigences d’Israël.
TS : En cas
d’absence de décision politique permettant à l’armée de répliquer aux
violations [du cessez-le-feu et aux agressions israéliennes, quelle serait la
position de la résistance, à l’avenir ?
Hassan Nasrallah : Le conseil des
ministres a donné pour mission à l’armée de défendre le Liban, notamment dans
le Sud.
TS : A la lumière de
ce qu’a dit le président [du Parlement] Nabih Berri, au sujet de la résistance,
qui doit se poursuivre tant que les Fermes de Shebaa et que les collines de
Kafr Shouba seront occupées, quelle sera la position du Hezbollah, sur le
terrain, en ce qui concerne la poursuite de l’occupation des Fermes de Shebaa
par Israël ?
Hassan Nasrallah : Notre position
politique est connue, et elle est claire. Cette terre est une terre libanaise
occupée, et il faut que cette terre soit restituée au Liban. C’est la
responsabilité de l’État libanais, comme il était de sa responsabilité, en
1948, de défendre le territoire libanais et, ensuite, de récupérer chaque
arpent du territoire libanais occupé en 1978 ou en 1982 et, jusqu’à ce jour, il
est de la responsabilité de l’État libanais de récupérer ces territoires. Dès
lors que l’État veut bien assumer ses responsabilités, la Résistance doit le
soutenir ; mais si l’État veut en revanche se débarrasser de cette
responsabilité, il devient de la responsabilité de la Résistance de s’atteler à
la résolution de ce problème.
Résister est notre droit
légitime ; mais allons-nous exercer ce droit ici et maintenant ?
Non ; c’est une question de temps. Vous avez sans doute remarqué que, de
2000 à 2006, tout en réaffirmant ce droit, nous avons eu un comportement
différent, en ce qui concerne les fermes de Shebaa, de celui que nous avions eu
antérieurement à 2000, pour différentes raisons politiques, sécuritaires et
logistiques. C’est la raison pour laquelle nous nous contentons de dire, comme
l’a dit également le président Nabih Berri, que la résistance est notre droit,
que nous devons conserver ce droit et que ces terres doivent nous être rendues.
Aujourd’hui, on peut nous demander si nous accordons une chance à l’État
libanais ? Même après l’an 2000, l’État n’a jamais cessé d’avoir des
opportunités, d’avoir « ses chances » ; nous n’avons pas ouvert
de front secondaire dans les fermes de Shebaa, ni nous n’avons monté
d’opérations quotidiennes dans ces fermes. Les opérations que nous y
effectuions, nous les appelions « opérations de rappel » ; ces
opérations étaient espacées les unes des autres dans le temps, de plusieurs
mois. Nous sortons, aujourd’hui, d’une véritable guerre, et nous n’éprouvons
aucune impatience à effectuer des opérations dans les fermes de Shebaa. Mais
nous affirmons bien haut que nous en avons le droit, et que personne ne saurait
offrir des garanties et des assurances sécuritaires aux Israéliens, qui
continuent à occuper une partie de notre territoire. Aujourd’hui, l’État et le
gouvernement peuvent prendre l’initiative… Quoi qu’il en soit, nous suivons
cette question [des fermes de Shebaa] et nous verrons bien comment les choses
évolueront. Après la guerre, il faudra reconsidérer de manière équilibrée la
politique et l’organisation militaire du parti, dans le sens où le parti [le
Hezbollah, ndt] avait ses positions, ses abris, ses munitions et ses armes, il
combattait sur le front, et où, désormais, ce front a été refermé. La mission
militaire du parti de la Résistance n’est plus, désormais, sa priorité absolue.
TS : Comment
imaginez-vous la transition entre l’étape actuelle, où l’aspect militaire était
prédominant, et l’arène politique ? Quel rôle aura le Hezbollah après la
guerre de Juillet 2006 ?
Hassan Nasrallah : Le Hezbollah n’a
peut-être pas besoin de cette mutation dramatique sur le plan organisationnel,
car, tous les trois ans, le parti a procédé à des congrès d’évaluation en vue
de la réorganisation et du développement de son appareil et de ses capacités et
d’apporter les réformes adaptées à sa structure, correspondant à l’expansion
constatée sur le terrain, tant sur le plan politique que sur le plan populaire
ou encore sur celui de la définition des missions.
Par conséquent, nous ne
sommes peut-être pas confrontés à une mutation tellement importante, étant
donné que la structure du parti, en particulier à partir de 1990 et depuis lors
étaient celles d’une organisation militaire concernée par la résistance, ne
s’occupant que de cela, et dont c’était l’unique mission ; et puis il y
avait, parallèlement, un autre organisme, tout aussi important, organisationnel,
populaire et politique, qui se consacrait entièrement à ces tâches. Aucun de
ces deux corps n’était influencé négativement par l’autre ; au contraire,
ils s’influençaient mutuellement de manière positive et synergique.
J’explique : les réalisations de la Résistance profitaient à l’autre corps
[politique], grâce à son apport en matière de polarisation et de participation
populaires, d’efficacité politique et d’activité informationnelle. Cet apport
en matière d’adhésion populaire et en présence politique assurait un surcroît
de capacité au corps combattant [1] au sein
du Hezbollah.
TS : Une
reconsidération de la structure organisationnelle du Hezbollah est-elle possible,
dès lors que l’énorme acquis du parti au plan national libanais et au niveau
arabe en général est de nature à se faire reconnaître au-delà de la communauté
chiite ?
Hassan Nasrallah : J’imagine qu’il
sera possible, sur la base de l’expérience acquise au cours de cette dernière
guerre, de repenser beaucoup des idées et du programme du Hezbollah, en
particulier en ce qui concerne les relations politiques et l’augmentation des
possibilités d’en nouer de nouvelles et de les développer et / ou d’en ouvrir de
nouvelles au niveau de la totalité du territoire libanais. Parmi les aspects
positifs de ce qui s’est passé durant cette guerre, il y a le fait que les
contacts avec les autres forces et les autres courants politiques ont débordé
des cadres officiels et des états-majors des partis, par la force des choses,
et non plus d’une manière planifiée par qui que ce soit. Quand les réfugiés
sont partis se mettre à l’abri dans d’autres régions du Liban que la leur, il
s’est produit, dans un contexte sécuritaire et humain extra-ordinaire, un
surcroît d’interaction avec d’autres citoyens libanais : avec des
sunnites, dans les régions sunnites ; avec les chrétiens, dans les régions
chrétiennes ou encore avec les druzes, dans les régions druzes. Et on a pu parfois
faire état – à de rares exceptions près – des impressions positives que les
réfugiés ont rapportées, une fois retournés chez eux, qui étaient des
impressions positives et parfois excellentes. Et même si on a pu qualifier
parfois cette solidarité de solidarité [purement] humaine, et non de solidarité
politique, c’est une des réalisations, une des bénédictions les plus
importantes de cette guerre, car, à ma connaissance, le Liban n’avait plus
connu, depuis des lustres, une telle solidarité humaine, en particulier quand
on se souvient des convulsions intérieures et de la guerre civile qu’a connue
le Liban, ainsi que ce qui l’a précédée, et que la période qui lui a succédé.
Sans doute, d’aucuns, en
qualifiant cette solidarité libanaise d’humaine et de non-politique, ont-ils
voulu en diminuer l’importance et la valeur. Mais, en ce qui nous concerne,
nous ne minimisons pas la valeur de cette solidarité, car nous voyons dans
cette solidarité humaine une grande valeur, non moins importante que celle de
la solidarité politique. Et puis il y a aussi un autre aspect : ceci
[cette minimisation] s’est produit au lendemain de propos tenus tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur du Liban, selon lesquels le Liban aurait été au
bord de la dissension interconfessionnelle, voire de la guerre civile.
Et voici qu’on nous
présentait soudain un tout autre tableau que celui d’une solidarité populaire,
dans laquelle les communautés, les régions et les gens s’ouvraient mutuellement
à l’autre dans des circonstances particulièrement sensibles et dans le contexte
de questions particulièrement difficiles à résoudre. Cette donnée [nouvelle]
laissera assurément une marque très profonde sur la mentalité du Hezbollah, sur
sa compréhension des choses, sur son fonctionnement, sur son action et sur ses
relations ; je veux dire que cela conduira au développement et à
l’amélioration de cette cohésion et de cette interaction sociales [et
sociétales].
Naturellement, il y a une
chose que nous avons évoquée et à laquelle il faut prêter une certaine
attention, c’est notamment le fait que le Hezbollah, tant sa direction que ses
adhérents – appartienne majoritairement – voire quasi exclusivement – à la
communauté chiite et que, par conséquent, le développement organisationnel en
ce sens [celui de l’ouverture et du pluralisme, ndt] qui a été évoqué au cours
de plus d’un débriefing, doit tenir compte de certaines sensibilités, dans le
contexte de la situation prévalent aujourd’hui au Liban, y compris en ce qui
concerne nos prises de contact, en raison des complexités politiques internes
particulières au Liban.
Par exemple, nous avons
demandé à un certain nombre de nos responsables politiques et de nos chargés de
relations publiques d’établir des relations directes y compris avec les
familles – c’est-à-dire que nous serions allés chez les familles et que nous
aurions rencontré les notables de ces familles, pour nous présenter à eux, leur
donner des explications et répondre à leurs questions, ceci, afin d’établir
avec ces notables des relations directes. C’est là un droit tout à fait
naturel, et il faut que cela soit possible, au Liban ; je veux dire :
il faut que les relations entre les chiites et les sunnites, ou entre les
sunnites et les chiites ne passent pas obligatoirement par l’intermédiaire des
leaders, ni des partis, ni des cadres politiques ; il faut que ces
relations soient des relations populaires et directes. Malheureusement, nous
avons constaté que ce genre d’initiative risquait de susciter certaines
susceptibilités qui étaient de nature à les mettre au grand jour d’une manière
indésirable ; on aurait aussi pu dire en effet que le Hezbollah voulait
faire de l’entrisme dans le domaine sunnite, et c’est là la moindre des
incriminations de certains, selon lesquels le Hezbollah aurait eu pour projet
de falsifier le sunnisme en chiisme et d’appeler certains sunnites à se faire
chiites. Ce sont là, bien entendu, des mensonges et des billevesées sans aucun
fondement.
Quoi qu’il en soit, nous
comprenons ces sensibilités et ces susceptibilités, et je suis personnellement
d’accord avec ce que vous avez noblement évoqué dans votre question : le
Hezbollah doit absolument s’adresser plus qu’il ne l’a fait jusqu’à présent aux
autres communautés confessionnelles, aux autres courants. Nous avons, par
exemple, une évaluation positive sur plus d’un domaine ; par exemple, pour
parler des chrétiens, il faut savoir qu’avant même la guerre, depuis environ un
an et demi, nous avons avec une partie d’entre eux des relations solides, qu’il
s’agisse de certains partis politiques [de la tendance nationaliste, selon les
anciens clivages] présents au sein des partis nationalistes libanais, ou
orientés à gauche, ainsi qu’avec des chrétiens des régions de Zghorta et
d’Ehden, par exemple. Ancienne, aussi, la relation que nous entretenons avec
l’ancien Premier ministre Soleïman Franjiyéh, dont le leadership est excellent
et réel ; personne ne peut en ignorer l’importance et la grande
représentativité. Il y a aussi le mouvement des Maradah [= les Révoltés,
ndt] : cela apparaît jusque dans le communiqué institutionnel qu’il a
publié récemment, à l’occasion de sa re-formation, et où il est question des
armes de la Résistance, des armes du Hezbollah, dans les mêmes termes que ceux
du Hezbollah, ce qui signifie qu’il y a entre nous une totale identité de vues
sur ce plan-là. A propos des régions chrétiennes et de la façon dont les
réfugiés y ont été accueillis, nous pouvions nous attendre à ce que ces
relations fussent excellentes à Zghorta et à Ehden, en raison, dans ces deux
localités, d’une alliance ancienne entre nous et le ministre Soleïman Franjiéh,
et nous avons constaté dans ces régions une sympathie sincère et très intense,
dont nous les remercions ; la même chose s’est produite dans d’autres
régions, où sont présents certains politiques [alliés], et c’est là quelque
chose de logique et naturel.
Ce que d’aucuns s’étaient
imaginé, c’est que nos relations qui s’étaient ouvertes, récemment, avec le
courant nationaliste était des relations purement formelles et officielles.
Mais en réalité, il s’est avéré qu’il s’agissait d’une relation populaire et
naturelle, spontanée. Cela s’est manifesté très clairement au travers de la
guerre, et en particulier dans la manière dont a été traité le problème des
personnes déplacées.
Même quand nous allons
dans les institutions dépendant du Patriarcat, c’est-à-dire dans les monastères
et dans les écoles, je peux dire, d’une manière générale, qu’aujourd’hui,
l’élan du Hezbollah, la confiance du Hezbollah, la conviction qui est celle du
Hezbollah, c’est qu’il faut ouvrir et interconnecter nos relations et les
renforcer avec les milieux chrétiens – qu’il s’agisse d’amitiés anciennes, ou
de ces amitiés apparues au cours de la période difficile que nous venons de
traverser, ou encore de la recherche de nouvelles relations et de nouvelles
amitiés. Je vous affirme que cette conviction [chez nous] est encore plus
forte, après cette guerre. De même, dans le milieu sunnite, même si notre
attachement à nos relations dans ce milieu est ancien et plonge ses racines
dans les spécificités du Liban et dans celle du monde musulman, ainsi que dans
les répercussions qu’a cette spécificité [locale] sur les relations
chiito-sunnites où que ce soit dans le monde. Même chose en ce qui concerne les
druzes, tant ceux qui étaient dans le même camp que nous durant cette guerre
qu’une partie de ceux qui ont des désaccords politiques ou avec lesquels nous
sommes en opposition sur le plan politique – les druzes se sont montrés
solidaires sur le plan humain, et c’est là quelque chose que nous ne saurions nier
ou oublier.
TS : Les chiites
avaient-ils un projet particulier – à travers le Hezbollah – qui aurait fait
qu’on aurait tenté de frapper celui-ci durant le dernier conflit ?
Hassan Nasrallah : On parle tout le
temps de je ne sais quel « projet particulier », et cela n’est pas la
réalité. Le projet du Hezbollah a été proclamé ; il est connu. Le
Hezbollah a une vision déclarée, sur le plan politique, et nous ne cessons de
réitérer notre position : le Hezbollah est sans doute le parti qui s’exprime
le plus, à travers des discours, notamment ; c’est un parti qui a une
présence médiatique forte, qui exprime ses convictions, ses points de
vue ; c’est un parti, aussi, qui a un programme qui a été ouvertement
présenté au public à toutes les élections – programme électoral que le parti a
immédiatement entrepris, une fois élu, de traduire en réalisations politiques.
Certains nous invitent à
nous engager aujourd’hui au sein de l’État libanais… à ceux-là, nous disons que
nous avons participé aux élections en 1992, alors qu’eux, en revanche, ils les
ont boycottées… Nous, nous avons participé aux élections de 1996 ; et eux,
ils les ont boycottées… Mais voilà les mêmes, aujourd’hui, qui font de la
surenchère sur nous, et qui nous convient à nous engager dans le projet de l’État.
Nous n’avons pas de projet particulier et nous disons, quant à nous, de manière
très claire – et là, ce n’est pas, vous pouvez me croire, de la langue de bois
politique, mais bien un discours intellectuel qui s’appuie sur des fondements
philosophiques et religieux, et pas seulement sur un vocabulaire purement
politique – que nous nous inscrivons dans la vision religieuse islamique –
cette vision unanime chez tous les musulmans – c’est-à-dire dans une vision qui
est musulmane, et qui n’est ni (simplement) chiite, ni (purement) sunnite. Nous
affirmons que les gens ont besoin d’un imâm [un guide, ndt]. Dans le langage
d’aujourd’hui, un imâm, cela veut dire un ordre, une organisation ; cela
veut dire un État. Aucun groupe humain ne peut vivre sur un territoire
déterminé sans État, en étant dépourvu de l’identité et du contenu de cet État.
Il y a toujours eu, en permanence, une disputation juridico-théologique [2] sur le point suivant : quand il y a à
trancher entre un régime politique faisant l’objet de beaucoup de critiques et
d’objections, d’un côté et, de l’autre côté, l’anarchie et / ou la guerre
civile, que doit-on faire ? Certains considéraient que la chose principale,
fondamentale, essentielle, c’était l’existence dudit régime politique [quel
qu’il soit], et qu’il fallait à tout prix éviter de tomber dans
l’anarchie ; qu’il était préférable d’endurer tous ces aspects négatifs,
plutôt que d’encourir le risque de connaître encore bien pire – la guerre
civile.
Nous affirmons aujourd’hui
que tous les Libanais ont besoin de sérénité, de tranquillité. Quand certaines
personnes viennent au Liban et disent : « Nous avons peur de
vous ; rassurez-nous ! », je tiens à leur répondre : « Et
moi aussi, j’ai peur de vous ; rassurez-moi ! » Tout le monde,
au Liban, a besoin d’être rassuré ; cela est dû au fait que le Liban était
– et qu’il se trouve encore aujourd’hui, bien entendu – sur la faille sismique
locale, régionale et mondiale. C’est le résultat des immixtions étrangères dans
nos affaires – en particulier des immixtions états-uniennes et israéliennes.
TS : Parlons
maintenant, si vous le voulez bien, de vos relations avec l’Arabie saoudite, en
particulier depuis la publication, par ce pays, des premiers communiqués
évoquant (de votre part) un aventurisme inconsidéré. Quelles sont vos relations
avec Riyad ? Y a-t-il des rancunes, une interruption dans les contacts,
dans l’échange des points de vue ? Ou bien, au contraire, ce qui s’est
passé a-t-il été seulement passager ? Avez-vous repris contact avec les
Saoudiens ?
HN : En ce qui
concerne les prises de position saoudiennes, au début du conflit, et aussi en
ce qui concerne la déclaration émanant du sommet égypto-jordanien, sans oublier
l’atmosphère générale de la première réunion des ministres arabes des Affaires
étrangères au Caire, le moins qu’on puisse dire – et je mesure mes propos –
c’est que nous étions parfaitement fondés à protester, et qu’ils n’ont aucun
droit à être attristés ou à geindre !
Je ne veux pas leur dire
quelle évaluation nous faisons de leur position, en particulier en ce qui
concerne ce fameux « aventurisme inconsidéré » et les propos du même
acabit. Je les renvoie à Monsieur Ehud Olmert lui-même, qui leur expliquera de
quelle manière les Israélo-États-uniens ont utilisé ces déclarations et prises
de positions pour justifier leur guerre d’agression contre le Liban. Même si,
bien sûr, comme nous le savons, les Israéliens se sont prévalu de bien pire
encore que ces déclarations arabes officiellement proclamées, puisqu’ils ont
parlé de contacts que certains gouvernements arabes avaient établis avec eux
pour bénir leur guerre contre le Liban et les exhorter à la mener sans relâche
et sans faiblir, jusqu’à ce que le « Hezbollah soit liquidé » !
A ce sujet, je dirai que
c’est là ce que les Israéliens prétendent ; nous ne sommes absolument pas
disposés à les croire sur parole, sur ce point.
Mais, à la lecture des
prises de position arabes officielles, proclamées, sur la guerre du Liban et
sur la Résistance – des déclarations que ces gouvernements ont diffusées
officiellement, par la voie diplomatique – je me limiterai à leur dire
ceci : que vous l’ayez voulu, ou non, votre prise de position a servi de
couverture à l’ennemi ou, dans le meilleur des cas, elle a représenté un
abandon du Liban et de la Résistance libanaise – cette Résistance dont vous
aviez pourtant tous déclaré, en 2000, que vous étiez fiers d’elle, et que vous
aviez félicitée pour sa victoire. Aujourd’hui, nous ne voulons pas nous arrêter
trop longtemps sur ce qui s’est passé de fâcheux. Nous en prenons note et nous
nous efforçons d’en tirer les leçons.
En ce qui concerne les
pays arabes envers lesquels nous avons certains reproches à faire, en raison de
leurs prises de position à tout le moins inamicales, nous pensons qu’il est
naturel que ces pays s’efforcent, comme nous nous y efforçons de notre côté, de
restaurer nos relations dans l’intérêt arabe et islamique, ainsi que dans
l’intérêt national de tous les pays concernés.
En ce qui concerne les
Frères saoudiens, s’il existe un reproche, il est plus grave ; car nous
avions avec eux une relation développée et parce que j’avais rencontré à de
multiples reprises l’ambassadeur d’Arabie saoudite à Beyrouth, le Dr. Abd al-Aziz
Khujah, ainsi que des responsables saoudiens de passage à Beyrouth. Par
ailleurs, le roi Abdullah Ibn Abd al-Aziz a eu de bonnes paroles, à plus d’une
occasion, tant au sujet du Hezbollah, d’une manière générale et de la
Résistance qu’à mon égard. Si bien qu’une semaine encore avant le déclenchement
de la guerre, on a pu faire état de ses propos selon lesquels Hassan Nasrallah
était « son cher fils », « notre héritier sur lequel nous
parions… » etc, etc…
TS : Vous avez été
invité en Arabie saoudite, par le passé, et on s’est perdu en conjectures quant
aux raisons pour lesquelles vous avez décliné cette invitation ?…
Hassan Nasrallah : C’est exact ;
j’ai effectivement été invité à me rendre en visite officielle en Arabie
saoudite. Ceci ayant été évoqué par les médias, je vais répondre, à ce sujet.
Quand l’ambassadeur saoudien à Beyrouth m’en a transmis l’invitation, je lui ai
dit que je l’acceptais sous l’angle politique et fraternel, que j’en étais
honoré, qu’accepter cette invitation ne posait pas de problème politique ;
mais que cela posait un problème de sécurité, car [en réalité] je ne pouvais
pas me déplacer. C’est si vrai que je ne me suis pas rendu en pèlerinage à La
Mecque depuis 1986. Non que je ne désirerais pas effectuer ce pèlerinage, mais,
là encore, pour des raisons de sécurité. Tout le monde sait bien, d’ailleurs,
que tout musulman, en particulier s’il est pratiquant et religieux, ne désire
rien tant que de se rendre en pèlerinage à La Mecque. Je suis privé de cette
bénédiction, et je ne peux pas non plus effectuer le petit pèlerinage, bien que
l’invitation m’en ait été faite chaque année : à chaque fois, j’ai dû
décliner cette invitation, à mon grand regret, au motif de : la sécurité…
Enfin, bref : l’important, c’est que nous n’avions aucune réserve d’ordre
politique en ce qui concerne cette invitation officielle à nous rendre en
Arabie saoudite. Certains responsables saoudiens pensent que ce qui m’aurait
incité à en décliner l’offre, cela aurait été des des mises en garde iraniennes
et syriennes ; ça n’est pas tout à fait exact. En tous les cas, l’avenir
montrera que le mouvement politique le plus indépendant de tous, au Liban, par
rapport à tous les axes régionaux et à tous les pays, c’est bien le Hezbollah.
Mais je tiens à rectifier la déduction erronée de certains responsables en
Arabie saoudite : je leur dis que lorsque les Iraniens et les Syriens ont
eu connaissance de l’invitation saoudienne qui m’avait été adressée, ils m’ont
encouragé à l’honorer, me disant que cela permettrait de développer les
relations – contrairement, donc à ce que certains responsables saoudiens
veulent bien donner à accroire. La réalité, je le répète, c’est que
l’empêchement était purement sécuritaire. J’ai d’ailleurs informé son
Excellence l’ambassadeur saoudien à Beyrouth du fait que je n’étais pas
personnellement en mesure de me rendre en Arabie, mais que tout frère
appartenant au parti et représentant son secrétaire général, soit qu’il
appartienne au Conseil exécutif, soit qu’il s’agisse du frère ministre Muhammad
Fanish, pourrait s’y rendre à ma place et me représenter. J’ai dit aux
Saoudiens qu’ils avaient une liste de ces noms à leur disposition et qu’ils
pourraient choisir eux-mêmes le représentant du Hezbollah qu’ils souhaiteraient
éventuellement inviter [à ma place], sans que je sois amené moi-même à les
mettre dans l’embarras en désignant quelqu’un. Et que ce représentant du
Hezbollah [ayant leur agrément] se rendrait en Arabie, où il me représenterait
personnellement, tout en représentant également la direction du parti ;
que je le chargerais des questions à examiner au cours de cette visite. Mais
les Saoudiens ne m’ont pas répondu. C’était avant la guerre. Je le répète, par
conséquent : les causes [de mon non-déplacement officiel en Arabie saoudite]
étaient purement sécuritaires et en aucun cas politiques ; je réaffirme
également que nous sommes très attachés à nos relations avec l’Arabie saoudite
et que nous souhaitons les développer et les améliorer.
TS : Puis-je déduire
de ce que vous venez de nous expliquer que vous aviez véritablement motif à
être mécontent ?
Hassan Nasrallah : Oui. C’est
vrai ; cela nous a particulièrement affectés – en plus du reste… Vous
marchez avec nous dans la même direction, et voilà qu’en des circonstances
particulièrement délicates – critiques, même –, des circonstances dans
lesquelles c’est notre destin qui est en jeu, vous venez nous dire ce qui nous
a été dit ! ?… Oui ; nous étions fondés à faire certains
reproches. Mais quoi qu’il en soit, aujourd’hui, nous avons des amis communs,
au Liban, qui ont œuvré à faire en sorte que nos contacts soient renoués et
nous n’avons aucune objection à cela, bien entendu. Bien au contraire :
nous avons établi de nombreux contacts ces tout derniers jours et, si Dieu le
veut, les choses vont continuer à s’améliorer…
TS : On ne peut pas
dire que le Hezbollah ait réservé un accueil délirant, dans la banlieue Sud de
Beyrouth, à l’émir du Qatar ; d’autant qu’on connaît l’importance
régionale du Qatar, et aussi ses relations particulièrement influentes ?…
Hassan Nasrallah : D’une manière
générale, nos relations avec l’ensemble de nos frères des pays du Golfe se sont
poursuivies, comme par le passé. En ce qui concerne l’émir du Qatar… Celui-ci
est le premier dirigeant arabe à être venu nous rendre visite dans les
quartiers Sud de Beyrouth, et c’est là quelque chose de très important, qui
nous touche beaucoup. C’est quelque chose qui a une valeur [symbolique] énorme,
à nos yeux. Tout dirigeant arabe qui aura le même geste et viendra nous rendre
visite dans la banlieue Sud de Beyrouth, nous l’accueillerons de la même
manière. Cela tient à notre devoir d’accueillir dignement nos hôtes et
d’exprimer toute notre reconnaissance pour l’honneur qu’ils nous font en venant
nous rendre visite et, cela, sans considération aucune pour les appréciations
politiques que nous pouvons avoir, par ailleurs.
TS : Pourtant, ça ne
semble pas avoir été le cas, avec un dirigeant international aussi éminent que
Kofi Annan ?
Hassan Nasrallah : Je pense que
l’image de « parti de fer » que l’on donne du Hezbollah est peut-être
exacte en ce qui concerne l’esprit de discipline de la plupart des membres de
notre parti. Mais, entre nous et la population de la banlieue Sud de Beyrouth,
il n’y a aucune « discipline de fer » ! Oui, c’est vrai :
les frères qui ont organisé la visite d’Annan dans les quartiers Sud de
Beyrouth ont été surpris par le comportement de certaines personnes envers le
secrétaire général de l’Onu et la délégation qui l’accompagnait. Vous pourrez,
en tous les cas, re-visionner les archives vidéo, et vous pourrez vérifier que
les personnes agressives qui s’étaient rassemblées là pour attendre le passage
de Kofi Annan n’appartenaient pas au Hezbollah. C’était de simples citoyens.
TS : Avez-vous,
actuellement, des contacts avec les Égyptiens ?
Hassan Nasrallah : Nous en aurons
peut-être bientôt. Peut-être les relations redeviendront-elles ce qu’elles
étaient, comme dans le cas de l’ensemble des relations internationales du
Hezbollah… ? Bien sûr, nous n’avons eu aucun entretien bilatéral avec son
Excellence l’ambassadeur égyptien Hussein Darrar ; mais il a sans doute
[sic] rencontré certains députés du parti [au Parlement libanais] et cela, plus
d’une fois.
TS : En ce qui
concerne les secours arabes ; sont-ils du niveau que vous
escomptiez ?
Hassan Nasrallah : Avec toute notre
gratitude et toute notre considération pour les pays arabes qui ont annoncé
qu’ils envoyaient ou enverraient des secours au Liban, ce qui a été annoncé
n’est pas à la hauteur de la [légendaire] générosité arabe, et cela ne couvre
pas les besoin du Liban, qui sont immenses, en matière de reconstruction.
TS : Peut-on dire
que le [très] chiite Hezbollah serait, pour ainsi dire, devenu le parti chef de
file des musulmans sunnites dans la bataille contre Israël ? Quelle
évaluation faites-vous de l’attitude tant des régimes que des peuples arabes et
musulmans par rapport au conflit ?
Hassan Nasrallah : Bien sûr, j’ai
beaucoup lu ou entendu, qu’Untel -que je ne nommerai pas…- ou que le Hezbollah
incarnait désormais une avant-garde arabe ou islamique, ou quelque chose dans
ce genre… Je tiens à la précision ; or, je n’imagine pas que cette
expression soit exacte. Oui, c’est vrai : le Hezbollah, comme votre
serviteur, jouit aujourd’hui d’un grand respect dans les mondes arabe et
musulman, ainsi que d’une grande confiance et d’une grande crédibilité. C’est
là le fruit de notre tenace résistance, de notre victoire, de nos réalisation,
et cela tient également au fait que nous affrontions l’ennemi commun de tous
les Arabes et de tous les musulmans : Israël. En ce qui me concerne
personnellement, je pense que cela ne va pas plus loin. Quant à l’enthousiasme
de certains, et à la tentative de présenter les choses de façon à pouvoir
parler d’un rôle de leader du Hezbollah au niveau arabe, d’avant-garde
déterminée à diriger le monde arabe et à y provoquer des changements
révolutionnaires, c’est très exagéré, et telle n’est pas la réalité…
Soit dit entre
parenthèses : cela ne fait qu’augmenter nos problèmes. Le Hezbollah ne se targue
nullement de tout diriger, ni au Liban, ni non plus, a fortiori, dans
l’ensemble du monde arabe. Personnellement, je ne me la joue pas « grand
chef ». Ni au sein du Hezbollah, ni a fortiori au niveau du monde arabe
considéré dans son ensemble…
TS : Quelles
risquent d’être les répercussions de cet état de fait sur votre volonté de
couper court à tout risque de guerre de religion entre chiites et sunnites.
L’on sait que vous avez énormément œuvré à ce qu’ils coexistent en bonne
intelligence ?
Hassan Nasrallah : Effectivement,
c’est ce qu’il y a de plus important, en ce qui concerne les possibles
conséquences redoutables, absolument catastrophiques, de cette guerre. Les
points marqués l’emportent grandement sur les sacrifices endurés ; il ne
faut donc pas que le rayonnement de ces sacrifices courageusement consentis
empêche de voir l’ampleur du succès et de la victoire, qui sont devenus
réalité. Et au premier rang des points acquis, il y a la question des relations
chiito-sunnites. En effet, le projet fondamental [des États-uno-sionistes,
ndt], après l’invasion états-unienne de l’Irak – et c’est un projet qui
continue à menacer ce pays arabe, et à travers lui toute la nation arabe et
toute la communauté musulmane mondiale [‘ummah] – ce projet fondamental auquel
travaillent d’arrache-pied les États-unis et Israël, consiste à fomenter une
guerre inter-religieuse – une fitnah – impitoyable et destructrice, en semant
la dissension entre les (musulmans) sunnites et les (musulmans) chiites.
TS : Passons, si
vous le voulez bien, au dossier de la reconstruction du Liban. Le président [du
Conseil des ministres] Siniora explique que le Hezbollah entend que son
intervention se limite – c’est du moins ce qu’il dit avoir compris – à assurer
une allocation correspondant au montant d’un loyer pendant une durée de dix ans
« seulement » à ceux dont le logement a été détruit ainsi qu’à
l’achat de mobilier, et que ceci signifierait que vous seriez revenu sur votre
engagement initial de vous charger de la reconstruction intégrale ? La
déduction de M. Siniora est-elle exacte ?
Hassan Nasrallah : Jamais de la
vie ! En aucun cas ! C’est totalement faux ! Dès le premier jour
du cessez-le-feu, ainsi que le lundi suivant, lors d’une interview télédiffusée
par New TV, en présence de M. Siniora, j’ai personnellement indiqué – et
je le répète ici – que nous restons fidèles à notre engagement. Nous avons fait
une promesse aux sinistrés, et nous n’avons en aucun cas cessé d’y être
fidèles. Cette promesse, c’est que les sinistrés retrouveront leur maison et
leurs biens tels qu’ils étaient, et même mieux que ce qu’ils étaient. Nous
parlons donc bien ici d’une véritable reconstruction. Nous avons annoncé
publiquement cet engagement. Après cette annonce, nous avons indiqué qu’il y
aurait plusieurs étapes successives. La première de ces étapes – l’étape en
cours – nous l’avons appelée ‘l’étape de fourniture de solutions alternatives
provisoires’ – concerne les personnes qui ont tout perdu : leur domicile
et leurs meubles. C’est ce que nous avons décidé, en ce qui concerne les
maisons et immeubles totalement détruits ou inhabitables, et c’est ce qui a été
effectivement réalisé.
Le principal problème
auquel nous sommes confrontés, c’est naturellement la reconstruction intégrale
des logements totalement détruits [par les bombardements israéliens]. Nous
sommes engagés par nos annonces, et nous assurons…
Et puis voilà que l’État
vient nous dire que cette tâche relève de ses prérogatives ; et je ne nie
nullement que cela soit bien le cas. Voici ce qui s’est passé, en réalité – et
c’est ce que j’ai expliqué au cours de ma dernière interview télévisée – :
ce n’est pas nous, qui nous serions adressés au Premier ministre Siniora, pour
lui dire que nous aurions été incapables de reconstruire les immeubles totalement
détruits. Cela n’a absolument pas eu lieu. Nous n’avons jamais dit à Siniora
que nous avions besoin de son aide ! C’est lui qui a pris l’initiative –
ce dont nous le remercions – de demander à nous rencontrer afin de discuter de
ce que nous allions faire au sujet de la reconstruction afin, nous a-t-il dit,
« que je puisse [c’est Siniora qui parle, ndt] savoir, en tant que
gouvernement, ce que je serai en mesure de proposer et de faire, en
contrepartie. Quand un pays viendra, dans le cadre de protocoles qui seront
officiellement décidés de manière bilatérale, se charger de reconstruire [à ses
frais, ndt] les immeubles détruits [dans tel ou tel quartier, ndt], ma mission
s’achèvera là. Y a-t-il d’autres domaines dans lesquels je puisse aider les
propriétaires des immeubles [ainsi] reconstruits [grâce à l’aide
internationale, ndt] ? Je suis naturellement à leur service. »
Quand le gouvernement
vient proposer 50 millions de livres libanaises pour reconstruire une unité
d’habitation, que disons-nous ? Nous disons que, par principe, la famille
dont on reconstruira l’habitation, au cas où la somme offerte par l’État
suffit, cette habitation sera reconstruite grâce à l’aide gouvernementale. Et,
dans le cas où l’allocation gouvernementale ne suffit pas, nous nous sommes
engagés à apporter à la famille concernée le supplément nécessaire pour
reconstruire tout ce qui a été démoli, afin de remettre l’habitation dans son
état préalable. C’est là un engagement absolu, sur lequel il est hors de
question que nous revenions.
TS : Pendant le
conflit, comment s’établissaient les contacts entre les trois présidents et
tous les autres états majors politiques ?
Hassan Nasrallah : En ce qui concerne
le président [de la République libanaise], M. Emile Lahoud, nous étions en
relations constantes, grâce à un intermédiaire. En ce qui concerne le président
[du Parlement] Nabih Berri, j’ai déjà indiqué au début de cet entretien qu’il
existait entre nous une coopération, une compréhension et une coordination,
ainsi que des liaisons téléphoniques qui nous permirent de rester en contact
vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Avec le président [du conseil des
ministres], M. Fouad Siniora, nous avons eu plusieurs modalités de contact
ou de dialogue ; soit par l’intermédiaire des ministres appartenant au
parti Hezbollah, au sein du conseil des ministres et aussi, parfois, nous avons
eu des contacts directs avec le Premier ministre ou avec son conseiller
politique, le frère hajji Hussaïn Khali. Mais ce sur quoi nous nous mettions
d’accord, en fin de compte, c’était sur la question de savoir la part de
reconstruction qui serait réalisée par le canal de son Excellence le président
[du Parlement] Nabih Berri, sachant que c’était lui qui était chargé de
l’administration politique de la guerre. Nous avons toujours été assis ensemble
autour de la table du conseil des ministres, ou bien nous nous sommes parlé
dans les coulisses, entretenant ainsi un dialogue permanent avec le Premier
ministre. Et nous avons veillé, pendant toute la durée de la guerre, à ce que
le gouvernement paraisse [et soit réellement] uni, fort, cohérent, en dépit que
nous consignions nos réserves, nos observations et nos oppositions sur certains
points ou sur certaines prises de position. Cela fut le cas notamment lors de
la discussion des sept points [en vue d’un cessez-le-feu,
ndt] : d’autres que nous ont admis les sept points à titre de principes
généraux, les détails nécessitant des débats [au Parlement] et une prise de décision
ultérieure en conseil des ministres. Ainsi, quand la discussion de la résolution
1701 a été mise à l’ordre du jour – et alors que nous avions de
sérieux points de désaccord sur certains chapitres de cette résolution , j’ai
déclaré que je la considérais inique et partiale, et nos réserves à son sujet
sont sérieuses, mais – nous avons, là encore, veillé à l’unité de la position
gouvernementale et nationale et nous avons dit que cette résolution avait été
entérinée à l’unanimité, [mais] avec certaines réserves.
TS : Quid de vos
relations avec Walid Jumblat ?
Hassan Nasrallah : Pendant la guerre,
nous n’avons pas eu de contact direct avec Monsieur le député Walid Junblat.
Comme vous le savez sans doute, depuis la crise des communiqués et des prises
de position précédentes, il n’y avait plus de contacts réciproques entre lui et
moi ; nous nous rencontrions seulement dans le cadre des tables rondes du
débat national. Mais, en-dehors de ces séances, il n’existait aucun contact
entre nous, et cette situation a prévalu durant toute la durée des trente-cinq
jours du conflit. Les premiers jours de la guerre, il a pris certaines
positions positives. J’ai personnellement demandé au frère Nawaf al-Moussaoui
d’entrer en contact avec le ministre [druze, ndt] de l’Information, le frère
Ghâzî al-Uraïdhi, afin qu’il transmette au ministre Junblat nos remerciements
pour les positions qu’il avait alors adoptées et exprimées. Mais jusqu’ici, les
choses ne sont pas allées jusqu’à la restauration des relations normales qui
existaient entre nous jusqu’à il y a, de cela, environ, un an…
TS : Y a-t-il
actuellement des tentatives de renouer ce contact ?
Hassan Nasrallah : En ce qui nous
concerne, nous n’avons jamais fermé la porte du dialogue. Je vous dis, en toute
sincérité, que, tant d’une manière médiatisée que non-médiatisée, c’est-à-dire,
y compris, dans les coulisses, lorsqu’on nous proposait, parfois (souvent à
l’initiative d’amis communs) de reprendre ces contacts et cette relation, nous
n’avons jamais formulé la moindre objection. Et, un jour, je l’ai dit, lors
d’une interview à la télévision. Et j’ai ajouté que ce n’était fondamentalement
pas nous qui avions coupé les ponts avec Junblat, en dépit de la position très
ferme que nous avions publiée en réplique à la manière dont il venait de
qualifier l’armement de la Résistance. Nous avions répondu quant à nous que
nous ne souhaitions boycotter personne. Notre politique n’est pas de boycotter
qui que ce soit au Liban, même si nous avons pu avoir de très importantes
divergences politiques avec lui, ajoutant que nous étions prêts à rétablir le
contact et à dialoguer. Monsieur Walid Junblat nous a fait répondre qu’il
n’accepterait de nous rencontrer que dans le seul cadre du conseil des
ministres… C’est donc clair : nous n’avons, pour ce qui nous concerne,
jamais cherché à ostraciser quiconque, et en particulier par M. Junblat.
TS : Vous avez été
accusé d’ouvrir la porte, en revanche, aux tiraillements politiques internes
lors du débat sur un gouvernement d’union nationale, en liaison avec
l’application des accords de Taëf ?…
Hassan Nasrallah : En vérité, je
n’avais nullement l’intention d’ouvrir une quelconque controverse politique
interne… J’ai répondu à certaines questions posées par le ministre Walid
Junblat au cours d’une conférence de presse qu’il avait organisée. J’ai
considéré qu’en grande partie, ces questions étaient dépassées, qu’elles
appartenaient au passé, qu’il y avait reçu des réponses, soit directement de ma
part, soit autour de la table ronde du débat national. Mais la question
centrale que Junblat a posée, c’est une question clé, si je puis m’exprimer
ainsi. Une question clé, en ce sens que cette question en ouvre beaucoup
d’autres. C’est une question relative à l’accord
de Taëf, cela ne fait pas l’ombre d’un doute. Et si vous voulez
mettre sérieusement en application les accords de Taëf, alors, d’accord :
commençons par considérer que le premier point, le point essentiel, qui
conditionne la mise en application effective de Taëf, c’est la formation d’un
gouvernement d’union nationale, comme cela est stipulé expressément dans le
texte de cet accord lui-même…
TS : … mais eux, ils
ont répondu en disant que cela ne s’imposait qu’au premier gouvernement
libanais formé après la signature de Taëf, n’est-ce pas… ?
Hassan Nasrallah : Exactement !
Jusqu’à présent, ils disaient -je parle ici de la majorité des Forces du 14
mars- deux choses : primo, le gouvernement d’union et de concorde
nationales stipulé par l’accord de Taëf n’a jamais existé, tout au long des
seize années écoulées depuis la signature dudit accord, et ils attribuent cet
état de fait à la période de la « tutelle syrienne » sur le Liban,
comme ils disent ; et, secundo, que la plupart des attendus des accords de
Taëf n’ont jamais été appliqués jusqu’à présent.
Alors ? N’est-ce pas
génial, si nous, nous disons que ce gouvernement n’a pas été formé et que
l’accord n’a pas été mis en application dans la plupart de ses articles et que
c’est précisément ce que nous voulons faire, et tout de suite ?
Le préalable naturel,
comme le prévoit l’accord de Taëf, pour mettre en application ce qui ne l’a pas
été, c’est la formation d’un gouvernement d’union nationale. Ce n’est là en
rien une hérésie politique ; c’est, au contraire, une volonté de croire en
notre pays et de veiller politiquement à sa sauvegarde !
Permettez-moi [pour
conclure] de réaffirmer que ce qui a mis fin à la guerre, c’est le fait que les
Israéliens redoutaient de s’acheminer vers une catastrophe militaire au cas où
ils auraient poursuivi leur offensive terrestre ; c’est le fait que
l’horizon se soit refermé devant eux et qu’ils n’ont connu qu’échec après échec
après échec…
Le Liban doit s’apprêter
aujourd’hui à faire face à de grands défis, à des défis redoutables, lourds de
dangers. Alors, dites-moi : si nous entreprenons d’augmenter la force de
notre pays et son inviolabilité, en procédant à la formation d’un gouvernement
d’union nationale : nous sommes perdants, ou bien nous sommes
gagnants ? Si un gouvernement réussit à réaliser certaines avancées, cela
signifie-t-il qu’il faille se priver de la possibilité de renforcer notre pays
politiquement, en faisant participer [au gouvernement] ceux qui en avaient été
exclus à un moment donné ? Si les possibilités de former un gouvernement
d’union nationale sont réunies, permettant de faire face aux défis énormes à
venir prochainement, pour le Liban, qu’est-ce qui nous empêche de le faire ?
La logique que je viens
d’exposer est une logique de raison et de prudence. Ce n’est en aucun cas une
logique de rouerie politique, car cela n’est absolument pas dans ma manière de
raisonner.
J’ai dit :
« Vous voulez appliquer l’accord de Taëf et bâtir l’État libanais ?
Le préalable naturel, pour ce faire, c’est la formation d’un gouvernement
d’union nationale… Bien. Alors : allons-y ! Formons ce gouvernement
d’union nationale, et ne perdons pas notre temps à répliquer à ce verbiage
politico-juridico-constitutionnel unanimiste, qui tient tellement à son
discours du type : « Cousez, mais pas avec cette
alêne ! »… »
D’ailleurs, pourriez-vous
avoir l’amabilité de me dire quelle autre alêne ils souhaiteraient nous voir
employer ?
|
Talal Salman |