On purge Bounan
[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ debord of directors ] [ FAQ ]
Posted by [anonyme] on September 02, 2000 at 05:07:22 AM EDT
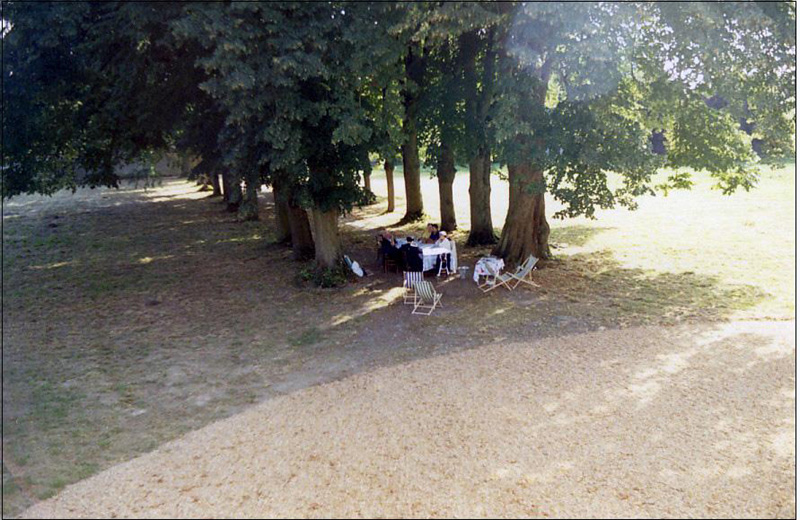
Examen d’une campagne anticélinienne
Pierre Monnier, dans son livre Céline et les têtes
molles (Le Bulletin célinien, 1998), n’est pas le seul à réagir aux
opuscules hystériquement anticéliniens qui ont paru récemment. A gauche aussi, on
se gausse de ces attaques qui visent à déconsidérer totalement un écrivain qui,
sans les honneurs qui lui sont actuellement rendus par ailleurs, n’eût jamais
suscité tant de hargne.
Dans un récent recueil d’articles, Philippe Muray,
auteur d’un Céline paru en 1981, répond avec talent aux duettistes
Bounan & Martin et sans aucune complaisance vis-à-vis de l’auteur des Bagatelles.
Extrait.
« On purge bébé.
Examen d’une campagne anticélinienne » in Exorcismes spirituels II (essais),
Ed. Les Belles Lettres, 1998, pp. [126]-152. Cet article a paru initialement en
1997 dans la revue L’Atelier du roman. Ce recueil comporte six autres
articles sur Céline extraits de diverses autres revues.
________________________________________________________
C’est ainsi que l’actuelle campagne
anticélinienne, avec en éclaireurs deux petits livres complémentaires, L’Art
de Céline et son temps de Michel Bounan et Contre Céline de
Jean-Pierre Martin, n’a d’autre objectif ultime que le bannissement de Céline
des bibliothèques. Pas le Céline des pamphlets, bien sûr, introuvable depuis
longtemps, mais le reste, tout ce qui reste encore de Céline, depuis Voyage
jusqu’à Rigodon, avec en point d’orgue son expulsion manu militari
de la collection de la Pléiade. Plus émotif que son collègue en purification
éthique, Martin nous le dit d’emblée avec une belle franchise :
« quatre volumes dans la Pléiade », c’est trop pour ses nerfs. D’une
façon quelque peu lourde, et afin que nul n’en ignore, il l’énonce dès le
sous-titre de son ouvrage : D’une gêne persistante à l’égard de la
fascination exercée par Louis Destouches sur papier bible. Il y revient
plusieurs fois, il s’en plaint amèrement : « Céline, Maître penseur
aigri de notre fin de siècle, Céline sur papier bible. » « Le
consensus est désormais de son côté. Il est sur papier bible. Il est au
programme de l’agrégation. » Nous voilà prévenus, on ne fera pas de
cadeaux. Le temps est révolu où on pouvait prétendre lire encore Céline, et le
commenter, et le critiquer. Il convient maintenant de l’instruire en
bloc. Comme une cause jugée d’avance. Comme une affaire de droit commun.
L’inquisiteur moderne est au travail : regardons-le donc exercer son
pouvoir. Et tentons de comprendre au nom de quoi il juge. L’intelligence de la
société hyperfestive est le commencement de sa critique.
Les attaques de Bounan et de Martin
ne relèvent pas de l’histoire des idées ; elles ressortissent pleinement
de la post-histoire des loisirs et de la propagande qui les accompagne. La
morale, au même titre que la culture et le tourisme, offre un certain nombre de
débouchés compensatoires que le monde ancien du labeur ne procure plus. Bounan
et Martin sont des employés de l’Espace Bien. Ils n’analysent pas
Céline ; ils confessent en long et en large une foi antiraciste dont on ne
peut que les féliciter, ainsi que le désir de liquider un problème qui leur
paraît un scandale, et une survivance abominable en nos temps rénovés. Ils ne
veulent plus voir le problème puisqu’ils connaissent la solution. Ils n’ont pas
de questions à poser puisqu’ils disposent des réponses. Ils ne questionnent pas
Céline, ils le mettent à la question. La bataille qu’ils engagent ne vise pas à
éclairer d’une façon nouvelle les livres de leur bête noire, elle a pour
objectif de les disqualifier. Il ne faut pas que Céline soit seulement
responsable des crimes qu’il a commis. Il faut enfin qu’intégralement il soit
accusé. Et de naissance, comme on le verra.
D’où le recours à des inventions ou
des exagérations qui ne tendent qu’à sur-accabler un inculpé jugé d’avance. Ce
n’est pas assez que Bagatelles existe, comme un crime ineffaçable ;
il faut dénicher encore d’autres forfaitures ; ou supposer à celles que
l’on connaît d’autres motifs que ceux qui tombent sous le sens. il est
d’ailleurs curieux de noter que les anticéliniens en viennent assez vite à
l’accumulation de griefs imaginaires, comme si ceux que l’on sait ne
suffisaient pas. Parce que ceux que l’on sait ne leur suffisent pas à eux.
Sartre fut un pionnier dans cette voie, avec sa phrase célèbre, véritable
chef-d’œuvre dans la recherche de causalité postiche à l’ignominie évidente des
pamphlets : « Si Céline a pu soutenir les thèses socialistes des
nazis, c’est qu’il était payé. » La pratique de la calomnie surajoutée n’a
guère entravé, jusqu’ici, le célinophobe de bonne volonté. Elle le gêne moins
que jamais dans la mesure où la réalité n’existe plus. La vieille critique
marxiste reprochait à la religion d’offrir aux hommes un bonheur illusoire, et
se proposait de détruire cette illusion au profit d’un bonheur réel. Mais le
réel, aujourd’hui, n’est plus une valeur sûre. Il doit donc sans cesse être
restauré par quelque chose dont on peut conclure rapidement qu’il tient du
conte de fées, c’est-à-dire de quelque chose qui, pas davantage que les
miracles ou les prodiges, ne se conteste. Or, dans les contes de fées, il faut
des sorcières.
Ce n’est donc pas un écrivain, et
encore moins un romancier, dont nous entretiennent Martin et Bounan ;
c’est un criminel perpétuel, dont la criminalité est homogène dans toutes ses
manifestations. Loin de décomposer l’« objet » Céline, et de tenter
de conceptualiser ses parties, Bounan et Martin les ré-amalgament. Ils
réunifient cette œuvre disloquée par l’Histoire en général et par le délire de
son auteur en particulier. Ils ne veulent voir qu’une seule tête de Turc. Leur
éthique totalisante et unitariste exige un objet d’exécration totalement
cohérent. La division, les incompatibilités qui cohabitent, leur apparaissent
comme des trahisons par rapport à la communauté ; par rapport à eux, qui
ne sont personne que le commun. L’ambiguïté n’est pas leur fort. Ils
s’éclairent aux slogans comme jadis à la chandelle. Cette stéréotypisation en
rappelle bien d’autres. Elle se produit sans doute par mimétisme avec ce qu’ils
ont décidé de nous faire savoir qu’ils ne pouvaient plus du tout supporter.
Le rejet de Céline m’est toujours
apparu comme un droit imprescriptible. On ne peut contraindre personne à lire
ses livres, encore moins les aimer, et même pas le seul Voyage. Son art
ne le disculpe de rien. Ses romans ne sauraient excuser ses pamphlets. Nul ne
peut prétendre fermer les yeux sur L’École des cadavres pour jouir en
paix de Mort à crédit. On peut, en revanche, éviter de dire n’importe
quoi, et, pour commencer, qu’il y aurait des masses de choses cachées qu’il
conviendrait aujourd’hui de dévoiler. On voit mal en quoi, par-dessus le
marché, l’immoralisme de certains œuvres rend plus supportable le déferlement
de la moralité. Que le vice soit blâmable ne fait pas la vertu plus drôle ni
plus sacrée. Les fautes de Céline, et les pires de ses crimes, sont connus
depuis près de soixante ans. Il n’y a rien à soupçonner chez lui puisque
sa culpabilité a été publiée dans son intégralité. Céline n’est pas un faux
innocent qu’il serait urgent de démasquer. C’est un vrai coupable. On ment
quand on affirme apporter du nouveau réellement nouveau à propos de cette
culpabilité.
À la lettre, les libelles de Bounan
et Martin sont des entreprises d’intoxication par lequelles on prétend
désintoxiquer le lecteur naïf qui n’aurait jamais rien su de l’infamie
célinienne, et c’est bien ainsi que cette double offensive a été saluée :
« Il y a, en France, un gros non-dit autour de Céline » (Gilles
Tordjman dans Les Inrockuptibles). « Voilà Céline remis à sa place.
Ceux que bouleversent ses livres ne pourront plus l’ignorer » (Grégoire
Bouiller, Le Monde). « Deux ouvrages viennent d’établir la vérité
sous les masques si convenus » (Alain Suied, Le Mensuel littéraire et
poétique). Ayant constitué en axiome un aveuglement général qui n’a jamais
existé, Bounan et Martin peuvent bonimenter à leur aise. Sans ce bluff du
scoop, leurs livres n’auraient même pas lieu d’exister. Et leurs auteurs
n’auraient pu se décerner, en les écrivant, de si précieuses brevets de
néo-bien-pensance.
Je ne m’attarderai pas sur les
critiques obscures de M. Martin concernant mon propre Céline. Je ne sais
pas, au juste, pourquoi ce Martin me cherche ; et de toute façon je ne
perdrai pas mon temps à défendre un ouvrage déjà vieux de dix-sept ans et que
je ne pourrais qu’aggraver si je le réécrivais. Je ne vais pas non plus prendre
la défense des romans de Céline, ils le font tout seuls et ils le font très
bien¹. Il me paraît d’ailleurs hors de question de discuter de Céline, au
fond du fond, avec un Bounan ou avec un Martin. Le problème des liens
effectifs entre les romans et les pamphlets, entre la vision qui se dégage de
ceux-ci et ce que nous apprennent ceux-là, est un peu trop complexe pour qu’on
en délibère avec des lascars qui voudraient nous faire croire qu’ils sont les
premiers à ne pas considérer les pamphlets comme un « bloc à part »
(Martin). Si rien de ce qu’ils ont publié ne nous informe sur Céline, tout, en
revanche, dans leur prose, nous renseigne sur notre époque. Leurs livres n’ont
pas à être contestés ; on ne peut que les commenter en vrac. Au surplus,
ces littérateurs vont si bien ensemble que je les évoquerai comme ils
m’apparaissent, à la façon des duettistes venant pousser leur chansonnette sur
le Théâtre des Droits de l’homme, où ne cessent d’être jugés et rejugés les
forfaits du passé, et le passé en tant que forfait. Pourquoi mériteraient-ils
un plus grand respect ? Il ne semble jamais venir à l’esprit du Docteur Bounan
et de Mister Martin qu’un roman ait pu, en des temps reculés, être autre chose
qu’une manifestation de solidarité avec les plus démunis. De même ne
paraissent-ils comprendre les œuvres que dans la mesure où ils peuvent croire
qu’elles adhèrent ou militent. De ce fait, les arcanes de l’histoire récente,
c’est-à-dire l’étendue des dégâts causés par l’évaluation morale des choses et
l’élimination de toute vision critique, leur échappent fatalement. En moins de
deux générations, notait un employé de Libération juste après la mort de
William Burroughs (mais sans avoir bien sûr, lui non plus, les moyens
d’examiner le lièvre qu’il était en train de soulever), ce sont certaines des
caractéristiques les plus « marginalisantes » de la personnalité de
cet écrivain (le fait, tout simplement, qu’il était drogué et homosexuel) qui
lui ont permis « d’intégrer le panthéon de la political
correctness ». C’est aussi à la faveur de cette mutation qu’est
apparue une nouvelle classe étrange, mais parfaitement logique, d’opposants
rituels et officiels : organisateurs de subversion, mécontents appointés,
salariés dans la branche rébellion de l’Institution, panégyristes de la
guérilla qui décoiffe, révoltés connivents, scouts de l’émeute, Fripounets des
barricades et Marisettes du Grand Soir. Autant de personnages inédits dont
notre excellent Bounan et notre magnifique Martin n’ont pas la moindre idée
puisque, d’une façon ou d’une autre, en tout ou partie, ils les incarnent.
Philippe MURAY
1. L’une des plus belles apologies récentes de Voyage au bout de la nuit a été composée il y a une dizaine d’années par Allan Bloom dans L’Âme désarmée : « Le seul écrivain qui n’exerce aucune espèce de séduction sur les Américains, qui n’offre aucune prise au charcutage de nos critiques marxistes, freudiens, féministes, déconstructionnistes ou structuralistes, qui ne propose à nos jeunes gens ni pose, ni sentimentalité, ni soporifiques, est justement celui qui a le mieux exprimé la façon dont la vie se présente à un homme prêt à s’interroger courageusement sur ce que nous croyons et ce que nous ne croyons pas : Louis-Ferdinand Céline. C’est un artiste beaucoup plus doué et un observateur beaucoup plus perspicace que Thomas Mann ou Albert Camus, pourtant bien plus célèbres que lui. Robinson, l’homme qu’admire Bardamu dans Voyage au bout de la nuit, est un égoïste, un menteur, un truqueur et un tueur à gages. Alors pourquoi l’admire-t-il ? En partie pour son honnêteté, mais surtout parce qu’il préfère se laisser tuer par sa maîtresse que de lui dire qu’il l’aime. Il croyait en quelque chose, ce dont Bardamu est incapable. Les étudiants américains sont rebutés et horrifiés par ce roman ; ils s’en détournent avec dégoût. Mais si on pouvait le leur ingurgiter de force, cela pourrait les inciter à reconsidérer bien des choses, à admettre qu’il serait urgent de repenser leurs prémisses, à expliciter leur nihilisme implicite et à l’examiner sérieusement. Si je cherche une image de notre condition intellectuelle actuelle, je ne puis m’empêcher d’évoquer les bandes d’actualités cinématographiques qui nous ont montré les Français s’éclaboussant joyeusement sur une plage, lors des premiers congés payés décrétés par le gouvernement de Front populaire de Léon Blum. Cela se passait en 1936, l’année où l’on a laissé Hitler réoccuper la Rhénanie. Tous nos grands thèmes se trouvent évoqués dans l’image de ces congés payés.»