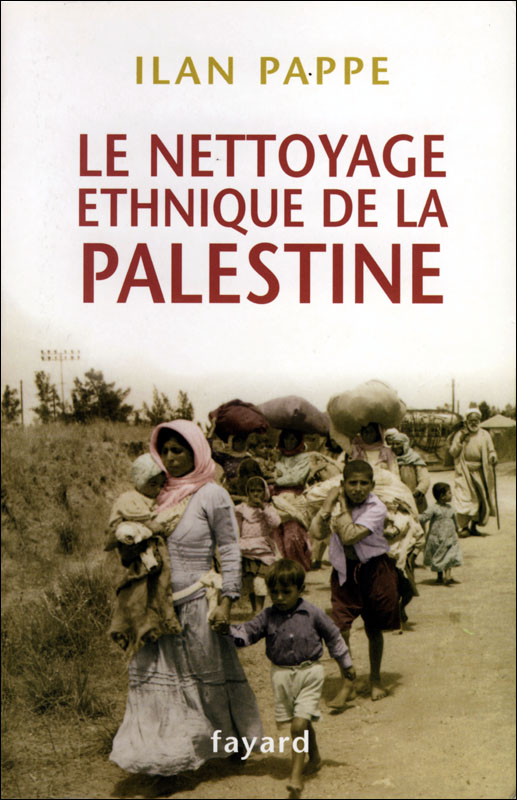← Accueil
|
Le
Nettoyage ethnique de la Palestine
Ilan Pappé
PRÉFACE
Nous ne pleurons pas l’adieu
Nous n’avons pas le temps ni les larmes
Nous ne comprenons pas l’instant de l’adieu
Pourquoi c’est l’Adieu Et il nous reste les larmes
Muhammad Ali Taha (1988),
réfugié du village de Saffuriya.
Je suis pour le transfert forcé. Je ne vois rien là d’immoral.
David Ben Gourion à l’Exécutif
de l’Agence juive, juin 1938.
La « Maison rouge » était un bâtiment typique
des premiers temps de Tel-Aviv. Elle faisait l’orgueil des maçons et artisans
juifs qui l’avaient construite dans les années 1920 pour être le siège de
l’union locale du syndicat ouvrier. Elle a servi à cela jusqu’au jour, vers la
fin de l’année 1947, où elle est devenue le quartier général de
Aujourd’hui
Dans cette maison, par un froid mercredi après-midi,
celui du 10 mars 1948, onze hommes, vieux dirigeants sionistes et jeunes
officiers juifs, ont mis la dernière main à un plan de nettoyage ethnique de
Comme tenteront de le montrer les premiers chapitres de ce livre, ce plan était à la fois l’inévitable produit de la volonté idéologique du sionisme d’avoir une population exclusivement juive en Palestine et une réaction à la situation sur le terrain après la décision du cabinet britannique de mettre fin au Mandat. Les heurts avec les milices locales palestiniennes créaient le contexte et le prétexte parfaits pour concrétiser la vision idéologique d’une Palestine ethniquement homogène. La politique sioniste s’est d’abord fondée, en février 1947, sur une logique de représailles contre les attaques palestiniennes ; puis, en mars 1948, elle a pris l’initiative d’un nettoyage ethnique à l’échelle du pays’.
Une fois la décision prise, il a fallu six mois pour l’appliquer. Quand tout a été fini, près de 800 000 personnes — plus de la moitié de la population indigène de Palestine — avaient été déracinées, 531 villages détruits, 11 quartiers vidés de leurs habitants. Le plan décidé le 10 mars 1948 et surtout sa mise en œuvre systématique au cours des mois suivants ont été un cas clair et net de ce « nettoyage ethnique » que le droit international actuel considère comme un crime contre l’humanité.
Après l’Holocauste, il est devenu pratiquement impossible
de dissimuler des crimes contre l’humanité à grande échelle. Dans notre monde
moderne mené par la communication, notamment depuis l’essor des médias
électroniques, on ne peut plus nier ou cacher à l’opinion publique les
catastrophes créées par l’homme. Un de ces crimes, pourtant, a été presque entièrement
effacé de la mémoire publique mondiale : la spoliation des Palestiniens
par Israël en 1948. Cet
événement, le plus fondamental de l’histoire moderne de
Le nettoyage ethnique est un crime contre l’humanité. Aujourd’hui, ceux qui le commettent sont considérés comme des criminels, à traduire devant des tribunaux spéciaux. Peut-être est-il difficile de dire comment il faudrait qualifier ou traiter, sur le plan du droit, les initiateurs et les exécutants du nettoyage ethnique de 1948 en Palestine, mais il est possible de reconstituer leurs crimes, et de parvenir ainsi à un récit historique plus exact que ceux qui ont été élaborés jusqu’à présent, et à une position morale plus juste.
Nous savons comment s’appelaient ceux qui étaient assis
dans cette pièce, au dernier étage de
Pour les Palestiniens et pour tous ceux qui ont refusé de croire au récit sioniste, il était clair bien avant la rédaction de ce livre que ces personnages avaient commis des crimes, mais qu’ils avaient réussi à échapper à la justice et ne seraient probablement jamais jugés. Pour les Palestiniens, outre leur traumatisme, la frustration la plus profonde a été de voir constamment, depuis 1948, le comportement criminel de ces hommes si radicalement nié et la souffrance palestinienne si totalement ignorée.
Il y a une trentaine d’années, les victimes du nettoyage
ethnique ont commencé à reconstituer le panorama historique que le récit
officiel israélien de 1948 avait tout fait pour dissimuler et pour déformer. Le
conte qu’avait concocté l’historiographie sioniste parlait d’un
« transfert volontaire » massif de centaines de milliers de
Palestiniens : ils auraient décidé de quitter momentanément leurs maisons
et leurs villages pour laisser le terrain aux armées d’invasion arabes venues
détruire l’État juif naissant. Dans les années 1970, en rassemblant des
souvenirs et des documents authentiques sur ce qui était arrivé à leur peuple,
des historiens palestiniens, dont le plus éminent est Walid Khalidi,
ont réussi à retrouver une large part de ce qu’Israël avait tenté d’effacer.
Ils ont vite été rejetés dans l’ombre par des ouvrages comme Genesis 1948, de Dan Kurzman, paru en 1970 et
réédité en 1992 (avec une introduction de l’un des exécutants du nettoyage
ethnique de
L’entrée en scène, dans les années 1980, de la
« nouvelle histoire » en Israël aurait pu être une percée politique
dans la bataille de la mémoire en Palestine : un petit groupe d’historiens
israéliens ont tenté de réviser le récit sioniste de la guerre de 1948. J’en
faisais partie, mais nous, les « nouveaux historiens », n’avons
jamais beaucoup contribué à la lutte contre la négation de
L’historien israélien Benny Morris a été l’un des auteurs les plus en vue sur le sujet. Comme il s’est exclusivement fondé sur les documents des archives militaires, il a abouti à un tableau très partiel de ce qui s’était passé sur le terrain. Mais ce résultat a été suffisant pour faire comprendre l’essentiel à certains de ses lecteurs israéliens la « fuite volontaire » des Palestiniens était un mythe, et l’image qu’avaient d’eux-mêmes les Israéliens (persuadés d’avoir fait en 1948 /14/ une guerre « juste » à un monde arabe hostile et « primitif ») était considérablement compromise et peut-être déjà condamnée.
Le tableau était partiel parce que Morris a pris au pied de la lettre, voire considéré comme vérité absolue, les rapports militaires israéliens qu’il a trouvés dans les archives. Il a donc ignoré des atrocités comme l’empoisonnement (le l’alimentation en eau d’Acre par la typhoïde, de nombreux cas de viol et les dizaines de massacres perpétrés par des soldats juifs. Il n’a cessé aussi de soutenir — à tort — qu’avant le 15 mai 1948 il n’y avait pas eu d’évacuations forcées. Les sources palestiniennes montrent clairement que, plusieurs mois avant l’entrée des troupes arabes en Palestine et à une époque où les Britanniques étaient encore responsables du maintien de l’ordre dans le pays — donc avant le 15 mai —, les forces juives avaient déjà réussi à expulser par la violence près de 250 000 Palestiniensl. Si Morris et les autres historiens avaient exploité les sources arabes ou s’étaient tournés vers l’histoire orale, ils auraient peut-être mieux compris la planification systématique à l’oeuvre derrière l’expulsion des Palestiniens en 1948, et décrit en termes plus véridiques l’énormité des crimes commis par les soldats israéliens.
Il aurait été nécessaire à l’époque, et il l’est toujours aujourd’hui, tant historiquement que politiquement, d’aller plus loin que le type de récit donné par Morris. Pas seulement pour achever le tableau (en donner, en fait, la seconde moitié), mais aussi pour une autre raison, infiniment plus importante : parce que nous n’avons aucun autre moyen de comprendre pleinement les racines du conflit israélo-palestinien actuel. Et surtout, bien sûr, parce que poursuivre la lutte contre la négation du crime est un impératif moral. Aller plus loin, d’autres avaient déjà commencé à le faire. L’ouvrage le plus important, comme on pouvait s’y attendre au vu de ses contributions antérieures, a été le livre fondateur de Walid Khalidi, All That Remains. C’est un almanach des villages détruits, qui demeure un guide essentiel pour qui veut mesurer l’ampleur de la catastrophe de 1948.
L’histoire déjà exposée, dira-t-on peut-être, aurait dû suffire à susciter des interrogations troublantes. Mais le récit de la « nouvelle histoire » et les apports de l’historiographie palestinienne récente n’ont pas réussi à percer dans l’espace public de la conscience et de /14/ l’action. Dans ce livre, je voudrais explorer à la fois le mécanisme du nettoyage ethnique de 1948 et le système cognitif qui a permis au monde d’oublier et aux perpétrateurs de nier le crime commis par le mouvement sioniste contre le peuple palestinien en 1948.
Autrement dit, je veux plaider pour une refondation de la
recherche historique et du débat public sur 1948 : le paradigme du nettoyage ethnique
doit remplacer celui de la guerre. Je suis certain que l’absence du premier
explique en partie pourquoi la négation de la catastrophe a pu se perpétuer si
longtemps. Quand il
a créé son État-nation, le mouvement sioniste n’a pas
fait une guerre dont la conséquence « tragique mais inévitable » a
été l’expulsion d’une « partie » de la population indigène. C’est le
contraire. L’objectif premier était le nettoyage ethnique de l’ensemble de
Aux yeux de certains, cette approche — faire du paradigme du nettoyage ethnique le fondement a priori du récit de 1948 — paraîtra d’emblée une inculpation. À bien des égards, effectivement, c’est mon J’accuse contre les dirigeants politiques qui ont conçu le nettoyage ethnique et les généraux qui l’ont exécuté. Cela dit, si je les désigne nommément, ce n’est pas parce que je souhaite qu’on les juge à titre posthume, mais c’est pour humaniser les persécuteurs autant que les victimes : je ne veux pas que les crimes commis par Israël soient attribués à des facteurs insaisissables, aux « circonstances », à l’« armée », que l’on dise comme Morris « à la guerre comme à la guerre* », ou autres formulations floues qui dédouanent les États souverains et permettent aux individus d’échapper à la justice. J’accuse, mais j’appartiens aussi à la société qui est condamnée dans ce livre. Je me sens à la fois responsable et élément de cette histoire, et, comme d’autres membres de ma société, je suis /16/ convaincu — mes dernières pages le montreront — que ce douloureux voyage dans le passé est le seul chemin qui peut permettre d’avancer vers un avenir meilleur pour nous tous, Palestiniens et Israéliens. Parce qu’au plus profond, c’est de cela qu’il s’agit dans ce livre.
* En français dans le
texte. (Toutes les notes de bas de page sont du traducteur.)
Je ne crois pas que quiconque ait déjà tenté cette
démarche. Les deux récits
historiques officiels rivaux sur ce qui s’est passé en Palestine en 1948
ignorent l’un et l’autre le concept de nettoyage ethnique. Si la version
sioniste/israélienne affirme que la population locale est partie
« volontairement », les Palestiniens parlent de la
« catastrophe », la « Nakba »,
qui leur est tombée dessus — ce qui est aussi, en un sens, un terme fuyant,
puisqu’il renvoie au désastre lui-même sans dire qui ou ce qui l’a provoqué.
Le mot Nakba a été adopté, pour des raisons
compréhensibles, afin de tenter de contrer le poids moral de
Le livre s’ouvre sur une définition du nettoyage ethnique que j’espère assez transparente pour être acceptable par tous : c’est celle qui a servi de base aux actions judiciaires contre les auteurs de ce type de crime dans le passé et aujourd’hui. Étonnamment, le discours juridique, habituellement complexe et impénétrable pour la plupart des mortels ordinaires, s’exprime ici en langage clair et sans jargon. Cette simplicité n’amoindrit pas l’horreur du crime, ne nie pas sa gravité : elle décrit sans détour une politique odieuse que la communauté internationale juge aujourd’hui impardonnable.
La définition générale du nettoyage ethnique s’applique
presque mot pour mot au cas de
Mais l’histoire de 1948 n’a évidemment rien de complexe,
et ce livre s’adresse autant aux néophytes qu’à ceux qui, depuis des années et
pour diverses raisons, s’intéressent déjà à la question de