La Monnaie entre violence et confiance
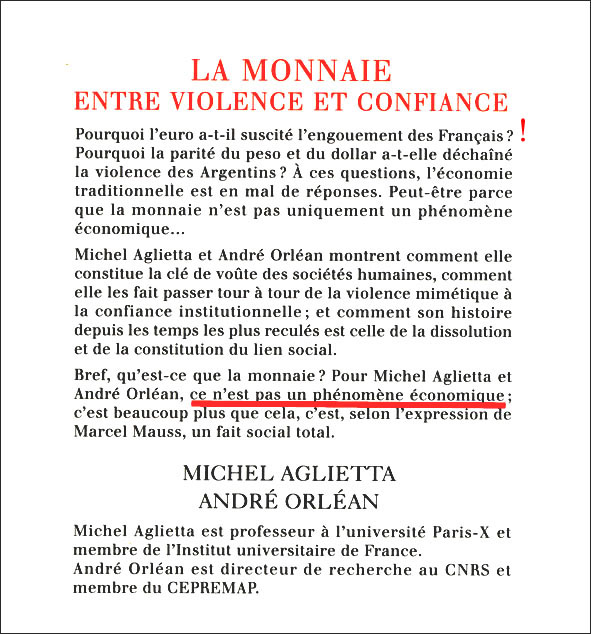
Chapitre II
MARCHANDISE ET MONNAIE :
L’HYPOTHÈSE MIMÉTIQUE
/35/ L’analyse que ce livre
cherche à développer part de l’hypothèse qu’il n’est d’économie marchande
[de société marchande]
que monétaire. Nous voulons dire par là que tout rapport marchand, même dans sa
forme la plus élémentaire, suppose l’existence préalable de monnaie. Ou bien
encore, d’une manière plus concise et directe, le rapport marchand est toujours
un rapport monétaire. C’est ce que nous appellerons dorénavant
« l’hypothèse monétaire. » Dans le chapitre précédent, nous avons
déjà eu l’occasion de souligner l’importance de cette hypothèse en faisant
valoir a contrario les impasses auxquelles conduisent nécessairement les
approches concurrentes, à savoir celles qui pensent l’échange hors de la
monnaie en se fondant pour cela sur le concept de valeur. Si l’hypothèse
monétaire reste ultraminoritaire chez les économistes contemporains, on trouve
cependant aujourd’hui d’importants économistes hétérodoxes pour la prendre au
sérieux. Nous pensons tout particulièrement aux travaux de Carlo Benetti et
Jean Cartelier que nous avons déjà eu l’occasion de discuter au chapitre
précédent. Leur approche axiomatisée est fort élégante.
Considérant que la
monnaie est première dans l’ordre économique conformément à l’hypothèse
monétaire, et qu’il n’appartient pas à la discipline économique d’en penser la
genèse, ils sont conduits fort logiquement à en faire le postulat de base de
leur construction. Un tel point de vue nécessite au préalable que soit défini
avec précision ce qu’on entend exactement par monnaie. Il faut en caractériser
les traits essentiels. C’est ce travail d’explicitation qui les a conduits au
concept de « système de paiement . » Une fois l’institution monétaire
décrite convenablement, il est alors possible /36/ d’analyser la
manière dont une économie monétaire [société monétaire = société marchande] se comporte.
La monnaie est-elle une forme socialement efficace ? En quel sens ?
En quoi les actions individuelles qu’autorise ce rapport social
conduisent-elles ou non au plein emploi ? Voilà quelques-unes des
innombrables questions qu’il s’agit d’étudier. Autrement dit, pour eux, nul
besoin de chercher à comprendre ce qu’il y a « derrière la monnaie ».
Ce n’est pas du ressort de l’économiste. La monnaie est une donnée
institutionnelle de base, celle qui définit le domaine d’analyse de
l’économiste. Elle n’est rien d’autre que le nom qu’on donne à la règle du jeu
social que jouent les acteurs économiques. Comme l’écrit Jean Cartelier :
« La monnaie ne saurait être un résultat de la théorie, puisqu’elle est
une donnée initiale. »
Il nous semble cependant qu’on doit aller plus loin. On s’en
est longuement expliqué dans le chapitre précédent. Identifier la monnaie à une
institution dont les traits constitutifs sont fixés ex ante, a pour conséquence de rejeter hors de l’analyse
toute dynamique portant sur la monnaie elle-même. Or, l’observation dément la
pertinence d’un tel rejet. Dans la réalité des économies marchandes [des sociétés marchandes], la
monnaie est en perpétuelle mutation et les évolutions endogènes qu’elle connaît
sont un aspect fondamental de la manière dont ces économies [ces sociétés] s’adaptent et se
transforment. Il convient d’analyser avec soin ces adaptations et ces
transformations, faute de quoi notre compréhension de l’ordre marchand
resterait parcellaire. Or, cela, l’argumentation théorique de Benetti et
Cartelier se l’interdit par construction au motif que l’émergence de la monnaie
n’appartient pas au domaine de l’économiste car elle renvoie à des forces
sociales composites, en rien réductibles à la seule économie [c’est à dire à rien]. Notre
point de vue est différent. Selon nous, on ne doit pas confondre la question de
l’apparition de la monnaie au sein de sociétés qui en sont dépourvues et celle
des mutations endogènes que connaissent perpétuellement les sociétés
monétaires. Si la question de l’émergence historique peut à bon droit être
considérée comme dépassant le cadre strict de l’économie, il en est tout
autrement des évolutions endogènes que connaît la monnaie au sein des économies
[sociétés] marchandes
constituées. Dans cette dernière situation, il s’agit de penser la manière dont
le rapport monétaire évolue spontanément pour répondre aux défis du moment.
Cette évolution doit être considérée comme un élément clef de l’autorégulation
de ces sociétés. Il s’ensuit que l’approche monétaire, si elle doit partir de
la monnaie, ne saurait se la donner sous la forme d’une institution achevée.
Aucune monnaie n’est définitivement instituée. Constamment surgissent /37/
de nouveaux prétendants qui remettent en cause sa primauté. Telle est notre
thèse fondamentale.
L’ambition de ce livre étant de rendre intelligible l’institutionnalisation des monnaies comme leur dépérissement, il nous faut donc abandonner les hypothèses de Benetti et Cartelier et construire un nouveau point de départ. Cet invariant à partir duquel nous proposerons de penser la logique d’évolution des systèmes monétaires, ce sera la concurrence des monnaies. Le chapitre V en proposera une analyse précise. Ce faisant, il s’agit de souligner que l’unification monétaire n’est jamais acquise. Il en est ainsi parce que les rivalités concurrentielles ne se cantonnent ni à la sphère des marchandises, ni à celle des actifs financiers. Elles prennent également pour cible les conditions d’accès à la monnaie qu’elles cherchent à transformer au mieux des intérêts des uns et des autres. Avec l’hypothèse de concurrence des monnaies, notre conception d’un rapport monétaire toujours en devenir, jamais assuré de sa légitimité, trouvera son expression la plus achevée. La concurrence peut être si intense qu’elle conduit à l’éviction de la monnaie ancienne et à son remplacement par une nouvelle monnaie, comme ce fut le cas en Allemagne en novembre 1923 lorsque le rentenmark succéda au mark.
Sauf à voir dans ces phénomènes l’expression de ruptures
radicales dans les principes mêmes de fonctionnement des économies [sociétés] considérées, il nous
faut bien considérer que, par-delà ces mutations, se perpétue une même
structure formelle des rapports sociaux dont il convient alors d’élucider le
contenu. Autrement dit, il nous faut expliciter ce que nous entendons par
monnaie et de quelle manière s’impose son inachèvement. C’est l’objet du
présent chapitre. À partir de ces données premières, il nous sera possible de
penser les transformations monétaires comme des évolutions endogènes à travers
lesquelles se trouve exprimée l’essence même du rapport monétaire. Il est vrai,
et cela justifie partiellement la prudence de Benetti et Cartelier, que penser
ces transformations institutionnelles oblige à sortir d’une conception étroite
de l’économie.
Pour mener à bien cet objectif, dans une première partie intitulée « L’échange marchand », nous commencerons par définir la nature du rapport marchand et de la marchandise. Pour ce faire, nous mobiliserons d’importants travaux anthropologiques qui nous permettront de faire apparaître pleinement la spécificité de ces relations sociales. Ce sera l’occasion de souligner l’importance que jouent les valeurs individualistes dans la constitution de la société /38/ marchande. À l’issue de cette réflexion, le rapport marchand apparaîtra comme un rapport social paradoxal au sens où il a pour finalité de séparer les individus. C’est là une conséquence de la primauté des relations aux choses sur les relations entre individus.
La deuxième partie est consacrée à la construction logique de la monnaie. Pour ce faire, on part du rapport de séparation tel qu’il a été analysé dans la partie précédente. Parce que la séparation marchande soumet brutalement tous les sociétaires à la loi de la rareté sans filets de sécurité pour les protéger des errements du sort, elle provoque une fragilité extrême des situations individuelles. Cette précarité des positions si caractéristique de la société moderne donne naissance à un besoin spécifique de protection ou d’assurance, ce que nous appellerons le « besoin de richesse. » Autrement dit, dans notre perspective la « richesse » est définie comme ce qui permet de se protéger de l’incertitude marchande. Sur ce point, notre démarche est très proche de celle que développe John Maynard Keynes, par exemple lorsqu’il analyse la crainte des acteurs économiques à l’égard d’un futur imprévisible, crainte qui les conduit à rechercher la liquidité’. Notre démarche ne s’affirme véritablement originale que lorsqu’elle en vient à l’analyse proprement dite de la richesse. Il s’agit de rompre avec les conceptions issues des théories de la valeur pour penser la richesse comme étant de nature essentiellement, conventionnelle : la richesse est ce qui est désiré par tous les membres du groupe. C’est là une définition « autoréférentielle » puisque est richesse ce que tous considèrent comme étant richesse. On peut soutenir que Keynes n’est pas loin de partager cette analyse lorsqu’il insiste sur le caractère conventionnel de la monnaie. Cependant, faute d’une théorie adéquate, ces idées sont restées floues. Il était nécessaire d’en proposer une formalisation rigoureuse. Avec la théorie girardienne de l’imitation, il nous a semblé trouver un cadre d’analyse adéquat permettant de mener à bien cette modélisation. En effet, puisque désirer la richesse, c’est désirer ce que les autres désirent, le mimétisme s’impose comme le comportement rationnel adapté à cette configuration spécifique. À partir de cette hypothèse, on a pu construire un modèle de concurrence mimétique. Le résultat essentiel auquel il nous a conduits est que la recherche mimétique de la richesse par tous les agents débouche nécessairement sur la focalisation de tous les désirs de richesse sur un même bien. Cette polarisation unanime a pour conséquence de transformer radicalement la nature du bien élu le mettant à distance des individus. Ce qui n’était qu’une /39/ forme privée et provisoire de la richesse, acquiert désormais une légitimité sociale et voit ses propriétés stabilisées. On reconnaîtra dans ce processus d’élection-exclusion, si caractéristique de la pensée girardienne, le processus même de formation de la monnaie. Au terme de ce processus mimétique, la monnaie apparaît comme l’institution qui donne forme à la séparation marchande. Elle est monnaie par la grâce de la polarisation mimétique.
* * *
/59/ L’incertitude
et la rareté
Dans
une économie [une
société] fondée sur
la séparation, chacun dépend des autres et du groupe d’une manière totalement
opaque puisque l’action collective s’y construit comme le résultat non
intentionnel, non programmé ni encadré, du libre choix de tous. C’est
cette même idée fondamentale qu’on trouve chez Marx lorsqu’il parle d’« anarchie marchande »
pour qualifier le fait que la production y est la conséquence imprévisible d’une multitude de décisions
indépendantes. La société marchande est, pour cette raison, une société
de l’opacité radicale et de l’imprévu. Le social s’y livre aux agents toujours a posteriori comme un fait brutal
et inattendu. Pour
désigner cette dimension fondamentale de la séparation, on parlera
d’incertitude. Les effets de cette incertitude sont d’autant plus
dévastateurs que la société marchande ne connaît pas ces mécanismes d’assurance
contre le risque que sont les liens de solidarité existant entre /60/ parents, voisins
ou proches, grâce auxquels, dans les sociétés traditionnelles, chacun peut
mobiliser l’assistance des autres en cas de mauvaise fortune. Tout au
contraire, le rapport
marchand est un rapport d’une extrême brutalité. L’incertitude s’impose
aux hommes sans appel car rien n’est à attendre des autres pour en adoucir la
sentence. Ce sont les objets qui dictent leur loi aux individus et cette loi,
c’est la rareté. Par exemple, les modifications imprévues que connaît
périodiquement la consommation font que certains produits cessent soudainement
d’être demandés, ce qui va entraîner de nombreuses difficultés pour les
producteurs concernés. Il en est de même en tous domaines car les goûts, les
techniques et les ressources disponibles se transforment de manière incessante
sous l’action même de la concurrence. Les acteurs économiques ne prennent
connaissance de ces transformations qu’ex post. Il
s’ensuit chez tous les sociétaires un sentiment de profonde angoisse puisque
l’existence sociale et même physique de chacun se trouve alors mise en jeu.
C’est ainsi que la rareté s’impose à tous et modèle la mentalité
marchande. [La rareté est
un résultat permanent (avant, il n’y avait que des famines épisodiques). C’est
le trou du cul Malthus, qui au moins était lucide, et ses condisciples qui ont
sciemment organisé la rareté comme famine permanente : « La faim les
poussera vers la fabrique. »]
Il faut bien comprendre que, la rareté n’est aucunement une donnée naturelle [La rareté est un résultat] qu’on pourrait mesurer à l’aide d’indicateurs objectifs comme, par exemple, le niveau de vie moyen de la population considérée. De même, on commettrait une méprise totale en disant que plus une société est prospère, moins la rareté y est présente. Il en est tout autrement [c’est le contraire]. La rareté désigne une forme d’organisation spécifique, instituée par le marché, qui fait dépendre, dans des proportions inconnues des autres sociétés, l’existence de chacun de sa seule capacité à acquérir des objets sans qu’il puisse attendre un secours d’autrui [Bravo !]. Apparaît ici le fait que la liberté et l’indépendance par rapport aux autres qu’institue si puissamment la séparation marchande peut tout aussi bien prendre la forme de la solitude et de l’exclusion. Le manque, la pénurie ou la famine pour certains alors que d’autres bénéficient de plus qu’ils n’ont besoin, loin d’être considérés comme des scandales, y sont analysés comme l’expression de régulations sociales tout à fait légitimes. C’est une réalité profondément étonnante, et même scandaleuse, aux yeux des peuples antérieurs, habitués à valoriser l’identité sociale des êtres.
Marshall-Salalins le décrit merveilleusement dans un ouvrage admirable. Étudiant les peuples de chasseurs-cueilleurs, c’est-à-dire une des sociétés les plus anciennes du globe puisqu’elle remonte au paléolithique, il montre que ces sociétés, paradoxalement, connaissent l’abondance. Certes le niveau de vie y est très /61/ modeste mais personne n’y meurt de faim, car la coutume du partage et de l’entraide y domine la vie sociale. Dans ces sociétés, « aucune relation entre l’accumulation de biens matériels et le statut social n’a été instituée ». On peut même dire que toute l’organisation communautaire vise à « limiter la propriété des biens matériels ». C’est dans nos sociétés que la rareté s’impose comme une puissance autonome [Bravo !], sans appel, qui règle la vie des individus, sans considération pour leur dignité sociale :
« C’est nous et nous seuls qui avons été condamnés aux travaux forcés à perpétuité. La rareté est la sentence portée par notre économie et c’est aussi l’axiome de notre économie politique... L’homo œconomicus est une invention bourgeoise ; il n’est pas derrière nous, disait Mauss, mais devant nous comme l’homme moral. Les chasseurs-collecteurs n’ont pas bridé leurs instincts matérialistes ; ils n’en ont simplement pas fait une institution. »
Cette pression de la rareté pèse sur nos épaules. Elle hante nos esprits. Elle trouve une première expression dans les luttes concurrentielles auxquelles la course aux objets donne lieu. Mais il faut aller plus loin. En effet, la propriété des marchandises, même en grand nombre, ne fournit qu’une garantie partielle contre les errements du sort. Le péril potentiel que la séparation fait peser sur les individus marchands n’y trouve qu’un exutoire imparfait. Il en est ainsi pour une raison fondamentale qui tient à la nature même de l’incertitude marchande : on ne sait pas de quoi demain sera fait, même de manière probabiliste. Or, par nature, les marchandises répondent à des besoins spécifiques. Il n’existe pas de marchandises multifonctionnelles permettant d’affronter l’infinie diversité des circonstances futures. C’est pourquoi, face à cette incertitude indéterminée, la marchandise est impuissante.
Pour bien comprendre ce point théoriquement fondamental, il n’est que de considérer ce qui se passerait si l’on pouvait réduire l’incertain à une liste probabilisable d’événements définissables a priori. Pour désigner cette conception affaiblie de l’incertitude, on parlera d’« hypothèse probabiliste ». Dans le cadre de cette hypothèse, chaque agent est capable de déterminer aujourd’hui, pour chaque occurrence anticipée, les marchandises dont il aura besoin demain de façon à s’adapter de manière optimale. Si on suppose l’existence de marchés à terme permettant l’achat aujourd’hui de ces marchandises pour le moment futur où ces événements sont supposés se produire, alors les agents peuvent aujourd’hui s’assurer de manière parfaite contre les effets de l’incertitude. Le point remarquable /62/ est que ce résultat est obtenu sans qu’il soit besoin de faire appel à autre chose qu’aux marchandises. En conséquence, l’hypothèse probabiliste préserve la toute-puissance de la loi marchande face au futur. Pour cette raison, on ne sera pas surpris d’apprendre que telle est l’hypothèse retenue par l’économie néo-walrassienne. Il est convenu d’appeler « modèle de Arrow-Debreu » la version de l’équilibre général qui intègre un futur probabiliste. Ce modèle démontre de manière rigoureuse que l’introduction des marchés à terme de marchandises contingentes permet une gestion optimale de l’incertain probabilisable sans qu’il soit nécessaire de faire appel à la monnaie. Ce faisant, une nouvelle fois, apparaît en pleine lumière le statut de la théorie néo-walrassienne : penser une société qui serait de bout en bout régie par la seule loi de la marchandise. Que, pour cela, il faille retenir des hypothèses peu plausibles n’affecte que marginalement cette démarche théorique. Lorsqu’un écart est constaté entre la réalité et la théorie, celui-ci n’est pas interprété comme révélant l’inadéquation du discours théorique mais comme mettant en évidence les efforts qu’il reste à faire pour que la réalité soit pleinement conforme à son modèle. Pour cette raison, il convient d’être prudent face aux positions épistémologiques qui soutiennent que l’économie serait une science du même type que la physique ou la chimie [en fait, c’est de la politique, Combasle].
Pour
notre part, avec Keynes, nous contestons que l’hypothèse probabiliste soit une
description pertinente de l’incertitude marchande. Celle-ci ne saurait en rien
faire l’objet de prévisions objectives, même de nature probabiliste. Il
en est ainsi parce que l’incertitude n’est pas seulement liée aux événements
exogènes qui affectent l’économie [la société], par exemple les variations météorologiques, déjà
difficilement prévisibles, mais qu’elle dépend également des actions des
acteurs économiques qui, du fait même de l’autonomie des choix individuels,
échappent au cadre probabiliste. Il faut donc bien distinguer deux conceptions de l’incertitude,
l’incertitude probabilisable de la théorie néo-walrassienne, le plus souvent
nommée « risque », et l’incertitude non probabilisable, le plus
souvent nommée « incertitude radicale » ou simplement
« incertitude » lorsque aucune confusion n’est possible. Selon
que l’on privilégie l’une ou l’autre des incertitudes, on est conduit à des
diagnostics divergents. Le rôle de l’incertitude non probabilisable a été mis
en avant par Keynes. Dans la citation qui suit, écrite en 1937, il s’efforce de montrer qu’il ne
faut pas confondre incertain et probabilisable :
« Par savoir
incertain, je ne cherche pas simplement à distinguer ce qui /63/ est connu avec certitude de ce qui est seulement
probable. En ce sens, le jeu de roulette n’est pas incertain... L’espérance de
vie est seulement légèrement incertaine. Même le temps n’est que modérément
incertain. Le sens en lequel j’utilise ce terme est celui qui fait dire que la
perspective d’une guerre en Europe est incertaine ou qu’est incertain le prix
du cuivre ou le taux de l’intérêt dans vingt ans, ou encore l’obsolescence
d’une invention nouvelle, ou la situation des propriétaires privés dans le
système social de 1970. Pour
toutes ces questions, il n’existe aucune base scientifique permettant d’établir
quelque probabilité que ce soit. Simplement, nous ne savons pas »
L’hypothèse probabiliste a ceci de remarquable qu’elle suppose que toute l’incertitude peut in fine se réduire aux seuls aléas objectifs dont la météorologie nous fournit l’archétype. Dès lors, chaque individu n’a plus à se préoccuper du comportement des autres : la seule connaissance des aléas potentiels suffit. Ce faisant, l’hypothèse probabiliste permet de construire une médiation objective entre les acteurs économiques en matière de risque de la même manière que l’hypothèse de nomenclature l’avait fait en matière d’utilité. Dans les deux situations, la même logique est à l’œuvre : séparer les hommes [je ne comprends pas bien en quel sens]. Prendre en considération l’incertitude non probabilisable remet fondamentalement en cause cette construction : se donne à voir un besoin spécifique de protection et d’assurance que la marchandise se trouve incapable de combler parce que l’incertitude non probabilisable met l’individu face à un futur totalement indéterminé. Cette indétermination n’est que l’autre face de l’autonomie laissée aux acteurs marchands dans le choix de leur stratégie. Face à l’imprévisibilité des circonstances à venir, l’achat de marchandises spécifiques devient inefficace. Ce qu’éprouve l’individu marchand est d’une intensité bien trop grande pour trouver une réponse satisfaisante dans l’accumulation de marchandises. L’exigence de sécurité qui le taraude trouve ses racines dans la séparation marchande elle-même en tant qu’elle isole les individus et les plonge dans un monde opaque, incertain et d’autant plus menaçant qu’il sait ne rien pouvoir attendre d’autrui. Privés de la protection des solidarités traditionnelles, soumis aux diktats de la rareté, les gens cherchent désespérément à stabiliser les bases de leur existence, c’est-à-dire à conjurer provisoirement la menace de l’exclusion.
L’exigence de protection et le besoin de société
/64/ Cette exigence de protection va jouer un rôle central dans la suite de notre réflexion. C’est à partir d’elle que nous penserons la monnaie. Aussi arrêtons-nous un instant pour en préciser la nature et la portée. Soulignons à nouveau que les déterminations psychologiques ne jouent ici qu’un rôle tout à fait secondaire. Dans notre approche, l’exigence de sécurité est l’expression d’un fait social, la séparation marchande, et c’est en tant que telle qu’il faut en saisir la portée. Pour donner tout son sens à cette exigence de sécurité, il nous faudra préciser à qui elle s’adresse et qui est capable d’y apporter une réponse adéquate. C’est tout l’objet du travail qui va être entrepris que d’élucider ces points. Anticipons un court instant sur les résultats à venir de façon à faire comprendre la logique globale de l’argument, ce qui, nous l’espérons, permettra de le rendre plus clair.
On a vu que les marchandises ne pouvaient répondre à
cette exigence. Il en est de même des individus sauf à sortir du rapport
marchand et de la logique objectale qui l’exprime. La réponse qui sera apportée
est que ce besoin s’adresse au groupe marchand lui-même, c’est-à-dire à la société marchande [ça y est, ils l’ont dit !].
Pour le dire autrement et de manière plus précise, nous partirons de cette
exigence de sécurité pour construire la nécessité d’une présence active de la société et mettre en évidence
la forme particulière que cette présence active revêt dans l’économie
marchande [la société
marchande], en l’occurrence la monnaie [la monnaie est donc la présence active de la société en chacun, dans tous, et partout.
C’est une règle que tous connaissent, que tous appliquent, sauf quelques
un : les criminels qui la violent et les saints qui l’ignorent]. Le
problème ainsi posé fait ressortir l’enjeu fondamental de notre approche de la
monnaie : penser la société en tant qu’entité autonome, dotée d’une force
spécifique, capable de répondre au besoin de protection [à quel prix !] des individus. On
comprend alors mieux pourquoi l’approche néo-walrassienne échoue à penser la
monnaie : parce
qu’elle ne laisse aucune place à la société en tant qu’entité autonome. Dans la théorie de l’équilibre
général, les objets sont supposés
satisfaire exhaustivement tous les besoins
individuels. De
cette manière, est obtenue la clôture du monde objectif sur lui-même sans que jamais la question de l’appartenance
sociale n’apparaisse.
Il en est ainsi parce que le rapport aux objets absorbe, sans reste, toute la substance
sociale. Plus fondamentalement, dans cette analyse, l’idée que la société serait porteuse de
déterminations singulières, est absolument niée. La société en tant qu’entité
autonome n’existe pas : tout passe par les marchandises et elles seules. En cela, la démarche
néo-walrassienne est pleinement cohérente avec ses /65/
présupposés individualistes. C’est une réalité, non pas sociale, mais
statistique, sans autre contenu que descriptif.
Cette négation du social n’apparaît nulle part avec plus de force que dans la citation suivante de Milton Friedman :
« Pour l’homme libre, la nation ne propose aucun but propre, sinon celui qui résulte de l’addition des buts que les citoyens, chacun de leur côté, cherchent à atteindre ; et il ne reconnaît d’autre dessein national que la somme des desseins individuels. »
Ce déni de la société et des appartenances particulières, en l’occurrence nationales, par lequel elle s’exprime, est au fondement de l’universalisme libéral. Cette conception d’une société muette et invisible ne laisse alors aucune place à la monnaie [alors que, notez bien, il n’y a que la monnaie qui compte pour ces trous du cul, pour la raison de quinze pour cent]. C’est ce qu’illustre parfaitement l’analyse de Don Patinkin qui, pour introduire cette dernière, doit supposer un besoin résiduel que les objets ne pourraient pas satisfaire. C’est ainsi qu’il suppose l’existence de « désagréments » [chochote, va !] liés aux transactions, ce qui lui permet de justifier la nécessité d’un bien nouveau, à savoir la monnaie, permettant de faire face à ces désagréments [alors que dans le real world, c’est seulement ce bien nouveau qui est l’objet de toute l’attention de ces trous du cul, c’est à dire comment faire quinze pour cent, et même vingt pour cent et quarante huit pour cent quand on peut. C’est ce que Jarry nommait la pompe à phynance alias le profit. Comment feraient-ils sans ce « bien nouveau »].
Notre approche suit formellement cette même logique. Elle établit que le monde de la marchandise ne saurait se clore sur lui-même parce que subsiste chez les agents un désir de sécurité ou d’assurance qui doit trouver un mode adéquat d’expression et de satisfaction. Notre approche et celle de Don Patinkin divergent en ceci qu’il nous est apparu nécessaire, pour ce faire, de sortir du rapport objectal : ce qui est fondamentalement l’objet de la demande des individus, c’est la protection de la société. On retrouve là une des fonctions les plus essentielles de la souveraineté. Cette demande de protection qui monte spontanément des individus marchands confirme que la conception d’une société muette et neutre n’est pas tenable. À travers cette demande, les individus marchands expriment leur volonté d’un lien social qui les préserve et les protège contre les ravages de la rareté et de l’incertitude. Ils demandent que leur qualité d’être social soit reconnue.
II doit être clair qu’un tel besoin a trouvé de multiples
moyens de se satisfaire, variables selon les individus, les époques et les
sociétés : le droit, les solidarités traditionnelles ou l’État sont, à des
degrés divers, des réponses apportées à cette même exigence. Ce qui nous
intéresse ici est la manière spécifique qu’a retenue la société marchande pour
y faire face. Comme nous l’avons souligné à plusieurs reprises, nous ne
cherchons pas à penser l’émergence ou la nécessité de la société marchande.
Nous cherchons à montrer /66/ comment la séparation marchande rend
nécessaire la monnaie du fait de l’incertitude et du besoin de sécurité qu’elle
suscite. Soulignons que le raisonnement qui va être présenté se situe dans un
temps purement logique et non historique. Il ne faudra pas en déduire que la
séparation marchande est historiquement antérieure à la monnaie. La séparation
marchande, de par les déséquilibres qu’elle contient, ne pourrait exister, si
tant est qu’on puisse lui imaginer une forme sociale viable, sans la monnaie.
Autrement dit, le rapport
marchand est toujours un rapport monétaire. Comme nous l’avons déjà
souligné dans le chapitre premier, nous nous situons dans une économie [dans une société] déjà
marchande. Dans le présent chapitre théorique, nous ne cherchons pas à
expliquer comment la monnaie marchande s’est imposée historiquement à des
sociétés qui l’ignoraient. Cette analyse historique sera menée dans le
chapitre IV mais sur des bases totalement différentes.
LA
RICHESSE
Dans l’ordre
marchand, l’exigence de protection éprouvée par les individus prend la forme
spécifique d’un désir d’objet, ce qu’on appellera « la richesse ». En
cela, il revêt une forme sociale qui respecte la logique d’anonymat et de libre
transfert qu’on trouve aux fondements du rapport marchand. À ne retenir que
l’aspect formel de cette définition de la richesse, il peut sembler que nous
sommes simplement face à l’extension du rapport objectal aux besoins
spécifiques qu’engendre l’incertitude. C’est ce qu’a retenu Don Patinkin dans
sa construction de la monnaie. Mais, à y regarder de plus près, la richesse
apparaît comme un objet tout à fait énigmatique et particulier. En effet, il ne
peut s’agir que d’une « chose » multifonctionnelle, puisque, par
définition de l’incertitude marchande, elle doit satisfaire une multiplicité
indéterminée de besoins, en l’occurrence tous les besoins que son détenteur
jugera nécessaires en fonction des circonstances variables qui se présenteront.
Cette plasticité radicale est une nécessité qui se déduit de la notion même
d’incertitude telle que nous l’avons présentée plus haut.
De manière
évidente, aucune substance naturelle ne peut répondre à cette indétermination
des besoins et des événements qui est au fondement de l’incertitude
keynésienne. Ce qui est en jeu, c’est bien plutôt l’existence d’une
« chose » permettant d’acquérir tous les biens et services jugés
utiles par celui qui la détient ; c’est à dire /67/ une « chose » que les possesseurs de ces biens et
de ces services, quels qu’ils soient, sont prêts à accepter en échange de leurs
possessions. Ainsi présentée, la richesse n’est dans l’ordre marchand que le
nom donné au désirable absolu, cette « chose » contre laquelle chaque
membre du groupe est toujours prêt à aliéner ce qu’il possède. Il s’agit donc
d’une marchandise d’un type très particulier en ce qu’elle tire sa force de sa
capacité à être acceptée par tous les membres du groupe. Pour désigner cette
propriété constitutive de la richesse, on parlera de « liquidité ». La liquidité de la richesse fait
d’elle un talisman qui protège de tous les ennuis potentiels que l’incertitude
marchande peut faire naître. En ce sens, on conçoit qu’elle sort du cadre
strictement utilitaire. Car son utilité ne provient pas d’un tête-à-tête entre
l’objet et l’individu suivant la logique objectale décrite précédemment, mais
d’une capacité de la richesse à focaliser le désir unanime du groupe. Il
s’agit d’une réalité tout à fait nouvelle et spécifique. Cette richesse
absolument liquide parce que absolument désirable aux yeux de tous les
sociétaires marchands, est à la base de la monnaie. Comme on le verra, la
monnaie est une richesse socialement reconnue et légitimée.
Notons dès à
présent l’ambivalence propre à la richesse. Introduite initialement comme
l’expression d’une exigence de sécurité et de protection, la richesse est ce
qui permet un repli sur soi, une pleine autonomie face aux aléas de
l’économie marchande [de la
société marchande]. Cependant, parce qu’elle autorise un agent
économique à « cesser le jeu » unilatéralement, elle fait peser, par
ce fait même, au groupe marchand tout entier, la menace sérieuse d’une rupture
dans les enchaînements économiques. Cette menace est d’autant plus crédible que
la richesse mobilisée est importante et qu’elle peut servir de support à la
constitution de nouvelles alliances porteuses de manières innovantes d’échanger
et produire. C’est le cas d’un producteur investissant sa richesse dans de
nouvelles techniques rendant obsolètes les formes antérieures de production. Il
s’ensuit une mutation des liens marchands qui met en péril les positions
acquises. La richesse
apparaît alors comme l’instrument privilégié par lequel s’exerce la domination
sur la société et sur les autres. Le « hors jeu » peut se
comprendre à la fois comme élément d’une stratégie défensive ou offensive,
comme désir d’autonomie ou comme volonté de puissance. Notons que cette même
ambivalence était déjà présente dans la séparation elle-même. Comme on l’a vu,
la liberté de choix peut y être solitude et l’indépendance exclusion. C’est
dans les deux cas une même potentialité qui s’énonce différemment selon qu’elle
est /68/ voulue et subie. C’est là une
caractéristique très générale qui traverse toute l’économie marchande [la société marchande].
Ainsi, la lutte concurrentielle est indissolublement agression des autres et
défense contre l’agression des autres. Il est souvent impossible de savoir
lequel de ces deux motifs, la survie ou l’expansion, prévaut. Par exemple, le
vaste mouvement d’OPA des années 1990 ne doit pas seulement s’interpréter
comme un pur désir de puissance mais également comme la nécessité de croître si
l’on ne veut pas disparaître.
Ce désir de richesse comme réponse à l’incertitude n’est pas inconnu de la théorie économique. Il a trouvé son meilleur théoricien avec Keynes. En effet celui-ci, lorsqu’il analyse ce qu’il appelle « la préférence pour la liquidité », en fait une conséquence de la crainte qu’éprouvent les acteurs économiques face à un futur par trop incertain. L’incertitude les pousse à sortir du jeu économique dans l’attente de nouvelles informations qui rendraient l’investissement productif moins risqué. Pour Keynes, c’est principalement la détention de monnaie qui sert de vecteur à cette stratégie d’attente méfiante. Il écrit :
« Notre désir de détenir de la monnaie comme réserve de richesse est un baromètre du degré de défiance que nous éprouvons à l’encontre de nos propres calculs et conventions concernant l’avenir... La possession de monnaie calme notre inquiétude. »
Selon Keynes, le sujet marchand, grâce à la détention de monnaie, échappe à toute décision impliquant une activité concrète. Le thésaurisateur se trouve dans une situation d’attente, de hors jeu et de repli sur soi. La monnaie est le moyen grâce auquel toute décision peut être reportée jusqu’à l’obtention d’une meilleure information. Ce que dit Keynes à propos de la monnaie peut être étendu à tout objet représentant la richesse. On peut le constater au moment des crises économiques lorsque les agents économiques quittent la sphère productive pour se reporter sur des actifs qu’ils jugent plus stables comme l’immobilier, la monnaie ou l’or. Il s’agit pour eux de se prémunir contre un futur marchand devenu par trop imprévisible.
Ces analyses n’ont fait, jusqu’à présent, qu’exposer les
déterminations abstraites de la richesse telles qu’on peut les déduire de
l’analyse logique du rapport marchand. Reste à comprendre comment elles se font
jour concrètement et sous quelles formes elles s’imposent aux acteurs. Pour ce
faire, nous partirons de la situation élémentaire du face-à-face de deux
individus marchands, avant même qu’un principe monétaire reconnu par tous ait
été produit, ce qui correspond au « troc » pour la théorie classique
et ce que nous appellerons F1 en faisant référence à Karl Marx.
* * *
LA
LÉGITIMITÉ DE LA MONNAIE
La puissance de
la démarche proposée pour penser cette émergence réside, selon nous, dans le
fait qu’elle ne postule rien a
priori quant à la substance
et au contenu de la richesse : elle fait surgir du sens d’une structure
amorphe. En cela, nous différons radicalement des approches par la valeur qui,
toutes, se donnent dès l’origine un rapport social déjà stabilisé, des
individus marchands déjà pleinement socialisés et une société déjà établie.
Quel rôle peut y jouer la monnaie ? Celui, secondaire, de faciliter les échanges.
Notre perspective est tout autre. Notre point de départ n’est pas une réponse,
la valeur, mais une
question, celle que pose la séparation aux individus : comment
garantir mon existence sociale ? On doit souligner la rigueur de la construction
girardienne qui, dans l’analyse de F1, la scène originelle, tend à éliminer
toute forme de transcendance a
priori pour livrer dans
toute sa pureté l’alchimie sociale à partir d’une foule indifférenciée, en état
de panique, sans postuler /85/
d’autres significations sociales que leur lutte pour l’existence, l’accord
monétaire se construit comme polarisation mimétique des manques individuels.
Ainsi émerge une société qui n’existait pas antérieurement. Ce processus nous
donne à voir la manière dont la violence peut être exorcisée pour permettre la
vie en société. Soulignons que le lien monétaire ne supprime pas le manque et
la violence sociale qui l’accompagne. Il lui donne simplement une forme
socialement viable. Comme on le verra amplement, la question monétaire, loin
d’être réglée définitivement, travaille sans cesse l’économie marchande [la société marchande].
Constamment la monnaie élue doit faire la preuve de sa légitimité.
L’analyse du
processus d’élection-exclusion dévoile cette propriété essentielle : ce
qui fait qu’un objet est monnaie, c’est son acceptation par tous comme forme reconnue de la
richesse ; ce ne sont en rien ses propriétés naturelles. La nature
particulière de l’objet considéré ne joue ici qu’un rôle secondaire. On peut
dire que la monnaie a une nature autoréférentielle [non, pas vraiment : ce n’est pas la monnaie qui se
réfère à la monnaie] : est monnaie, ce que tout le monde considère
être une monnaie. C’est ce qu’exprime la propriété d’autoréalisation mise en
évidence précédemment : ce qui compte, c’est l’unanimité [non : c’est la connaissance
universelle de l’universalité de la connaissance de l’acceptation de la
monnaie. Samuelson a dit : « La monnaie est acceptée parce qu’elle
est acceptée ». Il ne faut pas confondre autoréférence et public
knowledge, autrement dit publicité. La monnaie est acceptée parce qu’il est
bien connu — ces mots manquent dans la phrase de Samuelson — qu’elle est
acceptée. Il n’y a aucun paradoxe là-dedans. Nous verrons ça plus tard.].
On retrouve largement
ce résultat dans diverses approches économiques. Chez Samuelson : « Paradoxe : la
monnaie est acceptée parce qu’elle est acceptée. » [pourquoi paradoxe ?]
C’est vrai également de la plupart des modèles dits de « prospection
monétaire » qui parlent alors de « bootstrap »
pour désigner ce phénomène. Sandrine Gimenez en définit précisément le
mécanisme de la manière suivante : « La monnaie moyen d’échange est
acceptée par les agents s’ils anticipent qu’elle le sera par tous les
autres. » Mais ces théories sont muettes sur le processus qui mène à l’unanimité des croyances.
Par ailleurs, pour que cette unanimité acquière un statut de médiation durable,
encore faut-il qu’elle
cesse d’être perçue comme un simple fait accidentel, comme le produit
transitoire du mimétisme, pour apparaître aux yeux des sociétaires comme une
réalité sur laquelle chacun peut désormais compter [cela fait quatre mille ans que l’on peut compter sur et
avec la monnaie]. L’élection-exclusion doit être perçue comme légitime par la société.
C’est ce qu’on a nommé précédemment « l’exclusion ». Ce terme met
l’accent sur le fait que désormais la monnaie apparaît aux yeux des
producteurs-échangistes douée d’une nature radicalement différente de celle des
autres marchandises profanes : elle a été exclue du cercle des biens
ordinaires [depuis quatre mille
ans]. Cette mutation dans la manière dont les sujets appréhendent /86/
l’objet élu joue un grand rôle
dans la stabilisation de l’unanimité mimétique.
Pour bien
comprendre ce rôle, il convient de revenir au modèle mimétique d’opinion
proposé précédemment. Jusqu’à présent, on a supposé que les agents, pour
chercher à découvrir la richesse [elle
est découverte depuis quatre mille ans], avaient exclusivement recours
au mimétisme. Une légère complication de ce modèle peut s’avérer utile. Il
s’agit d’introduire l’hypothèse supplémentaire selon laquelle certains
individus peuvent, de temps en temps, dévier du choix que leur dicte le
mimétisme parce qu’ils sont soudain convaincus qu’existe un meilleur choix
monétaire pour des raisons qui leur appartiennent. Si l’on introduit ce type
d’opinions déviantes, ce qui paraît raisonnable, alors l’unanimité n’est plus
nécessairement obtenue, ni, si elle l’est, reproduite. L’objet élu cesse de
recueillir mécaniquement, à chaque période, l’unanimité des choix car il se
trouve constamment concurrencé par quelques prétendants. Ces opinions déviantes
font naître une instabilité qui rend l’économie monétaire [la monnaie] moins efficace. Dans un tel cadre élargi, la
légitimité de la monnaie élue est un puissant facteur d’efficacité parce
qu’elle fait obstacle à l’apparition des opinions déviantes. D’une part, elle
fait naître chez tous les sociétaires un profond sentiment d’adhésion à la
monnaie commune, ce qui rend moins probables les dissidences. D’autre part, et
de manière encore plus puissante, constatant cette légitimité, chaque déviant
potentiel, anticipant une forte adhésion à la monnaie élue chez les autres, est
moins enclin à rendre publique cette déviance qui a peu de chances d’emporter
la conviction du groupe. De manière plus générale, et plus fondamentale,
l’institution monétaire ne saurait exister sans cette légitimité car c’est elle
qui incite les agents à anticiper la pérennité du fait monétaire. C’est au nom
de celle-ci qu’ils peuvent se projeter dans le futur et faire raisonnablement
l’hypothèse que la monnaie sera acceptée par les autres. La légitimité est ce
sur quoi la confiance
peut se construire. Elle est au fondement de l’acceptation par autrui.
LE MODÈLE
DE CONCURRENCE MIMÉTIQUE
Rappelons que
l’analyse qui vient d’être menée ne doit pas se comprendre comme cherchant à
décrire le processus
historique réel qui a conduit à l’institutionnalisation de la monnaie.
Nous ne croyons pas qu’une situation de séparation marchande sans monnaie, /87/
ce qu’on a appelé F1, ait précédé l’invention du rapport monétaire. Tout au
contraire, nous avons voulu montrer que la séparation marchande, en raison même
des fortes contradictions qui la traversent, appelle nécessairement la monnaie
pour exister comme l’institution qui donne forme sociale aux conflits intenses
que la rareté fait naître. Sans elle, il n’y aurait pas de société marchande [et non pas « d’économie
marchande » Bien dit cette fois. L’économie n’étant aucune institution de
la société, elle ne saurait être une partie de la société. La société, qui est
la mère des institutions est composée de nombreuse institutions parmi lesquelles
ne figure aucune institution qui serait l’économie, ni la production, ni la
consommation etc. Tout cela n’est qu’hypostase ou alors, légitimement,
classement]. C’est donc une analyse logique du rapport marchand qui a
été conduite. De ce point de vue, le passage de la violence essentielle à la
violence fondatrice doit se comprendre comme un modèle abstrait qui a pour
fonction de dévoiler la nature cachée de la monnaie. Ce modèle nous dit que la monnaie ne procède ni du contrat, ni de l’État, mais de la polarisation mimétique spontanée des individus marchands en quête
de protection. Dans le chapitre III, ce résultat sera disséqué. On montrera en
quoi cette conception par ailleurs originale est cependant, sous de multiples
aspects, proche de celles développées par François Simian ou par Georg Simmel.
La spécificité de
l’analyse logique de la monnaie qui a été proposée dans ce chapitre tient au
fait que ses éléments constitutifs sont des processus : d’une
part F1, la recherche de richesse, l’indifférenciation mimétique et la
violence essentielle ; d’autre part F3, l’élection-exclusion et
enfin F2, la concurrence des monnaies qui sera définie dans un instant.
Sont ainsi rendues intelligibles les puissantes forces sociales qui caractérisent l’économie
marchande [la société
marchande] et lui donnent son dynamisme. Il en est ainsi parce que la
séparation est un rapport contradictoire qui sans cesse fait naître des
rivalités nouvelles pouvant remettre en cause les institutions qu’elle a
antérieurement créées. Aussi, est-ce un mouvement sans fin qui est proposé à
l’analyse : une institution monétaire (F3) qui donne naissance à des
forces privées cherchant à remettre en cause cette institution via de nouvelles
monnaies embryonnaires, ce qu’on appellera « la concurrence des
monnaies » ou F2, concurrence conduisant à de nouvelles règles
monétaires (F3) ou pouvant déboucher sur une crise spéculative
majeure (F1) menant à une nouvelle institution monétaire (F3). Il
manque à notre analyse la caractérisation précise du processus F2. Elle
fera l’objet des développements ultérieurs, mais il est bon d’en dire déjà
quelques mots de sorte que le lecteur puisse embrasser l’ensemble de notre
construction théorique. Dans le modèle proposé jusqu’alors, une concurrence
généralisée entre tous les biens (F1) a seulement été prise en considération
car nous étions partis d’une situation sans monnaie. Lorsqu’on étudie
l’évolution des économies [sociétés] marchandes,
il est rare /88/ qu’on
observe une crise d’une telle ampleur. La recherche de la richesse ne se fait
pas dans la plus absolue incertitude. Elle se trouve focalisée sur un nombre
réduit de candidats légitimes, essentiellement la monnaie antérieurement
instituée plus un ou quelques autres biens pouvant aspirer à un rôle monétaire.
F2 décrit ce processus de spéculation mimétique entre deux ou trois
« monnaies partielles ». La violence sociale s’y trouve concentrée
sur un faible nombre de prétendants. Pour la désigner, nous utiliserons le
terme girardien de « violence réciproque ». Les trois processus F1,
F2 et F3 correspondent à trois expressions de la violence marchande :
violence essentielle, réciproque et fondatrice.
Dans cette
perspective, le modèle de concurrence mimétique constitue la pièce maîtresse de
notre analyse en ce qu’il nous donne à comprendre la dynamique des forces
concurrentielles lorsqu’elles ont pour objet, non pas une marchandise définie
ex ante comme il est fait habituellement, mais la
richesse. Le trait essentiel qui distingue cette dynamique concurrentielle de
celle traditionnellement analysée peut être résumé de la manière suivante :
lorsque la rivalité pour un bien censé exprimer la richesse augmente, il ne s’ensuit pas
nécessairement une diminution de la demande comme c’est le cas lorsque la
concurrence porte sur une marchandise. En effet, dès lors que
l’augmentation initiale du prix du bien considéré est interprétée par les
acteurs économiques comme révélant un intérêt grandissant du groupe pour cette
forme de richesse, cela conduira à une augmentation de la demande. Autrement
dit, contrairement aux
formes classiques de la concurrence, le fait que le prix augmente peut produire
un accroissement corrélatif de la demande. Il en est ainsi parce que le bien n’est pas recherché
pour son utilité intrinsèque mais en raison de l’attirance qu’il exerce sur le
groupe : une augmentation de son prix signifie qu’il est l’objet
d’un plus grand désir de la part du groupe. Qu’on pense à la spéculation sur
les devises ou sur les actions. Lorsque leur prix croît, leur demande peut
augmenter si l’augmentation initiale du prix est interprétée comme exprimant un
intérêt grandissant pour eux. On retrouve ce même type de propriété en économie
[bien dit : il s’agit de la doctrine de
ce nom] lorsqu’on étudie les biens à la qualité incertaine. Dans ce cas,
une augmentation du prix, lorsqu’elle est interprétée comme révélant une
qualité intrinsèque de la marchandise plus grande, peut conduire à une demande
plus forte.
Interprété de
cette manière, le modèle de concurrence mimétique nous sera utile pour penser
les dynamiques de spéculation /89/ comme pour penser F2, la
concurrence entre les monnaies. On retrouvera alors nos propriétés
cardinales : indifférenciation des acteurs, contagion des croyances,
multiplicité des équilibres et autoréalisation de l’unanimité. Le caractère
cumulatif de la concurrence mimétique a pour conséquence de faire converger la
recherche de la liquidité sur un bien unique. Autrement dit, la concurrence appliquée aux monnaies n’a
pas les propriétés stabilisatrices de la concurrence habituelle.
Conclusion
Tous les efforts
de ce chapitre ont été dirigés vers un même but construire une théorie
monétaire de la société marchande. Selon la perspective adoptée, il convient de
partir de la monnaie pour rendre intelligibles les prix des marchandises, les
volumes échangés, les taux d’intérêt et les cours des actifs financiers, ce qui
sera fait dans les chapitres qui suivent. Pour mener à bien un tel projet,
notre point de départ a été une étude minutieuse de la marchandise et de la
séparation marchande. Cette étude a permis d’en souligner les contradictions
internes, sources de violence : en privilégiant les relations aux objets,
le rapport marchand fait dangereusement régresser la relation à autrui,
désormais identifié au mieux à un coût, au pire à une menace. Elle laisse
l’individu marchand sans défense face aux lois de la rareté et aux dangereuses
incertitudes qui en sont l’expression la plus directe. Comme le dit Polanyi,
voici l’individu « dépouillé de la couverture protectrice des institutions
culturelles ». Ces menaces ne sont qu’une des deux faces d’une réalité
ambivalente qui, simultanément, libère la personne humaine des liens de
dépendance personnelle et des contraintes de subordination que faisaient peser
sur lui les sociétés à statuts. On a reconnu dans cette ambivalence du rapport
marchand une ambivalence propre à l’idéologie individualiste. C’est là un de
nos fils directeurs les plus essentiels : économie marchande [société marchande] et
individualisme doivent se comprendre, à la suite de Louis Dumont, comme les
deux faces d’une même réalité.
La question qui
est alors posée au théoricien, question qu’on retrouve au couur même de la
théorie économique, est de savoir comment une telle société, si énigmatique
dans son fonctionnement par rapport aux sociétés antérieures, peut accéder à
une existence /90/ stable.
La réponse des économistes orthodoxes consiste à postuler un individu
élémentaire parfaitement satisfait de ses liens aux marchandises, sans que
subsiste chez lui aucune demande de reconnaissance par autrui. C’est cette
hypothèse de complétude que nous avons critiquée. La nature même de la
séparation marchande interdit un tel état de satisfaction. Demeure chez les
individus marchands une exigence de protection ou de certitude que les
marchandises ne suffisent pas à leur procurer : autrement dit, un besoin
de société. Dans le monde marchand, il prend la forme d’un désir de richesse,
la richesse étant définie comme ce qui permet de se mettre provisoirement hors
jeu et, ce faisant, de se protéger contre les errements de la rareté. Ce désir
est tout à fait spécifique en ce qu’à travers des objets précieux, il se porte
sur les autres. Pour cette raison, il ne répond en rien à la structure
objectale que considère le plus fréquemment le formalisme économique.
L’hypothèse mimétique nous a permis d’appréhender la nature de cette quête si
singulière et d’en modéliser la logique. Pour cette raison, elle joue un rôle
central dans notre construction logique. Sans elle, l’énigme de la richesse et
de la monnaie serait restée entière.
Au point de départ
de l’hypothèse mimétique, on trouve un individu élémentaire aux antipodes de l’homo
œconomicus des manuels, à savoir l’individu girardien. Cet individu ne
connaît pas la loi de son désir. Il est incapable d’exhiber un ordre de
préférences stable. Le face-à-face avec la marchandise n’a pour lui qu’un sens
secondaire dans la mesure où l’individu girardien est tout entier tourné vers
les autres dont il recherche, avec avidité, l’approbation. Rien n’exprime mieux
cette incomplétude originelle que le désir de richesse. La richesse est, par
définition, ce qui est désiré par les autres de telle sorte que la rechercher,
c’est rechercher la reconnaissance des autres. À travers la richesse,
l’individu cherche à stabiliser son rapport au groupe dans son entier. C’est
cette même logique autoréférentielle qu’on trouve à l’ceuvre sur les marchés
financiers. Il s’agit toujours d’acquérir ce que la communauté financière,
autant qu’on peut en juger, décidera d’acquérir. Tel est le sens d’une
spéculation réussie. Sans l’hypothèse mimétique, il serait très difficile d’en
formaliser la structure.
Dans ce chapitre,
on a étudié ce mimétisme dans le cadre d’une situation dite
« originelle » au sens où les acteurs marchands y sont mis face à
face sans médiation instituée. On a montré que cette scène primitive conduit à
une situation de rivalité généralisée, qu’on a nommée « F1 » ou
«violence essentielle ». Le « théorème girardien » nous dit
qu’une telle situation débouche nécessairement sur une polarisation mimétique
des désirs : un même bien se trouve recherché par tout le groupe unanime.
Dans la théorie standard, l’exogénéité des préférences interdit une telle
polarisation /91/
mimétique. Chacun y recherche des biens spécifiques et l’imitation n’a pas lieu
d’être. C’est en cela que l’horno œconomicus peut être dit
« complet » et déjà « socialisé » : son rapport au
monde est, par postulat, supposé totalement stabilisé et spécifié. Cela revient
à supposer la société préconstituée et présente dans l’esprit de tous les
producteurs échangistes. Pour nous, la monnaie est ce bien élu par la grâce de
la polarisation mimétique. Elle s’impose alors en tant que forme socialement
reconnue de la richesse puisqu’elle est l’objet du désir de tous, ce qu’on a
encore appelé le « désirable absolu ». C’est ainsi qu’est engendrée
une référence commune qui met fin provisoirement à l’indifférenciation et qui,
ce faisant, ouvre un vaste espace aux échanges de marchandises. L’individu
provisoirement libéré du mimétisme peut alors se transformer en homo
œconomicus exclusivement soucieux des objets et de leur utilité. Mais une
telle transforination est précaire : les doutes sur la monnaie
réactiveront brutalement les réflexes mimétiques comme le montrera l’étude des
crises monétaires.
Pour comprendre l’originalité de cette construction, il est instructif de la comparer, non plus au courant néo-walrassien comme on l’a fait le plus souvent jusqu’à présent, mais à l’analyse que défend Karl Menger dans son célèbre article consacré à l’origine de la monnaie. Cette comparaison est intéressante car les deux approches partagent de nombreux points communs. Montrer en quoi elles se distinguent permettra de mieux faire comprendre ce que notre analyse a de spécifique et d’original. Pour ce faire, commençons par rappeler succinctement les thèses de Menger. Il part d’une situation dans laquelle les individus ont recours au troc pour échanger. Dans cette situation initiale, « chaque homme recherche uniquement les biens dont il a besoin directement et rejette les autres ». Comme on l’a vu, sur de telles bases, les échanges bilatéraux n’ont lieu que si la « double coïncidence des besoins » est respectée, ce qui limite sérieusement les transactions. Pour sortir de cette difficulté traditionnelle, Menger introduit une notion originale : l’Absatzfâhigkeit qui signifie littéralement « la capacité à être écoulé » ou encore « la capacité à être vendu », qu’on peut traduire par « degré d’échangeabilité ». Le terme choisi dans la version anglaise de l’article est « saleableness », la « vendabilité ». Menger souligne que c’est là une qualité qui varie beaucoup d’une marchandise à l’autre. Il note que les individus qui arrivent sur le marché en possession de biens dont l’Absatzfâhigkeit /92/ est élevée, peuvent acquérir plus rapidement la marchandise qu’ils recherchent que ceux dont les biens n’ont pas cette qualité. À tel point qu’il peut être plus avantageux pour un individu A qui possède un bien O au faible degré d’échangeabilité et veut acquérir un bien P, de faire du troc indirect, c’est-à-dire, dans un premier temps, échanger le bien O contre un bien M sans utilité directe pour lui mais dont l’Absatzfâhigkeit est plus élevée que celle du bien O, ce qui lui permet, dans un second temps, d’obtenir plus aisément le bien P qu’il convoite. On peut facilement montrer que les coûts de transaction du troc indirect, même s’il suppose deux échanges, sont inférieurs à ceux du troc direct dès lors que le bien M a un degré d’échangeabilité suffisamment fort". Menger propose alors un processus d’apprentissage évolutionniste qui fait que, peu à peu, les échangistes adoptent le troc indirect en utilisant comme intermédiaires les biens M à l’Absatzfdhigkeit élevée. À l’issue de ce processus, tous les individus utiliseront les mêmes biens M comme intermédiaires des échanges. Ces biens seront devenus des monnaies.
Pour prendre la mesure des convergences entre les deux approches, commençons par remarquer que l’Absatzfâhigkeit mengérienne est très proche de notre concept de liquidité. On pourrait même proposer ce terme comme traduction du mot allemand tant il s’agit dans les deux cas de décrire une même réalité : l’acceptabilité plus ou moins généralisée d’un bien au sein d’une communauté marchande. D’ailleurs, les deux théories en font un usage similaire. Dans les deux modèles, les individus renoncent à acquérir des biens directement utiles pour eux au profit de biens qui ne le sont pas mais qui, en raison de leur liquidité, leur permettent in fine d’arriver à leurs fins de manière plus efficace : la perte immédiate d’utilité est plus que compensée par le gain futur que permet la détention de M. Autrement dit, le détour par la liquidité s’avère rentable si l’on considère, non pas les besoins immédiats de l’individu, mais ses besoins à long terme. C’est précisément sur cette propriété qu’a été fondée toute notre démonstration. Par ailleurs, l’imitation est au coeur des deux processus. En effet, Menger note, sans utiliser le mot, que l’usage des biens M se propage par imitation au sein de la population. Au départ, souligne-t-il, seul un petit groupe prend conscience des avantages du troc indirect. Puis, les succès que ce groupe rencontre conduisent les autres à en faire autant. Plus profondément, Menger voit bien le caractère cumulatif de cette dynamique mimétique. Plus les objets M sont utilisés par certains pour le troc indirect, plus leur échangeabilité se trouve renforcée en raison /93/ même de ce nouvel usage. Enfin, Menger conclut en notant que la monnaie n’est pas un accident, ni une créature de l’État, ni le résultat d’un contrat volontaire entre les échangistes. C’est une « institution sociale ». C’est là exactement ce que nous voulons dire lorsque nous écrirons dans le chapitre suivant que la monnaie n’est « ni contrat, ni pouvoir, mais confiance ».
Cette indéniable proximité formelle tient au fait que nos deux modèles partagent une même idée essentielle : on ne peut comprendre les relations bilatérales d’échange qu’en pensant le rapport de l’individu marchand au groupe dans son entier. La liquidité comme l’Absatzftihigkeit désignent des qualités de nature holiste au sens où elles portent sur l’économie saisie dans sa globalité. Si l’échangiste mengérien se préoccupe du degré d’échangeabilité des biens, c’est parce qu’il se pense comme appartenant à une communauté d’échanges. Cependant, cette proximité formelle ne doit pas faire illusion. Chez Menger, l’idée de valeur prédomine, ce qui le conduit à penser la relation marchande sous la forme de l’évidence des besoins à satisfaire : des individus dotés de besoins naturels et objectifs recherchent dans l’utilité intrinsèque des marchandises qui leur sont proposées de quoi contenter leurs besoins. Les monnaies ne viennent que fluidifier les transactions. Aussi reste-t-il dans le cadre d’une approche instrumentale de la monnaie.
Dans notre approche, les besoins naturels ne suffisent
pas à stabiliser les rapports d’échange. Sans monnaie, sans codification des
marchandises, c’est-à-dire sans principe commun d’évaluation et de comparaison,
n’existent que des transactions éparpillées dépourvues de cohérence à la
manière du cas allemand étudié par Vincent Bignon. Chacun y exprime des besoins
variables, et le plus souvent indéfinis, qui ne se matérialisent sous une forme
ou une autre — du pain, des cigarettes, du chocolat — qu’au gré des rencontres
et des opportunités. Les rapports d’échange y sont alors contingents,
variables, sans règle. Aussi doit-on repousser l’idée selon laquelle il y
aurait à choisir entre le troc et la monnaie. Sans monnaie, l’économie
marchande [la société
marchande] ne peut échapper au chaos. Il faut toute la force des
institutions marchandes, au premier rang desquelles la monnaie, pour donner
forme sociale aux besoins humains et les sortir de leur naturelle flexibilité
et indétermination. En l’absence de ces institutions, les forces
concurrentielles n’ont aucun caractère structurant. L’idée que le lien marchand
serait un lien « naturel », émergeant « spontanément » des
besoins, est tout simplement absurde.
/94/ Cette analyse nous conduit à voir dans la situation
initiale considérée par Menger, une situation où règne l’incertitude la plus
absolue. Dans ces conditions, chacun cherche en priorité à stabiliser son
rapport au groupe, autant que faire se peut. Pour chaque échangiste, il ne
s’agit pas seulement de diminuer ses coûts de transaction mais d’assurer une
situation matérielle qui est mise en péril par la volatilité des transactions
et des rapports d’échange. D’où un sentiment d’impérieuse urgence qui est
totalement absent de la présentation mengérienne. La recherche des biens
liquides ou des biens ayant un fort degré d’échangeabilité correspond à cette
priorité et à cette urgence : trouver des biens faisant l’objet d’une
demande régulière et forte de la part du groupe considéré. Cependant, Menger voit
dans l’échangeabilité, une qualité exprimant le fait que, naturellement, dans
la situation F1 dite de « troc », l’objet considéré est très demandé.
Pour cette raison, il s’agit nécessairement d’une marchandise. Il se peut que,
dans telle ou telle configuration historique, c’est ainsi que l’objet monétaire
a été choisi. Mais ce n’est en rien une nécessité logique. D’un point de vue
théorique, n’importe quel « objet » peut faire l’affaire. C’est même
vrai dans le modèle de Menger. Si, pour une raison ou une autre, à un moment
donné, un objet quelconque est considéré par une partie importante Q de la
population des échangistes comme étant l’intermédiaire adéquat du troc
indirect, cet objet va circuler largement. En conséquence, son degré
d’échangeabilité va devenir très important, non en raison de son degré
intrinsèque d’échangeabilité qui peut être très faible, voire nul, mais en
raison du rôle qu’il joue désormais dans les trocs indirects de la
sous-population Q. Il deviendra alors rationnel pour les individus restant
de l’adopter comme intermédiaire des échanges.
On retrouve cette
idée d’indétermination de l’objet monétaire développée par les modèles de
prospection monétaire". Ces modèles, qui sont très proches des idées de
Menger, s’éloignent du courant néo-walrassien en ce qu’ils entretiennent une
vision décentralisée et évolutionniste des transactions. On y démontre que
n’importe quel bien peut devenir monnaie. Il suffit pour cela que les individus
croient qu’une majorité Q du groupe va le prendre comme monnaie. C’est ce
qu’on a appelé précédemment « l’effet bootstrap ». On
retrouve alors les propriétés d’autoréalisation et de multiplicité d’équilibres
mises en évidence lors de l’analyse du modèle de concurrence mimétique.
L’intérêt de la notion de liquidité par rapport à celle d’Absatzftihigkeit tient précisément au fait qu’elle s’émancipe
de la notion d’échangeabilité objective ou intrinsèque
Tableau 2-1. Les modèles alternatifs de la
monnaie
|
|
Théorie de la concurrence parfaite Modèles d’équilibre général |
Théorie évolutionniste Menger et Modèles de prospection |
Théorie institutionnelle Modèles mimétiques |
|
Comment les échanges sont-ils pensés ? |
Utilités individuelles,
auto- nomes et bien définies Hypothèse de nomenclature : les caractéristiques des biens sont de savoir commun Les échanges sont centralisés : coordination par le secrétaire de marché L’équilibre concurrentiel est amonétaire |
Utilités individuelles,
auto- nomes et bien définies Hypothèse de nomenclature : les caractéristiques des biens sont de savoir commun Hypothèse sur le degré d’échangeabilité des biens Les échanges sont décentralisés Problème de coordination dû à la non-double coïncidence des besoins Recherche de moyens d’échange : utilités indi- rectes vs directes |
Pas d’utilités individuelles prédéfinies Les biens n’ont pas de caractéristiques communes présupposées Variabilité et incohérence des rapports d’échange Recherche de la liquidité biens qui sont désirés par une large proportion du groupe |
|
Comment la monnaie est elle introduite ?- |
La monnaie est la (n + 1) marchandise Elle est introduite dans les fonctions d’utilité individuelles (Don Patinkin) Utilité directe de détenir
la monnaie Neutralité de la monnaie |
Les processus de prospection démontrent que des moyens d’échange peuvent émerger lors- que les individus ont des préférences straté- giques à leur égard La liquidité est le résultat d’une acceptation mutuelle Des processus autoréalisateurs |
La rationalité des individus qui recherchent la liquidité absolue est mimétique (Girard) Théorème girardien fondamental la dynamique mimétique généralisée converge vers une croyance commune sur ce qui |
|
|
|
peuvent faire émerger |
constitue la liquidité |
|
|
|
des moyens |
absolue |
|
|
|
de transaction comme résultat inintentionnel des interactions Pluralité possible des moyens de transactions :
multipli- cité d’équilibres Sélection par degré d’échangeabilité (Menger) La monnaie fiduciaire n’est pas nécessaire |
Le résultat du processus autoréalisateur est arbitraire La transformation de cette forme polarisée de la croyance en la monnaie (institution sociale) implique un processus de légitimation |
/96/ pour se focaliser sur la seule qualité
théoriquement pertinente, à savoir être désiré par tout le groupe.
Par ailleurs, la
construction mimétique se distingue radicalement de la construction mengérienne
par le fait que, à travers la liquidité et la richesse, ce qu’il s’agit
fondamentalement de penser est l’émergence d’une base stable d’évaluation des
biens et des personnes. De ce point de vue, les finalités des deux modèles sont
fort différentes. Chez Menger, comme les notions d’utilité et de besoin suffisent
à résoudre la question des évaluations, seule est en jeu la possibilité de
réaliser plus efficacement les transactions. Dans notre analyse, l’incertitude
des sujets a pour objet principal l’évaluation. Ce sont les fluctuations des
rapports d’échange qui nourrissent les difficultés des échangistes. Personne ne
sait exactement quelle est la bonne évaluation : tel est l’obstacle
principal aux échanges. Aussi les acteurs économiques plongés dans F1
sont-ils à la recherche d’une référence commune. Cela déclenche un processus
d’exploration mimétique dans lequel chaque échangiste détermine son choix à
partir de l’observation de ce que croient les autres. Ce processus cognitif
collectif conduit à l’unanimité du groupe sur un même objet. Cette élection
spontanée est ce qui rend possible la formation d’une évaluation socialement
légitimée. Ce processus cognitif est d’une grande généralité. On le retrouvera
dans toutes les configurations mettant en avant la liquidité, qu’il s’agisse de
liquidité financière ou bancaire.
* * *
Chapitre IV
LES
TRAJECTOIRES DE LA MONNAIE
Ce chapitre prend
une vue très longue sur le phénomène monétaire. Avant d’en aborder le contenu,
il n’est pas inutile de définir les relations entre théorie et histoire dans notre
conception de la monnaie. Les chapitres II et III ont établi des résultats qui
permettent une interprétation des faits historiques. En retour, on attend d’une
lecture de l’histoire monétaire des enseignements pour développer la théorie
des systèmes monétaires, de leur transformation et de leur fonctionnement. Ce
chapitre fait donc la charnière entre les concepts fondateurs et l’analyse des
institutions monétaires qui est indispensable à l’intelligence des problèmes
contemporains traités dans les trois derniers chapitres.
Les rapports entre
théorie et histoire seront examinés au cours de ce chapitre sous trois
aspects : l’origine de la monnaie, les transformations de la monnaie, les
sources de la confiance dans la monnaie. Des concepts seront construits à
partir de l’analyse historique l’abstraction, la centralisation, la
régulation. Ils sont intermédiaires entre le processus de
l’élection-exclusion qui fonde la monnaie dans son expression la plus générale
et les institutions concrètes dans lesquelles la monnaie remplit ses fonctions
d’opérateur social. C’est à partir de ces concepts intermédiaires que la
diversité des institutions monétaires peut être comprise.
La question de
l’origine est la plus épineuse. Le chapitre II a proposé une genèse théorique de
la monnaie à partir de la séparation marchande. Il a montré qu’une société
marchande ne pouvait exister sans la monnaie. Celle-ci précède donc logiquement
la permanence des rapports marchands stabilisés. Cette proposition théorique
très forte nie donc catégoriquement que la monnaie provienne /124/ d’un
développement de l’économie marchande [la société marchande]. En revanche, elle rend
possible l’hypothèse inverse : la monnaie fonde l’économie marchande
[la société marchande], mais
elle peut exister dans des sociétés où les rapports marchands sont subordonnés,
« encastrés » comme dit Polanyi ; elle peut aussi exister dans
des sociétés qui ne connaissent pas du tout les rapports marchands. Si elle ne
prétend pas faire la genèse historique de la monnaie, notre lecture de
l’histoire cherche à vérifier cette hypothèse : la monnaie précède le
développement de l’économie marchande [la société marchande]. La vérification de cette
hypothèse conforte incontestablement notre position théorique selon laquelle on
ne peut observer des sociétés marchandes que monétaires.
Or, la monnaie
est un fait de civilisation qui a une profondeur de temps vertigineuse. Bien
avant l’invention des pièces frappées au détail dans les cités grecques de la
mer Égée au vie siècle avant notre ère, des traces écrites de
l’époque sumérienne à Ur au IIIe millénaire font état
d’argent frappé à la tête d’Ishtar. C’était la déesse mère, symbole de la
fécondité ; mais aussi la déesse de la mort. Ainsi, l’ambivalence de la monnaie
marque-t-elle dès les origines l’ambiguïté du lien social : medium de cohésion, de pacification dans la communauté, mais aussi enjeu de
pouvoir et source de violence.
Les
transformations de la monnaie constituent le deuxième terrain sur lequel l’histoire
fournit un apport substantiel à notre théorie. C’est même un passage obligé
pour développer la théorie. On a montré au chapitre III que la monnaie ne
supprime pas les contradictions inhérentes au désir de richesse. Mais elles
prennent des formes dans lesquelles elles peuvent se mouvoir, transformant la
violence en dynamique sociale. Ces formes sont celles des monnaies privées
issues de l’endettement. Elles font de la rivalité marchande un rapport
contradictoire entre créanciers et débiteurs. Ce rapport, dont est issu le
capitalisme, est réglé par la monnaie et modifie en retour les règles de sa
souveraineté. Les systèmes monétaires se transforment donc dans le temps. La
question essentielle est alors de savoir si l’essor des rapports marchands dans
le capitalisme donne à ces transformations un sens — à la fois une direction et
une signification — sur une longue période. C’est l’ambition de ce chapitre.
Notre investigation de la longue durée va montrer que la monnaie est un champ
d’innovations où, s’il y a beaucoup de bruit et de fureur, il y a aussi du
sens. Des étapes cruciales pourront être repérées et les conditions monétaires
de la naissance du capitalisme seront identifiées.
/125/ Enfin, notre genèse théorique de
la monnaie a aussi montré que le rapport des membres de la société à la monnaie
est la confiance. En retour, les
sources de la confiance influencent ses formes et leur agencement. C’est sur ce
système de la confiance que se fonde la régulation de la société par la
monnaie. La mise en évidence des modes de régulation dans différents systèmes
monétaires historiques est un apport de ce chapitre, il nous aidera à
comprendre les politiques monétaires contemporaines qui seront étudiées
ultérieurement. En voici l’architecture.
La première
section analyse les avancées de l’abstraction. Elle énonce que la dimension la
plus fondamentale de la monnaie est d’être l’unité de mesure des valeurs. Elle
donne à la monnaie un caractère fiduciaire irréductible. La première
trajectoire historique est donc l’évolution des formes de la confiance.
La deuxième
section étudie la centralisation dans la technologie des paiements. Les
relations d’échange y apparaissent comme des réseaux de réseaux. Ce processus
est perpétuellement renouvelé car l’innovation dans les formes de paiements
subit l’épreuve de leur acceptabilité générale. Le morcellement des moyens de
paiements qui procèdent d’une même unité de compte est surmonté par des
organisations centralisées, lesquelles sont transformées par l’apparition de
nouvelles formes de paiements.
La troisième section évoque les avancées de la régulation. Celle-ci est ancrée dans les systèmes de paiements eux-mêmes et a pour raison d’être la conservation de la confiance. La régulation se déploie dans le temps. La monnaie y est intimement liée au crédit et la confiance s’exprime dans la croyance en une réserve de valeur. La régulation est donc celle de la finance et par son intermédiaire de l’économie dans son ensemble.