← Accueil
|
Les individus collectifs (1992) [1]
Vincent
Descombes
Pour
imprimer en corps 12, échelle 85 %
PHILOSOPHIES DE L’INDIVIDU
ONTOLOGIE DES INDIVIDUS
POLITIQUES
L’APORIE DE LA NATION
LA QUERELLE DE L’INDIVIDUALISME
MÉTHODOLOGIQUE
LE PROBLÈME LOGIQUE DES
INDIVIDUS COLLECTIFS
LA SÉMANTIQUE MÉDIÉVALE DE LA SUPPOSITIO
LA LOGIQUE DITE
« CLASSIQUE » DE L’EXTENSION DES TERMES
COLLECTIONS, ENSEMBLES,
SYSTÈMES
LA COLLECTION,
L’ENSEMBLE ET L’INDIVIDU COLLECTIF
BIBLIOGRAPHIE
Une collection d’individus n’est rien d’autre que le
référent d’une liste de noms.
Ce qui correspond dans la
réalité à un catalogue, ce sont plusieurs objets.
Ces objets ne sont nullement intégrés dans un tout du fait
d’avoir été catalogués.
|
C’est la même chose pour les faits
dits économiques. Qu’ils soient catalogués tels ne signifie pas qu’ils soient
des parties d’un
objet réel nommé « économie ». Ils ne sont que des éléments d’un
ensemble nommé « classe des faits économiques ». C’est un classement
dit Fourquet. C’est une opérateur, dit Willard Quine. Frege
dit : « Une propriété de la langue, néfaste pour la fiabilité de l’action de
penser, est sa propension à créer des noms propres auxquels nul objet ne
correspond. (…) Ainsi, une grande part du travail du philosophe consiste — ou
devrait du moins consister — en un combat avec la langue. » |
PHILOSOPHIES DE
L’INDIVIDU
S’intéresser
aux individus collectifs peut d’abord sembler aussi saugrenu que de s’occuper
de cercles carrés. Comment ce qui est individuel pourrait-il être en même temps
collectif ? Déjà l’étymologie paraît l’exclure : un individu est un
atome, un être indivisible.
Il
est vrai que l’emploi aujourd’hui courant du mot ne correspond plus à la
signification initiale de ce terme chez les philosophes, celle que l’on
retrouve en faisant appel à l’étymologie. Dans le langage ordinaire, l’individu
n’est plus ce qui termine une ligne d’analyse ou une classification : le tode
ti, ou « celui-ci » comme terme ultime d’une descente des
descriptions plus générales vers les plus particulières. Par exemple, on
progresse du général vers l’individuel au sens du philosophe chaque fois qu’on
se voit assigner une place individuelle (cette place, ce siège)
dans un transport où l’on n’avait encore retenu qu’une place (indéterminée).
Mais depuis le XVIIe siècle, lorsqu’on
parle sans plus d’un « individu », on veut dire par là une personne
indéterminée, un échantillon de l’espèce humaine.
Les philosophes tendent à
suivre l’usage commun quand ils traitent de la politique et de la morale. Ils
ont plus de mal à le faire en logique et en métaphysique. Rien du point de vue
logique ne justifie la restriction de l’individualité aux seuls êtres humains.
Ce qui compte ici est la possibilité d’indiquer un principe d’individuation.
La philosophie de la logique appellera « individu » tout ce qui est
susceptible d’une individuation, c’est-à-dire d’une différenciation donnant
lieu à un dénombrement. Par conséquent, on a des individus partout où, dans un
genre de choses donné, on peut dénombrer, dire s’il y a un ou plusieurs
échantillons du genre considéré.
Nous
pouvons donc individuer non seulement les personnes, les bêtes ou les choses
(c’est-à-dire des êtres classiquement rangés dans la catégorie de la
substance), mais aussi des êtres tels que les actions ou les relations. Pour le
logicien, le critère de l’individualité sera la possibilité d’utiliser un terme
singulier pour désigner ce dont on veut parler (à savoir, un nom propre, une
description définie ou un terme déictique). César et Napoléon sont donc pour
lui des individus, puisqu’on peut les nommer. Mais le passage du Rubicon (par
Jules César), le 18 Brumaire (de Napoléon Bonaparte) ou la bataille
d’Austerlitz ne sont pas moins des individus. De même, la relation de mariage
peut être définie en général (pour un couple indéterminé), mais elle peut aussi
être individuée (il n’existe qu’une seule relation de mariage qui soit le
mariage de cet homme et de cette femme).
Le
sens commun moderne s’écarte donc de l’usage des logiciens et des
métaphysiciens lorsqu’il oppose avant tout l’individuel au collectif (et non
plus au général ou à l’abstrait). Désormais, l’individu est moi (chacun
de nous) face à la société, laquelle est appréhendée sous deux aspects
opposés : tantôt comme une pluralité indéfinie d’êtres semblables à ego
(autrui, les autres), tantôt comme un antagoniste menaçant d’usurper mes
prérogatives de sujet conscient et responsable. Dans ce dernier cas, on dit
volontiers la société, l’article défini opérant ici comme une
totalisation du domaine du « non-moi » en un Léviathan formidable.
Si
l’on s’enferme dans cet emploi vulgaire du mot, il nous est évidemment
impossible de parler d’individus collectifs sans susciter des réactions de
défense. Quand l’individualité est fixée au moi et à l’autrui, la
collectivité doit rester une pluralité. Il lui est interdit de se donner pour
unifiable ou intégrable, sous peine de passer pour un organisme monstrueux,
pour quelque super-individu doté d’une conscience et de pouvoirs supérieurs à
ceux de ses membres.
Les
philosophes font profession de critiquer librement le sens commun. Ils
devraient donc être les premiers à rappeler que notre conception de
l’individuel est particulière et récente. Et s’ils négligeaient de le faire
d’eux-mêmes, les anthropologues seraient là pour les réveiller. Ainsi, Louis
Dumont [1975, p. 30-31] oppose l’« univers de l’individu »
(l’univers dans lequel nous nous sentons chez nous) et
l’« univers structural » des sociétés traditionnelles :
« [… ] Notre notion de
l’individu représente le choix d’un niveau privilégié d’où considérer les
choses, tandis que dans un univers structural, il n’y a pas de niveau
privilégié, les unités des divers ordres apparaissent ou disparaissent au gré
des situations. Entre l’unité la plus vaste et la subdivision la plus menue, où
s’arrêter ? Une caste, c’est un peu comme une maison : elle est une
du dehors, comme un bâtiment au milieu d’autres bâtiments ; vous entrez,
et de même que la maison se déploie en un ensemble de pièces, de même la caste
se segmente en sous-castes (etc.) à l’intérieur desquelles on se marie et rend
la justice. Tout est toujours virtuellement un et multiple, c’est la situation
du moment qui réalise l’unité et laisse à l’état virtuel la multiplicité, ou
l’inverse. »
Dumont
oppose ici non des doctrines savantes, mais des représentations
communes. « Notre notion », cela doit s’entendre de la notion dont se
satisfait l’entendement commun d’aujourd’hui. Pour un philosophe, il s’agit (ou
il devrait s’agir) d’une simple doxa. Il lui revient d’examiner cette
opinion pour l’accepter telle quelle ou la corriger selon qu’elle favorise ou
non la clarté conceptuelle.
Or
le moins qu l’on puisse dire est que les questions du tout et de la partie,
de l’ensemble et de l’individu, du plusieurs et de l’un,
sont des questions controversées dans la pensée contemporaine. Certains
philosophes sont « atomistes » ou « nominalistes » :
ils diront que les concepts correspondant à ce que Dumont appelle
l’« univers de l’individu » sont plus clairs que ceux de
l’« univers structural ». Ces philosophes créditent donc
l’entendement moderne d’un progrès général sur les façons de penser
traditionnelles. D’autres philosophes sont « holistes » : pour
eux, les notions « structurales » sont plus rationnelles que les
notions « atomistes ». Ces philosophes font donc cause commune avec
les anthropologues de la « comparaison radicale » [Dumont, 1983,
p. 17] : il s’agit pour les uns et les autres de contester la fausse
évidence (ou le « sociocentrisme ») des notions dont est équipé un
entendement moderne.
Dans
ce texte, j’essaierai d’articuler quelques raisons philosophiques qui militent
en faveur d’une réforme de l’entendement moderne. Dans son article sur
la valeur [ibid., p. 241, note 34], Louis Dumont déplorait la
faiblesse des philosophies contemporaines sur un sujet qu’il leur appartient
pourtant d’élucider :
« Si l’on se tourne
vers nos philosophies avec cette simple question : quelle est la
différence entre un tout et une collection, la plupart sont silencieuses, et
lorsqu’elles donnent une réponse, elle a chance d’être superficielle ou
mystique comme chez Lukacs. »
Le
contexte montre que les philosophies ici visées sont les doctrines néokantiennes
ou hégélianisantes. En fait, les hégéliens comme les néo-kantiens ne
reconnaissent le problème ici posé que sous les formules de la totalisation
et de la coïncidence du sujet et de l’objet. Mais nous ne sommes
peut-être pas condamnés à ressasser indéfiniment les apories de l’idéalisme
allemand. Rien ne nous oblige à penser toute chose en termes du sujet, de
l’objet, de leur opposition et de leur réconciliation éventuelle dans une
« totalité » (qui a toute chance d’être « idéale »). Il y
a, dans la philosophie d’aujourd’hui, la possibilité d’offrir mieux que des
réponses superficielles ou mystiques à la question du statut des individus
collectifs.
ONTOLOGIE DES INDIVIDUS
POLITIQUES
Y
a-t-il une différence entre un tout et une collection, et si oui, quelle est
cette différence ? La question peut être posée sur le terrain de la
logique. On demandera : y a-t-il une différence (affectant la forme
logique) entre une proposition dont le sujet est un tout (par exemple,
« Paris ») et une proposition collective dont le sujet, forcément au
pluriel, est l’ensemble des parties (par exemple, « les vingt
arrondissements de Paris », « les Parisiens »)? Le problème est
de savoir si la différence grammaticale du singulier et du pluriel a également
une signification logique. On se demandera donc si le passage du singulier au
pluriel est toujours possible, ou bien si nous ne devons pas reconnaître
certaines prédications comme ayant pour sujet le tout et non la collection des
parties. Paris est la capitale de
On
pourrait croire que ces questions sont trop spéculatives pour avoir une
incidence sur la réflexion en sociologie et en théorie politique. En fait,
c’est le contraire qui est vrai. Tout raisonnement sur la société et l’État
présuppose une certaine ontologie, c’est-à-dire une certaine façon de donner un
objet aux concepts mêmes de « société » et d’« État ». Chez
les grands penseurs, le moment philosophique devient explicite. Je n’en
donnerai qu’un exemple tiré du Contrat social de Rousseau. Dans sa
démonstration, il arrive à Rousseau de faire appel à des raisons d’ordre
ontologique. Ainsi, il présente un argument contre la doctrine de la représentation du peuple par un souverain
individuel :
« Je dis donc que la
souveraineté n’étant que l’exercice de la volonté générale ne peut jamais
s’aliéner, et que le souverain, qui n’est qu’un être collectif, ne peut
être représenté que par lui-même » [livre II, chap. 1 ; je
souligne].
La
phrase de Rousseau suppose qu’il y ait moins dans un être collectif que dans un
être individuel. Ce n’est d’ailleurs pas assez dire : le collectif n’est
pas seulement moins que l’individuel, il n’est en fait rien d’autre que la
pluralité des individus. Un être collectif (le souverain) se réduit à plusieurs
êtres individuels (les citoyens). Selon cette conception, rien n’est ajouté aux
individus quand on les désigne collectivement. Rien sinon la simple représentation de leur réunion en une pluralité.
L’unité plurielle visée par des expressions telles que « le peuple »,
« le souverain », « la volonté générale », est une représentation et non une res. Le peuple n’a
donc, à part des citoyens, qu’une pseudo-existence. Un nominaliste contemporain
dirait que le peuple ou l’État sont des « réifications » suscitées
par l’emploi des tournures nominalisantes du langage. Rousseau, lui, parle
d’une existence « abstraite » ou « de raison ». Dans la
première version du Contrat social, il écrivait :
« Il y a donc dans
l’État une force commune qui le soutient, une volonté générale qui dirige cette
force et c’est l’application de l’une à l’autre qui constitue la souveraineté.
Par où l’on voit que le souverain n’est par sa nature qu’une personne morale,
qu’il n’a qu’une existence abstraite et collective, et que l’idée qu’on
attache à ce mot ne peut être unie à celle d’un simple individu […
] » [Rousseau, 1984, t. III, p. 294-295 ; je souligne les
termes ontologiques].
Ce
texte tient pour équivalents le collectif et l’abstrait. Entre les citoyens et
le souverain, il n’y a qu’une différence de raison (faite par l’esprit) :
c’est pourquoi le souverain n’a pas d’existence indépendante, sinon par
abstraction. Le souverain, étant une personne seulement morale, ne peut pas
être cherché ailleurs que dans la pluralité des citoyens qui forment ensemble ♦,
collectivement ♦♦, le corps
politique. Quant à la différence qu’il convient de faire entre une personne
naturelle et une personne morale, elle est ici la suivante : la personne
naturelle existe et subsiste comme telle par elle-même, alors que la personne
morale n’existe qu’en un sens dérivé ou fictif, en vertu d’une convention
humaine ♦♦♦. On retrouve
ce contraste entre le naturel et le moral dans un fragment sur l’état de
guerre :
« Au fond, le corps
politique, n’étant qu’une personne morale, n’est qu’un être de raison. Ôtez la
convention publique, à l’instant l’état est détruit sans la moindre altération
dans ce qui le compose ; et jamais toutes les conventions des hommes ne
sauraient changer rien dans le Physique des choses » [ibid.,
p. 608].
|
♦ notez qu’ici, l’adverbe ensemble est malvenu car il contredit le propos de l’auteur : cet adverbe détermine le verbe « forment » : forment comment ? ensemble. Il dénote donc une action collective concrète (comme dans « se promener ensemble », ce qui n’a rien d’abstrait) où les citoyens s’activent à former l’État ♦♦ même remarque pour cet adverbe qui n’est qu’un synonyme d’ensemble. ♦♦♦ notez que chez Lewis les conventions
ne sont pas des conventions, mais des situations. Personne n’a convenu de
quoi que ce soit. Selon Lewis, chez Rousseau non plus les conventions ne sont
pas des conventions mais des conventions au sens de Lewis, c’est à dire des
situations. |
En
fait d’ontologie du corps politique, Rousseau est donc tout aussi nominaliste
que l’était Hobbes ou que le seront les « individualistes
méthodologiques » de nos jours. Pourtant, il faut souligner que le texte
du Contrat social ne représente que la moitié de l’ouvrage projeté par
Rousseau sous le titre des Institutions politiques. Rousseau reconnaît,
dans l’avertissement et dans la conclusion, qu’il manque une deuxième partie
portant sur les « relations externes » de l’État, à savoir « le
droit des gens, le commerce, le droit de la guerre et les conquêtes, le droit
public, les ligues, les négociations, les traités, etc. » [Du contrat
social, livre IV, chap. 9, p. 470]. Il me semble que cette
lacune est très grave, ses conséquences immenses.
Sous
le titre du Contrat social, le public croit le plus souvent trouver un
traité complet de théorie politique. Or Rousseau n’y a exposé que les principes
de la politique interne, c’est-à-dire de celle dans laquelle le corps
politique se présente d’abord comme divisé par les factions et par les
aspirations individuelles. Le problème politique majeur, si l’on se place au
point de vue des « relations internes », est alors de faire naître un
ordre légitime, une sujétion des individus, à partir de la multiplicité
initiale. Mais le lecteur qui ne prendrait pas garde à l’avertissement de
Rousseau – « ce petit traité est extrait d’un ouvrage plus étendu, entrepris
autrefois sans avoir consulté mes forces, et abandonné depuis longtemps »
[ibid., p. 349] – pourrait bien se figurer que le problème majeur
de la politique intérieure est aussi le problème majeur de la politique tout
court. Ce lecteur oubliera que Rousseau n’a traité que d’un moment de la vie
politique, et qu’il manque tout ce qui touche à la politique étrangère, aux
relations entre les peuples. Il manque donc ce que les démocraties ont toujours
eu du mal à concevoir en termes proprement politiques, plutôt qu’en termes
d’échanges commerciaux et humains, ou, sinon, de rapports de force militaire.
La disposition même du traité de Rousseau donne à penser que les
« relations internes » ont la priorité, qu’il faut les poser d’abord,
et qu’on pourra toujours ajouter par la suite des « relations
externes » à l’État une fois fondé. Mais en fait il n’en est rien. Quand
on passe de la vie interne de l’État à sa vie de relation, les choses
s’inversent. Ce qui vient au premier plan n’est plus la pluralité
constitutive de la souveraineté, mais l’unité du corps politique
souverain parmi ses voisins.
Bien
qu’il n’ait pas écrit l’ouvrage complet, Rousseau indique nettement, à
l’occasion, comment d’autres principes devront être introduits pour rendre
compte de la politique extérieure. On sait qu’il écarte la possibilité d’un
engagement irréversible du corps politique, par exemple sous la forme de
l’adoption d’une constitution. L’individu, en contractant, s’engage réellement
et devient un sujet soumis aux lois de l’État. Le souverain, lui, n’est jamais
tenu de respecter une loi, puisque c’est lui qui fait les lois. Rousseau cite
ici l’adage des juristes sur les engagements envers soi-même et montre comment
il s’applique diversement aux sujets et au souverain.
« Chaque individu, contractant,
pour ainsi dire, avec lui-même, se trouve engagé sous un double rapport ;
savoir, comme membre du souverain envers les particuliers, et comme membre de
l’État envers le souverain. Mais on ne peut appliquer ici la maxime du droit
civil que nul n’est tenu aux engagements pris avec lui-même ; car il y a
bien de la différence entre s’obliger envers soi, ou envers un tout dont on
fait partie » [Contrat social, livre I, chap. 7].
L’individu
est réellement sujet à des obligations nées de son contrat, parce qu’il s’est
engagé envers un tout dont il n’est qu’une partie. Mais un État qui se
donnerait une constitution ne ferait, selon Rousseau, que s’engager envers
lui-même. Que Rousseau puisse appliquer ainsi la maxime au cas du souverain
montre qu’il a construit son État dans le vide. L’État engendré par le pacte
social est le seul tout que connaissent les citoyens. Cet État souffre donc des
inconvénients de toute existence solipsiste : il est incapable de fonder
ses lois et ses résolutions sur autre chose que sa propre volonté.
Mais
les choses se présenteraient différemment si l’État était maintenant placé dans
un milieu peuplé d’autres États. L’État pourrait devenir une partie dans un
tout supérieur, dans le cadre d’un pacte international.
« Ne pouvant se
considérer que sous un seul et même rapport il (“le souverain”) est alors dans
le cas d’un particulier contractant avec soi-même : par où l’on voit qu’il
n’y a ni ne peut y avoir nulle espèce de loi fondamentale obligatoire pour le
corps du peuple, pas même le contrat social. Ce qui ne signifie pas que ce
corps ne puisse fort bien s’engager envers autrui en ce qui ne déroge point à
ce contrat ; car à l’égard de l’étranger, il devient un être simple, un
individu » [ibid.].
Cette dernière formule est intéressante :
elle suggère que l’individualité ou la non-individualité sont relatives au
point de vue adopté. On ne peut pas dire de l’État qu’il est
un être abstrait (la pluralité des citoyens concrets) ou un individu dans
l’absolu, hors de tout contexte. Un État peut être considéré isolément, en
faisant abstraction de son milieu externe. Pris ainsi, cet État n’a pas d’autre
principe d’individuation que celui fourni par ses membres ajoutés par la pensée
les uns aux autres. Autrement dit, l’État pris sans son milieu externe ne peut
pas être identifié à part des citoyens. En revanche, le « corps du
peuple » devient un être simple, un individu dans le
contexte des relations externes. Ce qui veut dire que du point de vue de la
politique étrangère, il n’y a plus lieu de tenir compte du caractère collectif
ou composite de l’État. C’est l’État comme tel qui s’engage dans une convention
internationale, ou qui négocie, ou qui fait la guerre. Ainsi, du point de vue extérieur, on ne tient pas
pour équivalents l’État et l’ensemble des citoyens.
Le
seul cas où les gouvernements étrangers s’occupent de ce que disent et veulent
les citoyens d’un État plutôt que de ce que disent et veulent les représentants
légitimes de cet État est le cas où justement cet État est anéanti ou risque de
l’être, que ce soit par une crise interne ou par une conquête extérieure.
Du
point de vue des relations internes entre ses parties, on l’a vu, l’État n’a
qu’une existence « abstraite et collective ». Cela veut dire que les
institutions politiques n’ont d’autre réalité que celle qui leur est conférée
par la volonté et l’activité des citoyens. Pourtant, il ne peut plus en être
ainsi quand nous levons l’abstraction initiale par laquelle le moment interne
de la vie politique avait été isolé. C’est d’un point de vue lui-même abstrait
que l’État fait figure d’entité abstraite. En l’espèce, l’abstraction revenait
à poser le tout de la cité comme l’horizon ultime de la vie des
citoyens. Il s’agit bien d’une abstraction, car le théoricien politique ne va
pas jusqu’à identifier le corps politique et l’univers. Certains anthropologues
appellent « cosmomorphes » les sociétés qui parviennent à se
représenter comme « coextensives à l’univers » [Barraud et alii,
1984, p. 514] parce qu’elles ne se préoccupent pas d’affirmer leur
intégrité et leur rang face à d’autres groupes humains habitant le même
univers. En effet, si l’État conçu par Rousseau était vraiment le tout ultime
au lieu d’être seulement isolé de son milieu, il devrait être cosmomorphe. Cet
État devrait être composé non seulement des citoyens, mais des différents
ingrédients de l’univers, de tout ce qui prend part à la vie universelle. Il
faudrait faire place, dans ces institutions, au soleil, aux plantes, aux eaux,
aux bêtes, aux morts, etc. De telles institutions ne pourraient être qualifiées
de « politiques » dans le sens moderne de ce terme. Dans son ouvrage,
Rousseau ne se propose pas de donner les principes d’un ordre universel, mais
seulement d’un ordre politique, qu’il oppose à celui de l’état de nature.
L’État selon Rousseau sait qu’il est particulier. C’est d’ailleurs pourquoi il
faut le doter d’une « religion civile », c’est-à-dire de cette sorte
de religion qui, « inscrite dans un seul pays, lui donne ses dieux, ses
patrons propres et tutélaires » [Du contrat social, livre IV,
chap. 8, p. 464].
Dans
la partie non écrite du traité de Rousseau, l’État n’aurait pas pu être
considéré comme un simple « être collectif ». La société politique,
dès qu’elle aurait été distinguée d’un monde extérieur et engagée dans divers
échanges avec des partenaires, aurait reçu de la forme de son inclusion dans un
ensemble plus vaste le principe de l’intégration de ses parties contractantes
dans un être unique et identifiable. Une société politique telle que nous la
concevons est individuée par les frontières de son territoire. À l’époque moderne des États
nationaux, la délimitation d’un territoire est justement ce qui permet de
passer de la simple représentation d’une
pluralité (
L’APORIE DE LA
NATION
Vers
1920, Marcel Mauss commence la rédaction d’une grande étude comparative sur la
nation, qu’il laissera inachevée [2]. Ce texte passionnant est riche en
notations utiles pour notre problème. Mauss fait observer que le principe des
nationalités est tout à la fois un phénomène récent dans l’histoire des
sociétés et une donnée à reconnaître pour l’avenir : l’heure est à la
constitution de nouvelles nations, non à l’internationalisme [3].
La formation des nations modernes, explique Mauss, est un phénomène
d’individuation. C’est lui qui emploie ce mot « individuation » pour
désigner deux transformations simultanées qui ont changé les vieilles sociétés
européennes en sociétés nationales. L’une de ces transformations est
interne : c’est la tendance à intégrer directement les individus dans la
nation, et donc à abolir les solidarités intermédiaires de village et de clan,
ainsi que les querelles et les inimitiés qui en résultaient. L’autre est
externe : c’est l’affirmation d’une souveraineté territoriale indivisible,
l’adoption d’institutions et de symboles nationaux (langue, école, droit,
littérature, drapeau, etc.).
L’individuation
de la nation conduit à l’individualisation du type humain présenté par ses
membres, donc leur uniformisation les uns par rapport aux autres et leur
singularisation par rapport aux étrangers.
« Tout, dans une nation
moderne, individualise et uniformise ses membres. Elle
est homogène comme un clan primitif et supposée composée de citoyens égaux.
Elle se symbolise par son drapeau, comme lui avait son totem ; elle a son
culte,
Mauss
ajoute que les sociologues doivent se garder de deux erreurs. La première est
d’attribuer aux sociétés traditionnelles des traits qui sont ceux des nations
modernes, et donc de les « considérer comme plus individuées qu’elles ne
sont » [ibid.]. L’autre erreur est de traiter toutes les sociétés
comme si elles n’en faisaient qu’une, donc de méconnaître la diversité des
individualités nationales dans l’histoire, et, ajoute Mauss, « surtout
dans les temps modernes » [ibid.]. Cette deuxième erreur menace
plus directement le penseur libéral, lequel préfère voir partout des hommes
(des semblables) plutôt que des types nationaux divers. Mauss juge que
l’internationalisme est une illusion, un développement idéaliste de
l’individualisme. En réalité, écrit-il en empruntant le vocabulaire de la
biologie, la vie internationale se réduit à une vie de relation entre sociétés
bien individuées : elle ne donne pas naissance à un individu supérieur
(qui serait quelque chose comme le Grand Être d’Auguste Comte). Or la formule
que Mauss donne de ce fait permet de déceler un paradoxe : « Une
société, c’est un individu, les autres sociétés sont d’autres individus. Entre
elles, il n’est pas possible — tant qu’elles restent individualisées — de
constituer une individualité supérieure » [ibid., p. 606].
L’idée
de Mauss est claire. Il veut dire que l’État mondial est une utopie. Toutefois,
la raison qu’il en donne pose un problème conceptuel, comme le fait remarquer
Louis Dumont. Ce dernier donne cette définition de la nation (en référence à
l’étude de Mauss) : « La nation est le groupe politique conçu comme une collection d’individus
et c’est en même temps, en relation avec les autres nations, l’individu
politique » [1979, p. 379]. Il y a donc, ajoute-t-il, une difficulté
logique : « Il peut sembler y avoir une incohérence logique dans la
conjonction des deux aspects : comment une collection d’individus peut-elle constituer un
individu d’ordre supérieur ? » [ibid., note 7] ♦.
|
♦ Il n’y a
incohérence que si la nation est une collection d’individus. Je ne comprends pas bien si ce point de vue
est celui de l’auteur ou celui qu’il prête à quelqu’un ; c’est en tout
cas celui de Dumont
ce qui est étonnant pour un homme qui dit qu’une caste est avant tout un
état d’esprit et qui ne comprendrait pas que la nation est aussi un
état d’esprit, que la totalité des individus est présente dans chaque
individu où elle agit en permanence, sauf chez les américanistes qui sont
internationalistes et qui prônent la révolution permanente sous le nom de
destruction constructive. En fait ce n’est pas le point de vue de Dumont mais
celui de l’idéologie de la nation qui correspond à l’idéologie de l’individu
(voir ce passage
complet dans les annexes, plus bas). |
Le
paradoxe peut être expliqué historiquement. La nation est un individu
politique : une société se pose comme nation lorsqu’elle réclame une place
à part entière dans le « concert des nations ». En même temps, elle se conçoit comme
composée d’individus. [ Que
faut-il entendre : que la nation se conçoit elle-même ainsi ou que
quelqu’un la conçoit ainsi ? ] Une nation moderne ne cherche
pas à s’identifier par rapport à un ordre universel. Ce qui constitue le groupe
national comme tel n’est pas une religion de ce groupe fixant normativement la
place des éléments du monde dans l’économie du tout. Dans une nation moderne,
il n’est d’autre religion que personnelle : l’ordre politique est devenu
autonome.
L’historien
et le sociologue expliquent comment s’est formée la représentation
paradoxale de la nation. Il reste à savoir si la contradiction relevée
ci-dessus peut être levée. On notera que cette contradiction de la représentation commune se retrouve dans les doctrines
dans lesquelles des philosophes ou des écrivains ont cherché à articuler l’idée
de nation. Les deux doctrines rivales, l’« ethnique » (Herder) et la
« consensuelle » (Renan), s’opposent justement en ce qu’elles mettent
l’accent sur l’un ou l’autre aspect de la représentation
commune. Les auteurs français préfèrent concevoir la nation comme une pluralité
de personnes qui veulent s’associer [ elles
ne veulent pas s’associer, elles naissent associées ].
Comme
l’écrit Dumont :
« Comme dans la
philosophie des Lumières en général, la nation comme telle n’a pas de statut
ontologique ; à ce plan, il n’y a rien, qu’un grand vide, entre l’individu
et l’espèce […]. C’est dire que la nation comme individu collectif, et en
particulier la reconnaissance des autres nations comme différentes de la
française, est très faible au plan de l’idéologie globale » [1983,
p. 129-130 (Seuil, Points,
« Le peuple et la nation chez Herder et Fichte », page 150)].
En
revanche, les auteurs allemands du début du siècle insistaient sur l’individualité
supérieure de la nation. L’aspect de l’individu collectif l’emportait sur celui
de la collection des
individus.
« Finalement,
au-delà de leur opposition immédiate, l’universalisme des uns, le pangermanisme
des autres ont une fonction ou une place analogue. Tous deux expriment une
aporie de la nation qui est à la fois collection d’individus et individu collectif, tous
deux traduisent dans les faits la difficulté qu’a l’idéologie moderne de donner
une image suffisante de la vie sociale (infra et intersociale)» [ibid.,
p. 130-131(Seuil, Points,
« Le peuple et la nation chez Herder et Fichte », page 151)].
On
retrouve dans cette dernière parenthèse l’accent mis par Mauss sur la différenciation
de la vie sociale en vie nationale (homogénéisation) et vie internationale (de
relation, de métabolisme).
LA
QUERELLE DE L’INDIVIDUALISME MÉTHODOLOGIQUE
Au
XXe siècle, les problèmes soulevés par l’emploi des concepts de
« tout » et de « parties » dans les sciences sociales ont
été souvent rassemblés dans une commune discussion portant sur
l’« individualisme méthodologique ». Les écrits de Karl Popper sont
l’expression la plus connue de ce courant de pensée. Philosophiquement, cette
doctrine se donne pour un nominalisme, une position dans la querelle des
« universaux [4] ».
Comme tel, le nominalisme est une thèse relative à ce qui existe (seulement des
individus) et aux formes de description adéquates (en termes singuliers). Mais
le terrain choisi par les nouveaux nominalistes, dans leur polémique contre les
écoles « monistes » et « organicistes », contre les
néohégéliens et les néo-aristotéliciens, est celui de la méthode des sciences
sociales. Dans un discours scientifique qui aurait atteint une pleine clarté
conceptuelle, nous pourrions faire la différence entre les termes du
vocabulaire employé qui ont une référence réelle et ceux qui ne servent qu’à
abréger le discours ou à coordonner les assertions. Or le vocabulaire des
sociologues et des historiens est riche de termes holistes : tantôt comme
termes désignatifs dotés d’une référence (au moins apparente) à des êtres
collectifs (l’État prussien, le Second Empire français, les États-Unis
d’Amérique), tantôt comme prédicats collectifs (« gagner » quand il
s’agit d’une bataille militaire ou d’une épreuve d’un sport d’équipe). Au cours
des controverses, il arrive que les nominalistes se réclament d’un solide bon
sens : on doit, disent-ils, se référer à des choses qui existent, des
choses qu’on peut voir et toucher. Il faut éliminer les entia non grata,
entités mystérieuses ou occultes. Mais on risque alors d’oublier que le
nominalisme, loin de parler au nom d’un bon sens éternel, surgit dans
l’histoire des idées comme une doctrine paradoxale et subversive. Les penseurs
nominalistes proposent une vaste réforme du langage ordinaire et savant,
réforme dont il reste à prouver qu’elle peut dépasser le stade de la simple
déclaration d’intention. La thèse nominaliste est que les termes
« holistes » sont éliminables en principe sinon en fait. Puisque le
tout n’est rien de plus que la sommation de ses parties, il doit toujours être
possible de remplacer une désignation collective par une liste énumérant les
individus concernés. Au lieu de dire : « Les douze Apôtres étaient
présents », on dira : « Pierre était présent et Jean était
présent et… etc. » jusqu’à ce qu’on ait épuisé la liste des douze Apôtres.
Les
sociologues qui acceptent de poser ces problèmes dans les termes polémiques de
Popper sont conduits à voir dans le marxisme la quintessence du holisme. C’est
un grave inconvénient. D’abord, cette simplification du débat empêche de
reconnaître la présence, dans les doctrines de Marx, d’une puissante
inspiration individualiste. On peut même soutenir que, dans l’architecture
générale de l’argument marxiste, la composante individualiste, reçue de la
pensée des Lumières et de l’économie politique, est une pièce plus importante
que les définitions holistes parfois données de l’homme en société [cf.
Dumont, 1977]. De même, Hegel est souvent présenté comme le porte-parole
moderne du holisme ; mais cette vue est « unilatérale », car le
propos [5]
de Hegel est justement de « surmonter » l’opposition entre le point
de vue de la « substance » (holisme) et celui du « sujet »
(individualisme). En second lieu, on perd de vue le contenu du problème posé.
Ce problème ne relève nullement de la théorie politique, d’un choix à faire
entre le libéralisme et le contrôle social. Il concerne bien la méthodologie
des sciences sociales, mais c’est à titre dérivé. En réalité, le problème est
tout à la fois logique et ontologique : quand nous déterminons qu’une
chose x fait partie d’une chose y, quelle sorte de
relation établissons-nous par là entre x et y ?
C’est le concept même de la relation de parties à tout qu’il s’agit ici
d’élucider.
L’exposé
de Popper dans Misère de l’historicisme [1957] montre qu’il ne conçoit
qu’une seule espèce de relation de parties à tout : la relation logique
entre un terme général et les objets contenus dans son extension.
Son programme d’un individualisme
méthodologique repose donc sur une confusion entre les groupes humains et les
ensembles abstraits que définissent les mathématiciens.
[ Excellent ] Si une société pouvait être
assimilée à un ensemble d’individus, la réduction individualiste serait
possible. Mais il faudrait pour cela que cette société soit un objet abstrait,
non une totalité réelle ♦.
|
♦ Les
sociétés ne sont pas des ensembles d’individus. Inversement « la
population » n’est pas un objet réel mais un objet logico-mathématique
qui intéresse les démographes et les statisticiens pour son cardinal et les
cardinaux de ses parties : tant de cul-de-jatte, tant de sourds, tant
d’Arabes, tant de suicides etc… De même que l’ensemble des arbres d’une forêt
n’est pas une partie de la forêt, la population n’est pas une partie de la
société. Étonnant, nan ? Évidemment, les parties de la population ne
sont pas non plus des parties de la société. C’est ainsi, il faudra vous y
faire. Enfin, les démographes et les statisticiens, pris individuellement,
sont des parties de la société, parties pénibles, mais il vaut mieux être une
partie pénible qu’une partie honteuse, tel le cadavre Glucksman. |
Lorsqu’il
introduit la position nominaliste, Popper fait la différence entre les termes
généraux (« universaux ») et les termes singuliers. Il donne les
exemples suivants de termes généraux : « énergie »,
« vitesse », « carbone », « blancheur »,
« évolution », « justice », « état »,
« humanité ». Il dit que les termes singuliers peuvent être traités
comme des noms propres ou des étiquettes conventionnelles. Ses exemples
sont : « Alexandre le Grand », « la comète de
Halley », «
Pour
ce faire, Popper fait appel à la notion d’ensemble ou de classe. La
différence entre les termes singuliers et les termes généraux serait alors la suivante :
a) un terme singulier est un nom pour une chose et une seule ; b) un terme
général est un nom pour plusieurs choses, pour une classe de choses.
Si
ces définitions étaient acceptables, on aurait en effet une ontologie
acceptable pour le nominaliste : dans la réalité que vise notre discours,
il n’y a que des individus. La contrepartie logique de cette thèse ontologique
est, on le voit, le nominalisme même : dans le discours, tous les mots
dotés d’une référence sont des noms, tantôt des noms propres valant pour
une seule chose, tantôt des noms communs valant pour plusieurs choses.
Popper
donne maintenant l’exemple d’un adjectif, le terme « blanc » (alors
qu’il citait tout à l’heure le substantif correspondant
« blancheur »).
Tout
comme le terme « Alexandre le Grand » est attaché à une chose et une
seule, qu’il nomme, le mot « blanc » est attaché à plusieurs choses
qu’il nomme ensemble (à savoir, les choses blanches, telles que ces flocons de
neige, cette nappe, etc.). Pour les nominalistes, écrit Popper, « les
universaux diffèrent des noms propres seulement en ce qu’ils sont attachés aux
membres d’un ensemble ou classe de choses singulières, plutôt
qu’à une chose singulière seulement » [ibid.]. Oui, mais comment le
terme général « blanc » est-il attaché à l’ensemble des choses
blanches ? Ce qui est blanc, est-ce les choses blanches prises
ensemble, donc leur ensemble (comme on dirait l’ensemble innombrable
des choses blanches)? Est-ce que ce n’est pas plutôt chacune des choses
blanches, donc toutes les choses blanches prises une à une
(« distributivement » et non « collectivement », selon la
distinction classique) ? Bien entendu, l’ensemble des choses blanches
n’est pas plus un ensemble blanc que, pour reprendre l’exemple de Russell
[1918, p. 131], la classe des cuillers à thé n’est elle-même une cuiller à
thé. Mais alors, Popper a tort d’écrire : « Il a semblé à ce parti
[nominaliste] que le terme universel “blanc” par exemple, n’était rien d’autre
qu’une étiquette attachée
à un ensemble [ donc
attachée à l’ensemble et non aux éléments de l’ensemble ]
de plusieurs choses différentes — des flocons de neige, des nappes et des
cygnes par exemple » [p. 27].
Car les « étiquettes » qu’on
voudrait attacher à la classe des choses blanches seraient attachées à cette
classe et non pas aux éléments de cette classe. En revanche,
les étiquettes attachées aux éléments de la classe décrivent ces éléments, mais
non leur classe. Autrement dit, Popper oublie ♦
ici qu’un ensemble ne peut pas être réduit aux éléments qui lui appartiennent.
|
♦ « oublie » est un
peut fort, car avant Frege, et même après, presque tout le monde faisait et
fait encore la confusion. J’en profite pour compléter la formule :
« l’ensemble des arbres d’une forêt n’est pas une partie de la forêt »
par cette autre : « Réciproquement : les arbres d’une forêt,
pris individuellement, ne peuvent pas non plus être une partie de leur
ensemble. Seul leur singleton le peut. » Seul un autre ensemble peut
être une partie d’un ensemble et seule une chose peut être une partie d’une
chose. De même, seuls les touts abstraits (les ensembles) sont la somme de
leurs parties (l’union des parties à ne pas confondre avec l’ensemble des
parties) parce que seuls les ensembles ont un cardinal (ce qui n’empêche pas
d’ailleurs que le cardinal de l’ensemble des parties est supérieur ou égal au
cardinal de l’ensemble dont les parties sont les parties. Théorème de
Cantor). Le bœuf n’en a pas, ni la vache. Une vache n’est pas la somme de
ses parties. De même l’ensemble des parties d’une vache n’est pas une vache,
mais il a un cardinal. Le cardinal de l’ensemble des parties d’une vache est
le nombre 373, tout boucher sait cela. |
Il
se trompe s’il croit pouvoir définir l’ensemble par la pluralité des
éléments : ces diverses choses. Un ensemble est un individu abstrait,
le référent identifiable d’un terme singulier ♦. Les éléments de l’ensemble des choses
blanches sont des individus concrets. Un ensemble ne peut pas être blanc, une
nappe ou un cygne ne peuvent pas être dénombrables. Bref, contrairement à ce
que soutient ici Popper, la notion d’ensemble ne peut pas rendre compte du
terme général. La notion d’ensemble, ou de classe, suppose celle du
prédicat ♦♦ : l’ensemble
des choses est l’ensemble des objets (ou surfaces) auxquels s’applique le
prédicat «… est blanc » ♦♦♦. La logique de la prédication précède et rend
compte de la logique des ensembles. C’est parce que nous pouvons appliquer le
terme général « blanc », par exemple à des nappes, que nous pouvons
définir quelque chose comme l’ensemble des nappes blanches et le distinguer de
l’ensemble des nappes de couleur ♦♦♦♦.
|
♦ Ce terme
singulier est aussi un nom propre, mais c’est le nom propre d’une
classe. C’est le fait qu’il soit un nom propre qui entraîne la confusion (Frege).
C’est là que la grammaire n’est pas
comprise. On croit dire une chose, en fait on en dit une autre. On croit
comprendre ce que l’on dit, en fait on ne comprend pas ce que l’on dit, cette
croyance est purement illusoire. Celui qui dit « économie » croit
parler — parce qu’il le veut — d’un être concret. Or il parle en fait
d’un être abstrait. Il trompe en se trompant, d’autant plus facilement que
son interlocuteur ne demande qu’à se tromper sans le savoir. ♦♦ Frege
dit : l’ensemble consiste dans le concept (le prédicat) et non
dans les éléments de l’extension du concept ] ♦♦♦ Frege dit : l’ensemble des
objets qui tombent sous le concept « … est blanc » ] ♦♦♦♦ Frege
dit : l’extension du concept consiste dans le concept et non dans
les éléments |
Lorsqu’il
traite de la logique des termes généraux, Popper croit satisfaire l’exigence
nominaliste en substituant des ensembles aux universaux, de façon à éviter une
référence apparente à des natures ou à des formes. Il ne voit pas qu’il introduit
de ce fait des individus abstraits, ce qu’un nominaliste convaincu ne saurait
accepter [ Bravo ! ] [6].
Mais lorsque Popper en vient ensuite à la méthode des sciences sociales, il
paraît avoir oublié ses distinctions logiques initiales. Nous avons la surprise
de constater qu’il n’assigne plus un objet et un seul aux termes singuliers.
Par exemple, il n’oppose plus le terme général « guerre » et le terme
singulier «
« La plupart des objets
de la science sociale, sinon tous, sont des objets abstraits ; ce sont des
constructions théoriques. (Même “la guerre” ou “l’armée” sont des concepts
abstraits, même si cela doit surprendre certains. Ce qui est concret, ce sont
les gens qui sont tués [the many who are killed], ou les hommes et les
femmes en uniforme.) Ces objets, ces constructions théoriques qui servent à
interpréter notre expérience sont le résultat de la construction de certains modèles
(surtout d’institutions) en vue d’expliquer certaines expériences […] » [ibid.,
p. 135].
Le
nominaliste méthodologique que veut être Popper oublie donc sa logique au
moment de formuler une ontologie nominaliste pour la science sociale. Il ne
sait plus faire la différence entre un terme général (comme l’est l’expression
« la guerre » dans une phrase comme « la guerre est la poursuite
de la politique par d’autres moyens ») et un terme singulier (comme l’est
la définition singulière d’un événement identifiable telle que « la guerre
de 14-18 »). La tâche que se fixe un nominaliste conséquent est d’indiquer
comment descendre du général au singulier : comment échanger une
assertion générale contre une combinaison d’assertions singulières. Or Popper veut rassembler sous
l’unique drapeau du « nominalisme méthodologique » deux entreprises
distinctes : la précédente, dont le but est de descendre, et une autre qui
entend monter des personnes individuelles aux êtres collectifs.
Ce deuxième programme est bien différent : il ne s’agit plus d’éliminer
les prédicats au profit des noms, il s’agit de reconstruire les assertions
portant sur les individus collectifs (l’armée, l’État) en combinant selon les
instructions d’un « modèle » des assertions portant sur les personnes
engagées dans diverses interactions.
Pourtant,
il y a un lien évident entre la méprise logique et la méprise sociologique de
Popper. Dans les deux cas, une assimilation abusive est donnée pour une
solution nominaliste du problème posé. En logique, Popper se méprend parce
qu’il croit pouvoir traiter un terme général d’usage prédicatif comme s’il
s’agissait d’un nom collectif (le nom d’une classe de choses). Il ne voit pas
que la classe des choses blanches, si elle est nommée dans notre discours, doit
l’être par une désignation singulière. Mais si le sujet d’une phrase portant
sur la classe des choses blanches est un nom propre de cette classe, il est
impossible que le prédicat de cette phrase s’applique à la pluralité des choses
blanches prises distributivement. Autrement dit, le verbe de cette phrase sera
au singulier. En sociologie, Popper se méprend lorsqu’il croit pouvoir traiter
les expressions désignant des entités collectives comme s’il s’agissait de
termes généraux. Il ne voit pas qu’il y a une différence logique de catégorie
entre un discours portant sur la guerre en général et un discours portant sur
une guerre nommément désignée. Or cette deuxième erreur est comme un écho de la
première. Par définition, une société humaine se compose de plusieurs
personnes. Comment se peut-il, demande Popper, qu’il y ait à la fois plusieurs
personnes individuelles et en plus la société de ces personnes ? Sa
solution est de dire qu’il en va ici comme des choses blanches : il n’y a
pas, outre les choses blanches, la blancheur.
Popper
croit donc qu’un nom collectif a le même statut qu’une description (telle que
« blanc » pour les choses blanches) s’appliquant à diverses personnes ♦.
|
♦ Ce qui
est confondre une collection et une collectivité. Les
collections ne sont pas des collectivités et les collectivités ne sont pas
des collections. Hélas, l’adjectif « collectif » s’applique indifféremment
aux collections et aux collectivités ce qui est une source supplémentaire de
confusion. |
Il
est probable que ce rangement monstrueux des universaux et des individus
collectifs dans la même catégorie ontologique est facilité par un emploi vicieux
de la notion de relation. On se figure qu’une analyse indiquant une
relation entre différents « termes » est celle qui reflète l’ordre
même des choses. Dans cet esprit, on rendra compte des universaux (la
blancheur) et des sociétés par des relations entre individus. Qu’est-ce que
c’est que cet ensemble des choses blanches ? Ce sont diverses choses qui
ont entre elles une certaine relation (à savoir, la relation de ressemblance
sous l’aspect de la couleur, si on accepte que le blanc soit une couleur).
Mais, demande-t-on, qu’est-ce maintenant qu’une société, par exemple la société
des citoyens français ? À nouveau, ce sont divers individus qui ont entre
eux une certaine relation (la relation du « lien social » ou de la
concitoyenneté). Ainsi, dans l’un et l’autre cas, il n’y a rien de plus dans la
réalité que les individus désignés considérés sous l’aspect de ce qui les relie
pour nous. Par des formalisations de ce genre, on arrive peut-être à donner un
air plausible à l’assimilation absurde d’un tout concret (un peuple) à un objet abstrait (un
ensemble).
Cette
mise en forme, inspirée par l’opposition que faisaient les vieux manuels entre
une « logique des termes » et une « logique des
relations », n’est qu’un pur trompe-l’œil. On fait comme si on s’était
donné d’abord des « termes », en dehors de toute relation ou
disposition mutuelle, par exemple l’ensemble (a, b, c), et
ensuite seulement une relation définie formellement, par exemple la relation «…
est entre… et… ». À partir de là, on obtient diverses possibilités
topologiques, « a est entre b et c », « b
est entre a et c », « c est entre a et b ».
Oui, mais ce n’est pas ainsi que nous déterminons des rapports de ressemblance
ou de concitoyenneté. Où sont les individus nommés « a »,
« b », « c », etc., qu’il aurait fallu se
donner initialement pour fixer ensuite entre eux une disposition qui donnerait
son sens à la ressemblance du blanc au blanc ou à la concitoyenneté du français
au français ? En réalité, une chose qui est blanche est par là même
semblable à n’importe quelle autre chose blanche : on n’a pas besoin pour
déterminer cette ressemblance de désigner les autres choses blanches. Quant au
citoyen français, il est comme tel le concitoyen de tout autre citoyen français,
y compris de ceux qu’on
serait bien en peine de désigner puisqu’ils ne sont pas encore nés.
L’individualisme
méthodologique n’est en aucune façon la solution philosophique à l’aporie qui bloque
l’intelligence moderne des individus collectifs. Il est bien plutôt une
expression particulièrement incohérente de cette aporie.
LE PROBLÈME LOGIQUE DES
INDIVIDUS COLLECTIFS
L’individualisme
méthodologique n’est pas la réponse à la question posée au début du présent
exposé, qui était : la philosophie d’aujourd’hui a-t-elle le moyen de
faire la différence entre une collection et un tout, et par là de fournir un
statut métaphysiquement satisfaisant aux individus collectifs ? On l’a
dit, les néokantiens et les néohégéliens offraient, au début de ce siècle,
leurs réponses à cette question. Mais ces réponses décevaient, puisqu’elles
commençaient par accepter qu’il y ait quelque chose de mystérieux et, au fond,
de contradictoire dans un tout : un tout, nous disait-on, est une
pluralité qui est en même temps une unité. Il était donc juste de qualifier ces
réponses de « mystiques » puisqu’elles revenaient à avouer que la
notion même d’un être composé de parties nous plaçait devant un cas de coïncidentia
oppositorum. Si on tient compte de ce fait, on acceptera certains arguments
critiques de l’individualiste méthodologique, ceux qui ne font qu’exprimer
l’insatisfaction où nous laissent les « hardiesses » spéculatives des
grands systèmes idéalistes. Mais il convient d’ajouter que les prescriptions
méthodologiques de l’individualiste ne règlent rien quant au fond.
Or
ce qui nous sépare des postkantiens tout autant que des classiques de la
philosophie moderne à ses débuts, c’est la logique. Il faut donc revenir aux
deux problèmes (distincts) rencontrés ci-dessus : a) comment doit se faire
la « descente » de la phrase au pluriel (ou proposition générale) à
une combinaison équivalente de phrases au singulier ? b) Comment doit se
faire la « montée » d’une phrase au pluriel assignant un prédicat
collectif à plusieurs individus, à une phrase équivalente au singulier
attribuant un prédicat à un sujet singulier ? Le premier problème est par
exemple, celui du passage d’une prédication portant sur les Apôtres (ou les
hommes) à une prédication portant sur Pierre, Jean, Jacques, Thomas, Mathieu,
etc. Le second problème est par exemple, celui d’une prédication concernant les
Athéniens à une prédication concernant Athènes.
Avant
d’aller plus loin, il importe de noter que la logique, par elle-même, n’a pas à
nous dire ce qu’il y a dans le monde. Elle ne prend donc pas part au débat sur
l’individualisme et le holisme dans les sciences sociales, contrairement à ce
que suggère l’exposé de Popper. Tout ce qu’on peut demander au logicien,
c’est : négativement, d’écarter les formulations incohérentes (donc les
formes invalides de « descente » et de « montée ») ;
positivement, de faire ressortir clairement, par une analyse, ce qui est
impliqué par telle ou telle façon de s’exprimer. Il n’y a donc pas une logique
pour le nominaliste et une autre pour le réaliste (sinon, on ne voit pas quelle
logique il faudrait appliquer dans la querelle entre le nominaliste et le
réaliste). Mais il y a un essai nominaliste de fixer les conditions d’une réduction
des universaux aux individus, un essai réaliste de rendre compte de la
référence des prédicats, enfin un essai individualiste d’éliminer la référence
à des êtres collectifs.
Toutefois,
le fait est qu’il y a eu plusieurs époques de la théorie logique. Et les
philosophes vont être plus ou moins à l’aise dans leur réflexion sur les êtres
collectifs selon le type de logique qu’ils croiront devoir appliquer. Pour
faire ressortir les contraintes qu’impose à un philosophe de l’âge classique
des Temps modernes (XVIIe-XVIIIe
siècle) sa logique (défectueuse), il est nécessaire de comparer brièvement sa
technique d’analyse à celle qu’aurait utilisé un scolastique médiéval et à
celle que nous-mêmes utilisons aujourd’hui.
LA
SÉMANTIQUE MÉDIÉVALE DE LA
SUPPOSITIO
Dans
l’enseignement logique des docteurs scolastiques, les deux problèmes mentionnés
ci-dessus de la « descente » (de l’universel à l’individuel) et de la
« montée » (des parties au tout) reçoivent des solutions distinctes.
En effet, en nous reportant à un traité des termes
« syncatégorématiques », nous apprenons que les termes omnis
et totus ont des propriétés logiques différentes : ils ne fixent
pas de la même façon le mode de référence (suppositio) du terme
(référentiel ou « catégorématique ») auquel ils sont associés [7].
L’étude du terme omnis se fera par l’étude d’exemples scolaires du
genre : Omnis homo praeter Socratem currit. Il s’agit maintenant de
discerner la référence du sujet de cette phrase, et de comprendre le rôle de omnis.
Le mot « Socrate » fait référence à Socrate, et la phrase dit que
Socrate, et lui seul parmi les hommes, ne court pas. De tout autre homme que
Socrate, la phrase dit qu’il court. Le sujet de la phrase « tout homme à
l’exception de Socrate » fait donc référence à tous les individus humains
inclus dans l’univers de discours. Si cet univers est limité par le contexte à
trois personnes, Socrate, Platon et Théétète, alors la phrase précédente
s’échange contre une proposition copulative disant : « Platon court
et Théétète court. » Par conséquent, le terme omnis ajouté à une
proposition indéfinie (Homo currit) change cette dernière en proposition
universelle, dont le sujet possède le mode de référence appelé suppositio
distributiva. Ce qui veut dire que, dans cette phrase, le sujet vaut pour,
ou fait référence à (supponit pro), tous les sujets auxquels il
s’applique comme terme général.
En
revanche, le terme totus ne sert pas à indiquer la suppositio
d’un terme général, de façon à autoriser la descente de la proposition générale
vers les termes singuliers, comme dans l’exemple précédent (« tout homme
court, donc Platon court, etc. »). Totus homo ne veut plus dire
« tout homme », mais « l’homme tout entier ». Il ne s’agit
plus de la relation de l’universel au singulier, mais de la relation du tout et
de ses parties. Le passage du tout à la partie obéit à une autre logique [ inclusion ] que celle
du passage du général au singulier [ appartenance ].
Si on méconnaît cette différence, on va commettre le sophisme dit de la
« division » (ce qui est vrai du tout est vrai de toutes les parties,
prises comme un tout, donc est vrai de toutes les parties, prises
« divisées » ou à part les unes des autres). Si toute la maison (tota
domus) vaut cent livres, cela ne veut pas dire que toutes les pièces de la
maison (omnes partes, quaelibet pars) valent chacune cent livres. Ici,
les écoliers sont normalement invités à s’exercer sur le sophisme
suivant : totus Socrates est minor Socrate.
Prouver
le sophisme suivant : tout Socrate est moins que Socrate. Preuve :
une partie de Socrate est moins que Socrate, et cela est vrai de toutes les
parties de Socrate (tête, pied, etc.), donc toutes les [ chacune
des ] parties de Socrate sont moins que Socrate, et toutes les
parties de Socrate sont tout Socrate, donc, etc.
Ainsi,
la descente de l’universel aux singuliers doit être nettement distinguée
de la division d’un tout en ses parties. Cette remarque suffit à
dissiper les confusions relevées tout à l’heure dans les thèses individualistes.
Mais
ici, il convient d’ajouter que pour certains prédicats, la division suit les
mêmes voies que la descente alors que ce n’est pas le cas pour d’autres.
C’est
ainsi que Pierre d’Espagne distingue deux cas dans son Traité des
distributions. a) Cas où le prédicat a pour sujet direct le tout et pour
sujet indirect les parties dont ce tout est constitué. Exemple d’inférence
valide : toute la maison est chaude, donc cette pièce de la maison est
chaude. b) Cas où le prédicat ne convient pas aux parties s’il convient au
tout. Exemple d’inférence invalide : toute la maison est grande, donc
cette pièce, etc.
Cette
idée qu’il faut distinguer les prédicats de la partie et ceux du tout est
juste. On verra tout à l’heure comment nous la retrouvons aujourd’hui.
LA
LOGIQUE DITE « CLASSIQUE » DE L’EXTENSION DES TERMES
Si
nous passons maintenant aux auteurs des débuts de l’époque moderne, nous
découvrons un paysage fort différent. La doctrine compliquée de la suppositio
des termes a été éliminée, et remplacée par la distinction entre
l’« étendue » de l’idée signifiée par un terme (on dit aussi :
« extension », « dénotation ») et la
« compréhension » de cette idée. Il appartient au logicien de
déterminer quelle « quantité » de l’étendue du terme est prise en compte
dans une proposition. Si c’est toute l’étendue du sujet, la proposition est
universelle. Si c’est seulement une partie de cette étendue du sujet, la
proposition est particulière.
Oui,
mais que va-t-on faire des propositions qui ne sont ni universelles, ni
particulières ? Comment convient-il d’analyser les propositions dans
lesquelles on ne trouve pas explicitement un « signe de quantité »
(comme « tout » ou « quelque ») ? La réponse de la
nouvelle logique est qu’il faudra fournir ce signe, de façon à pouvoir revenir
à l’un ou l’autre des cas pertinents pour une inférence syllogistique : le
sujet est pris selon toute son étendue, ou bien il est pris selon une partie
indéterminée de son étendue.
Une
première espèce de proposition à réduire est la proposition singulière.
Voici
comment les logiciens de Port-Royal disent qu’il faut la traiter :
« Que si le sujet d’une
proposition est singulier, comme quand je dis Louis XIII a pris
Cette
décision de tenir la proposition singulière pour une proposition quasi universelle
n’est d’ailleurs pas une invention d’Arnauld et Nicole [8].
Elle
a une conséquence grave : il faut maintenant comprendre la phrase
« Louis XIII a pris
Mais
que faire maintenant dans le cas plus difficile encore de la proposition qui a
pour sujet un nom collectif ? À la différence des « individualistes
méthodologiques » contemporains, les auteurs de Port-Royal aperçoivent
bien la difficulté, et ils admettront d’ailleurs la fragilité de leur solution.
Voici
pourquoi les propositions collectives échappent à l’alternative de l’universel
et du particulier :
« Les noms de corps,
de communauté, de peuple, étant pris collectivement, comme ils le
sont d’ordinaire, pour tout le corps, toute la communauté, tout le peuple, ne
font point les propositions où ils entrent proprement universelles, ni encore
moins particulières, mais singulières. Comme quand je dis : les Romains
ont vaincu les Carthaginois, les Vénitiens font la guerre au Turc, les juges
d’un tel lieu ont condamné un criminel,
ces propositions ne sont point universelles ; autrement on pourrait
conclure de chaque Romain qu’il aurait vaincu les Carthaginois, ce qui serait
faux. Et elles ne sont point aussi particulières : car cela veut dire plus
que si je disais que quelques Romains ont vaincu les
Carthaginois ; mais elles sont singulières, parce qu’on considère chaque
peuple comme une personne morale dont la durée est de plusieurs siècles, qui
subsiste tant qu’il compose un État, et qui agit en tous ces temps par ceux qui
le composent, comme un homme agit par ses membres » [ibid.,
p. 204].
Les
logiciens de Port-Royal reconnaissent l’irréductibilité de la proposition
portant sur un être collectif. C’est une manière indirecte de réintroduire une
différence entre omnis et totus. Ce qu’on dit de tout le peuple
romain, on ne le dit pas pour autant de tout Romain (au sens de chaque
Romain). Non seulement la victoire de Rome sur Carthage n’est pas une somme de
victoires personnelles, mais bien des Romains n’ont jamais pris part aux
combats contre Carthage. Mais on ne veut pas dire non plus qu’un groupe
d’hommes, qui étaient tous des Romains, ont vaincu des Carthaginois. La
solution d’Arnauld et Nicole est de reconnaître dans la proposition à nom
collectif une proposition singulière. Solution impeccable du point de vue
logique : ici, le pluriel « les Romains » vaut pour le singulier
« Rome ».
La
phrase attribue une victoire à la nation romaine, victoire qu’il n’est pas
question de « distribuer » entre les citoyens puisque le mot
« Romain » ne signifie pas ici la qualité générale de citoyen romain
(terme universel), mais sert à former le nom collectif de tout un peuple.
Or
cette solution logique irréprochable pose à nos auteurs un problème
métaphysique. Ils voient l’analogie avec le corps humain et acceptent de parler
de « personne morale ». Il en va ici comme des actions humaines :
dans certains cas, l’action accomplie par un seul membre du corps vaut pour une
action de l’homme tout entier (totus homo). Quand le bras armé de Brutus
frappe César, ce geste d’une partie du corps de Brutus est une action de
Brutus. Pourtant, si les logiciens de Port-Royal acceptent en somme le holisme
dans leur logique, ils ont du mal à lui trouver une référence dans la réalité.
Dans le discours, nous parlons de Rome comme s’il existait un tel être
subsistant pendant plusieurs siècles. Mais il s’agit pour eux d’une convention.
Dans la réalité, il n’y a que des Romains. C’est pourquoi Arnauld et Nicole
concluent leur chapitre par une leçon morale sur la vanité du sentiment
national :
« Et c’est ce qui fait
voir sur quoi est fondée la vanité que chaque particulier prend des belles
actions de sa nation, auxquelles il n’a point eu de part, et qui est aussi
sotte que celle d’une oreille, qui étant sourde se glorifierait de la vivacité
de l’œil, ou de l’adresse de la main » [ibid.].
Il
y a donc un écart entre l’ordre des mots et l’ordre des choses. C’est ce qui
ressort très clairement des remarques qu’ils font sur les « sujets
confus » de certaines propositions :
« Auguste disait de la
ville de Rome, qu’il l’avait trouvée de brique, et qu’il la laissait de marbre
[…] Quelle est donc cette Rome, qui est tantôt de brique, et tantôt de
marbre ? […] Cette Rome qui était de brique, était-elle la même que
Rome de marbre ? Non ; mais l’esprit ne laisse pas de former
une certaine idée confuse de Rome à qui il attribue ces deux qualités,
d’être de brique en un temps, et de marbre en un autre » [ibid.,
p. 195].
Pour
Arnauld et Nicole, la déclaration d’Auguste ne porte pas sur un seul et même
objet, qui serait la ville de Rome à travers ses métamorphoses, mais sur deux objets
représentés confusément comme un seul. Ils refusent de reconnaître à une ville
une réalité qui lui permettrait de survivre à une complète rénovation de ses
parties composantes.
Si
nous acceptions leur raisonnement dans le cas de Rome, tantôt construite en
brique et tantôt en marbre, il faudrait adopter le même point de vue matérialiste dans les autres
exemples cités au même chapitre. Un de ces exemples est la vieille difficulté
du flux : « Cette eau, disons-nous aussi, en parlant d’une
rivière, était trouble il y a deux jours, et la voilà claire comme du
cristal. » La contradiction n’est qu’apparente, disent-ils, puisqu’il ne
s’agit pas de la même eau. Mais ils négligent de noter ceci : l’exemple
suppose qu’on parle de la même rivière, et c’est d’elle qu’on veut dire
qu’elle est passée du trouble au clair. Ils sont comme éblouis par l’évidence
d’une identité matérielle d’un cours d’eau : cette rivière est un tout
composé de cette masse d’eau. Mais on peut très bien parler d’une rivière, la
même, sans s’occuper spécialement de la masse d’eau qui la constitue
matériellement à telle ou telle date. Ce qui importe alors est le cours
que suit une masse d’eau indéterminée, ou même le cours que pourrait suivre une
masse d’eau s’il y en avait une (dans l’hypothèse où la rivière est à sec). Il
s’agit alors de l’identité formelle ou structurale de la rivière, l’identité de
son cours géographique, laquelle est définie pour une certaine quantité d’eau
en général, et non pour telle ou telle partie individuellement désignée. Les
auteurs de Port-Royal sont décidément, pour reprendre les termes de Louis
Dumont, des citoyens de l’« univers de l’individu », étrangers aux
formes de pensée de l’« univers structural ».
Plus
grave encore est le cas de l’organisme vivant et de son métabolisme :
« Nous considérons le
corps des animaux et nous en parlons comme étant toujours les mêmes, quoique
nous ne soyons pas assurés qu’au bout de quelques années il reste aucune partie
de la première matière qui le composait […] Car le langage ordinaire permet de
dire : le corps de cet animal était composé il y a dix ans de certaines
parties de matière ; et maintenant il est composé de parties toutes
différentes. Il semble qu’il y ait de la contradiction dans ce discours :
car si les parties sont toutes différentes, ce n’est donc pas le même
corps » [ibid., p. 40].
Ici
encore, les logiciens de Port-Royal n’ont d’yeux que pour l’identité matérielle
d’un individu, donc d’une identité qui ne peut être que synchronique.
Ils ne savent donc pas définir une identité diachronique des êtres
matériels. Puisque ces êtres sont dans un état de flux, ils ne sont que
partiellement les mêmes d’un instant à l’autre, et ne jouissent d’une identité
pleine qu’à la faveur de nos représentations confuses.
Pourtant, dès qu’on introduit le concept d’une identité formelle ou structurale
pour les êtres matériels, la difficulté disparaît. Non seulement l’être composé
peut subsister (rivière) ou vivre (animal) en dépit de ce constant
renouvellement de ses parties, mais s’il se maintient le même au travers des
vicissitudes de son histoire, c’est grâce au métabolisme. Pour rendre
compte de ce fait incontestable, il convient donc d’appliquer ici les
distinctions classiques appliquées au vieux cas d’école discuté depuis les
Grecs : le bateau de Thésée qu’on ne cesse de réparer, de sorte qu’il ne
reste finalement plus une seule planche de la construction initiale, est-il ou
non la même chose au début et à la fin ? Solution : on écarte la
formule « la même chose », qui est équivoque, et on répond que c’est le
même bateau (défini comme construction ou structure), mais que ce n’est pas
la même collection de planches [9].
On
aperçoit comment les deux solutions offertes au problème posé par les
propositions dont le sujet n’est clairement ni particulier, ni universel,
finissent par interférer et créer un embarras pour l’analyse logique. La
proposition à sujet collectif est une proposition singulière. Oui, mais il a
été décidé de traiter la proposition singulière comme une proposition
universelle (pour faciliter les calculs syllogistiques). Par conséquent, le
sujet collectif, bien qu’il ne soit pas « universel » ou pris
« selon toute l’étendue » du terme général, sera pourtant traité
comme un sujet universel. Les Romains, pris collectivement, sont Rome
et non tous les Romains. Mais voici que Rome, à son tour, reçoit
un signe de quantité : « Rome » est lu comme tout Rome.
Or
que serait une partie du peuple romain sinon quelques citoyens romains ?
On est donc inévitablement conduit à se demander comment tous les citoyens
romains (tout Rome) peuvent être distingués de tous les Romains : comment
ce qui est vrai de tout Rome pourrait manquer d’être vrai de tous les Romains.
L’idée
que la proposition singulière ait quelque chose à faire avec l’universelle ne
cessera de produire des difficultés philosophiques. On sait comment Kant (qui
raisonne lui aussi dans le cadre de cette logique de l’extension des termes)
distingue trois « catégories de la quantité ». Il les dérive des
trois statuts possibles du sujet de la proposition, ce dernier pouvant être
universel, particulier ou singulier. Kant refuse donc, et fort justement, la
réduction classique de la proposition singulière à l’universelle.
Pourtant,
il en retient quelque chose. On a en effet la surprise de le voir faire
correspondre la catégorie de l’unité au jugement universel et celle de totalité
au jugement singulier. Pourquoi n’a-t-on pas l’inverse ? Pourquoi le
concept d’un n’est-il pas dérivé de la forme singulière du jugement, et
le concept de tout de la forme des jugements contenant le mot
« tout » (omnis) ?
Parce
que, explique Kant, « la totalité n’est pas autre chose que la pluralité
considérée comme unité » [Critique de la raison pure, § 11,
B 111]. Autrement dit, la troisième catégorie de la quantité est celle
d’un tout collectif (totus homo) e t non d’un tout distributif (omnis
homo). La « pluralité » qu’il s’agit de penser comme
« unité » n’est pas celle des échantillons d’un certain genre, mais
celle des parties d’un tout intégral. Mais, dans le même temps, Kant veut que
ce tout soit seulement une somme, puisqu’il dit qu’à cette catégorie de la
totalité appartient le concept de nombre.
Ainsi
que le souligne Kant lui-même, ce concept de totalité est foncièrement
« synthétique » : il doit unir en une seule détermination
intelligible les deux concepts d’abord opposés d’un et de plusieurs.
Il y a ici une impasse dont les idéalistes postkantiens ne parviendront pas à
sortir. Toute la réflexion sur les totalités sera chez eux affligée d’une
condition « synthétique » (ou même « dialectique »). Si on
veut concevoir un tout selon la catégorie kantienne, il faut se le représenter
à la fois comme plusieurs choses, ou plusieurs étapes d’un développement, ou
plusieurs aspects, et compter la pluralité de ces choses comme une seule
chose, la suite de ces étapes comme un seul procès, la diversité de ces aspects
comme une seule détermination. Pour se donner la pluralité, on a besoin du
terme général qui donne la description de chaque échantillon du genre, donc de
tous les échantillons. Mais pour concevoir plusieurs choses comme une seule, on
doit passer au sens collectif du tout, distinguer les parties d’un individu
complexe et le tout de cet individu. Pour concevoir une totalité selon les
instructions de la table kantienne des catégories, il faudrait avoir affaire
simultanément à un genre et à un individu, à quelque chose qui
serait à la fois omnis homo et totus homo, tout homme et un homme
total (intégral). C’est donc ici que prennent naissance certaines des apories
les plus célèbres de l’idéalisme : celle de l’« universel
concret » ou de l’« individu universel », et, pour que le sujet
connaissant soit capable de saisir de telles totalités, celle de
l’« intuition intellectuelle » ou du « savoir absolu ».
En
fait, celle des catégories kantiennes qui est la plus parente du concept de totus,
de tout intégral, est le concept de communauté (Gemeinschaft).
Kant
appelle relation de communauté cette relation qui lie les parties
interdépendantes au sein d’un système d’action réciproque. On pourrait même
aller jusqu’à dire que le contraste entre la catégorie de totalité et celle de
communauté reflète, jusqu’à un certain point, l’opposition du point de vue
individualiste et du point de vue holiste. Car la notion kantienne d’Allheit
ne fait qu’exprimer l’embarras de toute pensée qui, s’étant donné d’abord un
univers fait d’atomes indépendants (les « unités »), cherche ensuite
à les réunir. Si dix individus sont pris ensemble et considérés, selon la
catégorie de la totalité, comme une « unité », il semble que nous
trouvions maintenant onze individus (les dix individus du début et l’individu
collectif qu’est leur tout). Mais s’il y a onze individus dès qu’il y en a dix,
alors il y en a douze, et ainsi de suite. En revanche, la catégorie de Gemeinschaft
est plus favorable à une approche holiste des choses. Elle permet, mais
seulement jusqu’à un certain point, de concevoir un « univers
structural ». Seulement jusqu’à un certain point, comme on va le montrer
directement, et cette limite propre au concept kantien de détermination
réciproque est aussi celle d’une certaine version de l’analyse structurale, à
laquelle on peut donner le nom, pour fixer les idées, de structuralisme « saussurien »
(ou « phonologique »).
On
sait que Kant tire sa catégorie de communauté de la forme du jugement
disjonctif. Une telle dérivation serait inintelligible si nous cherchions effectivement
à trouver un lien entre la notion d’action réciproque et la forme logique d’une
proposition disjonctive notée « p ou q ou r ou…
etc. ». Mais en fait, Kant appelle jugement disjonctif ce qui est plutôt
un jugement catégorique avec prédicat complexe disjonctif, dont la forme
sera : « x est F ou G ou H ou…
etc. ». Or cette dernière forme va intéresser vivement Kant et ses
successeurs, pour la raison que donne Kant lui-même : elle permet de
penser une coexistence des êtres par coordination plutôt que subordination
[ibid., B 112]. Kant paraît avoir dans l’esprit le contraste
suivant : tantôt la détermination d’un genre de choses se fait par une
série de descriptions subordonnées, tantôt elle se fait par disjonction
exclusive. Les classifications naturelles donnent un exemple du premier type de
détermination (par subordination) : un A est un B, un B
est un C, un C est un D, de sorte que x, s’il est
un A, est un B, donc un C, donc un D. L’autre type
de détermination (par coordination) rassemble sur un pied d’égalité des
descriptions exclusives les unes des autres : x doit être ou bien
un A, ou bien un B, ou bien un C, ou bien un D, de
telle sorte que s’il n’est ni un B, ni un C, ni un D, il
est nécessairement un A. Comme on voit, la notion d’une détermination de
la nature de quelque chose par coordination de concepts exclusifs les uns des
autres peut nous mettre sur la voie de l’analyse structurale d’un système. La
disjonction prédicative complexe de Kant devient le jeu des oppositions
distinctives dans une théorie « saussurienne » des systèmes.
Dans
un système d’éléments (a, b, c), la valeur de l’élément
noté « a » est déterminée par le fait que a se distingue à la
fois de b et de c. Dans l’analyse structurale
« classique », il en va comme chez Kant : les oppositions
distinctives sont coordonnées, de telle sorte que le travail de caractériser un
individu à l’aide du système structuré revient en effet à lui attribuer un
immense prédicat disjonctif composé de descriptions définies. On aura
par exemple trois possibilités : être un A, être un B,
être un C. On aura ensuite une détermination circulaire ou
« diacritique » de ces descriptions : pour être un A,
il faut n’être ni un B, ni un C, et il n’y a qu’un seul
A dans le système ; de même, pour être un B, il faut, etc.
(On illustre aisément cette conception du système par l’exemple du système de
l’alphabet : il suffit de reprendre ce qui précède littéralement, et de
dire qu’il n’existe qu’une lettre « A » dans le système, et qu’elle a
pour signalement de n’être ni « B », ni « C », etc.)
Le
schéma conceptuel appliqué ici peut être figuré graphiquement par une série de
cases alignées ainsi :
|
A |
B |
C |
Or la faiblesse d’une telle méthode
d’analyse structurale est qu’elle nous oblige à nous munir d’emblée du prédicat
disjonctif ultime, celui qui permet d’identifier un individu et une
position dans le système. Puisque les « éléments » du système (les
concepts coordonnés de Kant, les unités diacritiques du structuraliste) sont
alignés, nous ne pouvons pas représenter la façon dont nous avons construit
cette disjonction prédicative. Mais dès que nous voulons représenter aussi la
construction (ou structure) du prédicat, et pas seulement sa systématicité (le
fait qu’il est exhaustif), nous devons réintroduire un ordre de
subordination. Qui plus est, nous ne sommes plus tenus de ne donner que des
descriptions définies. Le système n’a pas besoin d’être composé d’unités
atomiques, puisque les descriptions sont maintenant étagées selon les
différentes étapes de l’analyse, par une démarche du genre suivant :
premier niveau de
description : l’objet x est un A ou un f ;
deuxième niveau : si x
est un f, il est un B ou un C.
La
figuration graphique serait alors celle d’un arbre dichotomique, ou bien, si
l’on conserve l’image de cases juxtaposées, celle d’une série de cases de
taille décroissante :
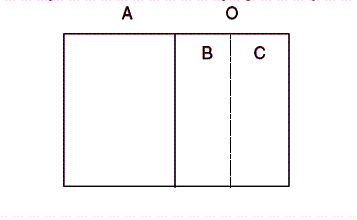
Pour
emprunter son vocabulaire à l’anthropologue, on dira que les concepts entrant
dans une disjonction kantienne ou les unités diacritiques du structuraliste
sont équistatutaires. En revanche, la deuxième méthode d’analyse
présentée ci-dessus combine l’opposition distinctive (équistatutaire) et l’opposition
hiérarchique [10].
Il va de soi que cette dernière sorte de distinction n’offre aucun sens tant
qu’on en reste à la représentation par
coordination.
En
effet, il nous faut maintenant dire qu’il y a opposition distincte ou
équistatutaire entre un A et un f, ou bien encore entre
un B et un C, mais qu’il y a opposition hiérarchique
entre un B et un f. Mais alors, demandera-t-on, si un
objet x n’est pas un A, et s’il est un B,
il sera opposé hiérarchiquement à lui-même ? Il le sera certainement. Ce
qui montre que l’analyse structurale enrichie de l’opposition hiérarchique ne
vise pas à classer des individus en les identifiant à des positions
diacritiques définies dans le système. Elle vise à représenter l’organisation
d’un système de descriptions. Les individus ne répondent pas une fois pour toutes
à une description, mais passent d’une description à l’autre selon les
circonstances. Soit l’illustration grossière suivante : dans un tournoi
national d’échecs, les équipes locales s’affrontent, puis fusionnent pour
former une équipe régionale chargée d’affronter l’équipe de la région voisine.
Si quelqu’un est un C, il applaudit d’abord l’équipe des C
dans sa partie contre l’équipe des B, puis se redécrit lui-même
comme un f pour applaudir son équipe des f contre l’équipe
des A.
Si
nous passons maintenant de la table kantienne des formes de jugement à celle
des catégories, nous faisons la même observation. La catégorie de Gemeinschaft
est définie par Kant de façon à pouvoir rendre compte d’un système de
coexistence au sens de la mécanique newtonienne. Le système solaire est une
« communauté » dans la mesure où le mouvement de chaque planète est
commandé par les interactions gravitationnelles au sein du système. Mais cette
catégorie ne permet pas de caractériser la dépendance réciproque des parties
d’un système organisé. Pour qu’il y ait organisme, la coordination des
existences ne suffit pas, il faut aussi cette intégration hiérarchique des
fonctions que Kant tente de penser sous le nom de « finalité
interne ».
|
♦ Le
système solaire est bien un système concret, mais il n’est pas un
système collectif. Les planètes sont incapables de tourner ensemble et
pourtant, elles tournent. à ce sujet, voir mes notes de lecture de mai 2006. |
COLLECTIONS, ENSEMBLES,
SYSTÈMES
Il
reste à se demander ce qui correspondrait, dans la logique moderne
(c’est-à-dire celle qui est issue de l’œuvre de G. Frege), à cette
opposition du général (omnis) et du global (totus). On vient de
voir que la logique traditionnelle avait du mal à faire clairement cette
différence. La notion confuse d’une extension du terme et la tendance à
ignorer la différence de la proposition générale et de la proposition singulière,
faisaient qu’on risquait toujours de prendre la division d’un tout pour la
distribution d’une propriété.
Ces
difficultés n’existent plus pour le logicien contemporain. De façon générale,
notre logique rend impossible l’assimilation d’une proposition portant sur une
chose individuelle à une proposition portant sur une propriété commune. La
raison en est que le point de vue du logicien sur la phrase est
structural : les mots ne composent pas la proposition par simple
coordination, mais par subordination.
Dans
un article célèbre, le théoricien de l’intelligence artificielle Herbert Simon
a proposé de distinguer deux types possibles de formation d’un système
complexe : directement, par simple coordination des éléments les uns aux
autres, ou par étapes. Il va de soi que la construction d’un système complexe
est plus facile par la deuxième méthode, celle qui consiste à réunir les pièces
élémentaires dans des sous-systèmes, qu’on rassemble ensuite dans des systèmes
de niveau supérieur, jusqu’à ce qu’on obtienne le système final. Dans ce cas,
la genèse du système reflète son organisation hiérarchique, en entendant ici
par « hiérarchie » un ordre de complexité :
« Par un système
hiérarchique, ou hiérarchie, j’entends un système qui est composé de
sous-systèmes liés entre eux, chacun d’eux étant à son tour de structure
hiérarchique, jusqu’à ce que nous arrivions à quelque niveau inférieur de
sous-systèmes élémentaires. Dans la plupart des systèmes naturels, il est
quelque peu arbitraire de savoir où doit s’arrêter la division et quels
sous-systèmes doivent être tenus pour élémentaires. Il est vrai que la physique
fait un grand usage du concept de “particule élémentaire”, mais ces particules
ont une tendance surprenante à ne pas rester bien longtemps élémentaires [11] »
Simon
ajoute qu’on peut appeler « système simple » celui qui présente
l’organisation hiérarchique la plus plate. Il donne pour exemple une chaîne de
polymérisation : des éléments identiques (les monomères) s’associent
indéfiniment les uns aux autres le long d’une chaîne dotée d’une stabilité
relative.
Si
l’on retient ces distinctions, on peut caractériser ce qui fait l’originalité
de la logique moderne. Alors que la logique traditionnelle traitait la
proposition comme un polymère, notre logique lui reconnaît une structure plus
complexe. Et, en effet, dans les vieux manuels de logique, la forme logique par
excellence, celle sur laquelle on travaille, est donnée par le trop célèbre
schéma « sujet-copule-prédicat ». Le « sujet » et le
« prédicat » sont des « termes » qui peuvent échanger leurs
places autour de la copule au prix de quelques modifications dans les
« signes de quantité ». La phrase est donc bien quelque chose comme une
chaîne constituée d’éléments identiques, au moins quant à la fonction,
qu’associe un à un le même lien copulatif. Dans la logique traditionnelle, la
copule est ce mortier qu’il faut glisser entre les briques pour obtenir le mur,
soit ici la proposition.
En
revanche, la nouvelle logique se passe de copule. Son but est de représenter
clairement, par un symbolisme artificiel, la complexité logique de la
proposition. Comme l’indique Michael Dummett dans un chapitre de son livre sur
Frege intitulé justement « La hiérarchie des niveaux » le logicien insiste
sur la hiérarchie des types logiques d’expressions parce qu’il veut trouver des
parties logiques intermédiaires, entre le niveau le plus élémentaire des mots
et le niveau le plus élevé de la proposition complète. Pourquoi ces unités
intermédiaires ? « La raison en est évidemment que la phrase est
construite par étapes » [Dummett, 1973, p. 35]. La phrase est donc un
système doté d’une structure qui est toujours complexe. Contrairement à
ce que soutenait l’analyse traditionnelle, les propositions catégoriques
élémentaires elles-mêmes ont une structure complexe. Alors que l’ancienne
logique nous demandait d’analyser « Socrate marche » selon le schéma
« terme-lien-terme » « (Socrate-est-un-marchant »), la
nouvelle analyse reconnaît dans cette phrase deux parties hétérogènes (la
fonction et l’argument). Mais la différence entre les deux analyses est encore
plus évidente dans le cas de phrases complexes. Dummett rappelle l’exemple de
Frege [1969, p. 170] : « Le carrosse de l’empereur est tiré par
quatre chevaux. »
Le
grammairien, quelle que soit sa doctrine, reconnaît la complexité de cette
phrase. Les différents mots forment d’abord des groupes ou des syntagmes avant
d’entrer dans la composition de la phrase. Le logicien traditionnel, lui, croit
pouvoir ignorer cette complexité. Il décidera vraisemblablement de voir dans
cette phrase l’expression d’un jugement de relation, « le carrosse de
l’empereur » donnant un terme, « quatre chevaux » donnant
l’autre terme, le reste de la phrase indiquant la relation. Pour Frege, cette
analyse a le défaut de ne pas mettre en évidence la différence entre
l’opérateur principal et les opérateurs subordonnés de cette phrase. Si l’on
voulait nier cette proposition, sur quoi faudrait-il faire porter la négation ?
Pas sur le verbe, mais sur l’attribution du nombre. Ainsi, le groupe
grammatical « quatre chevaux » ne forme pas une unité logique,
contrairement à ce que suggère l’association d’un adjectif et d’un substantif.
En fait, la phrase répond à la question : combien y a-t-il de chevaux
tirant le carrosse de l’empereur ? Selon cette analyse, le nombre
« quatre » est un prédicat de deuxième ordre, ou prédicat de
prédicat, qui attribue une propriété à la propriété qu’indique le prédicat
«… est un cheval tirant le carrosse de l’empereur ».
Ce
progrès dans l’analyse met fin à l’oscillation antérieure entre le tout pris au
sens d’omnis et le tout pris au sens de totus. On ne risque plus
de confondre le tout logique et le tout réel. Ici encore, on peut reprendre un
exemple de Frege [12] :
quelle différence y a-t-il entre une forêt et ce que le mathématicien appelle
un ensemble d’arbres ? La différence est que la forêt peut brûler, mais
non l’ensemble des arbres de la forêt. Si des arbres brûlent, la forêt brûle en
partie. Si tous les arbres de cette forêt brûlent, la forêt brûle complètement.
Seul peut brûler un objet matériel combustible. Le bois peut brûler, qu’il se
présente à nous comme buisson, arbre, bosquet, futaie, forêt. Si l’ensemble des
arbres d’une forêt ne peut pas brûler, c’est que justement cet ensemble n’est
pas constitué par des objets réels en bois, les arbres, mais qu’il est
construit, à titre d’objet abstrait, par une opération logique. À coup sûr, le
langage ordinaire ne fait pas la différence entre une forêt et un ensemble
d’arbres. Mais le terme logico-mathématique d’ensemble doit être pris au sens
fixé par la théorie des ensembles, pas au sens ordinaire.
En
exploitant cet exemple de Frege, on pourrait dire que l’analyse traditionnelle
parvient mal à distinguer les deux phrases suivantes : tous les arbres de
la forêt ont brûlé – toute la forêt a brûlé.
L’ancienne
logique traite l’expression « tous les arbres de la forêt » comme une
unité logique, ce qui renforce l’impression d’une équivalence avec la notion
d’une forêt. Dans cet exemple, il se trouve que coïncident une proposition
universelle en omnis (« tout arbre de la forêt a brûlé ») et
une proposition singulière en totus (« la forêt tout entière a
brûlé »). Mais la coïncidence n’est pas formelle : elle est due à
l’exemple. Elle ne permet donc pas d’assimiler les deux formes logiques (pas
plus que le fait que 2 + 2 =
2 x 2 n’autorise à assimiler les deux
opérations de l’addition et de la multiplication).
Frege,
dans son article, fait ressortir ainsi la différence qui nous occupe :
a)
Une forêt est un exemple de ce qu’il appelle des « touts collectifs »
(kollektiveGanze). Il donne dans la même page un autre exemple : un
régiment d’infanterie (partie de l’armée et tout composé de bataillons). Si
nous parlons ici de tout, c’est en opposition à la partie. Cette relation de tout à partie
est transitive (la partie de la partie est la partie du tout) ♦. C’est pourquoi il est possible de considérer un
même être tantôt comme partie d’un tout supérieur, tantôt comme le tout formé
par des parties de taille ou de complexité inférieures. Ici, ajoute Frege dans
une remarque précise, les mots « individu » (Individuum )
et « chose singulière » (Einzelding) sont inutiles. Rien n’est
définitivement indivisible. Les branches des arbres de la forêt font partie de
la forêt. Les bataillons des régiments d’une division de l’armée font partie de
l’armée. Nous sommes bien dans un « univers structural » dépourvu
d’un niveau privilégié d’individuation des entités. Du point de vue logique, il
suffit à Frege de noter que ces touts collectifs peuvent recevoir des noms,
donc être désignés directement. C’est, comme on va le voir, la grande
différence logique avec les ensembles (d’où résulte la différence ontologique que les premiers
sont des êtres réels et les seconds des
êtres de raison).
|
♦ La
différence entre ces deux exemples est que la forêt ne possède pas
d’intérieur tandis qu’armée, régiments, bataillons, si. On peut détruire la
moitié de la forêt, ce qui reste est encore une forêt. Si l’on détruit la
moitié d’une armée, il n’y a plus d’armée. On peut également découper une
forêt en lots selon son bon plaisir, on ne le peut d’une armée sans la
désorganiser. |
b)
Un ensemble (ou classe) n’est pas une large entité matérielle, ni un
conglomérat rassemblant des objets. L’ensemble des arbres de la forêt ne vient
pas au monde du fait que les arbres ont poussé « ensemble » ♦, mais du fait qu’il est possible de décrire ces
arbres et de dire de chacun d’eux qu’il est un arbre de la forêt. Le point de
vue ensembliste s’introduit au moment où nous nous intéressons à cette
propriété d’être un arbre de la forêt. Y a-t-il des cas répondant à la
description « est un arbre de la forêt » ? Il peut y en avoir
plusieurs, un seul ou aucun. C’est pourquoi le théoricien parle encore
d’ensemble là où il n’y a pas de pluralité (par exemple de l’ensemble, à
élément unique, des arbres de la forêt qui seraient en même temps vieux d’un
siècle, dans le cas où un seul arbre est vieux d’un siècle), et même là où rien
ne répond à la description fixée (par exemple, l’ensemble des éléments communs
à l’ensemble des arbres de la forêt et à l’ensemble des arbres qui ont échappé
à l’incendie, dans le cas où tous les arbres ont brûlé). Cette fois, la
relation pertinente n’est plus « x fait partie de y »,
mais « x appartient à l’ensemble E des objets remplissant
telle condition ». La
relation d’appartenance n’est pas transitive. C’est pourquoi il faut fixer une
fois pour toutes le niveau d’individuation. La complexité interne des éléments
d’un ensemble ne peut pas être prise en compte dans un raisonnement sur cet
ensemble. Pour reprendre l’exemple usuel, l’ensemble des paires de chaussures
de quelqu’un ne se confond pas avec l’ensemble de ses chaussures : les
éléments du second ensemble ne font aucunement partie du premier.
|
♦ Ce qui
est inexact : les arbres ont poussé en même temps, simultanément, mais
pas ensemble. Ils en sont incapables. L’adverbe ensemble dénote une
action commune dont sont bien incapables les arbres, sauf quand la forêt se
met en marche. |
LA
COLLECTION , L’ENSEMBLE ET L’INDIVIDU COLLECTIF
La
leçon qui se dégage de cette discussion est que les individus collectifs – ou encore, les « systèmes
réels », par opposition aux « systèmes nominaux »
[Dumont, 1988, p. 27-28] – [ ou
encore totalités concrètes par opposition à totalités pensées ]
sont des êtres au statut irréprochable, pourvu qu’on prenne soin de ne pas les confondre avec des
collections d’individus ou avec des ensembles d’individus.
Pour
conclure, il convient de représenter systématiquement les rapports entre ces
trois concepts ontologiques : la collection, l’ensemble et
l’individu collectif. On peut partir de la distinction entre le
singulier et le pluriel, donc de la notion de nombre.
Les
choses ne sont pas en un certain nombre sans plus. Elles sont en un
certain nombre à être dans un certain cas. Nous obtenons ainsi les deux
concepts d’individu et de collection d’individus. Le singulier et
le pluriel affectent les attributs (et non les objets). Il n’y a pas d’objet pluriel ou d’objet singulier,
mais il y a des attributs communs à plusieurs objets et d’autres attributs qui
n’appartiennent qu’à un seul objet. Par exemple, à la question :
quels sont les employés de ce ministère qui sont allés au Japon le mois
dernier ? la réponse pourra consister : à ne nommer aucun nom si
personne n’est dans ce cas, à donner un nom désignant un individu si une seule
personne est dans ce cas, ou bien enfin à donner une liste de noms désignant
une collection d’individus si plusieurs personnes sont dans ce cas. Il est vrai
que, dans le langage ordinaire, le mot « collection » s’emploie de
deux façons, tantôt dans un sens faible pour désigner plusieurs choses
prélevées par une méthode quelconque dans un domaine, tantôt dans un sens plus
fort, pour parler de choses qui ne sont pas seulement prélevées, mais réunies
et conservées dans un certain but (ainsi, les collections d’un musée ♦). C’est seulement le sens faible qui nous
intéresse ici. Dans ce
sens, une collection d’individus n’est rien d’autre
que le référent d’une liste de noms . Ce qui correspond
dans la réalité à un catalogue, ce sont plusieurs objets. Ces objets ne sont nullement
intégrés dans un tout du fait d’avoir été catalogués ♦♦. Si plusieurs employés du
ministère ont voyagé au Japon le mois dernier, cela ne crée pas entre eux un
lien social : nous
n’avons pas dit qu’ils avaient voyagé ensemble ♦♦♦.
|
♦ Dans ce
cas la collection peut porter un nom, c’est la collection Pinautculture.
Il s’agit d’un objet réel. ♦♦ Bravo. C’est la même chose pour
les faits économiques. Qu’ils
soient catalogués tels ne signifie pas qu’ils soient parties d’un objet réel
nommé « économie ». Ils ne sont qu’éléments d’un ensemble. C’est un classement dit
Fourquet. Chaque nom de la liste, chaque nom du catalogue dénote un
objet, mais cette désignation n’apport aucune modification à l’être de
l’objet. Les objets ne sont pas plus « ensemble » du fait qu’ils
sont catalogués. ♦♦♦ C’est la même chose pour les
faits catalogués « économiques », ils ne voyagent pas ensemble :
l’adverbe « ensemble » prend un sens totalement opposé à celui du
substantif. L’adverbe dénote une relation interne alors que le
substantif dénote une relation externe qui advient par un tiers.
Cela signifie, entre autres, que les choses sociales, contrairement aux
choses ordinaires, sont dotées d’un intérieur. Le fond des choses,
l’intérieur, la raison d’être existent dans ce cas et ne résultent pas de
l’apparence transcendantale justement dénoncée par Kant. Cet intérieur n’est
pas le supra sensible. Les choses sociales sont des choses en-soi. Étonnant,
nan ? Ici, je raisonnerai comme Durkheim raisonnait pour la religion :
c’est ce fait qui entraîne l’apparence transcendantale dénoncée par Kant,
c’est la familiarité des hommes avec les choses en soi que sont les
choses sociales, des choses dotées d’un intérieur des choses, des choses
dotées d’une raison d’être, qui permet à leur entendement de produire
l’apparence transcendantale dont Dieu n’est qu’un cas particulier. C’est
également cette familiarité quotidienne qui permet de produire la faute qui
consiste à hypostasier un être logique, l’économie, une classe de fait (un
classement dit le surintendant Fourquet), en un être réel. Ces choses en soi
sont le familier qui n’est pas pour autant connu. Les musulmans disent Allah,
les Occidentaux disent « l’économie ». |
Avec des attributs tels que ceux d’une activité collective , comme « voyager en
groupe », nous passons de la collection d’individus à l’individu
collectif. Une collection d’individus n’est pas comme telle un sujet de
prédication distinct de ces individus. En revanche, un groupe d’individus est
comme tel le sujet de prédicats irréductibles. Pour que le
groupe (constitué par une mission ministérielle) se rende de Paris à Tokyo, il
faut normalement que les membres de ce groupe se déplacent de Paris à Tokyo.
Pour que le groupe soit reçu par le maire, il faut que ses membres soient reçus
par le maire.
Mais cette condition n’est pas
suffisante, et elle n’est pas strictement nécessaire. Elle n’est pas
suffisante : il ne suffit pas que les mêmes individus se déplacent pour
que le groupe se déplace, car ils doivent se déplacer au titre du groupe (et
non pas se déplacer simultanément avec des missions personnelles). La condition
n’est pas non plus strictement nécessaire : le groupe peut se déplacer, ou
être reçu, même si tous les membres du groupe ne sont pas du voyage ou de la réception.
Ce
dernier point illustre aussi la différence entre un individu collectif et un ensemble
abstrait. Un groupe social peut se déplacer, être retardé, intervenir dans
les affaires. [ Une armée peut
attaquer ou se replier. ] Nous lui attribuons donc des activités et
des états qui ont une dimension causale. Nous le décrivons dans ses capacités à
modifier ou à être affecté par le cours des choses, ainsi que dans son
histoire. [ Une armée peut
être mise en déroute. ] Un groupe est donc bien un sujet concret * de
prédication. En revanche, un ensemble reçoit des prédicats d’un ordre
logique supérieur, tels que l’identité, l’inclusion dans un autre ensemble,
etc. Si on commet l’erreur
de prendre un groupe humain pour un ensemble au sens logico-mathématique, on
crée un paradoxe : il devient impossible qu’un groupe change dans sa
composition. Il serait logiquement interdit à un club de perdre des adhérents
ou d’en acquérir. Je ne peux pas projeter de m’inscrire au club déjà formé par
diverses personnes, car la nouvelle liste de membres où mon nom figure définit
un nouvel ensemble des membres du club et donc, dans cette hypothèse, un
nouveau club. [ Étonnant,
nan ? ]
|
Note de Heil
myself ! *. C’est Marx qui aurait été content de
comprendre cela. |
On
peut s’imaginer qu’une société est ontologiquement équivalente à la pluralité
des personnes qui la composent si on ne considère que son identité
synchronique. Encore faudrait-il que cette identité soit définie, dans le
cas d’une société un peu large, à la minute près. Mais aucune liste ne peut
donner l’identité diachronique d’une société. Car l’identité d’une
génération à une autre doit être définie non seulement pour le passé, mais pour
le futur.
Mais
comment pourrait-on enregistrer sur une liste les noms de membres qui
n’existent pas encore ? Quant à une liste couvrant le passé et le présent,
elle offre l’inconvénient noté par les logiciens de Port-Royal : ce ne
sont pas tous les Romains, passés et présents, qui ont vaincu les Carthaginois.
En
reconnaissant que le concept d’individu collectif est pleinement justifié, nous
n’ajoutons pas une nouvelle classe ontologique à un univers déjà constitué par
les individus ordinaires. La philosophie des mathématiques se demande à bon
droit si les ensembles ne seraient pas des entia non grata.
Mais
le problème ne se pose pas du tout de savoir s’il existe des individus
collectifs en plus des individus ordinaires. Car ce que nous appelons « individu
collectif » n’est pas autre chose qu’un individu ordinaire considéré dans
sa composition, ou structure. Or nous devons tenir compte
de cette composition de l’individu pris comme un système de parties, ou bien de
la composition du système dont cet individu fait partie, pour rendre compte des
propriétés que nous lui reconnaissons. Par définition, toutes les propriétés
d’un individu sont susceptibles d’être d’abord exprimées comme des propriétés
individuelles (par exemple, par un verbe au singulier). Mais déjà Pierre
d’Espagne nous avertissait qu’on ne peut pas toujours inférer de la propriété
du tout à celle de la partie. On distinguera trois cas :
1) certaines propriétés
individuelles sont des fonctions additives des propriétés des parties (on parle
alors de propriétés résultantes) ;
2) d’autres sont des
propriétés holistiques émergentes parce qu’elles sont produites par le
mode de composition des parties ;
3) d’autres enfin
peuvent être appelées des propriétés fonctionnelles (ou téléologiques) :
ce sont les propriétés qui conviennent à l’individu en tant qu’il entre
lui-même en composition, à titre de partie, avec d’autres individus dans un
système. Certains auteurs jugent la notion de « propriété émergente »
suspecte, parce qu’ils la croient associée avec des doctrines vitalistes ou
spiritualistes. Mais, comme le rappelle le biologiste C. H. Waddington [in
Kenny et alii, 1973, p. 75], nous n’attribuons aucun pouvoir occulte à
un système quand nous expliquons certaines de ses capacités par la structure
dont il est doté :
« Les parties détachées
d’une voiture peuvent présenter, une fois qu’elles sont assemblées avec les
relations requises, la propriété nouvelle de locomotion, y compris selon des
mouvements à première vue aussi inacceptables que celui de monter en haut d’une
colline contre la gravité. »
Les
propriétés individuelles d’un système sont à la fois les propriétés collectives
de ses parties et les propriétés que manifeste ce système dans le milieu dont il
fait partie. La relativisation des concepts d’individualité et de collectivité
va donc de pair avec la prise en compte, pour tout individu, de deux
structures : celle qui caractérise la composition de ses parties et celle
de son milieu environnant. Une explication de type « mécaniste » (ou
réductif) rend compte d’une capacité apparemment simple de l’individu par la
complexité de son milieu interne. Une explication de type
« fonctionnel » (ou téléologique) ignore largement cette complexité
interne, parce qu’elle rapporte les propriétés individuelles à la complexité du
milieu externe [Simon, 1969, p. 7 sq.]. On peut mentionner ici un
exemple que cite le philosophe des sciences Romano Harré [1979,
p. 91-92] :
« […] Bien que “grand”
(tall) soit une propriété non collective d’une personne, on peut
soutenir que c’est une propriété collective d’un assemblage de membres et d’os.
On l’analyserait alors comme l’attribut relationnel d’une collection
d’individus pris collectivement. »
À
l’appui de cet exemple, on pense aussitôt à la pratique de l’anatomiste ou du
paléontologue qui déterminent la taille de l’animal tout entier en raisonnant
sur les proportions entre les parties qui subsistent et les autres. Or ce
raisonnement ne prend pas seulement en compte les données du milieu interne
(quelle peut être la taille d’un animal dont voici la mâchoire ?). Il
n’oublie pas que cet animal fait partie d’un milieu (cet animal vivait-il dans
l’eau ou sur terre ?). Dans la vie de relation et les échanges avec le
milieu, les propriétés collectives émergentes (« holistiques »)
tendent à se manifester au dehors comme propriétés individuelles. Romano Harré
donne quelques exemples tirés de la psychologie de la forme : la structure
interne d’une chose (par exemple, d’une suite de sons ou d’une surface)
n’apparaît pas (à l’oreille ou à l’œil) comme propriété collective des
éléments, mais comme qualité sensible individuelle (comme mélodie ou comme
couleur).
Ainsi,
pour passer de l’expression collective d’une propriété d’un système à une expression
individuelle de cette propriété, il faut donner un dehors à ce système. On retrouve la leçon de
Rousseau : à l’égard de l’étranger, le corps du peuple devient un être
simple, un individu.
* * *
Ce
texte est extrait du séminaire « Philosophie et anthropologie »,
organisé à l’Espace séminaire du centre Georges Pompidou dirigé par Christian
Descamps. Participaient à ce séminaire : Alain Caillé, Daniel de Coppet,
Vincent Descombes, Mary Douglas, Louis Dumont, Philippe Raynaud, John Skorupski,
Lucien Stéphan et Tzvetan Todorov.
BIBLIOGRAPHIE
|
• ARNAULD
A., NICOLE P., [1662] 1970, • BARRAUD
C., DE COPPET D., ITEANU A., JAMOUS R., 1984, « Des relations et des
morts », in Différences, valeurs, hiérarchie, textes offerts à Louis
Dumont, réunis par J.-C. Galley, Paris, EHESS. • D’ESPAGNE
Pierre, The summulae logicales of Peter of Spain, édition et trad. en
anglais du traité VII par J. P. Mullally, Indiana, Notre-Dame UP., 1945. • DUMMETT M., 1973, Frege : Philosophy
of Language, Londres, Duckworth. • DUMONT
Louis, 1975, • ———————
1977, Homo aequalis, Paris, Gallimard. • ———————
[1966] 1979, Homo hierarchicus, Paris, Gallimard, collection
« Tel ». • ———————
1983, Essais sur l’individualisme, Paris, Seuil. • ——————— 1983, Affinity as a Value, • ———————
[1971] 1988, Introduction à deux théories d’anthropologie sociale,
Paris, EHESS. • FREGE G., 1966, Logische Untersuchungen,
G. Patzig, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. • —————
[1884] 1969, Les Fondements de l’arithmétique, Paris, Seuil. • HARRÉ R., 1979, Social Being, •
HEGEL G. W. F., 1939, • KENNY A. et alii, 1973, The Development
of Mind, Edimbourg UP. • KRETZMANN N., 1982, « Syncategoremata,
exponibilia, sophismata », in KRETZMANN N., KENNY A.,
PINBORG J. (sous la dir. de), The Cambridge History of Later Medieval
Philosophy, Cambridge UP. •
MAUSS M., 1924, « Appréciation sociologique du bolchevisme », Revue
de métaphysique et de morale. • ——————
1969,
« La nation », in Œuvres, Paris, Minuit. • POPPER K., [1957] 1986, The Poverty of
Historicism, Londres, • PRIOR Arthur, 1962, Formal Logic, • QUINE W. V., 1982, Methods of Logic, • ROUSSEAU
J.-J., 1964, Œuvres complètes, t. III, Paris, Paris, Gallimard, • RUSSEL B., 1918, The Philosophy of Logical
Atomism, • SIMON H. A., [1962] 1969, « The
architecture of complexity », in The Sciences of the Artificial, • WIGGINS David, 1980, Sameness and
Substance, |
Notes
|
[1] Ce
texte de Vincent Descombes est tiré de Philosophie et Anthropologie,
centre Georges Pompidou, coll. « Espace international,
Philosophie », 1992. [2] « La
nation » [Œuvres 3, 1969, p. 573-639]. [3] Voir
aussi Mauss [1924, p. 103-132]. [4] K.
Popper [1986, p. 136]. Popper écrit : « […] La tâche de la théorie
sociale est de construire et d’analyser soigneusement nos modèles
sociologiques en termes descriptifs ou nominalistes, c’est-à-dire en termes
d’individus, de leurs attitudes, attentes, relations, etc., selon un postulat
qu’on peut appeler l’“individualisme méthodologique”. » [5] « Dans
l’esprit universel donc, chacun a seulement la certitude de soi-même,
c’est-à-dire la certitude de ne trouver dans la réalité effective rien
d’autre que soi-même ; chacun est aussi certain des autres qu’il est certain
de soi-même. – En tous j’intuitionne ce fait qu’ils sont pour eux-mêmes
uniquement chacun cette essence indépendante que moi-même je suis […]
J’intuitionne Eux comme Moi, Moi comme Eux » [Hegel, 1939, p. 292]. [6] Voir
par exemple W. V. Quine [1982, p. 131] : « Il y a plus qu’une
différence de notation entre le terme général “homme”, ou “est un homme”, et
le nom de classe “espèce humaine”. Le terme général est vrai de chacun des
individus divers, les hommes. Le nom de classe est le nom d’un objet abstrait, la classe des
hommes. Grâce au terme général, nous pouvons parler en général des hommes
sans soulever la question philosophique de savoir si, au-delà des divers
hommes, il y a en plus un objet qui est la classe de ces hommes. Le nom de
classe soulève une telle question et il demande une réponse positive. » [7] Voir
les textes cités et les commentaires dans Kretzmann [1982, p. 211-245]. [8] Arthur
Prior [1962, p. 160] relève la réécriture de Socrates currit en omnis
Socrates currit dans un ouvrage faussement attribué à Duns Scot. [9] Voir la
discussion détaillée de ces problèmes dans Wiggins [1980]. [10] Louis Dumont, Affinity as a Value [1983,
p. 26-27]. Voir aussi « Vers une théorie de la
hiérarchie » (postface de l’édition « Tel » de Homo
hierarchicus). [11] H. A. Simon, « The architecture of
Complexity » (1962), dans Simon [1969, p. 87]. Cet
article est celui qu’utilise Arthur Koestler dans son livre The Ghost in
the Machine, auquel se réfère à son tour Louis Dumont [Essais sur
l’individualisme, p. 241, note 34, Seuil Points, p. 275]. [12] Dans
son compte rendu du livre de Schröder [cf. Frege, 1966, p. 93
et 95]. |
|
« Nous entendons par nation une société matériellement et moralement intégrée, à pouvoir central stable, permanent, à frontières déterminées, à relative unité morale, mentale et culturelle des habitants qui adhèrent consciemment à l’État et à ses lois. » En premier lieu, le titre de nation ainsi défini
ne s’applique qu’à un petit nombre de sociétés connues historiquement et,
pour un certain nombre d’entre elles, ne s’y applique que depuis des dates
récentes. » (Mauss, œuvres, III, « * * * « En somme une nation complète est une société
intégrée suffisamment, à pouvoir central démocratique à quelque degré, ayant
en tous cas la notion de souveraineté nationale et dont, en général, les
frontières sont celles d’une race, d’une civilisation, d’une langue, d’une
morale, en un mot d’un caractère national, Quelques éléments de ceci peuvent
manquer ; la démocratie manquait en partie à l’Allemagne, à * * * « Nous demanderons
d’abord qu’on nous accorde deux définitions : celle de la nation, celle
de la société. La société est un groupe d’hommes vivant ensemble sur un
territoire déterminé, indépendant, et s’attachant à une constitution
déterminée ♦. » Mais toutes
les sociétés ne sont pas des nations. Il y a actuellement, dans l’humanité,
toutes sortes de sociétés, depuis les plus primitives, comme les
australiennes, jusqu’aux plus évoluées, comme nos grandes démocraties
d’Occident. Qu’on nous promette d’utiliser da distinction classique de
Durkheim entre les sociétés « polysegmentaires » à base de clans,
les sociétés tribales, d’une part ; et d’autre part les sociétés
« non segmentaires » ou intégrées. Parmi celles-ci on a confondu
(Durkheim et nous-mêmes avons aussi commis cette erreur) sous le nom de
nation, deux sortes de sociétés qui doivent être distinguées. Dans les unes
le pouvoir central est extrinsèque, superposé, souvent par la violence quand
il est monarchique ; ou bien il est instable et temporaire quand il est
démocratique. Celles-là ne méritent que le nom d’États, ou d’empires, etc. Dans
les autres, le pouvoir central est stable, permanent; il y a un système de
législation et d’administration ; la notion des droits et des devoirs du
citoyen et des droits et des devoirs de la patrie s’opposent et se
complètent. C’est à ces sociétés, que nous demandons de réserver le nom de
nations. Aristote distinguait déjà fort bien les έθνη
des πολεϊς par le degré de conscience ♦♦
qu’elles avaient d’elles-mêmes (
|
|
Note
de la page 275 de Essai sur l’individualisme (1983) Affirmer que le mode moderne de pensée est
destructeur des touts dont l’homme se voyait jusque-là entouré peut sembler
excessif, voire incompréhensible [le
programme de ROC avait « lu » « tours » au lieu de
« touts ». Étonnant, nan ?]. Pourtant je pense que
c’est vrai en ce sens que chaque tout a cessé d’être pourvoyeur de valeur au
sens ci-dessus. Si l’on se tourne vers nos philosophies avec cette simple question :
quelle est la différence entre un tout et une collection, la plupart sont
silencieuses, et lorsqu’elles donnent une réponse, elle a chance d’être
superficielle ou mystique comme chez Lukàcs (cf. Kolakowski, op. cit.).
Je considère comme exemplaire que la constitution du système de Hegel
résulte d’un glissement dans la localisation de l’Absolu, ou de la valeur
infinie, de On a noté la
reconnaissance de la hiérarchie des niveaux chez Gregory Bateson (ci-dessus, n. 1,
p. 261). Un biologiste, François Jacob, a introduit l’« intégron » dans
un sens semblable au holon de Koestler ( |