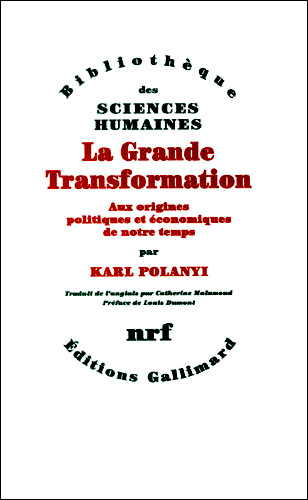PRÉFACE
« Voici un livre qui fait paraître désuets ou usés
la plupart des livres du même domaine. Un événement aussi rare est un signe des
temps. Voici, à une heure cruciale, une compréhension neuve de la forme et du
sens des affaires humaines. » C’est en ces termes que le sociologue Robert
Mac Iver présentait ce livre en
1944 au public américain. Le jugement reste vrai dans l’essentiel, et pourtant
un paradoxe nous attend ; si Karl Polanyi a profondément influencé le
développement des sciences sociales, ce n’est pas par ce livre-ci, mais par un
autre versant de ses idées qui n’intervient ici qu’à l’arrière-plan.
Expliquons-nous. La Grande Transformation, c’est ce
qui est arrivé au monde moderne à travers la grande crise économique et
politique des années 1930-1945, c’est-à-dire, Polanyi s’emploie à le montrer,
la mort du libéralisme économique. Or ce libéralisme, dont Hitler a été le fossoyeur
adroit, était une
innovation sans précédent apparue un siècle plus tôt. C’était une
innovation très puissante, mais si contraire à tout ce que l’humanité avait
connu jusque-là qu’elle n’avait pu être supportée que moyennant toutes sortes
d’accommodements. L’innovation
consistait essentiellement dans un mode de pensée. Pour la première fois, on se
représentait une sorte particulière de phénomènes sociaux, les phénomènes économiques,
comme séparés de la société et constituant à eux seuls un système distinct
auquel tout le reste du social devait être soumis. On avait en ce sens
dé-socialisé l’économie,
et ce que la grande crise des années trente imposa au monde, c’est une resocialisation
de l’économie. La
« grande transformation » représente donc en quelque façon l’inverse
de la transformation qui a donné le jour à l’idéologie de l’économie libérale. (En
fait, je ne puis me défendre de supposer que Polanyi avait dans l’esprit
quelque chose comme l’allemand Umwandlung, légitimement traduit sans doute /II/ par « transformation », mais que je
préférerais quant à moi comprendre plus littéralement, et plus largement à la
fois, comme le « grand retournement » — l’expression ayant l’avantage
de rappeler l’arrière-plan historique général dont le libéralisme s’était
séparé.
|
Je lis : que le
libéralisme est une innovation ; que cette innovation consiste essentiellement (ce qui
laisse entendre qu’il y a un résidu qui n’est pas un mode de pensée)
dans un mode de pensée. C’est donc un mode de pensée qui a fait tout ça,
toute cette merde, qui occupe l’Irak et la Palestine et qui essaye vainement
de s’implanter en Afghanistan (le pays le plus important du monde donc, le
pays des irréductibles) pour la seconde fois en cent ans ! Je
soutiens au contraire que c’est seulement l’économie qui est l’objet d’un
mode de pensée, une idée dans la pensée bourgeoise (Une Enquête, 1976).
Les faits économiques ne sont économiques que parce que les économistes les
appellent ainsi. Sinon, ce sont des faits sociaux tout à fait ordinaires qui
n’ont rien de particulier et sont soumis aux mêmes exigences que tous les
faits sociaux. L’enfant qui rampe sous les métiers à tisser à Manchester est
un fait totalement inconnu chez les sauvages et dans les autres sociétés,
mais il n’implique nullement l’existence d’un objet réel qui serait
« l’économie ». Les bourgeois appellent ce fait
« économique » seulement pour cacher son vrai nom qui est « criminel ».
Cela dit, je ne suis pas d’accord avec Dumont. L’innovation, comme il dit, ne
fut pas seulement un mode de pensée mais un mode d’action, notamment
« la révolution des enclosures ». Le véritable mode de
pensée, comme le souligne Polanyi du peu que j’aie pu voir en le parcourant,
c’est la généralisation de l’appât du gain, pendant cent ans (deux
cents aujourd’hui), comme jamais on ne le vit dans toute l’histoire du
monde selon P. L’appât du gain devient, pour des raisons qu’il faut
étudier, le dieu de cette époque et le seul dieu dans un monde que d’aucun
ont osé appeler désenchanté. On est seulement passé de la magie blanche à la
magie noire, au Satanic Mill. CES GENS SONT DES POSSÉDÉS. C’est pourquoi je
préférais cette traduction en français du titre du roman de Dostoïevski. A
possédés, possédés ennemis (y compris Necaïev qui est un produit de cette
possession. Possession, envoûtement, magie noire. Modernes mon cul). Bien vu
les Mollah. Les landlords english se croient tout permis. Mais cela,
évidemment parce qu’ils regorgent d’idées d’enrichissement. C’est là
qu’on voit la puissance des idées. J’ai déjà vu dans le livre que Polanyi
signale le cas des frères Bentham, ces deux ordures, pour la surabondance
jaillissante de leurs idées d’enrichissement. Tout cela s’est payé un onze
septembre. Valsez saucisses (Paraz alias Bitru). |
La source de l’originalité de Polanyi, c’est d’avoir
regardé la société moderne, ou l’économie dite libérale, à la lumière des sociétés non modernes
et en contraste avec elles. L’implication était qu’à l’inverse on ne pouvait
bien évidemment appliquer aux sociétés non modernes les concepts économiques
modernes, comme d’autres s’obstinaient à le faire, et Polanyi a essayé en
conséquence de dégager quelques concepts généraux qui puissent les remplacer
(voir, ici même, chapitre 4). L’ouvrage collectif Trade and Market (1957) marqua le début d’un
renouveau dans l’étude des économies
non modernes. Rétrospectivement, il est clair que ces vues nouvelles
correspondaient à un besoin profond chez les anthropologues et les historiens,
car ici Polanyi a fait souche. Ses concepts ont été appliqués et discutés dans
les domaines les plus divers — de l’Océanie à la Grèce ancienne en passant par
l’Afrique, ils ont été mis au travail, pour ainsi dire, par les chercheurs les
plus originaux dans tous ces domaines. En contraste avec ce bouillonnement
créateur, dont nous ne dirons rien ici, la littérature relative à La Grande Transformation, dont le thème nous touche
pourtant plus immédiatement, est bien pauvre. Ceux qui ont été les élèves de
Polanyi parlent de /III/ ce livre comme d’un ancêtre
tutélaire situé en amont de leurs propres préoccupations, et si le livre est
très largement l’objet de respect, les spécialistes de l’histoire moderne le
mentionnent élogieusement plus souvent qu’ils ne le considèrent de près.
Initialement, l’ouvrage a certainement été desservi
par les circonstances de sa publication (1944 à New York, 1945 à Londres).
Comme le remarque George Dalton, nombreux étaient alors les universitaires
mobilisés, et les tâches et préoccupations de l’immédiat après-guerre n’étaient
pas non plus favorables à une reconsidération aussi exigeante que celle
proposée par Karl Polanyi. Lui-même d’ailleurs, commençant à enseigner à
l’Université Columbia à New York, s’engageait dès 1947 dans la recherche sur le
versant non moderne du sujet, qui groupait ses premiers adeptes,
l’anthropologue Conrad Arensberg, puis l’économiste Harry Pearson et d’autres.
Il se peut aussi que le public anglo-saxon, qui avait vécu le nazisme seulement
du dehors, ait été moins profondément sensibilisé à cet aspect du problème que
ne l’eût été un public d’Europe continentale. Mais surtout il est clair
rétrospectivement que c’est la nouveauté de la thèse, le fait qu’elle heurtait
de front toutes sortes d’idées plus ou moins admises, comme nous le verrons
chemin faisant, qui doit expliquer que ce grand livre soit passé plus ou moins
inaperçu. Il avait fallu à l’auteur, pour parvenir à le produire, une passion intellectuelle peu
commune, telle qu’on l’aperçoit à l’œuvre pendant vingt-cinq ans dans la
brève biographie que l’on trouvera ci-après et que l’on doit à la veuve de
l’auteur, elle-même décédée en 1978.
La Grande Transformation n’est pas le seul ouvrage
qui soit né de la nécessité où se sont trouvés les intellectuels européens
entre /IV/ 1930 et 1945 de s’expliquer avec la maladie de leur temps, et
avant tout de répondre au défi que le phénomène national-socialiste lançait à
leurs valeurs. Mais de toutes ces réflexions qu’un danger mortel a provoquées,
l’ouvrage de Polanyi renferme à coup sûr l’une des plus profondes. Je dirais
même la plus profonde, si je ne me souvenais que seul le hasard m’a fait
connaître un certain nombre des ouvrages en question, et que d’autres m’ont
sans doute échappé. En effet, cette réflexion vitale a souvent tourné court,
même de la part d’auteurs par ailleurs distingués. Elle a même parfois tourné à
la caricature, témoins La Destruction de la raison de Lukács, ou La
Société ouverte et ses ennemis de Popper [ce sale
con]. Dans le premier cas le besoin de faire prévaloir une
interprétation marxiste de l’histoire intellectuelle allemande, dans le second cas
le recours désespéré à un individualisme intransigeant aboutissent à remplacer
l’intelligence par l’ostracisme.
En contraste, voici un économiste viennois d’origine
hongroise, qui, de son poste d’observation de L’Économiste autrichien,
a suivi les vicissitudes des affaires mondiales depuis 1920. C’est un
socialiste convaincu, mais un socialiste sans œillères — et faut-il rappeler la
grande misère dans ces années-là de Vienne, capitale d’un empire tout à coup
réduite à elle-même, dont Polanyi célèbre fièrement, dans une note, les
réalisations municipales socialistes comme un « triomphe sans précédent de
la culture » (p. 374) ? À travers les pages qu’il consacre à
l’histoire mondiale, économique et politique, de cette période (chapitres
16-18), on imagine Polanyi se colletant avec l’actualité et toujours ramené aux
problèmes fondamentaux de ce régime — le capitalisme libéral — qu’il ne se
contente pas de condamner mais qu’il veut à toute force comprendre.
Dès l’arrivée de Hitler au pouvoir en Allemagne, ce juif
hongrois passe en Angleterre. Il y fera de l’enseignement extra muros, une sorte d’équivalent de
nos cours du soir, et sa veuve nous dit l’importance pour lui de sa découverte
de ce pays. C’est que, s’il voit bien que la fin de l’étalon-or a déclenché
la catastrophe totalitaire, la venue au pouvoir de ce qu’il appelle le « fascisme » hitlérien,
la crise est celle du marché autorégulateur, et la cause est à chercher plus
haut, comme il le dit à la fin du deuxième chapitre : « pour comprendre le
fascisme allemand, il faut remonter à l’Angleterre ricardienne ».
Voilà déjà un pas important : le totalitarisme est vu non pas comme un
phénomène aberrant, ruse diabolique du grand capital selon certains, ou crise
du progrès selon Lukács, ou postérité des philosophies holistes selon Popper,
mais comme enraciné au cœur même de la modernité économico-sociale.
|
Je vous l’avais bien dit,
pour le onze septembre ; tout ça vient de là. L’américanisme est
anglais. Radio Londres ment aussi. |
/V/ Ce n’est pas tout, et le pas décisif — à
quelque moment qu’il ait été franchi — est la « mise en perspective »
de l’innovation ricardienne grâce aux rapports de Thurnwald sur l’économie de certaines
tribus mélanésiennes. C’est là, c’est dans son ouverture anthropologique, dans
le contraste avec des formes « primitives » de la production et de
l’échange, que Polanyi trouve de quoi éclairer tout le développement moderne,
toute la boucle qui, partant de l’innovation du marché autorégulateur, aboutit
à l’enterrement du libéralisme par Adolf Hitler [Hélas, il a raté son coup Adolf]. On devine bien
comment Polanyi aura été attiré au départ par les descriptions — d’ailleurs
excellentes — de Thurnwald (à qui Malinowski et d’autres seront
vraisemblablement venus s’adjoindre plus tard) : sa conviction socialiste
a dû trouver là un aliment et une confirmation. Mais la sympathie pour des économies exotiques est
une chose, et la définition comparative du libéralisme économique en est une
autre.
Dans ce qui précède, on a tenté de dégager schématiquement la démarche d’ensemble de Karl Polanyi. On y reviendra en conclusion. On voudrait maintenant s’arrêter sur quelques points et énumérer quelques vertus de l’ouvrage, étant entendu que sa densité, sa richesse en thèses secondaires et subsidiaires défient toute tentative de résumé linéaire. Le lecteur voudra bien excuser le décousu de ces remarques.
Il faut, en premier lieu, répondre à une objection
massive du sens commun. Comment peut-on présenter Hitler comme ayant contribué
à enterrer le libéralisme économique alors que sa défaite a été la victoire de
la liberté [non de Coca Cola,
du business, il ne faut pas tout mélanger], du moins pour les
Alliés occidentaux, et que cette victoire s’est accompagnée — selon toute apparence
— non seulement d’une réaffirmation solennelle des institutions démocratiques
mais aussi de la restauration de la liberté dans le domaine économique ?
Or voici comment l’auteur définit la nature de ce qu’il appelle le fascisme
On peut décrire la solution
fasciste à l’impasse atteinte par le capitalisme libéral comme une réforme de l’économie de marché
réalisée au prix de l’extirpation de toutes les institutions démocratiques, à
la fois dans le domaine industriel [tiens !
industriel tout d’un coup et non plus économique] et dans le
domaine politique (p. 305).
/VI/ La question
est alors de savoir si, tandis que les institutions démocratiques étaient
victorieuses, et rétablies là où elles avaient été supprimées, le capitalisme
libéral a survécu. Polanyi dit : Non, le libéralisme économique est mort.
Entendons-nous bien : les nazis ne l’ont pas tué, ils ont seulement, les
premiers, compris qu’il était moribond, ils l’ont enterré sans cérémonie et ont
tiré profit de cette avance tandis que leurs adversaires étaient encore
empêtrés dans l’« impasse ». Il y a ici deux questions de fait. Sur
un premier point on peut, semble-t-il, répondre affirmativement : la
politique économique des nazis a en effet consisté à subordonner à nouveau, à
l’encontre de la doctrine libérale, l’économie à la politique, ou à la
société globale telle qu’ils la concevaient. Il y a, ou il y a eu, sur ce point
des opinions contraires, mais elles ne paraissent pas défendables [D. cite Franz Neumann, Behemoth, The
structure and Practice of National Socialism, NY, 1942].
Pour ouvrir une parenthèse, on peut regretter tout
particulièrement ici le silence des auteurs subséquents sur les vues de
Polanyi. Si je ne me trompe, la thèse sur le nazisme ne semble pas avoir été
discutée dans les travaux, pourtant nombreux, où des théoriciens de la
politique ont traité du totalitarisme. C’est grand dommage.
Reste une seconde question. Est-il vrai que le
libéralisme économique n’ait pas survécu à la grande crise des années trente et
à ses développements ? Ici encore le sens commun peut s’insurger :
nous savons mieux qu’il y a quarante ans ce qui a survécu à la guerre, et
n’entendons-nous pas chaque jour défendre les mérites de la libre entreprise et de la concurrence [c’est écrit en 1982 ! du temps triomphal du lycéen
aux grosses couilles July et de la quadruple ordure renégate Montand] —
qu’on pense à la réhabilitation du profit dans les pays communistes — et ceux
de la liberté du commerce ? Mais le libéralisme économique — faut-il le
rappeler ? — demandait bien davantage. Contrairement à ce que son nom
suggérerait, c’était une
doctrine intolérante [question
intolérance, ils ont trouvé à qui parler], excluant toute intervention
de l’État, une doctrine selon laquelle, le libre jeu de l’économie étant la condition de l’ordre,
toute interférence était néfaste. L’institution centrale était le marché, le
marché était considéré comme autorégulateur, et la société devait s’y soumettre
quoi qu’il arrive. C’est cela qui a été balayé dans la /VII/ tourmente et qui, en
pratique, n’existe plus. De mille façons, des éléments de dirigisme ou de
socialisme se sont introduits, et le président Reagan [The Killers I (44 magnum) and II (Remington 280)
but Cassavetes twice] ne saurait tenir le discours de Herbert Hoover,
auquel le New Deal de Franklin Roosevelt a bel et bien mis fin. Les
« libéraux » d’aujourd’hui sont des gens qui s’efforcent de faire à
la liberté dans ce domaine la plus grande part possible, tout en sachant très
bien [vraiment ?] qu’il
est nécessaire de limiter et de contredire cette liberté à bien des égards.
Qu’on songe seulement à l’assurance-chômage, ou à la réglementation du
commerce européen dans la C.E,E. Il est donc clair que des valeurs sociales [vraiment ?] se sont imposées
ici et sont venues limiter — à tout le moins — la reconnaissance de la liberté
économique.
Admettons donc, en ce sens,
que nous vivons dans un monde post-libéral. Il n’en est pas moins vrai que le
libéralisme économique et l’économisme en général sont étroitement liés au
développement moderne, et que le libéralisme économique en particulier tient de
près à nos valeurs fondamentales, puisqu’il se donne comme une application particulière de
l’idée de liberté, si même les libertés essentielles ne sont pas ses
produits (cf. ici même, p. 327). Il
importe donc de savoir comment nous en sommes arrivés là, et d’abord comment
cela a commencé. Prenant les choses de très haut, Polanyi constate que l’idée
même d’économie est
récente [1826, cf. surintendant Fourquet et 1960 cf.
Ian Hacking]. Dans
les autres civilisations et cultures, ce que nous appelons phénomènes économiques
n’est
|
le singulier
induit par la grammaire implique que sont désignés par un singulier des
phénomènes indépendants les uns des autres qui sont subrepticement considérés
comme un tout, une unicité, par cette obligation de la grammaire. Il
faudrait dire : ce que nous appelons phénomènes économiques ne sont
pas distingués, en fait, en toute correction : « les phénomènes
que nous appelons “économiques” ne sont pas distingués, c’est à dire nommés
tels, dans d’autres civilisations. » Voilà ce que parler veut dire.
Voilà comme on pense subrepticement de travers. |
pas distingué des autres phénomènes sociaux, n’est pas érigé en un monde
distinct, en un système, mais se trouve dispersé et étroitement imbriqué (embedded)
dans le tissu social. Marcel Mauss avait dit quelque chose de semblable
lorsqu’il avait parlé du don ou de l’échange comme d’un « phénomène social
total » où s’enchevêtrent aspects économiques, religieux, juridiques et
autres, de sorte que les séparer analytiquement ne saurait suffire à comprendre
de quoi il s’agit. Mauss avait certainement le sentiment, en contraste, du
caractère exceptionnel des institutions et représentations modernes, mais s’il
s’était émancipé en fait de l’évolutionnisme unilinéaire, il ne l’avait pas
formellement répudié : au fond, c’était un homme d’avant 1914, et
peut-être fallait-il une nouvelle génération, marquée plus jeune par l’entre-deux-guerres
et le drame des /VIII/ années 1930 à 1945 pour oser
jeter un regard plus radical sur l’âge d’or du capitalisme industriel et, à la
lumière des résultats de l’anthropologie, voir son idéologie prédominante — ou
du moins une partie importante de cette idéologie — comme une innovation
aberrante dans l’histoire de l’humanité [je ne vois que la pal pour remédier à cela].
Arrêtons-nous un instant sur cette transition, ce
dépassement de l’évolutionnisme unilinéaire qui avait fortement marqué les
débuts de la science sociale. Voilà bien un trait qui a pu détourner de
l’ouvrage de Polanyi le lecteur non spécialiste, plus ou moins imbu de la
notion d’un progrès linéaire de l’espèce humaine à travers une succession de
formes sociales. Il était bien satisfaisant et bien confortable de croire que
la civilisation qui a développé la connaissance rationnelle et l’action sur la nature, ou comme
disent certains les « forces de production », à un degré inouï, se
trouve au faîte de l’humanité, et que même les insuffisances et les tares
qu’elle recèle disparaîtront grâce à la poursuite du même mouvement de progrès
— même s’il y faut une transformation sociale [que les youpis américains s’enferment dans des villes
fortifiées par exemple, des camps retranchés. On sait ce qu’il advient des
camps retranchés. Bientôt en Irak. Le royaume d’Israël est aujourd’hui un camp
retranché, un super Dien Bien Phu]. Ajoutons que, dans cette
perspective, une certaine « dialectique » aidant, l’explication
causale donnait la clef de tous les changements, transitions et
transformations.
Par rapport à ce schéma grandiose, l’idée
polanyienne d’une discontinuité radicale entre la modernité et tout le reste
paraît bien pauvre et bien primitive, et à première vue on imagine mal qu’elle
représente un progrès par rapport à la précédente. C’est qu’ici le progrès de
la connaissance a été négatif, il a consisté à apprendre que nous étions dans
l’erreur, à savoir que nous ne savions pas [il y en a toujours, et des masses, qui ignorent qu’ils ignorent,
l’homme à la petite quéquette et la théorie exacte notamment. Le socrate se
fait rare]. Je dis progrès de la « connaissance », car ce
qu’on appelle encore « science sociale » est si différent des
sciences exactes que le terme de science prête à confusion.
Il est sans doute impossible
de justifier en peu de mots le changement de perspective : il y faudrait
toute l’histoire des sciences sociales. Au reste, la transformation n’est pas
achevée : il y a encore, comme l’on sait, par exemple, des sociologues
marxistes [Foutre ! une
insulte directe à Soral], et ce type d’orientation demeurera
présent ; il est même à quelque degré nécessaire. On peut tout de même
remarquer que dans ce domaine l’unilinéarité repose toujours au fond sur le
choix d’une variable. On peut parler d’un progrès dans l’art de la poterie,
mais que dire lorsque des gens qui perdent la poterie construisent
simultanément une organisation sociale « supérieure » ? [le seul savoir est non pas le
savoir-faire, ni même le savoir des savoir-faire, mais le savoir du monde, le
savoir de l’humanité. Je suis bien d’avis que dans le savoir-faire s’exprime
toujours en sous-main le savoir de l’humanité, dans la poterie notamment à
figures rouges ou à figures noires] Marcel Mauss notait souvent, dans
ses cours d’ethnologie, cette présence simultanée d’un déclin et d’un progrès.
Si vous faites choix d’un aspect de la vie sociale de l’homme et que vous
subordonniez le /IX/ reste, vous pourrez — si
votre documentation est suffisante — construire une échelle d’excellence. Et si
vous choisissez ce en quoi vous excellez, vous vous trouverez au sommet. Il en
sera tout autrement si vous essayez de prendre en compte l’ensemble [il s’agit ici d’un adjectif et d’un faux
substantif : « tous les aspects », pourquoi employer le mot
« ensemble » alors] des aspects de la vie sociale... vous
entrerez alors, comme dans La Grande Transformation, dans la sociologie
comparative ou, pour reprendre une suggestion d’Edgar Morin [ce nullard total : les choses
sont complexes, savez-vous ?]
qui semble excellente, dans l’anthroposociologie, une sociologie qui a
l’espèce humaine pour horizon. Ce faisant [parle-t-il d’Edgar Morin ?], vous vous déprendrez de la
tendance à l’explication causale au profit de l’appréhension ou compréhension
de configurations d’idées et de valeurs.
On pourrait parler ici — mais peut-être a-t-on abusé
de l’expression — de révolution copernicienne de la sociologie : voici
que, sans négliger en aucune façon nos excellences propres, nous cessons de
nous prendre pour le nombril du monde : nous nous voyons à d’autres égards
relégués à un canton écarté de l’univers des sociétés humaines. Karl Polanyi,
économiste et historien de l’économie,
a, au même titre que des anthropologues, montré la voie, témoin la floraison de
travaux que son influence a suscités sur les économies primitives, archaïques et antiques.
Mais revenons à l’innovation moderne telle que
Polanyi la décrit. Elle se voit à plein à propos de l’institution que Polanyi
met au centre de l’affaire : le marché. On voit la nature sociologique du
marché changer du tout au tout par une triple transformation :
unification, extension, émancipation. La société moderne n’a pas créé de toutes
pièces le marché : sinon toujours, du moins souvent il y avait des marchés
dans d’autres sociétés, toutes sortes de marchés : des marchés locaux et
des marchés extérieurs, sans relation les uns avec les autres, et avec des
développements très différents ici et là. Or voilà que tout cela fusionne et qu’il
n’y a plus qu’un marché, un grand marché abstrait dont les divers marchés
concrets sont des manifestations particulières, un marché unifié, national
d’abord, mondial ensuite : le marché unifié s’est étendu aux dimensions du
monde. À ce marché vorace il faut des marchandises, il faut que tout devienne
marchandise, même ce qui ne l’était pas : le travail, la terre, la monnaie
[et le roquefort]. Enfin, ce marché rejette tout contrôle et
prétend à une sorte d’autorité suprême : les États souverains eux-mêmes
s’inclinent devant sa loi.
Direz-vous que tout ici
n’est pas nouveau ? Que toutes choses soient devenues marchandise, on le
sait depuis longtemps, en un sens depuis Shakespeare, au besoin commenté par
Marx. C’est /X/
clair pour le
travail et pour la terre, ce l’est déjà beaucoup moins pour la monnaie, puisque
l’on a souvent pensé — et même, pour une part, Marx — qu’elle était marchandise
dès l’origine. Il reste que le phénomène ne prend tout son sens que d’une part
en contraste avec le cas général, et tout particulièrement avec les sociétés
archaïques et anciennes, et, d’autre part, lorsque l’aspect idéologique, soit
la doctrine du capitalisme libéral jusques et y compris l’étalon-or, est mis au
premier plan.
L’installation d’un tel système n’allait pas de soi.
Polanyi attire l’attention sur un gros fait de solidarité sociale qui a retardé
de quarante ans l’instauration d’un marché concurrentiel du travail et auquel
il a été sensibilisé par homologie avec la Vienne d’après 1918 (p. 365).
Ce gros fait, c’est Speenhamland, du nom de la localité du Berkshire où des
notables (« juges de paix ») réunis en 1795 ont décidé d’assurer aux
pauvres dans chaque commune (« paroisse »), qu’ils aient ou non du
travail, un minimum vital sous forme d’un revenu indexé sur le prix du pain et
tenant compte des charges de famille. Ce système de secours devait se
généraliser à d’autres comtés et n’être remplacé qu’en 1834 par la nouvelle loi
sur les pauvres. Speenhamland surprend comme un anachronisme : est-ce un
legs d’un lointain passé, surgissant au temps de la Révolution industrielle, de
Ricardo et de Malthus, ou une anticipation de nos « assurances
sociales » ? Il est vrai que la mesure n’était pas exempte de calcul
de la part des riches et qu’elle a à la longue servi leurs intérêts et
desservi, et même dégradé, les pauvres [ce
que savaient parfaitement Marx et Engels]. Mais elle démontre
à elle seule l’incongruité /XI/ foncière du libéralisme économique dans
l’histoire des sociétés : le « marché du travail » n’a régné que
de la fin de Speenhamland à l’assurance-chômage. On comprend que Karl Polanyi
revienne plusieurs fois au cours du livre, avec une sorte de prédilection, à
cet épisode. Cela d’autant plus que, comme il l’explique dans une note
détaillée (p. 365 sq.), le fait a été longtemps méconnu. On est surpris,
rétrospectivement, de ne pas l’avoir rencontré dans les longues annexes
relatives à la situation ouvrière au Livre 1 du Capital, qui
traitent en fait de la période postérieure.
Speenhamland une fois liquidé en
1834, le marché autorégulateur est maître de la situation. Le thème majeur de
Polanyi dans cette période, c’est la peinture des effets désastreux du système.
Il montre que l’essor
économique inouï que l’on sait est acquis au prix d’une profonde
désorganisation sociale. Les misères créées, les lézardes et menaces qui
apparaissent dans le corps social obligent à prendre des mesures de défense, de
protection de la société. Ces mesures ont la forme de réglementations qui interfèrent
avec le libre jeu du marché. D’où un débat permanent entre les libéraux, qui
prétendent que les défauts dans le fonctionnement du système proviennent de ces
interventions extérieures, et leurs adversaires qui affirment que l’utopie
libérale a suffisamment montré sa nocivité et que seules les mesures de
sauvegarde et de limitation ont empêché le pire [y compris, enfin, le bombardement de New York qui n’était
pas du tout prévu au programme des youpis]. On peut penser
qu’aujourd’hui, l’histoire et l’anthropologie aidant, la cause est entendue,
mais peut-être y a-t-il place pour une observation. Ce genre de débat oppose au
fond deux systèmes de valeurs, et l’opposition est conçue de manière fort
abstraite, soit « moderne » contre « traditionnel » [salafistes, les anciens !].
Quant au premier terme, on remarque que le domaine économique n’est pas le seul
où l’innovation moderne se soit dans le fait combinée avec des éléments
étrangers, voire contraires. La société démocratique a seulement greffé son modernisme
sur un tronc traditionnel : la Révolution française n’a pas fait table
rase de la famille par exemple et, comme Tocqueville nous a invités à le
reconnaître, la démocratie politique elle-même n’a fonctionné correctement à
l’échelle d’un Etat que là où elle s’est adossée à des valeurs d’un autre ordre
/XII/ (États-Unis, Angleterre). L’idéal est une chose, et le
fonctionnement de fait en est une autre. La même schématisation opère quant à
la façon dont l’autre pôle, le pôle « traditionnel » — soit ici :
les nécessités de la société globale comme tout — est conçu, témoin Max Weber
l’opposant froidement à la « rationalité ».
Toujours est-il que s’il s’agit de juger un système
social — ou ici de mesurer la nocivité du marché autorégulateur — on se placera
ici ou là ; d’un point de vue moderne les sociétés traditionnelles sont
révoltantes, d’un point de vue traditionnel la société moderne est contre
nature [le
bombardement de New York prouve qu’elle est révoltante, le mot est faible]. Je ne cherche pas ici à
jeter une ombre propice sur les horreurs de la Révolution industrielle (et je
pense à d’autres débats aussi bien, par exemple sur l’esclavage aux Etats-Unis [question toujours d’actualité : il
n’y aurait donc plus d’esclaves aux Etats-Unis. Non il y a des prostitués]).
Je veux dire seulement que le risque que nous courons, dès que nous prenons
conscience de ce genre d’opposition, est de dramatiser. En réalité et fort
heureusement, il est resté beaucoup de tradition dans la modernité [aujourd’hui, c’est fini. Les choses sont
bien tranchées. La tradition est en Arabie, ailleurs, il n’y en n’a plus.
C’est le fun, le pride et le prout qui règnent], et la
conjonction des deux vues opposées est sans doute le moyen de garder la tête
froide et de mieux pénétrer les situations réelles [et les blindages israëliens et autres].
Que résulte-t-il de cette observation dans le cas
présent ? La nocivité du marché autorégulateur n’est qu’un aspect du
processus, et il ne faudrait pas, en lui réservant notre attention, perdre de
vue l’ensemble, à savoir que le libéralisme économique s’est de la sorte
enfoncé dans les contradictions qui devaient le conduire à sa perte, la
« grande transformation » [ou
bien l’Irak ?]. De plus, ce qui rend compte de tout cela, c’est
l’inadaptation à la vie sociale de ce système de représentations et
d’institutions [c’est peut dire
mais c’est déjà bien de le dire]. C’est enfin de compte le caractère
exceptionnel de cet économisme par rapport aux autres sociétés connues qui est fondamental
pour nous, et que nous ne devons pas sous-estimer, pas plus que nous ne devons
sous-estimer la puissance et les acquisitions sans précédent de la modernité.
Cette modernité, il nous faut l’assumer à la fois dans sa puissance et dans ses
limites.
À propos de dramatisation, je puis donner un exemple
sur le cas à tout prendre un peu différent de l’impact des innovations modernes
sur une autre culture. Polanyi parle brièvement, et avec mesure, de l’Inde
(pp. 215-216). Il avait devant lui une littérature qui, selon moi,
exagérait grandement l’impact de l’économie /XIII/ moderne et de la domination britannique
sur la société des castes, laquelle a, en fait, remarquablement résisté. Il
faut dire en général que la capacité de résistance des sociétés s’est avérée
extrêmement variable. Dans certains cas, il y a eu disparition totale,
physique. Dans le cas de l’Inde tout au contraire, la nouveauté a été intégrée
dans un ensemble structurellement inchangé, au moins dans sa forme apparente —
étant entendu qu’il a pu y avoir un affaiblissement interne que nous ne sommes
pas en état d’apprécier. A y regarder de plus près, on aperçoit qu’ici
l’ampleur du changement a été exagérée par des gens qui étaient intéressés, de
diverses façons, à penser de la sorte : comme si souvent, l’observateur a
projeté ses présupposés sur le donné.
On aimerait connaître les opinions des spécialistes
sur les thèses mineures ou subsidiaires dont le livre de Polanyi regorge, qu’il
s’agisse d’économie
ou d’histoire sociale, et qui sous-tendent sa thèse majeure. Soulignons
seulement deux points généraux. Polanyi insiste sur le fait que le changement
demande à être lent pour être effectif et bien toléré, et qu’un changement trop
rapide est traumatique — de quoi nous avons des exemples récents [New York, New York].
L’observation serait banale, si nous n’avions trop connu une surévaluation
déraisonnable du changement en soi.
Un peu de la même façon, on applaudit à l’effort de
Polanyi pour replacer les classes sociales dans la société globale (pp. 208-210).
Affaire de bon sens ? Peut-être, mais alors le bon sens a beaucoup
souffert depuis Marx et Engels, avec l’oblitération de la société globale au
profit des seules classes sociales et de leurs intérêts.. Par exemple, il apparaît à
quelque degré dans ce livre que les relations entre classes sociales dans un
pays donné sont dans une certaine mesure sous la dépendance de la culture
particulière de ce pays : les « mêmes » classes n’avaient pas
exactement les mêmes relations en Angleterre, en France ou en Allemagne. Voilà
un point qu’un minimum de familiarité avec la matière semblerait devoir
imposer, à tout le moins comme une hypothèse recommandable. Comment se fait-il qu’on s’en avise si
peu aujourd’hui encore [qui s’avise
de quoi que ce soit aujourd’hui, époque de la destruction constructive] ?
/XIV/ La Grande Transformation apparaît en somme comme la
critique la plus radicale qui soit du capitalisme libéral. Encore faut-il
préciser : ce n’est pas une critique de l’industrie [soudain il n’est plus question
d’économie ?], mais de l’idéologie, et la critique est radicale
parce qu’objective, anthropologique. Disons donc que le livre contient la vue
la plus objective de la société des XIXe-XXe siècles en tant que dominée par la conception libérale de l’économie.
On peut concevoir l’embarras de maint lecteur :
s’il s’agit du capitalisme, comment choisir entre les différentes vues qu’on
lui en a proposées : entre le capitalisme de l’exploitation, le
capitalisme de la rationalité, et le capitalisme du marché [et le capitalisme de l’enculisme, alors] ?
Observons seulement que, cette dernière vue étant la seule véritablement
anthropologique, ou comparative, ce qu’il peut y avoir de vrai dans les deux
autres demande à être situé à l’intérieur de la perspective de Polanyi. Il est
vrai que la perspective comparative de Polanyi n’est pas complète, mais porte
seulement sur un aspect — si fondamental qu’il soit — de l’idéologie,
savoir : la
constitution des composantes économiques de la vie sociale en un sous-système
distinct qui subordonne tout le reste [ceci n’est pas « la constitution » mais
seulement le rêve de la constitution, le rêve des singesmincs que guette
le pal]. On pourrait montrer que d’autres traits idéologiques accompagnent
celui-ci, par exemple que, s’agissant d’un primat des relations aux choses à
l’encontre des relations entre hommes [se
faire enculer huit heures pendant cinq jours par semaine, ce n’est pas une
relation entre hommes ça ?], il est lié à une primauté générale de
l’individu comme valeur. Bref, le clivage crucial qui occupe Polanyi est lié à
d’autres aspects idéologiques, et sa perspective peut être élargie ou complétée
dans ce sens.
Ici nous retrouvons un problème déjà aperçu dans ce
qui précède, et qui réclame toute notre attention. Si nous admettons que le
libéralisme économique a vécu, n’en résulte-t-il pas un amoindrissement et une
menace pour la liberté comme valeur en général et pour la démocratie en
particulier ? Un champion du libéralisme comme Hayek a beau jeu de
dénoncer les dangers qui résultent pour la liberté de la planification et du
dirigisme (cf. ci-dessus p. VII, n° 1). Que Polanyi soit attaché à la
liberté ne fait pas de doute, mais si sa conviction et son intention sont
claires, son « interrogation angoissée » quant à l’avenir de la
liberté (p. 332) ne reçoit pas de réponse qui tienne aujourd’hui, à la lumière de ce qui s’est imposé
à nous depuis 1944. Où en sommes-nous, Par rapport à la préoccupation même de
Polanyi ?
/XV/ L’auteur n’avait guère d’illusions sur
l’U.R.S.S. (p. 329), mais du fait des circonstances de guerre et sans
doute aussi par désir de dominer ses sentiments personnels, il n’a pas voulu
être catégorique. En fait, il est bien clair que l’U.R.S.S. n’a rien de commun
avec le socialisme au sens de Polanyi. Le fait est que là où on s’est proposé
explicitement de mettre fin au libéralisme économique, ou au primat de l’économie sous sa forme
capitaliste, on a détruit la liberté et fait régner l’oppression. Une analyse
élargie de l’idéologie économique, comme celle à laquelle je viens de faire
allusion, donne des raisons de penser qu’il y a là, non pas un hasard, mais une
nécessité [oui, Staline a voulu
réaliser l’économie].
Restent les pays démocratiques, où la liberté subsiste
comme idéal et comme norme fondamentale, mais où on admet en pratique que, dans
le domaine économique, la liberté ne suffit pas à tout et doit être contenue
entre certaines limites. Des pays où, en somme, on observe dans le domaine
économique ce qu’on appelle sur un autre plan une « coexistence »
d’opposés. C’est une coexistence empirique, plus ou moins obscure ou honteuse,
une sorte d’alliage sans formule précise : il y a liberté sur un point,
dirigisme ou protectionnisme sur un autre. La complexité des questions et des
situations telles qu’elles se présentent à l’expérience, l’absence de grandes
lignes et de principes directeurs font que ces problèmes sont du ressort
exclusif des techniciens et des hommes politiques et échappent à l’opinion
publique.
Idéalement pourtant, on peut concevoir qu’il en soit
autrement, et c’est peut-être de ce côté que l’on peut chercher à répondre au
vœu fervent de Karl Polanyi. La preuve est faite d’une part que la liberté doit
demeurer suprême, ou disparaître [le
monde aussi peut disparaître, bon débarras], d’autre part qu’à suivre
ses seules injonctions jusqu’au bout partout on parvient à l’absurde ou à
l’intolérable — comme dans le libéralisme économique. Outre que la Loi doit
rester suprême, il résulte de là que la liberté peut et doit être contredite à
des niveaux subordonnés aussi bien dans la Loi que dans la conscience des
citoyens. Dans ce but, il faudra distinguer différentes formes de liberté [il serait temps] et différents
niveaux d’expérience en garantissant leur hiérarchie, c’est-à-dire mettre en
œuvre un modèle plus complexe qu’on ne fait d’ordinaire. L’essentiel est de
subordonner les nécessaires disciplines sociales aux droits et libertés
individuels [la liberté est une
affaire collective] fondamentaux. C’est ici peut-être qu’on s’écarte du
rêve socialiste de Polanyi — encore qu’il /XVI/ ait parlé en un passage de subordonner l’efficacité de la production
à la liberté personnelle (pp. 328-329) [la liberté
personnelle est une affaire collective]. Ainsi, on peut à tout le moins concevoir une
configuration clairement articulée où la liberté politique affirme sa
suprématie et où la liberté économique [c’est
à dire la liberté du commerce et des commerçants] soit, elle, assujettie
aux contraintes d’une
économie à quelque degré planifiée ou dirigée ; où, sur d’autres
plans, les droits respectifs des individus d’une part, des peuples et
collectivités de l’autre, la primauté relative des relations internationales et
intra-nationales, et en général les valeurs individualistes [les valeurs individualistes sont des
affaires collectives] et les nécessités de la vie sociale soient
combinés par subordination réciproque dans un ordre général.
Quitte à déborder pour un instant notre objet propre,
indiquons brièvement comment la démarche de Polanyi demande à être prolongée
sur l’autre versant de sa pensée, particulièrement quant aux sociétés tribales.
Ici on peut se demander si Polanyi n’a pas à vrai dire tourné court ;
ayant critiqué l’économie
comme idée, il a pensé à la conserver comme chose [intéressant, nous allons voir ça], et il en est venu à
proposer l’emploi de concepts généraux, dont celui de réciprocité. Mais
celui-ci est à peine moins sociocentrique que celui de production. Il suppose,
en effet, des sujets qui demeureraient intangibles à travers les échanges entre
eux, et Mauss nous a appris au contraire que dans ces sociétés on échange, dans
les cas les plus significatifs, quelque chose de soi en même temps que des
choses. Or l’Essai
sur le Don de
1925, où l’on trouve ce genre de propositions, est sans doute à l’heure
actuelle le texte le plus admiré par les anthropologues dans le monde
entier ; un peu partout, et entre autres à Paris, on s’efforce de
travailler dans la ligne que l’on trouve indiquée chez Mauss. Par rapport à Polanyi, cela
revient à refuser jusqu’au bout la compartimentation que notre société
et elle seule propose, et, au lieu de chercher dans l’économie le sens de la totalité sociale — ce à quoi Polanyi s’est
certes opposé —, à chercher dans la totalité sociale le sens de ce qui est chez
nous et pour nous économie.
[je ne comprends pas bien ce
passage. Ce qui est chez nous et pour moi économie n’est rien du tout
sinon l’objet d’une croyance non fondée, croyance qui a, bien évidemment, sa raison
d’être, raison d’être qui est le véritable objet d’étude. Un objet d’étude
encore plus intéressant, c’est ce qui a lieu effectivement ; mais il est
fort possible qu’il ne soit pas encore abordable aujourd’hui. La raison d’être
paraît à la fin, quand on n’a plus besoin d’elle, quand les jeux sont faits,
ailleurs que dans la philosophie, évidemment]
|
« Une transformation a lieu dans l’Europe occidentale au long des siècles, elle est signalée de la façon la plus spectaculaire par l’émergence de nouvelles catégories de pensée, comme le politique et l’économique, et les institutions correspondantes. » (Dumont, Genèse et épanouissement de l’idéologie économique, « Introduction », page 23)
|
Éclairons cela par un exemple. On connaît la fonction
de la monnaie comme « équivalent général », mais on ne s’est guère demandé
quelles étaient au plan global — j’entends au plan de la société globale et des
représentations globales qui y ont cours — les conditions nécessaires à
l’existence d’un tel « équivalent général ».
/XVII/ Or, si nous admettons que les monnaies
de coquillage de certaines sociétés mélanésiennes ne sont pas à considérer
comme autre chose que des monnaies, nous trouvons que ces sociétés ont réponse
à notre question. En effet, chez elles, on trouve, comme Maurice Leenhardt et
Hocart l’avaient déjà dit, que la monnaie représente tout simplement, ou avant
tout, la vie ou, ce qui est à peu près la même chose, les ancêtres. Voilà bien
l’universel au sens de ces sociétés, c’est-à-dire ce qui est partout comme
valeur, et voilà où, pour elles, le symbole puise sa capacité d’équivalent
général — ou virtuellement général.
Nous avons vu la grande originalité de La Grande Transformation dans son comparatisme, dans
l’idée, implicite ou sous-jacente comme telle, que la civilisation moderne et
son histoire deviennent compréhensibles dans un sens tout nouveau une fois vues
en relation avec les autres civilisations et cultures. Voilà un début de cette
« mise en perspective » anthropologique qu’Evans-Pritchard demandait
et annonçait. Voilà, me semble-t-il, retrouvée cette promesse d’un nouvel
humanisme que certains d’entre nous trouvaient dans l’enseignement de Mauss, et
qui peut-être résonne aujourd’hui aux oreilles de la profession anthropologique
dans le monde.
Rien n’est plus actuel que cette mise en relation des
cultures. Il est banal de dire que le monde où nous vivons est un monde où les
différentes cultures interagissent, mais notre vue est le plus souvent étroite
et nous sommes loin de mesurer à quel point notre monde est tissé de cette
interaction des cultures.
Par exemple, les événements mondiaux récents ont
montré toujours de nouveau le poids de l’amour-propre des nations ou États,
l’importance pour les peuples du sentiment et de la préoccupation de leur
dignité. Or, ce besoin de reconnaissance de l’identité collective se situe
précisément au point d’articulation des valeurs universalistes et des cultures
particulières : il s’agit en définitive du poids des cultures et de leur
interrelation. Notre monde est un /XVIII/ monde interculturel, et ce point de
vue fait pleinement droit aux représentations des acteurs, qu’on a eu tendance
à sous-estimer.
En fait, ce que nous prenons comme l’ensemble des
idées et valeurs modernes est déjà à l’heure actuelle dans une grande mesure le
résultat de cette interaction des cultures, du fait d’une action en retour des
cultures dominées sur la culture dominante. Cette action en retour passe je
crois presque inaperçue, et je voudrais la signaler brièvement, en attendant
une présentation moins schématique.
Je n’ai pas en vue ici le simple emprunt par la
culture moderne d’éléments détachés des cultures traditionnelles, comme par
exemple l’influence de la plastique africaine sur les peintres du XXe siècle, mais quelque chose
de beaucoup plus central, au plan de l’idéologie sociale et politique.
Lorsqu’une culture déterminée s’adapte à la culture moderne ou, comme disent
les anthropologues, « s’acculture », elle construit normalement des
représentations qui la justifient par rapport à la culture dominante (Russie au
XIXe, Inde aux XIXe-XXe siècles). Ces
représentations sont si l’on veut une « synthèse », plus ou moins
profonde, une sorte d’alliage sui generis des deux sortes de
représentations ; elles ont deux faces : une face universaliste en
relation avec la culture dominante, une face particulariste en relation avec la
culture dominée, et pour cette raison ces produits de l’acculturation d’une
culture particulière peuvent passer dans la culture dominante ou
universelle du moment. Je ne donnerai qu’un exemple. J’ai montré ailleurs que
la théorie ethnique des nationalités est née de l’affirmation par Herder des
droits égaux de toutes les cultures face au cosmopolitisme des Lumières
occidentales — ce que nous pouvons prendre comme un aspect de l’acculturation
de l’Allemagne à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle aux idées-valeurs
des Lumières et de la Révolution française. Or cette théorie ethnique des
nationalités figure au XXe
siècle dans le patrimoine moderne pur et simple. L’Allemagne a ainsi frayé la
voie aux acculturations subséquentes et fourni un instrument indispensable à
l’adaptation au monde réel des valeurs individualistes.
Le monde de nos représentations réputées modernes
est ainsi pénétré de notions qui résultent en réalité de l’interaction entre la
modernité et la non-modernité, ou de l’adaptation spontanée de la modernité au
monde ambiant.
Ces notions plus ou moins synthétiques — dont
l’inventaire est /XIX/ à faire — doivent à leur origine des caractères
qui peuvent paraître préoccupants ; elles sont souvent empreintes d’une
sorte d’intensification ou de surenchère par rapport aux notions d’où elles
sont sorties, et dans certains cas elles se sont révélées à ce titre
dangereuses. Je ne puis ici que faire allusion à ce problème, mais il semble
bien que la révolution bolchevique d’un côté, le nazisme de l’autre, n’aient
été possibles qu’à partir de telles combinaisons. Dans le premier cas l’artificialisme scientiste de
Marx s’est accru, chez Lénine, de la prétention à passer par-dessus le
stade bourgeois ou capitaliste de développement économique. Et cette prétention
ne s’explique que par l’héritage du populisme russe. Le cas du nazisme est plus
complexe, mais il a, entre autres, et fort nettement, le caractère d’une
surenchère par rapport au bolchevisme qu’il copie et prétend dépasser.
Si nous nous retournons vers la Grande
Transformation, nous voyons que nous ne nous en sommes guère éloignés : là
aussi la modernité, en l’espèce le libéralisme économique, s’allie en première
approximation à
son contraire
dans la vie d’aujourd’hui.
Dans ce domaine
comme dans d’autres, les idées-valeurs modernes, c’est-à-dire celles de
l’individualisme, se sont combinées dans le fait, même là où elles continuent
d’être affirmées, avec des valeurs opposées qu’on peut qualifier de non modernes,
constituant ainsi ce qu’on pourrait appeler pour la clarté la
« post-modernité » de notre temps. En ce sens la Grande
Transformation continue...
Louis Dumont
Août 1982.
|
Ça commence mal Je survole et,
chapitre 4, je lis ceci : « Précisons notre propos.
Aucune société ne saurait naturellement vivre, même pour peu de temps, sans
posséder une économie d'une sorte ou d'une autre ; mais avant notre
époque, aucune économie n'a jamais existé qui fût, même en principe, sous la
dépendance des marchés. En dépit du chœur d'incantations universitaires, si
opiniâtre tout au long du XIXe siècle, le gain et le
profit tiré des échanges n'avaient jamais joué auparavant un rôle important
dans l'économie humaine. Quoique l'institution du marché ait été tout à fait
courante depuis la fin de l'Âge de pierre, son rôle n'avait jamais été que
secondaire dans la vie économique. » Ce n’est pas seulement une
économie sous la dépendance des marchés qui caractérise notre époque, mais la
proclamation de l’existence d’une économie tout court, ce qui signifie entre
autre, la proclamation que toutes les civilisations ont eut une économie, ce
que nous assène notre Polanyi. Il n’y avait pas d’économie à Kirivina
(j’ignore ce qu’est devenu ce district aujourd’hui). Les gens n’avaient pas
de besoins à Kirivina. Il n’y avait pas de système des besoins à Kirivina
(quoique, du temps de Malinowski, la pêche aux perles faisaient déjà déserter
les pêcheurs de leurs devoirs rituels.) Heil Hegel ! Grande Loi : où il y a des rites,
il n’y a pas de besoins. C’est aussi simple que ça. |
|
C’est
bien vrai « Il
fut un temps où l'on appelait libres penseurs les sans-dieu, les athées. Nous
avons depuis longtemps dépassé ce stade. Chez les athées aussi, on peut trouver
quantité de gens étroits d'esprit et sans énergie, avec une mentalité de
petits-bourgeois, qu'on devrait considérer comme tout sauf des libres
penseurs, alors qu'une disposition religieuse peut rendre un homme capable de
la révolte spirituelle la plus audacieuse, et parmi ceux qui sont morts pour
la cause de la liberté de pensée, la première place sera toujours occupée par
Jésus de Nazareth. » |
Fragment de manuscrit cité par la femme de Polanyi dans son introduction
|
« La perspective de The
Great Transformation, son schéma général et, surtout, les expériences qui
lui avaient donné naissance avaient pris forme dès 1940. Le livre fut publié
à New York en 1944, à Londres en 1945. Lors d'un congrès de sociologie qui se tint en
Angleterre en 1946, Polanyi formula ses thèses en trois points : 1.
Le déterminisme économique est principalement un phénomène du XIXe
siècle, qui a maintenant cessé d'opérer dans la plus grande partie du
monde ; il n'a eu d'effet que dans un système de marché, lequel est en
train de disparaître rapidement en Europe ; 2.
Le système de marché a violemment déformé nos vues sur l'homme et la
société ; 3. Ces vues déformées
se révèlent être l'un des principaux obstacles qui empêchent de résoudre les
problèmes de notre civilisation. » |
Extrait de l’Introduction d’Ilona Duczynska