Réponse à l’auteur de
« Marx envers et contre Marx»*
et à quelques autres
Revue de Préhistoire
contemporaine n° 1. 24
mai 1982.
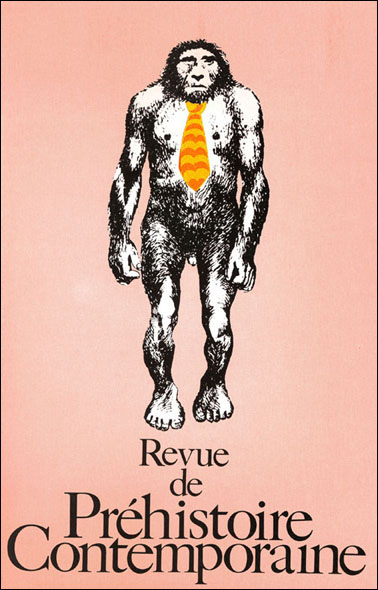
1. Précisions
2. L’objet comme infirmité
3. Notre position en ce qui concerne Hegel
4. La division du travail est le mouvement de la pensée
dans le monde
5. La physique à la rescousse de la préhistoire
contemporaine
6. L’archéologie à la rescousse de la préhistoire
contemporaine
7. L’ethnographie à la rescousse de la préhistoire
contemporaine
1. Précisions.
Selon
l’immonde réalisme matérialiste marxiste tel qu’il est formulé dans l’immonde Matérialisme
et empiriocriticisme – déjà justement dénoncé par Pannekoek dans son Lénine
philosophe – la connaissance se rapporte à une réalité extérieure,
matérielle, indépendante de la conscience, à un donné objectif que la pensée
rencontre sans l’avoir constitué. Cette conception est d’ailleurs celle de tout
réalisme matérialiste. Selon l’immonde réalisme matérialiste, l’objet de la
pensée, bien que n’étant pas posé par la pensée est cependant connaissable.
Selon l’immonde réalisme matérialiste l’objet est la réalité et la connaissance
est le reflet de cette réalité. (Guy Haarsher, présentation du Jeune Hegel
de G. Lukacs, Gallimard, 1981.)
Ou
encore : " Selon le réalisme il est juste et sensé d’affirmer
qu’une réalité existe et qu’elle est indépendante de l’esprit humain. De plus,
selon ce courant de pensée, l’esprit humain peut progresser dans la direction
d’une connaissance toujours meilleure d’une telle réalité. " (Bernard
d’Espagnat, A la recherche du réel, Le regard d’un physicien,
Gauthier-Villars, 1979.)
Nous sommes
évidemment en désaccord total avec le réalisme matérialiste. D’abord sur la
nature de la connaissance et donc sur toutes les questions qui en découlent au
premier rang desquelles la question de la réalité. Pour le réalisme
matérialiste, la connaissance se réduit à la conscience de l’individu. Pour
nous au contraire la connaissance n’est pas la conscience ou la pensée de
l’individu mais un monde, mais le mouvement de la pensée dans le monde
et la connaissance ainsi entendue constitue elle-même la réalité. Il s’ensuit
bien évidemment que la connaissance ne se rapporte pas à une réalité extérieure
et indépendante mais à elle-même. Et la connaissance entendue au sens réaliste
matérialiste, comme pensée ou conscience de l’individu, se rapporte
nécessairement à la connaissance comme monde. La pensée se rapporte donc
nécessairement au mouvement de la pensée dans le monde.
Il peut
sembler cependant que nous soyons d’accord sur deux points avec le réalisme
matérialiste puisque 1o nous estimons avec Hegel qu’une réalité
existe et qu’elle est extérieure à la conscience et à la pensée de l’individu
pauvre, 2o nous estimons, contre Kant, que la réalité est
connaissable. Mais cet accord est une simple apparence car nous sommes
absolument opposés au réalisme matérialiste sur le sens des mots comme nous
sommes absolument opposés à lui sur le sens des mots communisme et révolution.
Une réalité existe mais non telle que la conçoit le réalisme matérialiste. La
réalité de ce réalisme n’est pas réelle. C’est un des mérites de la discussion
du physicien d’Espagnat, quelles que soient par ailleurs ses conclusions, de
mettre en évidence la naïveté de cette conception matérialiste et surtout de
montrer que ces questions toujours supposées résolues par le dogmatisme
matérialiste ne le sont pas.
Selon nous, la
réalité existe indépendamment de la conscience et de la pensée mais cependant
elle ne saurait être opposée à l’esprit humain comme le veut le matérialisme.
Pour ce dernier, l’esprit humain se réduit à la conscience ou à la pensée.
Ainsi, tout indigné qu’il est par le procédé de Lénine contre Mach, Pannekoek
(de même que Lukacs) ne peut concevoir que, si le monde est de nature spirituelle,
cela ne signifie pas pour autant qu’il soit " psychique ",
dans la conscience. Pour nous au contraire, l’esprit humain consiste dans le
mouvement de la pensée dans le monde et la réalité n’est autre que ce
mouvement. Aussi, la réalité ne saurait être opposée à l’esprit humain mais
seulement à la conscience et à la pensée. C’est l’esprit humain lui-même qui
est indépendant de la conscience et de la pensée de l’individu et non seulement
de sa pensée et de sa conscience mais de toute sa vie. La pensée et la
conscience de l’individu ne sont pas la connaissance. Considérées en
elles-mêmes elles sont misère et ignorance. Une réalité existe indépendamment
de la conscience et de la pensée mais cette réalité est déjà connaissance
puisque mouvement de la pensée dans ce qui existe, et cette connaissance est
indépendante de la conscience et de la pensée de l’individu. Cette fameuse
réalité indépendante de la conscience n’est pas, comme le veulent les
lénin’philosophes, matérielle, mais spirituelle comme le veut Hegel.
De même, si
nous affirmons, contre Kant, que la réalité est connaissable, c’est évidemment
pour des raisons bien différentes de celles des matérialistes. Selon nous,
après Hegel, si la réalité est connaissable, c’est parce qu’elle est déjà connaissance.
Si nous semblons donc admettre avec le réalisme que " l’esprit humain
peut progresser dans la direction d’une connaissance toujours meilleure de la
réalité " c’est seulement parce que, pour nous comme pour Hegel,
esprit humain, connaissance et réalité sont une seule et même chose. Si nous
admettons que la connaissance puisse progresser, ce n’est pas en ce que la
pensée déterminée progresserait vers la connaissance d’une réalité immuable
mais au sens où la réalité étant de toute façon connaissance, mouvement de la
pensée dans le monde, la progression de la connaissance est la progression de
la réalité elle-même et particulièrement la progression du mouvement de la
pensée dans le monde vers la forme pensée. Ce n’est donc pas le travail de la
pensée de s’approprier le monde comme le prétend Saligue, conception
parfaitement politique, léniniste (l’État est cette prétention de la pensée
particulière et bornée à se saisir du monde) mais le travail du monde de
s’approprier la forme pensée.
Ensuite, nous
pouvons sembler d’accord avec Kant et Saligue puisque nous affirmons en quelque
sorte que nous ne pouvons connaître que la connaissance. Mais évidemment, notre
conception de la connaissance n’est pas celle de Kant pas plus que notre
conception de la chose. Cette connaissance que l’on peut connaître est déjà le
mouvement de destruction de ce qui existe. De même, la chose n’est pas ce qui
existe mais le mouvement de sa destruction et la question de la connaissance de
ce qui existe (question nécessairement posée par un spectateur du monde) ne se
pose plus puisque ce qui existe est détruit, du moins son indépendance.
La connaissance ne laisse rien derrière elle qui serait à connaître. Là où la connaissance
passe, l’herbe de l’indépendance ne repousse plus. La chose n’est pas ce qui
existe mais une aventure qui arrive à ce qui existe, l’aventure de sa
destruction. Comme on le voit, notre conception de la connaissance est
extrêmement " matérialiste " au sens d’Hiroshima et
Nagasaki, évidemment.
Nous affirmons
encore, avec le réalisme matérialiste, que la conscience de l’individu pauvre
rencontre un donné objectif sans l’avoir pour autant constitué.
Autrement dit, nous admettons que ce donné est un véritable donné. Mais là
encore, nous nous opposons absolument au réalisme matérialiste car nous
affirmons contre lui que l’objet, le donné objectif, n’est pas la réalité.
Nous nous
opposons donc au réalisme matérialiste sur la nature de la réalité extérieure
et indépendante, sur la nature du donné objectif, sur la nature de l’objet et
de l’objectivité. Nous nous opposons à la confusion faite par le réalisme
matérialiste entre pensée et connaissance, entre pensée et mouvement de la
pensée dans le monde. Nous nous opposons à la confusion faite par le réalisme
matérialiste entre donné objectif et réalité, entre objet et réalité. Mais
surtout, contrairement à l’immonde réalisme matérialiste et à tous ses
partisans, qu’ils soient à Moscou, à Champ Libre et même dans les monts
Nan-Chan-Fouchtra, nous combattons, comme le font en ce moment même les
Polonais avec des moyens bien supérieurs aux nôtres, l’indépendance et
l’extériorité de la réalité. Comme les Polonais en ce moment même, nous
combattons contre ce fait qu’aujourd’hui pour tout individu pauvre la réalité
se ramène à un donné objectif. Ce combat contre une pensée absolument dominante
et universellement admise aujourd’hui – sauf à Copenhague – sera notre modeste
contribution au combat des Polonais puisque cette pensée est non seulement
celle de leurs maîtres staliniens depuis trente ans mais aussi celle de
prétendus alliés de ces Polonais.
Indépendamment
du fait de savoir si ceux qui prétendent que la théorie révolutionnaire moderne
peut exprimer la révolte des Polonais mentent, on a pu remarquer dernièrement
que beaucoup plus prosaïquement des partisans de cette théorie révolutionnaire
moderne ont menti à Paris. Donc la question n’est pas tant que cette
théorie risque de mentir à Varsovie mais beaucoup plus prosaïquement qu’elle a
déjà menti à Paris, à notre porte donc. C’est donc là qu’il faut balayer. Et
combattre ici le rôle contre-révolutionnaire de la pensée
révolutionnaire " moderne " sera précisément notre façon de
secourir les Polonais. Il est important pour les Polonais que la pensée de
leurs maîtres, pensée qui domina jusque dans la pensée de Marx et dans celle de
l’I.S., soit désormais combattue à Paris car les Polonais combattent en Pologne
le monde qui a produit cette pensée. Il est important que les Polonais sachent
que la pensée de leurs maîtres est attaquée dans la théorie à Paris tandis
qu’eux attaquent directement ces maîtres dans le monde en Pologne. Alors que
nulle part dans le monde on ne peut ignorer que les Polonais attaquent leurs
maîtres, personne ne sait ou presque que la pensée de ces maîtres est attaquée
dans la théorie à Paris et certains de ceux qui le savent font tout pour que
cela ne se sache pas. Faudra-t-il donc que les Polonais déjà fort occupés nous
délivrent de cette racaille ou bien le ferons-nous nous-mêmes?
2.
L’objet comme infirmité.
En 1841
Feuerbach écrivait : " La conscience de l’objet est la
conscience de soi de l’homme. " Il ne croyait pas si bien dire! En
effet, en 1841 c’est à cela qu’est réduite la conscience de soi de l’homme, à
cette infirmité. Alors que la conscience de soi de l’homme libre devrait ne pas
se distinguer de la conscience de la communication mondiale, elle se réduit en
1841 à la conscience de l’objet! On comprend mieux, a contrario, ce que voulait
Hegel : il voulait que la conscience de soi de l’homme ne se distingue pas
de la conscience de la communication mondiale, ce qui lui est évidemment
reproché par Lukacs. Il ne tiendrait pas compte de l’objet! Et la constatation
de Feuerbach est présentée comme un progrès sur la pensée de Hegel. Et c’en est
un puisque c’est aussi la constatation véridique de l’état dans lequel se
trouve la conscience de soi en 1841. Mais c’est aussi un mensonge dans la
mesure où Feuerbach présente cette infirmité comme la nature même de l’homme.
Hegel pêche par optimisme. Il ne veut pas voir la misère dans laquelle est
plongée la conscience de soi ou plutôt il pense que cette misère peut trouver
une solution purement philosophique, seulement pensée et non pratique. La
question de former enfin une idée de la réalité n’est pas un problème de pensée
mais un problème de communication.
Tout au
contraire de ce qu’affirme le stalinien Lukacs,
l’" objectivité " ne constitue pas " un mode
naturel (appréciez le naturel) de domination humaine du monde " mais
bien une infirmité historiquement produite par l’aliénation de la
communication. La connerie matérialiste est seulement une modalité de cette
infirmité. Avec Hegel et contre le stalinien Lukacs, nous affirmons que
l’objectivité doit disparaître. L’art témoigne de cette infirmité en tentant de
la dépasser avec les moyens dont il dispose. L’art témoigne que la finitude de
l’objet est une pure apparence qui résulte seulement de la finitude de
l’individu pauvre. Sous l’apparence finie il montre le mouvement de l’esprit,
le mouvement de la communication, le mana dont est précisément exclu l’individu
pauvre. Hegel poursuit donc le but de l’art avec d’autres moyens. Cela explique
d’ailleurs la supériorité incontestée de son esthétique. L’objet et
l’objectivité sont seulement la forme que prennent, pour l’observateur pauvre,
le riche mouvement de la pensée dans le monde. Il y a nécessairement quelque
chose de réel dans l’objet, précisément ce qui donne l’objet, cette
aumône d’un monde riche aux pauvres qui l’habitent.
La conscience
de l’objet est nécessairement conscience d’un état de la communication, la
conscience de l’objet est la forme que prend cette conscience d’un état de la
communication dans l’aliénation de la communication, pour l’homme pauvre et
isolé. La réduction du riche mouvement de la communication, du riche mouvement
de la pensée dans le monde à un simple objet pour la conscience de l’homme
pauvre est la simple corrélation de la réduction de sa vie à une vie de pauvre,
privée de communication et isolée de la communication mondiale.
Donc, selon
nous et contre Hegel, l’objectivation ne signifie pas que le monde serait la
réalisation – improprement nommée objectivation – d’une pensée particulière. Au
contraire, l’objectivation est la réduction, par la pensée séparée et bornée de
l’homme pauvre, de l’homme séparé du riche mouvement de la pensée dans le
monde, la réduction de ce riche mouvement à un " simple "
objet. Encore n’est-ce pas n’importe quelle conscience pauvre, celle du public
le plus général, qui saisit la réalité comme un objet mais seulement la
conscience de personnes disposant de temps pour la réflexion, la conscience des
professeurs. Le pauvre ordinaire, le pauvre qui n’est pas professeur a
généralement d’autres soucis et de plus connaît aussi bien que n’importe quel
Trobriandais, comme il le prouve désormais à chaque panne d’électricité, le
mana qui réside dans les objets. C’est donc tout à fait improprement que les
professeurs identifient habituellement les termes
" objectivation " et " réalisation ".
Tout au contraire l’objectivation du riche mouvement de la pensée dans le monde
par la conscience pauvre du professeur est la déréalisation de ce
mouvement. Cela n’a rien d’étonnant, au contraire il est normal que l’individu
pauvre radicalement séparé du riche mouvement de la pensée dans le monde ne
puisse rien comprendre à ce mouvement et qu’il ne puisse saisir ce mouvement
que comme quelque chose de séparé, posé devant lui et incompréhensible.
D’autant plus pour cette catégorie de la population à laquelle appartiennent
les professeurs, catégorie dont la majeure partie des efforts tend à vouloir se
dissimuler à tout prix qu’elle est pauvre.
Le prétendu
" objet de connaissance " est déjà connaissance. Aussi,
ce qui est à connaître dans cet objet n’est pas une prétendue nature, une
prétendue matière réputées, par la pensée réaliste dominante,
" réelles " et seules réelles, mais bien la connaissance
elle-même, c’est-à-dire l’acte de destruction irrémédiable de ce qui existe. Et
ce qu’ignore l’observateur pauvre n’est pas la prétendue nature ou la prétendue
matière, le prétendu réel de la pensée réaliste dominante, mais la connaissance
elle-même, mais le mouvement de destruction irrémédiable de ce qui existe. Ce
n’est pas de la prétendue nature ou de la prétendue matière dont l’observateur
pauvre est séparé, mais de la connaissance même, mais de sa propre espèce
pratique. Ce n’est pas la prétendue nature ou la prétendue matière qu’il
s’agirait de dominer mais simplement la connaissance. Ce n’est pas la prétendue
nature ou la prétendue matière qui domine l’homme mais la connaissance, mais sa
propre essence.
Aussi est-ce
insuffisant d’observer avec Marx et Boas que l’œil qui voit est l’œil de la
tradition : ce que voit cet œil est la tradition elle-même, chose
bien connue des sauvages qui auraient le tort, selon Lévi Strauss de ne pas
faire de différence entre le moment de l’observation et le moment de la
conception. Aussi la critique de Feuerbach par Marx est-elle encore
insuffisante, ce qui n’est pas étonnant vu la conception restrictive de Marx
quant à la connaissance. Ce n’est pas seulement le cerisier ou le pêcher parce
qu’ils sont importés ou tel objet parce qu’il est manufacturé mais tout objet,
fut-il la plus lointaine galaxie peu susceptible d’importation, qui est déjà
connaissance, déjà état du monde en tant que connaissance. En fait,
l’observation d’une galaxie est la description des performances d’un méga
instrument : l’instrument monde, dans son œuvre de destruction
irrémédiable de l’immédiateté de ce qui existe. C’est une naïveté mais aussi
une calomnie du monde que de prétendre vouloir atteindre la pureté originelle
d’une matière qui constituerait la réalité ultime. Cette pureté originelle de
ce qui existe est irrémédiablement détruite, car la connaissance comme monde
n’est pas, comme la morale de Kant, sans main, mais lourdement pratique comme
le voulaient Marx et Hegel, même s’il faut affirmer cela contre Marx mais aussi
contre les solipsistes enragés pour qui l’esprit et la connaissance sont
toujours, quoiqu’ils en disent, leur petit esprit et leur petite connaissance
de savants salariés, coincés, avec leur petite auto, dans les embouteillages.
Or la connaissance, le jugement de tout ça, c’est l’embouteillage lui-même.
Nous rappelons
la fameuse thèse de Marx critiquant Feuerbach : Feuerbach ne saisit le
sensible que sous la forme d’objet, non d’activité. Voilà une excellente
critique qui s’applique aussi excellemment à Marx. Marx et les matérialistes ne
saisissent le sensible que sous la forme d’objet, non d’activité. Hegel montre
que la finitude de l’objet est seulement une apparence et que l’être de l’objet
est plutôt l’infini, c’est-à-dire au sens de Hegel une activité infinie,
interne. Le concept de spectacle est déjà un progrès puisque l’objet y est
directement saisi comme spectacle d’une activité ou représentation d’une
activité : " Tout ce qui était directement vécu s’est éloigné
dans une représentation. " Évidemment, ce " directement
vécu " n’a jamais existé dans aucun âge d’or antérieur, c’est
seulement une figure de style, une illusion du ressouvenir et de la
récollection. En effet, ce qui semble avoir été directement vécu, à savoir la
communication, ne paraît tel que parce qu’il était aussi moins grand, moins
universel, plus intime donc, bucolique et idyllique pour parler comme Hegel
parle des héros homériques qui construisaient eux-mêmes leur lit, leurs armes
etc.
Les
" objets ", les marchandises s’opposent à la
marchandise, au processus total de l’aliénation de la communication. C’est
cet aspect total de la marchandise qui dépasse et englobe chaque marchandise
particulière aussi bien que tout " objet " particulier, que
Debord désigne par le terme de spectacle. Avec ce concept de spectacle,
ce côté total de la marchandise ne peut plus être ignoré car il est impossible
de considérer une marchandise particulière comme un spectacle sinon comme élément
d’un décor où se joue une pièce d’envergure mondiale. Ce n’est plus une
marchandise particulière qui peut être spectacle mais seulement la totalité de
leur accumulation et de leurs relations. Et ce qui est réel dans une
marchandise particulière est seulement ce qui tient à son rôle dans un décor
total, seulement ce qui a trait au spectacle de la communication totale. C’est
en ce sens que la marchandise est l’œuvre d’art moderne : elle dénonce
elle-même sa finitude comme pure apparence et révèle que son être est plutôt
l’infini, un mouvement infini.
La question
n’est donc pas que l’objet soit extérieur ou non à l’individu, à la
subjectivité puisque précisément, tout dans ce monde est extérieur à
l’individu, pure subjectivité vide, mais que l’objet est une infime
manifestation – à la mesure de l’infime individu réduit à cette pure
subjectivité impuissante et malheureuse – de ce tout extérieur à
l’individu et qui est la réalité, la substance, le sujet véritable de cette
extériorité. Tout comme l’objet – cette prétendue réalité pour le matérialiste,
pour le lénin’philosophe – la réalité est absolument extérieure à l’individu et
de plus ne se manifeste pas sinon comme objet – dans la théorie – et comme
spectacle hors de la théorie, heureusement. En tant que spectacle de la
communication totale, le spectacle dément heureusement les prétentions à la
finitude de l’objet de la théorie matérialiste et léniniste.
Le spectacle,
le monde achevé comme spectacle, dément la pensée pauvre du professeur qui ne
peut saisir la communication que comme objet. En ce sens le spectacle est bien déjà
la réalisation de l’art. Il fait à grande échelle et pour tous ce que l’art
faisait à petite échelle et pour quelques-uns. C’est pourquoi les tardives
mesures prises par l’ennemi en ce qui concerne la
" démocratisation " de l’art (musique et théâtre dans les
couloirs du métro!) sont absolument dérisoires en regard du spectacle mondial
et le laisseront aussi démuni devant les révoltes qui se préparent que l’y
laissèrent ses cultureux et sociologues devant les révoltes de 1968.
N’en déplaise
à Lukacs, oui il faut en finir avec la logique matérialiste, improprement
nommée logique de la conscience ordinaire par Hegel, et fondée sur la
séparation entre le contenu de la connaissance et la forme de la connaissance,
contenu qui est abusivement tenu par les matérialistes pour être l’objet et
forme aussi abusivement tenue par les mêmes pour la conscience de l’individu.
Avec Hegel, nous soutenons que la connaissance est le monde lui-même,
c’est-à-dire le mouvement de la pensée dans ce qui existe et que la prétendue
forme de la connaissance, la pensée ou la conscience de l’individu, n’est en
général que la forme de l’ignorance et de la misère. Avec Hegel nous soutenons
que le monde est connaissance puisqu’il est mouvement de la pensée dans ce qui
existe. Donc, c’est bien à la pensée que renvoie nécessairement toute pensée
mais non pas à la pensée particulière mais au mouvement de la pensée dans le
monde et il n’y a rien dans notre expérience qui ne soit posé et déterminé par
le mouvement de la pensée dans le monde. Hegel a donc raison de postuler que
loin d’être indifférente à tout contenu la logique a pour objet véritable le
mouvement de la pensée dans le monde, autrement dit que la logique comme
pensée a pour objet véritable la logique du mouvement de la pensée dans le
monde. C’est parce que le monde est mouvement de la pensée dans ce qui existe
que le monde est logique, qu’il soit ou non pensé et le malheur de la pensée
est justement que ce mouvement de la pensée ne soit encore pour elle qu’un
objet.
Mais nous nous
opposons à Hegel sur ce point : la logique comme mouvement de la pensée
dans le monde, comme activité du monde, n’est pas
l’" objectivation ", l’extériorisation, l’aliénation de la
logique comme pensée. C’est au contraire la pensée séparée qui, incapable de
saisir le mouvement de la pensée dans le monde, effectue l’
" objectivation " de ce mouvement dans la mesure où sa
cécité forcée réduit cette richesse à la dimension d’un objet, dans la
mesure où elle voit un objet là où il y a, en réalité, le riche mouvement de la
pensée dans le monde. Là où il y a un monde de la communication, la pensée
séparée de ce monde ne voit qu’un objet.
N’en déplaise
à Lukacs, étant donné que la connaissance, en tant que mouvement de la pensée
dans le monde, est le réel lui-même, que la connaissance est un monde et
non une pensée particulière, la connaissance est aussi, comme le voulait Hegel,
l’essence du réel, c’est-à-dire le mouvement qui supprime les déterminations
les portant ainsi à l’existence. Et la pensée et les déterminations de la
pensée, loin d’être étrangères à l’objet, constituent plutôt, par ce biais, son
essence comme le voulait Hegel.
Avec Hegel,
nous attaquons le réalisme de l’objet qui veut que le concept reçoive de la
perception sensible, de la conscience de l’homme pauvre, son contenu et sa
réalité. Or précisément cette perception sensible de l’homme pauvre ne décèle
qu’un objet là où a lieu le mouvement de la pensée dans le monde, là où a lieu
la communication mondiale. Le concept reçoit son contenu et sa réalité de la
communication et la communication est le mouvement de la pensée dans le
monde. Le concept, ce qui conçoit faut-il le dire, n’est pas une pensée
particulière mais bien le mouvement de la pensée dans le monde, mais bien la
communication elle-même. En effet, c’est la communication mondiale qui conçoit,
qui produit, qui fabrique, qui détermine tout ce qui existe y compris la
pauvreté et l’ignorance propre à la pauvreté. Donc, en dernière analyse l’objet
qui est la forme que prend la réalité du mouvement de la pensée dans le monde
pour la conscience pauvre, l’objet, donc, reçoit bien ses déterminations du
mouvement même de la pensée dans le monde car c’est bien le monde qui produit
l’homme pauvre et la pensée pauvre et non l’inverse. C’est donc bien de la
pensée et de ses déterminations que l’objet reçoit son essence. L’objet est ce
petit enclos que le monde attribue à la chèvre pauvre de M. Seguin. Au-delà
s’étend le vaste monde.
3.
Notre position en ce qui concerne Hegel.
Pour Hegel, le
seul véritable commencement est le but. Il en résulte, c’est là une
position constante chez Hegel, que le résultat est contenu dans le commencement
parce que, en tant que but, le commencement contient le résultat comme idée.
Marx et Lukacs partagent ce point de vue ainsi qu’on peut en juger dans Le
jeune Hegel de Lukacs, mais ils n’ont pas su faire grand-chose de cet
accord. Cependant Hegel s’égare quand il conçoit le monde comme but,
téléologie. Lukacs a donc parfaitement raison de lui reprocher de retomber dans
l’ancienne téléologie théologique. Pourtant, dans le même ouvrage, Lukacs
montre que Hegel a violemment combattu cette téléologie théologique. Pour
Lukacs, justement, le grand mérite philosophique de Hegel consiste dans le fait
qu’il a fait descendre le principe du but, du ciel où il avait été projeté par
la théologie, dans la réalité terrestre de la véritable action humaine. C’est
en cela que nous apprécions Hegel. Sa conception de la téléologie reste grande
et novatrice aussi longtemps qu’elle reste terrestre. Et toujours efficace et
redoutable contre la racaille situ-marxo-stalinienne. Pour cette racaille,
Hegel est toujours le diable, l’Antéchrist.
Hegel a le
tort de faire du monde un but et donc de concevoir le commencement du monde
comme idée du monde. Pour Hegel, le mouvement de l’idée dans le monde est
immédiatement idée au point que l’on se demande nécessairement quand on lit
Hegel à quoi bon toute cette histoire entre le commencement du monde et sa fin
puisque le résultat (le monde qui prend une forme d’idée) est aussi le
commencement (l’idée du monde). Si dans le but, dans le travail tel que nous le
définissons après Hegel et Marx dans notre Introduction à la science de la
publicité, le résultat est aussi le commencement dans la mesure où le
commencement contient le résultat comme idée, le résultat proprement dit n’est
justement pas idée, mais réalisation d’une idée. C’est précisément ce qui
distingue le résultat du commencement et qui fait du commencement un vrai
commencement, du résultat un vrai résultat et du travail, du but qui se
réalise, un vrai travail, une vraie réalisation. Or, dans la conception du
mouvement de l’idée de Hegel, le commencement et le résultat sont tous deux
idée ce qui entraîne que la réalisation est seulement idée de réalisation,
réalisation illusoire.
On comprend
aisément l’erreur de Hegel. Tandis que le résultat du travail, comme
accomplissement du but, n’est pas lui-même idée, le monde accompli doit être
idée du monde, monde théoricien ou n’être pas accompli. Évidemment cette idée du
monde, ce monde théoricien est une organisation pratique du monde, donc se
distingue de l’idée telle qu’elle existe dans l’individu. Il n’en demeure pas
moins que le résultat dans ce cas doit être idée du monde, le devenir idée du
monde plutôt que le devenir monde de l’idée comme le voulait Hegel. On a donc
une double différence entre le résultat du but ou du travail et le résultat de
l’histoire, le résultat du monde. 1o Le but, en tant que
commencement contient le résultat comme idée tandis que le résultat proprement
dit n’est pas une idée mais la réalisation d’une idée. 2o Le monde
qui commence ne contient pas l’idée du monde bien qu’il contienne le mouvement
de l’idée et que ce soit pour cela qu’il commence, qu’il est monde, mouvement
de l’idée dans ce qui existe. Mais le monde comme résultat, le monde accompli
comme monde doit être idée, doit être idée du monde. C’est parce que le but est
idée du résultat que le résultat n’est pas idée. C’est parce que le
commencement du monde n’est pas idée du monde que le résultat du monde doit
l’être.
La critique
que Marx adresse, à juste titre, à Hegel est que l’idée du monde n’existe pas à
l’origine du monde, que le monde n’est pas d’abord une idée du monde
(particulièrement dans sa célèbre critique de la conception hégélienne de
l’État). Mais emporté par son élan, Marx nie du même coup le mouvement de
l’idée dans le monde, le mouvement du but dans le monde. La critique de Hegel
par Marx n’est donc pas nulle mais mauvaise. C’est elle qui permettra à Lénine
et Staline de s’y référer sans cesse pour anéantir de la manière sanglante que
l’on sait ce mouvement de l’idée dans le monde tout en se conduisant, avec
succès, comme si l’idée du monde existait, comme si le monde pouvait être
d’abord une idée avant que d’être monde. Hegel mérite une meilleure critique
que celle-là. Une véritable critique de Hegel doit être une réhabilitation de
Hegel comme une véritable critique de Marx doit être aussi une réhabilitation
de Marx. Dans la bouche des marxistes, la mauvaise critique de Hegel par Marx,
réputée achevée et resservie telle quelle, devient une véritable calomnie de
Hegel et donc de Marx par la même occasion au même titre que la prétendue
critique de Marx par les putes intellectuelles, récemment. En ce sens, donc,
nous continuons d’affirmer que Hegel n’a jamais été critiqué comme il le
mérite, que jamais il n’a été rendu à Hegel ce qui revient à Hegel malgré tous
les efforts de Marx et de Lukacs en ce sens. Chaque louange pour l’historicité
de la conception de Hegel est en fait une calomnie d’autant plus calomnieuse
qu’elle est dissimulée sous la forme de la louange. Et non seulement une
calomnie de Hegel mais de la société et de son mouvement révolutionnaire.
Notre position
exacte face à Hegel est la suivante : si nous admettons avec lui que le
véritable commencement est nécessairement le but, si nous admettons encore avec
lui que le monde est le mouvement de l’idée dans ce qui existe, le mouvement du
but dans ce qui existe – et cela contre les matérialistes – nous nous opposons
à Hegel en soutenant que le commencement du monde – l’apparition du but dans ce
qui existe – n’est pas idée du monde et que le mouvement de l’idée dans le
monde n’est pas le mouvement de l’idée d’un monde. Le monde existe dès
qu’apparaît le but dans ce qui existe, mais ce but n’est pas monde et le monde
n’est pas but. C’est une tâche à réaliser et non pas comme le voulait Hegel
dans sa conception, l’alpha et l’oméga, le commencement et le résultat.
Le monde
contient bien l’idée et son mouvement, comme le commencement hégélien donc,
comme le but, mais le monde ne contient pas pour autant l’idée du monde, l’idée
de ce mouvement. L’idée et son mouvement contenus par le monde ne sont pas pour
autant idée du monde et mouvement de l’idée du monde.
Contre Lukacs,
nous approuvons Hegel quand il soutient que la réalité est le mouvement de la
pensée dans le monde et que c’est pour cette raison que la réalité peut aspirer
à former une idée de la réalité. Mais, avec Lukacs, nous nous opposons à Hegel
quand il fait de ce mouvement de la pensée une pensée. C’est précisément là la
contradiction et le contenu de l’histoire du monde : le mouvement de la
pensée dans le monde n’est pas lui-même une pensée, le mouvement de l’idée dans
le monde n’est pas lui-même une idée. Ce n’est donc pas, comme le pensaient
Hegel et Staline, l’idée qui doit devenir monde, mais, comme le voulait
également Hegel, le monde (c’est-à-dire le mouvement de l’idée dans ce qui
existe) qui doit devenir idée. Et c’est seulement parce que le monde est mouvement
de l’idée dans le monde, parce que le monde est, de toute façon, rationnel, que
le monde peut aspirer à devenir lui-même idée, peut aspirer à devenir un monde
théoricien, un monde conscient de lui-même.
Hegel est
impuissant à maintenir l’esprit hors de la conscience, tel qu’il est dans le
monde précisément. Lukacs a donc raison de lui reprocher de concevoir l’esprit
comme conscient, d’attribuer au processus historique une forme consciente.
Lukacs a raison de souligner que lorsque Hegel fait du mouvement de la
conscience dans le monde une conscience, un but, il retombe dans l’ancienne
théologique. Mais pour Lukacs, Hegel a tort indifféremment de concevoir le
processus historique comme esprit et comme conscience. Pour Lukacs, esprit et
conscience sont nécessairement synonymes car le stalinien Lukacs ne connaît
comme esprit que l’esprit de Staline. Or Hegel n’a pas tort de concevoir le
processus historique comme esprit, comme processus spirituel mais seulement de
le concevoir comme conscience. Hegel a raison contre le stalinien Lukacs, le
processus historique est bien spirituel. Mais le fait que l’esprit, la
communication, soient spirituels, aient trait au mouvement de la pensée dans le
monde, en quoi ce fait implique-t-il que cet esprit, cette spiritualité du
monde, ce mouvement de la pensée dans le monde soient conscients, conscience,
pensée? En rien justement. Le mouvement de la pensée dans le monde n’est pas
lui-même une pensée, ni le mouvement d’une pensée. Et jusqu’à aujourd’hui,
personne n’a pu penser ce mouvement. Hegel a été contraint de penser ce
mouvement de la pensée comme une conscience et son histoire comme histoire de
la conscience (Phénoménologie). Pour Hegel, le mouvement de la pensée qu’il
personnifie sous le nom de l’Idée est le démiurge de la réalité. Il a
parfaitement raison de concevoir le mouvement de la pensée comme le démiurge de
la réalité mais il a parfaitement tort de personnifier ce mouvement. Mais qui
peut le lui reprocher aujourd’hui? Qui a fait mieux? Nous connaissons les
salauds qui ont fait pire et pas seulement dans la philosophie, mais dans le
monde.
Si l’on doit
cependant concevoir un support conscient à l’esprit, c’est seulement parce que
tout en demeurant extérieur à toute conscience l’esprit agit nécessairement par
la médiation de chaque conscience.
Cependant, si
Hegel a le tort de concevoir l’esprit comme une conscience il postule aussi
contradictoirement l’indépendance de l’esprit par rapport à la conscience.
Parfois chez Hegel l’esprit est une simple conscience, parfois il est ce qui
s’oppose à la conscience. Or cela ne plaît pas non plus à Lukacs.
Le stalinien
Lukacs est encore plus choqué par le fait que Hegel ose prétendre qu’il y ait
une réalité spirituelle hors de la conscience que par le fait que Hegel ose
réduire le processus historique à un processus conscient.
Pour Lukacs,
l’indépendance de l’esprit par rapport à la conscience, l’existence d’une réalité
spirituelle indépendante de la conscience constitue l’illusion fondamentale de
l’idéalisme objectif de Hegel et non pas la misère fondamentale et très réelle
de la conscience dans le monde de l’aliénation. Le monde démontre aujourd’hui,
par le spectacle de la communication totale, cette indépendance de l’esprit par
rapport à la conscience, cette existence d’une réalité spirituelle
indépendante de la conscience car, tout ce qui était directement vécu s’est
éloigné dans une représentation. Au grand scandale de Lukacs, Hegel postule
l’objectivité de l’esprit et le monde moderne lui donne raison. Et cette
objectivité n’est pas celle d’une " nature ", celle d’une
" matière " mais bien celle d’une réalité spirituelle,
mais bien celle du mouvement de l’idée dans le monde.
4.
La division du travail est le mouvement de la pensée dans le monde.
Marx définit
lui-même le travail comme but : " Une araignée accomplit des
opérations qui ressemblent à celles du tisserand, une abeille, par la
construction de sa cellule de cire, humilierait bien des architectes. Mais ce
qui distingue a priori le plus mauvais architecte de la meilleure
abeille, c’est qu’il a construit la cellule dans sa tête avant de la construire
dans la cire. A la fin du processus du travail émerge un résultat qui était
déjà présent au début dans la représentation du travailleur, donc déjà
présent en idée. (Nous ferons remarquer que c’est lui qui le dit, et pas
nous!) Non qu’il œuvre seulement à une transformation de la forme de l’objet
naturel; il réalise en même temps dans l’objet naturel sa fin, fin
qu’il sait et qui détermine, en tant que loi, le mode et la manière de son
faire; fin à laquelle il doit soumettre sa volonté. " (Le
Capital.)
On trouve dans
les carnets de notes de Marx une analyse de l’échange qui met en évidence le
mouvement de l’idée dans le monde, dans le monde et non plus seulement dans le
travail, dans le but. " Quand je produis plus que je ne puis moi-même
utiliser directement de l’objet produit, ma surproduction est calculée
en fonction de ton besoin, elle est raffinée. Je ne produis qu’en apparence
un surplus de cet objet. Je produis en vérité un autre objet,
l’objet de ta production, que je pense échanger contre ce surplus,
échange que j’ai déjà accompli en pensée. " (MEGA I, t. III,
p. 544). Et selon une autre traduction : " Lorsque je produis
plus d’objets que je ne pourrais employer à mon usage immédiat, je produis sciemment
cet excédent en vue de ton besoin. Les objets en surplus que j’ai produits ne
sont qu’une apparence. Ce que j’ai produit en vérité, c’est un autre
objet, l’objet de ta production que je voudrais échanger contre ce surplus, et
j’ai produit ce surplus parce que j’avais déjà accompli cet échange dans mon
esprit. Le rapport social où je me trouve avec toi, le travail que j’ai
fait pour satisfaire ton besoin, n’est qu’une apparence et notre
complémentarité mutuelle n’est elle aussi qu’une apparence derrière laquelle se
cache le fait fondamental du pillage réciproque. " (Nous soulignons.)
Ce texte met
clairement en évidence le mouvement de la pensée non plus seulement dans le
travail mais dans les travaux sans même qu’il soit besoin d’écarter les
présupposés utilitaristes de Marx (l’échange est censé n’apparaître qu’avec un
surplus alors que l’ethnographie nous montre que seul est produit dans les sociétés
archaïques ce qui est échangé; si j’échange avec toi c’est seulement dans un
bête dessein égoïste pour satisfaire mon trivial besoin; le rapport social que
j’ai avec toi est donc seulement pillage et tromperie réciproque et notre
complémentarité mutuelle est une simple apparence etc.). Au contraire, quand
bien même ces présupposés utilitaristes seraient justifiés, ce texte n’en
montre pas moins que même dans ce cas pour " satisfaire ses
besoins " l’homme n’en est pas moins tributaire du mouvement de la pensée
dans le monde. Nous avons déjà noté avec Marx et Hegel que le travail est la
réalisation de la pensée et que c’est donc la pensée qui anime le travail. Mais
ici la pensée n’anime plus seulement le travail mais plusieurs travaux dans la
mesure où la pensée qui anime effectivement, et non pas seulement en apparence,
un travail donné est la pensée d’un échange, un échange déjà effectué en pensée
comme dit Marx lui-même.
Dans
l’échange, les objets que je produis ne sont qu’une apparence. Ce que j’ai
produit en vérité, c’est un autre objet, l’objet de ta production. Et si
j’ai produit cet objet autre, c’est parce que j’avais déjà accompli un échange
dans mon esprit. Donc, le véritable auteur de mon activité est la pensée de
cet échange et mon activité est la condition de cet échange, la condition de sa
réalisation. On pourrait objecter que c’est seulement la pensée d’un autre
résultat qui agit dans mon travail et non la pensée de l’échange. Or il n’en
est rien car l’idée d’un autre résultat ne peut agir dans mon travail que pour
autant que je sache que l’idée de la réciprocité agit dans chacun des deux
travaux. Donc, dans l’échange, l’idée qui se réalise dans un travail
particulier est seulement en apparence l’idée de ce résultat particulier ou
même l’idée d’un autre résultat mais en vérité l’idée d’un échange. Autrement
dit, l’auteur du produit de chaque travail particulier n’est ni ce travail
particulier, ni même l’autre travail, mais la pensée de l’échange, mais le
mouvement de cette pensée dans les travaux, mais la totalité des deux
travaux sous forme pensée. Si les différents travaux sont la condition
de la réalisation de l’échange, l’idée de l’échange est la condition des
différents travaux et, dans l’aliénation, cette idée doit préexister non
seulement à tout échange mais à toute pensée d’échange déterminé comme on peut
d’ailleurs le constater dans notre monde avec la valeur (cf. Une enquête sur
la nature et les causes de la misère des gens, Champ Libre, 1976).
L’ethnographie constate la même chose dans les sociétés fossiles vivantes.
Ainsi la pensée de l’échange est l’élément dans lequel se meut tout
travail particulier. Voilà un résultat parfaitement hégélien : la
médiation est aussi la condition, ainsi la condition peut-elle être sa propre
condition.
Dans
l’échange, ce qui agit effectivement dans un travail donné, c’est donc, par la
pensée de cet échange, aussi un autre travail et donc un autre but et
donc un autre résultat en pensée, la pensée d’un autre résultat. Donc aussi
bien le travail d’une autre pensée que la pensée d’un autre travail. Comme on
voit, dans l’échange le travail est extrêmement habité, inspiré, vieille
notion bien connue des primitifs. Dans l’échange, le travail a perdu toute
immédiateté, il est totalement médiatisé et la pensée est l’élément de cette
médiation comme elle était déjà celui de la médiation entre le commencement et
le résultat. Donc, ce qui s’accomplit là où chaque travail semble s’accomplir,
c’est un autre travail et chaque travail est lui-même une apparence. Donc, chacun
des travaux, ici et là, n’a pas lui-même de vérité et de réalité puisque sa
vérité et son effectivité reposent dans un autre travail qui lui-même n’a plus
de vérité et de réalité pour les mêmes raisons. Dans l’échange en particulier
et dans une société réelle, les différents travaux n’ont donc aucune sorte de
réalité et de vérité et ne sont, à ce titre, que des apparences. Ce que
ces travaux possèdent de vérité et d’effectivité, ils ne le possèdent que par
leur médiation et dans leur médiation. Heil Hegel! Seul le passage ne passe
pas. Heil Hegel encore! Ce qu’il y a de réel dans un travail considéré
isolément, c’est la société, c’est l’activité de la société dans ce travail.
Et bien entendu, il faut que ce soit dans une société comme la
" nôtre " que pareille idée de considérer isolément
un travail puisse voir le jour, dans une société justement qui a séparé
complètement, non pas dans la pensée, mais dans le monde, chaque travail et la
totalité des travaux.
La
médiatisation des travaux par la pensée de l’échange (les travaux deviennent l’activité
de cette pensée) est un mouvement de la pensée dans les travaux car cette
pensée de l’échange n’existe pas comme pensée d’un super organisme qui
engloberait les divers travaux comme ses diverses fonctions (c’est la
prétention de l’État) mais comme pensée préexistant dans une dispersion de
travaux, donc comme communication. C’est ce mouvement que nous nommons esprit
en souvenir de Hegel et avec les restrictions que nous avons formulées
précédemment. Dans l’échange, par la médiation de la pensée de l’échange,
chaque travail n’est plus simplement réalisation de l’idée d’un résultat sinon
en apparence, mais réalisation de l’idée d’un autre résultat et réalisation du
résultat d’une autre idée : il est divisé. Dans l’échange, chaque
idée d’un autre résultat est réalisée par un autre travail dans la mesure où
elle-même habite la réalisation du résultat d’une autre idée. Dans
l’échange la réalisation d’une idée est aussi réalisation d’une autre idée,
chaque travail est lui-même et autre que lui-même, il est divisé et il est
divisé selon le processus envisagé par Hegel et non selon le processus
hiérarchique, étatique, patronal et syndical, le seul qui soit concevable par
les crétins. Dans l’échange ce qui est véritablement l’auteur du produit de
chaque travail n’est pas chaque travail particulier, ni même l’autre travail
mais la totalité des travaux, de même que ce qui agit n’est pas l’idée d’un
résultat particulier, ni même l’idée d’un autre résultat, ni le résultat d’une
autre idée mais l’idée de l’échange qui est leur totalité. Chaque travail
n’agit pas seulement, par la médiation de la pensée de l’échange, dans l’autre
travail, mais, dans la mesure ou l’autre travail agit réciproquement en lui,
réflexivement en lui-même par la médiation de son action dans l’autre travail.
Le mouvement de la pensée dans les travaux constitue ceux-ci en totalité de
travaux où non seulement l’autre travail mais la totalité des travaux agit en
chacun d’eux. Autrement dit, cette totalité est une véritable totalité (elle
est sujet, elle agit et elle seule agit vraiment) et non seulement
totalité pour un autre, totalité pour un observateur, du fait que toutes ses
parties sont présentes et agissent en chacune d’elles. De par la médiatisation
des travaux, chaque travail dépend pour sa conservation, non de lui-même mais
de la médiatisation, mais de la totalité des travaux. La médiatisation décide
qui doit vivre et qui doit mourir. Le mouvement de la pensée dans les travaux
est donc aussi le rapport de la totalité à elle-même dans chacune de ses
parties, sa réflexion. Ainsi cette totalité peut être soi sans pour
autant être une personne. Le rapport de la totalité à elle-même en chacune de
ses parties n’est pas conscience mais jugement inexorable qui décide qui
doit vivre et qui doit mourir.
Pour
comprendre notre conception de la division du travail comme communication, il
faut ne pas perdre de vue que par " travail " nous
n’entendons pas l’activité passive à laquelle est réduit le travailleur
aujourd’hui ou l’esclave sur un domaine, mais l’activité de l’animal en tant
que cycle complet de dissipation d’énergie, de dégradation d’énergie nécessaire
à la conservation de l’organisme : chasser, brouter, assimiler, éliminer,
dormir etc. Aussi, par division du travail nous n’entendons pas cette
division au sens syndical et patronal, c’est-à-dire la division des tâches des
esclaves dans les entreprises ou même la répartition des tâches entre les
entreprises ou les États mais la division du cycle complet d’assimilation et de
dissipation. Est-il besoin de rappeler ce que disait déjà l’I.S. : les
loisirs travaillent. Les prétendus loisirs sont partie intégrante du cycle
total de la conservation de l’organisme et donc partie intégrante de la
division interne infinie de ce cycle. Pour l’homme, par opposition à l’animal,
ce cycle est divisé à l’infini puisque son accomplissement présuppose un
monde divisé à l’infini.
Marx utilise
également dans les Grundrisse un raisonnement qui consiste à considérer
la société comme un seul individu pour remarquer que, de ce point de vue, tout
est également utile et que rien ne peut être considéré comme un surproduit, que
tout ce qui est produit est également détruit, et que, dans la société moderne,
le fait que tout ne puisse pas être détruit est un drame bourgeois. En ce sens,
la société bourgeoise est tout à fait potlatchique. Du même point de vue, si
l’on considère l’ensemble de la société comme un seul organisme, on voit que ce
cycle potlatchique est divisé à l’infini et que cette division est infinie,
parce qu’interne.
Dans
l’échange, la prétendue " production " au sens étroit de
processus de travail aussi bien qu’au sens large de totalité des travaux et des
produits des travaux est seulement une apparence qui ne produit rien du tout
sinon de la confusion parmi ses victimes. Cette prétendue production est en
fait un processus de communication. Chaque travail est seulement en apparence
travail immédiat, production, mais en vérité activité du mouvement de la pensée
dans la totalité des travaux et la totalité des travaux est seulement en
apparence juxtaposition inerte de travaux et de
" produits " mais en vérité médiatisation des travaux par
le mouvement de la pensée. Même remarque pour la prétendue consommation. Seule
la médiatisation des travaux, seul le mouvement de la pensée dans la totalité
des travaux produisent et détruisent ce qui est produit et ce qui est détruit
(à commencer par l’immédiateté du travail animal) et nulle
" production ", et nulle " consommation ".
La " production " et la
" consommation " sont, non des vues de l’esprit, mais des
vues de l’ignorance intéressée. Le prétendu système du travail et des besoins
est en fait un système de la pensée. Heil Hegel!
Nous nous
opposons évidemment aux présuppositions utilitaristes de Marx qui oblitèrent
les conclusions possibles de son analyse. Pour nous la seule chose qui ne soit
pas une apparence là-dedans est précisément notre " rapport
social ", " notre complémentarité réciproque "
qui sont, eux, la réalité, la chose même qui agit dans cette affaire
pour le meilleur et pour le pire (c’est cette réciprocité qui décide qui doit
vivre mais aussi qui doit mourir). Inversement, le " pillage
réciproque " est une pure apparence dans la pensée utilitariste de
Marx. D’ailleurs là où il existe, le pillage est si peu réciproque que
l’histoire de l’aliénation montre que ce sont seulement quelques-uns qui
pillent tous les autres et se gardent bien, sauf violente exception, de se
piller les uns les autres. Ensuite, il faut discuter la nature et l’objet de ce
pillage comme nous avons commencé à le faire ailleurs.
Selon les vues
utilitaristes de Marx, le fait de la médiatisation des travaux dans l’échange
est seulement destiné à satisfaire mon besoin égoïste comme je le satisferais
si j’étais seul sur une île déserte. Au mieux, il représenterait un progrès
permettant de mieux satisfaire ma goinfrerie égoïste. Selon nous, au contraire,
le but véritable et l’opération véritable ne sont plus la satisfaction d’un
besoin qui est seulement un but apparent, non essentiel, mais l’opération de
communication elle-même, mais la médiatisation infinie du besoin et de sa
suppression. Dans l’échange, l’immédiateté de la suppression du besoin est
elle-même supprimée car elle n’est plus effectuée par le travail immédiat mais
par la médiatisation des travaux, mais par la médiatisation de la suppression
du besoin. Selon Marx, la médiatisation des travaux a pour but la suppression
des besoins. Selon Marx, la médiatisation de la suppression des besoins a pour
but la suppression des besoins! Nous soutenons, contre Marx et tous les
utilitaristes, qu’au contraire la médiatisation des travaux a pour but la
médiatisation des travaux. Dans la mesure où la médiatisation des travaux par
le mouvement de la pensée dans les travaux n’est pas un individu, une personne,
n’est pas elle-même but, elle ne peut être but qu’en chacun des
travaux médiatisés. Nous soutenons donc qu’en chaque individu l’apparente
indépendance de la suppression des besoins a pour but effectif la
médiatisation infinie de cette suppression. Voilà pourquoi la marchandise est
belle et pourquoi votre fille n’est pas muette. Ce qu’il y a de beau dans la
marchandise, ce n’est même pas la médiatisation mais l’infini de la
médiatisation. Avec la marchandise, cette soif de médiatisation infinie ne
connaît plus de borne et elle n’épargne personne, pas même les plus pauvres qui
ne peuvent faire le voyage de Bayreuth. Et la marchandise, avec un art
consommé, sait allumer cette soif tout en veillant à ce qu’elle ne soit jamais
satisfaite, tout comme la musique de Wagner en quelque sorte. Voilà pourquoi la
musique tac-poum est belle : non parce qu’elle est musique, mais parce
qu’elle est marchandise. Le tac-poum n’est pas plus beau ou plus
révolutionnaire que n’importe quelle marchandise, c’est-à-dire pas moins
n’en déplaise au vieux con geignard (Ah! que la musique était belle du temps de
Wagner, ah! que la révolution était belle du temps de Durrutti) auteur de En
évoquant Wagner aux Nouvelles Éditions Maspéro. Ce qu’il y a de beau dans
le tac-poum, ce n’est pas la musique, c’est la marchandise. Voilà son infinie
supériorité sur la musique de Wagner. Cette marchandise, comme la musique de
Wagner, est l’œuvre d’un monde. Mais elle n’a même plus besoin, comme la
musique de Wagner, de la médiation d’un individu pour exister puisque ceux qui
la produisent sont seulement des histrions. Le tac-poum est immédiatement
l’œuvre d’un monde. Les mêmes qui se trémoussent au son du tac-poum pillent New
York à chaque panne d’électricité ou incendient les automobiles à Lyon ou
ailleurs sans même qu’il soit besoin de panne d’électricité. F. Pagnon est
encore plus incompétent que Marx et Engels en ce qui concerne l’art moderne car
il ne sait même pas que l’œuvre d’art moderne est la marchandise elle-même. Au
moins Marx se doutait de quelque chose. Mais on ne doute de rien à l’académie
Champ Libre.
Selon Marx, la
communication, toujours passée sous silence comme si les choses allaient
d’elles-mêmes, est l’instrument de l’animal et celui-ci est sujet. Selon nous
la communication est sujet et on ne peut même pas dire que l’animal est son
instrument ou même, comme nous l’écrivions encore dans notre Rapport sur
l’état des illusions, que le travail est la matière de la communication,
car précisément la communication est suppression de l’animal, suppression du
travail, celui-ci devient l’activité même de la communication pour le meilleur
et pour le pire (pour les pauvres, c’est pour le pire). Dans la communication,
l’opposition homme-animal est supprimée et donne lieu à une autre opposition,
celle de l’homme et du non-homme, de l’homme et de l’homme nié, du riche et du
pauvre mais pas de l’homme et de l’animal. L’animal cesse d’être un animal et
devient un homme quand il poursuit non plus sa satiété mais la médiatisation
infinie de cette satiété. Selon Marx, la médiatisation est le moyen et la
satiété le but. Selon nous la satiété est le moyen et la médiatisation infinie
le but. La médiatisation infinie de la satiété par la communication est
fondation de l’univers ainsi que le suggèrent les physiciens de l’école de
Copenhague.
Pour Marx
aussi bien que, 100 ans après sa mort, pour les crétins stalino-situationnistes
de Champ Libre (cf. En évoquant Wagner, p. 73) " la
reproduction des moyens de survie immédiate " est le
" fondement de la société ". (Quelle survie immédiate?
Pagnon va-t-il lui-même à Cuba, dans la pirogue qu’il a lui-même taillée dans
l’arbre qu’il a lui-même abattu, couper et presser la canne à sucre qu’il a
lui-même plantée, raffine-t-il lui-même son sucre, puis revient-il dans sa
petite pirogue sucrer son café – nous supposons que la survie
" immédiate " de Pagnon ne va pas jusqu’à se priver de café
– café qu’il a lui-même torréfié, qu’il est allé lui-même cueillir et sécher au
Brésil, dans le champ qu’il avait lui-même planté. Pagnon boit-il son café dans
de la porcelaine de Saxe ou de Limoges? Ou bien lappe-t-il, à quatre pattes,
dans l’écuelle que lui tend son maître? Et quand bien même tout cela serait,
d’où Pagnon tire-t-il ce savoir et ce savoir-faire encyclopédiques? Comme Hegel
le signale dans le passage de l’Esthétique où il compare la table du vigneron
et celle du petit bourgeois, il y a un monde entre notre tasse de café et nous.
C’est pourquoi nous buvons du café et fumons des cigares. Les austères savants
de Palo Alto viennent de découvrir, après quarante ans de recherche, qu’allumer
la cigarette de sa voisine, c’est communiquer. Il ne fait aucun doute qu’après
quarante autres années de recherche ils découvriront aussi qu’allumer sa propre
cigarette, c’est encore communiquer.) Selon nous, la médiatisation de ces
moyens est le fondement de la société, plutôt, la société n’est autre que cette
médiatisation infinie elle-même. On sait, depuis Malinowski, ce qu’il faut
penser du but effectif des voyages en pirogue de haute mer.
Comme le veut
Hegel, le travail animal devient humain parce qu’il est médiatisé et qu’il est
médiatisé par rien moins qu’un monde, c’est à dire une totalité de travaux identiquement
médiatisés. Chez l’homme la bête est niée, son immédiateté est supprimée dans
une activité plus haute qui est la communication, l’autodivision infinie d’un
monde. Chez l’homme la satisfaction du moindre de ses
" besoins " présuppose un monde et l’indépendance de ce
besoin particulier est seulement une apparence. Chez l’homme, le but véritable
n’est pas la satisfaction du moindre de ses besoins, mais, dans le
moindre de ses besoins, le monde qui médiatise ce besoin, mais la
communication totale et mondiale qui médiatise ce besoin, son existence comme
sa satisfaction. Ce n’est pas seulement la " production "
qui est raffinée mais le besoin lui-même qui cesse donc à l’instant de
seulement pouvoir prétendre être égoïste. En lui agit un monde. Il est le
produit d’un monde. Il est besoin d’un monde. Comme le note déjà Marx, dans
l’aliénation l’homme doit payer pour habiter une bauge. Aussi frustre que soit
en apparence un besoin humain, ce besoin n’en suppose pas moins la médiation
d’un monde. Non seulement le sanglier humain doit payer sa bauge mais il est
bien évident que c’est un monde qui le précipite dans une bauge plutôt que dans
un palais. L’immonde réalisme matérialiste prétend que l’homme ne se fait homme
qu’en interposant entre désir et satisfaction l’écran, la médiation du travail.
Mais quel est l’animal qui ne le fait pas? Pour nous au contraire, l’homme ne
se fait homme qu’en interposant entre désir et satisfaction la médiation de la
division du travail, qu’en interposant dans le travail lui-même donc, dans le
désir aussi bien que dans la satisfaction, la médiation d’un monde. Ce qui
n’est pas tout à fait la même chose. Ce fait n’a pas échappé à Marx qui en
parle régulièrement mais concurremment avec le point de vue réaliste
matérialiste. Surtout, il n’a rien su en faire.
Qui maîtrise
ce mouvement de la pensée dans les travaux maîtrise le monde. Aussi, le but
effectif de chaque homme apparemment engagé dans un travail déterminé
n’est-il pas ce travail ou même le résultat d’un autre travail censé satisfaire
ses besoins mais bien ce qui est réel, vrai et effectif dans tous les
travaux : leur médiation. Comme le note Marx lui-même " Avec
l’argent, le zèle au travail ne connaît plus de borne. " Évidemment
pas par amour du travail mais par amour de l’argent. La richesse, le mana, ce
que poursuit peu ou prou tout homme, est ce mouvement d’auto-médiation du
monde, mouvement d’auto-approfondissement, d’auto-création. La racaille
syndicaliste et socialeuse veut nous charmer avec l’exaltant mot d’ordre d’autogestion,
comme si la richesse avait jamais consisté à gérer quoi que ce soit. L’histoire
montre au contraire que la bourgeoisie n’a eu d’autre soucis, poussée et
contrainte par la marchandise, que de révolutionner le monde en permanence et
qu’encore aujourd’hui la seule question qui se pose est : qui, d’elle ou
des pauvres, va révolutionner ce monde. Seuls les larbins cadrifiés des maîtres
du monde gèrent ce qui est à gérer. Et précisément pour cela, ce sont des
pauvres.
Nous inférons,
après Hegel, qu’il n’y a rien dans notre expérience qui ne soit posé et
déterminé par le mouvement de la pensée dans les travaux du monde, par la
communication. Ce qui n’empêche pas, dans le monde de l’aliénation, que ce
mouvement de la pensée dans le monde demeure extérieur et rebelle à toute
pensée. Aujourd’hui encore, on ne sait rien de ce mouvement de la pensée dans
le monde. On se contente de le subir ou de tenter de le détourner à son profit
ce qui est à l’origine de différents rackets sociaux. D’ailleurs il est inexact
de dire que personne ne connaît le mouvement de la pensée dans le monde. Au
contraire tout le monde peut aisément le constater et doit même en tenir compte
pour la simple conduite de sa vie. La vérité est que personne ne peut rien en
dire et surtout pas, évidemment, ceux qui sont payés pour parler, ou bien s’ils
en parlent c’est seulement pour tenter d’obscurcir la menace de sa clarté. La
tâche de la pensée est de concevoir le mouvement de la pensée dans le monde
sachant que seul ce mouvement est qualifié pour se concevoir puisque c’est lui
qui conçoit tout. Cependant c’est bien la moindre des choses pour la pensée que
de rechercher le mouvement de la pensée dans le monde. D’ailleurs, c’est
seulement si le monde est bien mouvement de la pensée dans ce qui existe que
l’effort de la pensée déterminée peut avoir un sens. C’est seulement si le
monde, de par sa parenté avec la pensée déterminée recherche la forme pensée
que celle-ci peut rechercher le mouvement de la pensée dans le monde.
Une tentative
intéressante pour mettre en évidence, contre les prétentions matérialistes, le
but et le mouvement du but dans le monde est Critique de la raison
dialectique de J.-P. Sartre. On peut se demander comment un si constant
imbécile (cf. I.S. n° 7, 8, 9, 10, 11, 12) valet et défenseur public des
bureaucrates et des polices de Russie, Pologne, Cuba, Algérie, Chine et de
quelques autres États (on vit même le malheureux s’aboucher, sur la fin de ses
jours, avec des petits cons maoïstes) a pu écrire un tel livre, comment un homme
qui a constamment tout accordé aux staliniens sur l’essentiel a pu refuser
quelque chose au matérialisme. D’ailleurs, il ne remet pas en cause les
postulats matérialistes, à commencer par celui de la rareté initiale, et tente
de composer avec eux comme il a toujours composé avec les staliniens. D’autres
sont aussi imbéciles que Sartre, mais on ne leur connaît pas d’autre talent. Ce
n’est donc pas une raison pour ne pas répondre à ce livre puisqu’il traite
nommément de la question qui nous intéresse. La littérature traitant de cette
question n’est pas si abondante que l’on puisse faire la fine bouche et
dédaigner l’œuvre de l’imbécile. Les analyses de Sartre, dans leur effort pour
défendre le matérialisme, plaident contre le matérialisme aussi sûrement que
les notations de Malinowski, dans leur effort pour défendre le fonctionnalisme,
plaident contre le fonctionnalisme, de même que, comme nous le verrons plus
loin, le positivisme le plus strictement positiviste en physique plaide contre
le positivisme social d’Auguste Comte.
La tentative
de Sartre pèche de la même manière que celle de Marx : pour Sartre comme
pour Marx, l’enfer c’est les autres. Si je coopère, si nous exerçons une
réciprocité, soit positive comme l’échange, soit négative comme la lutte, c’est
toujours dans le seul but de satisfaire nos appétits égoïstes exacerbés par la
rareté. Tout ça sent son xixe siècle, sa propagande bourgeoise
révisée stalinienne. Le spectacle montre au contraire que le paradis, c’est
toujours les autres et que si parfois les autres sont présentés comme l’enfer,
il s’agit toujours d’autres opportunément loin, comme les Polonais ou les
pauvres petits Chinois qui ne mangent pas à leur faim. Selon le spectacle,
l’enfer est toujours ailleurs et jamais ici.
5.
La physique à la rescousse de la préhistoire contemporaine.
Lukacs nous
rapporte que Schelling et Fichte se disputent pour savoir si la nature est une
grande ou une petite région de la conscience. Lukacs leur reproche à juste
titre de ne pas mettre en doute tout simplement que la nature soit une région
de la conscience. Pour Lukacs, il est sans importance que la nature soit une
grande ou une petite région de la conscience puisque la nature n’est pas une
région de la conscience. Nous partageons évidemment le point de vue de Lukacs.
Mais en quoi le fait que la nature ne soit pas une région de la conscience
implique-t-il celui que la nature ne puisse être une région de l’esprit? En
rien. Sauf pour ceux qui, tels Lukacs, confondent esprit et conscience, ce
qu’ils reprochent à Hegel par ailleurs. Pour Hegel et pour nous, l’esprit étant
extérieur à la conscience rien ne s’oppose à ce que la nature soit une région
de l’esprit. Pour Hegel et pour nous, la conscience est seulement une région de
l’esprit, au même titre que la nature donc. Nous approuvons Hegel lorsqu’il
fait de la nature et de la matière une région de l’esprit. Pour Hegel comme
pour nous, la nature et la matière sont seulement des régions du monde. Le
monde n’est pas une région de la nature ou de la matière. Si Hegel a tort
cependant, c’est seulement parce qu’il fait malgré tout de l’esprit une
conscience comme le lui reproche à juste titre Lukacs et donc finalement de la
matière ou de la nature une région de la conscience, ce qui est ridicule. Il se
trouve aujourd’hui que c’est la physique la plus purement et strictement
positiviste qui se mêle de donner raison à Hegel.
Nous apprenons
par l’intermédiaire du physicien d’Espagnat (A la recherche du réel) que
Bohr définit la science avant tout comme une œuvre de communication entre les
hommes et non en termes d’une réalité donnée et intrinsèque qu’elle aurait pour
mission de tenter de décrire. En d’autres termes, la science est pour Niels
Bohr la synthèse d’une partie de l’expérience humaine. Bohr introduit
entre l’atome et l’homme un degré intermédiaire qui est l’instrument de mesure.
Et cet instrument est défini chez Bohr non par sa constitution mais par
référence à la communauté des êtres humains qui utilise ces instruments. Bohr admet
pour ces instruments ainsi définis ce qu’il n’admet pas en ce qui concerne les
électrons et les atomes : il admet qu’un instrument même non observé est
toujours dans un état bien défini occupant une région bien déterminée dans
l’espace. Dans la philosophie de Bohr, toute la réalité des atomes, des
molécules, etc... est en définitive ancrée sur celle des instruments lesquels
encore une fois, ne sont définis, semble-t-il, que par leur usage par l’homme.
Dans le cadre de la conception de Bohr la notion de réalité des
propriétés des objets semble bien être rigoureusement subordonnée à celle
d’expérience humaine et n’avoir de sens qu’à travers elle. C’est donc en
quelque sorte un nouveau cogito : la communication seule est
certaine, tout le reste est douteux. La conclusion de cette réjouissante école
de Copenhague est que la physique ne peut plus parler d’une nature en-soi
nature, d’une matière en-soi matière et d’un objet en-soi objet. Pour Bohr, la
nature et la matière sont seulement des régions du monde défini comme
l’activité totale des hommes. D’Espagnat ajoute : " Plus les
connaissances s’accroissent, plus devient grand le domaine de celles dont on
peut bien dire qu’elles sont connaissance de nous-mêmes avant d’être
connaissance d’un problématique monde extérieur ou d’une vérité
éternelle. "
On comprendra
aisément que nous sommes fort contents d’apprendre que des physiciens sont
contraints de faire référence à la notion de communication pour fonder la
notion de réalité et d’objectivité et des physiciens strictement
positivistes. Ainsi Bohr en arrive à conclure contre la salope Auguste Comte
qui voulait que les faits sociaux soient considérés comme des faits positifs,
que c’est au contraire les faits positifs prétendus de la plus positive des
sciences qui sont des faits sociaux, des états de la communication.
L’importance
conférée par Bohr aux instruments de mesure a pour conséquence que selon lui il
est impossible de parler d’un phénomène tant que l’on s’abstient de décrire de
façon complète le dispositif expérimental utilisé pour étudier ce phénomène
donc à la limite : le monde comme dispositif expérimental pour observer le
monde comme phénomène! En vérité il faut même dire que le dispositif fait
partie intégrante du phénomène et donc le monde comme dispositif fait partie du
monde comme phénomène. Ainsi, la propagation d’une particule dans l’espace
n’est pas en soi un phénomène. L’ensemble constitué par le dispositif émetteur,
la particule, le milieu traversé et un dispositif récepteur voilà selon Bohr un
phénomène dont la science physique peut légitimement parler. Mais ces
instruments qu’utilisent les hommes, il faut bien que les hommes les
construisent avant de les utiliser. Et pourquoi donc s’arrêter en si bon chemin
et délimiter le phénomène à la porte du laboratoire et ne pas l’étendre aux
différents endroits où les instruments sont fabriqués. Ainsi cet état préparé
par le physicien est inclus dans un état préparé par le monde lui-même, ce
phénomène est lui-même un état de la division mondiale du travail et le monde
est le seul dispositif adéquat pour observer le monde, autrement dit la réalité
seule est qualifiée pour observer la réalité. D’ailleurs d’Espagnat confesse
subrepticement – on ne s’étend pas sur de telles trivialités – combien la
recherche scientifique est tributaire d’un état de la division mondiale du
travail : " Pour que la recherche scientifique puisse continuer,
il faut un appui financier en provenance des États etc. " L’enfant,
l’homme de la rue et le sauvage ne sont pas comme un directeur de laboratoire
de physique théorique et particules élémentaires : ils savent, eux, que
l’accès aux marchandises n’est pas immédiat.
Pour nous, il n’y a pas de plus grande stupidité et qui ait un tel
soutien dans le monde que prétendre qu’il existe des objets en-soi objets.
Stupidité d’autant plus grande qu’elle est accompagnée généralement de la plus
grande suffisance. Comme le note finement Hegel, l’apparition est justement ce
qui n’apparait pas, la manifestation est ce qui ne se manifeste pas, le phénomène comme phénomène
est le supra-sensible (Phénoménologie). Attaquant les scientistes
d’Espagnat écrit : " Les scientistes adhèrent donc
nécessairement au principe d’objectivité forte. A dire vrai la plupart d’entre
eux le regardent même comme tellement évident que l’idée qu’il soit contestable
ne leur effleure même pas l’esprit. "
Il faut encore
noter l’emploi terroriste et de plus en plus fréquent par les réalistes
objectifs de termes comme " le physique " ou " le
biologique " pour faire sérieux et objectif. Mais il s’agit en fait
d’une pétition de principe qui essaye de fourguer, l’air innocent et en
passant, l’irrémédiable existence dudit " physique " et
dudit " biologique " alors que l’on ne connaît en fait que
la physique ou la biologie. Ces réalistes agissent exactement de même que les
économistes pressés par les démentis du monde et qui nous parlent maintenant
dans leurs journaux de " l’économique " espérant ainsi
intimider le bon peuple ignorant. Quand donc les mathématiciens vont-ils se
mettre à nous parler du mathématique? Ce serait un beau tollé :
platoniciens, platoniciens! Mais rien de tel quand les sentencieux de service,
tel le super crétin Morin dans les colonnes de l’Immonde dimanche, nous
assènent " le physique ", " le
physico-chimique ", " le biologique ".
Nous nous
élevons contre le point de vue qui veut que la connaissance glisse à la surface
d’une Nature toute constituée ou d’une matière toute constituée comme matière.
La connaissance ne glisse à la surface de rien du tout : elle rentre dans
le mou de ce qui existe. C’est quelque chose qui arrive effectivement à ce qui
existe, la suppression de son indépendance.
Le fait que
nous prétendions que ce que l’on désigne par les mots de nature et de matière
soit des régions de la connaissance ne signifie pas pour autant que nous
prétendions que rien n’existe qui ne soit pas idée, pensée. Le mouvement de
l’idée a lieu dans ce qui existe et n’est pas elle. Mais ce qui existe et qui
n’est pas la pensée n’est pas pour autant ce que l’on désigne par " matière "
et " nature ". Cela ne signifie pas non plus que ce qui
existe et n’est pas la pensée soit hors de portée de la connaissance comme le
prétend Kant. Au contraire, la connaissance en tant que monde, communication
pratique, mouvement de la pensée dans ce qui n’est pas elle est destruction
de ce qui existe et n’est pas la pensée, ou du moins destruction de son
indépendance : médiation, auto-médiation de ce qui existe. La connaissance
en tant que monde, loin d’être étrangère à l’être, est son auto-destruction, sa
division interne infinie. L’être n’est donc pas laissé intact hors de la
connaissance mais la connaissance est l’effrondrement interne infini de
l’être... Hegel donne une description éminemment poétique de cet
effondrement. Le style de Hegel, le style tornade et tempête, est le style
apocalyptique par excellence.
Autrement
dit : ce que l’on nomme " nature " et
" matière " ne sont pas ce dans quoi se mouvrait la pensée.
C’est déjà le mouvement de la pensée, c’est déjà une région d’un
état de la destruction de ce qui existe, c’est déjà une région de la fondation
de l’univers.
Sur ce point,
nous nous séparons de Hegel et sommes modestement dualistes. Le
mouvement de l’idée est le mouvement de l’idée dans ce qui existe et ainsi
devient monde. Nous admettons qu’il préexiste quelque chose au mouvement de
l’idée et qui n’est pas l’idée, mais nous dénions que ce quelque chose soit
" nature " ou " matière " du moins ce
que l’on désigne habituellement par ces mots. De toute façon, cette hypothèse
dualiste est totalement gratuite et superflue dans l’état des choses. Çà ne
mange pas de pain et nous ne nous priverons donc pas du plaisir de la faire.
Quelle souillure originelle évidemment pour notre essence divine. Nous ne
serons jamais que des divinités nées! Selon le mot de Lautréamont, nous
sommes d’ailleurs cette naissance éternelle. Les mythes religieux ont un
fondement rationnel, fondement rationnel auquel ne peuvent d’ailleurs prétendre
les laborieuses fables matérialistes, car ces mythes sont l’œuvre d’un monde et
connus comme tels.
Hegel a donc
raison contre Colletti (le contraire serait étonnant) qui prend Hegel comme
exemple de conception métaphysique de la matière, Hegel qui attribue à la
matière la dialectique propre à l’esprit imité en cela par les matérialistes
marxistes et par Marx lui-même. Or Hegel sait qu’il fait de la métaphysique
tandis que Colletti est comme Monsieur Jourdain qui fait de la prose sans le
savoir. La conception d’une nature en-soi nature est seulement une autre
métaphysique, ennemie de celle de Hegel, et de la pire espèce, de celles qui
s’ignorent. Hegel a raison de son point de vue puisque pour lui la matière est
seulement une région de l’esprit, ce que les matérialistes marxistes et
Colletti sont bien incapables de concevoir. C’est donc tout à fait
superficiellement qu’on peut les comparer à Hegel. La nature de Hegel n’est
évidemment pas la nature en-soi nature de Marx, des matérialistes marxistes et
de Colletti de même que l’esprit de Hegel n’est pas l’esprit de ces mêmes matérialistes.
Si Hegel a tort cependant, c’est encore de son propre point de vue et
non de celui, borné, de Marx et des matérialistes marxistes, parce qu’il est
infidèle à son principe et qu’en dépit de tous ses efforts il conçoit quand
même la nature comme nature en-soi nature. Il se contente de plaquer sur cette
nature en-soi nature une dialectique, en vain évidemment. Tout le monde connaît
sa mésaventure avec la huitième planète de notre système solaire!
Il est bien
évident aujourd’hui que la " nature " telle que nous la
" livre " la physique moderne est bien plus étonnante que
la nature de Hegel dans son Encyclopédie au point que d’estimés savants en
viennent à parler de la communication entre les expérimentateurs comme pouvant
seule fonder la certitude de leurs expériences. Le mathématicien Hilbert a
espéré pouvoir fonder l’arithmétique avec une proposition purement
arithmétique. Il en serait découlé que l’arithmétique était l’alpha et l’oméga
du monde. Or Gödel est quand même parvenu à démontrer mathématiquement
qu’une telle démonstration était impossible. C’est toujours une consolation. Il
faut donc au moins une proposition qui ne soit pas arithmétique pour fonder
l’arithmétique. Voilà au moins des recherches qui n’auront pas été vaines.
D’une manière
plus générale, nous nous trouvons en accord avec d’Espagnat et Saligue pour
contester que l’objet soit la réalité, que l’objet existe comme objet en-soi
objet, qu’une " nature " existe comme nature en-soi nature
indépendamment de la connaissance que l’on peut en prendre, cette connaissance
venant en quelque sorte se sur-ajouter comme reflet inessentiel et impuissant à
cette nature en-soi nature. De même nous contestons qu’il existe une matière
en-soi matière indépendamment de la connaissance que l’on en prend. Cette
dernière expression est d’ailleurs incorrecte puisqu’elle laisse supposer qu’on
prend de toute façon connaissance d’une matière ou même de ce qui existe
indépendamment de la pensée. Or il n’en est rien. La matière à titre de région
de la connaissance n’est pas ce dont la connaissance prend connaissance mais la
connaissance elle-même ou du moins un résultat. Ensuite la connaissance
ne prend pas connaissance de l’" être " de ce qui existe
indépendamment de la pensée, mais détruit cet être, détruit son indépendance.
Elle ne vise pas à connaître l’être, elle est la destruction de l’indépendance
de l’être.
6.
L’archéologie à la rescousse de la préhistoire contemporaine.
En fait cette thèse a déjà été avancée par Durkheim, mais d’une
façon plus générale et ne valant pas seulement pour le seul néolithique. Le
passage de ce qu’il appelle la solidarité par similitude à la solidarité par
différentiation aurait eu pour cause la densification démographique. 10/12/2002
Les études
stratigraphiques de l’archéologue Jacques Cauvin révèlent que la Mésopotamie où
la Bible situe justement le paradis terrestre constituait un jardin où l’on
n’avait pas besoin de semer pour récolter, ni d’élever des animaux pour manger
de la viande. Il y avait en abondance des gazelles, des ânes, des taureaux
sauvages dans la steppe, des chèvres dans la montagne, des sangliers, des
lapins et des canards dans les fourrés le long des berges de l’Euphrate, des
poissons et des moules d’eau douce dans le fleuve, des céréales sauvages à
profusion, du blé, de l’orge, du seigle et des lentilles, le fruit du
micocoulier. Jamais depuis que l’homme moderne était apparu sur la terre il
n’avait connu pareille variété ni une telle abondance.
Cauvin
présente une théorie qui bouscule les idées reçues sur les raisons qui ont
poussé l’homme à sortir de ce paradis terrestre et qui confirme pleinement
notre propre conception. Ainsi l’archéologie vient-elle à la rescousse de la
préhistoire contemporaine.
L’explication
classique, utilitariste, est que les hommes n’avaient pas le choix. Ils étaient
devenus trop nombreux. Ils auraient donc été obligés, pour se nourrir, de
cultiver la terre, de rassembler des troupeaux. Pour faciliter
l’accomplissement des tâches auxquelles ils se trouvaient désormais astreints,
ils auraient perfectionné leur outillage, passant de la pierre taillée à la
pierre polie. Pour cuire la soupe qui était devenue la base de leur
alimentation, ils auraient inventé la poterie. Et, comme ils avaient maintenant
un patrimoine à entretenir et à défendre, ils auraient cessé d’errer de grotte
en abri pour s’installer dans des villages permanents. C’est ce qu’on appelle
la révolution néolithique, illustration spectaculaire de la thèse fondamentale
de Marx qui veut que les rapports de production commandent les formes
d’organisation de la société.
Les études
stratigraphiques de Cauvin ne viennent pas confirmer cette belle théorie au
contraire. Ainsi les agriculteurs de Mureybet, site des fouilles de Cauvin,
continuaient à utiliser une herminette de pierre taillée alors qu’ils avaient
maîtrisé depuis longtemps l’art de la pierre polie. Ils l’appliquaient à la
fabrication de longs bâtons, que l’on suppose être des amulettes car ils n’ont
jamais été utilisés comme outil. Quant à la poterie, ils l’ont toujours ignorée
bien qu’ils sachent faire cuire l’argile. On a retrouvé sur le site des
figurines en terre cuite et même trois petits pots, grossièrement modelés et
cuits au four qui devaient contenir des fards ou onguents. Comme la pierre
polie à l’origine, la céramique, technique d’avant-garde, était réservée,
semble-il, à la vie religieuse.
On a trop
tendance, quand les hommes changent leurs habitudes, à invoquer la nécessité.
La nécessité n’est pas forcément bonne conseillère. Entre le xxe et
le xve millénaire, les chasseurs du Périgord avaient développé,
autour du renne, une civilisation dont les vestiges font encore notre
admiration. Pourtant, quand le climat se réchauffa et que les rennes
disparurent, ils n’ont pas été capables d’inventer de nouvelles techniques pour
se procurer la nourriture qui commençait à faire défaut. Ils se contentèrent de
végéter. La fin du paléolithique en Europe occidentale est une période de
déclin. Au contraire, le même réchauffement avait fait de la Palestine, à
partir du XIIe millénaire, un véritable pays de cocagne. Le ventre plein et
l’esprit tranquille, l’homme se trouvait prêt pour de nouvelles aventures.
Selon Cauvin,
la nature était assez prodigue pour que les chasseurs de Palestine aient
l’assurance, quel que soit leur nombre, de manger à leur faim en toute saison.
Alors, puisqu’ils n’avaient apparemment ni désirs ni besoins d’ordre
utilitaire, pourquoi se donner le mal de planter des céréales qui poussaient
toutes seules? Pourquoi transformer leur mode de vie? Car on constate qu’à la
même époque ils délaissaient presque complètement la pêche. Jadis, ils
chassaient tous les animaux, avec une préférence marquée pour les gazelles. A
partir de ce moment, ils se spécialisent dans la chasse au taureau sauvage qui
fournit certes plus de viande mais qui est aussi plus difficile à abattre. Or,
répond Cauvin prenant ainsi délibérément le contre-pied de l’explication
traditionnelle : " Ce qui a changé, c’est la société. Interrogez
n’importe quel maître d’école, n’importe quel animateur de club de vacances.
Ils vous diront tous qu’un groupe de cent personnes ou plus, ce qui constituait
peut-être l’effectif des premiers villages ne se conduit pas comme un groupe de
vingt. Des rivalités se manifestent, des conflits apparaissent. Il faut imposer
un minimum d’organisation, créer une hiérarchie. Et, quand elle existe, lui
trouver un but. L’agriculture n’est pas une réponse de l’homme aux exigences du
milieu mais à ses propres problèmes. Sans le vouloir, les chasseurs de
Palestine, en s’installant dans les villages, avaient déclenché un mécanisme
irréversible, dont les conséquences leur échappaient. " (Nouvel
Observateur du 14 janvier 1980). Ainsi donc, selon Cauvin, (nous lui
laissons la responsabilité de ses exemples), l’invention de l’agriculture fut
en quelque sorte une véritable opération de police. L’agriculture n’aurait pas
été inventée pour donner à manger à des hommes affamés, mais tout au contraire
pour occuper des hommes désœuvrés! Déjà! Vieux problème comme on voit. Donc il
y a bien quelque chose qui semble vrai dans la théorie traditionnelle : le
changement de société a bien été causé par une augmentation du nombre des
hommes trop prospères. Mais cette augmentation n’a pas eu pour conséquence une
insuffisance des ressources mais bien des désordres, des problèmes
d’organisation, des problèmes de communication.
" Pourquoi
tel changement décisif se passe-t-il à un moment plutôt qu’à un autre...? La
réponse de Braidwood fut le fameux " culture was not
ready ", fameux parce que cité souvent par les chercheurs de la
nouvelle école américaine comme le prototype, hélas, de l’aphorisme
préscientifique à dépasser... Or nous avons systématiquement mis en parallèle
toutes les composantes perceptibles de la sédentarisation depuis le support
naturel des changements jusqu’aux divinités nouvelles. Le facteur déterminant
dans les premières expériences agricoles nous est apparu comme une initiative
humaine, non le fruit d’une pression du milieu. C’est à elle-même, à ses
problèmes internes, que la société devrait s’adapter en changeant ses
stratégies, non à la caducité forcée des précédentes en regard de ses besoins
alimentaires. Les concentrations artificielles de céréales, comme peut-être la
chasse spécialisée des grands herbivores, exprimaient un progrès du travail
organisé, perceptible dans les architectures, au sein de sociétés accrues, où
cette organisation même était la condition d’un accroissement démographique
générateur de tensions sociales. "
" Sahlins
a bien montré que si les chasseurs cueilleurs vivaient une " société
d’abondance ", c’est que leur culture, c’est-à-dire leur
" milieu intérieur ", maintenait, dans l’équilibre, ces
besoins au plus bas. Puis le déséquilibre survient, et avec lui le changement.
Nous nous demandions quelles étaient les raisons du déséquilibre et le moteur
des changements. Notre analyse des faits, dans plusieurs circonstances
fondamentales, a montré que les raisons économiques ne pouvaient y être
déterminantes. On admirait cependant que chaque étape cruciale fut marquée par
un saut quantitatif dans la densité des groupes : soit lors du passage de
la grotte au village proto-sédentaire, soit, au viiie millénaire, à
l’apparition des premières communautés proto-agricoles, soit enfin, peut-être,
à la fin du viie millénaire, lorsque les agriculteurs occupèrent des
régions de Syrie-Palestine laissées vides jusqu’alors (littoral, zones arides)
parce que leurs conditions écologiques étaient impropres à l’agriculture
commerçante. "
" Or
ces sauts démographiques impliquaient, à chaque fois, une nouvelle manière de
cohabiter et de vivre les rapports intersubjectifs, donc une aptitude à
répondre en quelque sorte " du dedans " aux tensions
psychiques qui accompagnent toujours le remaniement des structures d’un groupe.
Il semble bien que la culture ait ici pour rôle de façonner cette aptitude.
C’est bien elle, à Mureybet, qui visiblement anticipe sur la situation
socio-économique nouvelle. Tout un faisceau d’innovations sans finalité
concrète (culte du Taureau, apparition de la Déesse, nouvelles manières, très
conditionnées psychiquement, de façonner la matière de façon purement
symbolique) sont à l’origine de cet " épanouissement
culturel " au sein duquel vont surgir à la fois une nouvelle approche
conquérante du milieu naturel et une technologie plus efficace, certaines
directions particulières (chasse du bœuf, haches polies, plus tard céramique
d’usage) paraissant très nettement déterminées par des clivages psychologiques
déjà expérimentés dans un contexte non matériel. " (Les premiers
villages de Syrie-Palestine, du IXe au VIIe millénaire
avant Jésus-Christ, Maison de l’Orient méditérranéen ancien, 1 rue Raulin,
Lyon).
7.
L’ethnographie à la rescousse de la préhistoire contemporaine
Des travaux de
Cauvin aussi bien que de ceux de Sahlins (Au cœur des sociétés, Raison
utilitaire et raison culturelle, Gallimard, 1980) on pourrait conclure, et
c’est d’ailleurs ce que font ces auteurs, que la nécessité matérielle de la
production n’existe pas comme principe déterminant de la vie sociale étant
donné qu’existe une nécessité immédiatement sociale de cette production. On
pourrait donc penser que nous sommes d’accord avec ces auteurs dont, de toute
façon, les conclusions viennent renforcer nos thèses. Mais il n’en est rien
puisque ces auteurs reconnaissent encore, sinon une nécessité matérielle de la
production, du moins l’existence de ladite production et d’une réalité
matérielle. Selon nous, ce n’est pas seulement la nécessité matérielle de la
production qui n’existe pas mais la production elle-même, ceci expliquant cela.
Si la production existe, c’est seulement comme apparence et pas pour tout le
monde, mais seulement pour les professeurs, les journaputes, les économistes.
Certainement pas pour les pauvres ordinaires qui ont d’autres soucis. Selon
Sahlins encore, les rapports de production sont la division du travail
et cette division du travail est opérée par des catégories et des capacités
culturellement déterminées (p. 257). Ici encore, il pourrait sembler que nous
soyons d’accord. Il n’en est rien. Indépendamment du fait que les rapports ne
sont pas de production, la division du travail, les rapports sociaux, ne sont
déterminés par rien du tout sinon par eux-mêmes. La division du travail est
sujet. Les rapports sociaux sont sujet. Ils sont immédiatement l’activité de la
pensée dans ce qui existe. Ils produisent les systèmes des professeurs, ce ne
sont pas les systèmes des professeurs qui les produisent.
De même que la
" population " du célèbre exemple de Marx dans les Grundrisse
repris dans la Contribution à la critique de l’économie politique, la
production est une pure abstraction, une pure idée. La
" production " n’existe pas plus que n’existe la population
et pas moins, comme pure idée. Nulle part dans le monde n’existe quelque chose
comme " la population ", nulle part ailleurs que dans des
têtes, comme idée. Cependant, dans la tête des policiers, statisticiens et
démographes, toutes variantes de policier, le mot " population "
désigne bien quelque chose, non seulement le concept de population mais
la chose à laquelle se rapporte de gré ou de force (de force en fait) ce
concept. Et cette chose désignée par le mot " population "
existe bien comme monde dans le monde, c’est-à-dire comme menace pour le policier,
le statisticien et le démographe. Mais cette chose qui existe dans le monde et
non plus seulement dans quelques têtes n’y existe pas pour autant comme
" population " et cela malgré tous les efforts déployés par
le policier, le statisticien et le démographe tant dans la pensée que dans la
pratique mais comme menaçante inconnue qui vit d’une vie inconnue, qui a des
pulsations en soi-même sans se mouvoir, qui tremble dans ses profondeurs sans
être inquiète. Jusqu’à aujourd’hui cette chose désignée par le mot population
par le policier, le statisticien et le démographe a toujours réussi à échapper
aux efforts du policier, du statisticien et du démographe pour la faire exister
comme " population ". La même remarque vaut pour les mots
de " production ", de " consommation ",
d’" économie ".
Il faudrait
quand même que les gens qui prétendent nous lire, voire même nous répondre,
comprennent bien cela. Nous prétendons que la terre tourne tandis qu’ils
peuvent constater de visu, croient-ils, chaque jour que Hegel ne fait pas,
qu’elle est parfaitement immobile. Rien de moins. Les hommes mangent! Et alors?
Ce n’est pas une raison suffisante pour en conclure que l’économie, la
production, la consommation existent. Les hommes existent! Ce n’est pas une
raison suffisante pour en conclure que la population existe. De même, le fait
que l’on puisse dire à juste titre que telle ou telle chose est produite ou
détruite ne permet pas d’en conclure à l’existence d’une
" production " et d’une " destruction "
et encore moins qu’elles sont produites par " le travail "
ou détruites par " le besoin ". Ceux qui croient en
l’existence d’une production et d’une consommation sont, en tant que
matérialistes, les plus bruyants à rire de la scholastique.
C’était
l’extrême complexité à laquelle était arrivé le système de Ptolémée à la fin du
xve siècle qui choquait l’esprit mathématique de Copernic. A cette
époque, on estimait qu’il fallait plus de quatre-vingts sphères
" pour sauver les apparences ", c’est-à-dire pour rendre
compte des mouvements observés, et, même à ce prix, ces mouvements n’étaient
pas complètement expliqués. Copernic estimait – il était chanoine de Frauenburg
– improbable que Dieu, qui pouvait créer toutes choses parfaites, ait construit
un univers aussi laid, et c’est ainsi qu’il revint à l’idée, depuis
longtemps discréditée, que la Terre était en mouvement, pour voir si, en
épargnant aux sphères certains mouvements, il pouvait rendre compte du reste
par un système plus simple. Pour d’autres raisons, nous avons également pensé,
nous aussi, à remettre la terre en mouvement. A quand désormais les nouvelles
équations de Newton et tout ce qui doit nécessairement s’ensuivre? Cette fois,
nous n’attendrons sûrement pas cent quarante-quatre ans la publication des Principia.
(Publication des travaux de Copernic : 1543; publication des Principia
de Newton : 1687.)
Contrairement
à la réalité supposée du réalisme, la chose que désigne le mot
" population " existe indépendamment et contre
l’observation, elle possède de façon interne, propre, des
caractéristiques indépendantes de l’observation car elle contient le mouvement
de la pensée. Cette chose est concept, conception, indépendamment de tout
concept ou de toute conception particulière, ce qui est parfaitement connu des
sauvages pour le plus grand étonnement des ethnographes. L’homme n’est pas
seulement le genre de tous les animaux, l’homme est le genre de toute chose.
L’homme est immédiatement existence et activité du général.
De même,
" Tous les animaux " qui, selon la préface de l’Encyclopédie
de Hegel, est le commencement de la science, désigne quelque chose qui bien
évidemment n’existe pas comme tous les animaux. Cependant, quelque chose
distingue tous les animaux de tous les hommes. Tous les hommes
existent comme tous les hommes quoiqu’ils en pensent et quoiqu’ils fassent.
S’il faut que quelqu’un pense " tous les animaux " pour que
ceux-ci existent comme tel, il n’est pas nécessaire que quelqu’un pense
" tous les hommes " pour qu’ils existent cependant ainsi.
Il n’est pas nécessaire que quelqu’un pense
" embouteillage " pour que les embouteillages existent. Au
contraire, chacun pense " pas d’embouteillage " depuis les
crétins technocrates responsables de la construction des autoroutes jusqu’au
dernier automobiliste. La raison pour laquelle les hommes existent
immédiatement comme tous les hommes quoiqu’ils en pensent est
précisément que tous les hommes est déjà mouvement de la pensée
dans ce qui existe, contient déjà le mouvement de la pensée. C’est parce
qu’il contient déjà le mouvement de la pensée avant même qu’on le pense que tous
les hommes peut se passer de toute pensée pour exister comme tous les
hommes au grand dam de ceux-ci d’ailleurs. Ainsi, en ce qui concerne les
hommes, " Tous les hommes " est aussi bien le commencement
de la science que le commencement de l’histoire réelle des hommes ce qui
confirme l’intuition de Hegel du monde et de son histoire comme
" science ", connaissance.
Ce que le
policier, le statisticien et le démographe désignent par
" population " existe donc immédiatement comme genre
pratique, sujet qui agit quoiqu’on en pense. Et c’est bien ce qui les inquiète.
Population, économie, production, base matérielle etc., sont seulement des
idées de ceux qui essayent de demeurer les maîtres de ce monde ou plutôt qui
essayent de le devenir enfin et ces idées n’ont de sens et d’efficacité qu’à
l’intérieur de leurs tentatives de manipulation de cette réalité
menaçante. Donc, population, économie, production, base matérielle ne sont pas
des moments du monde, comme le pense Sahlins, mais seulement des moments d’une
pensée, elle-même moment d’une action dans le monde. Cette action, elle, est un
moment du monde et donc par son intermédiaire, les pensées qui y président.
Mais ces pensées ne sont pas directement un moment du monde, moment existant
comme moment en-soi moment comme essayent de nous en persuader les porteurs de
ces idées et les promoteurs de cette action. Évidemment, la production est
encore moins " un moment fonctionnel d’une structure culturelle "
(p. 215). Bien entendu, nous pensons que c’est parce que tous les hommes est
déjà mouvement de la pensée dans ce qui existe qu’il est aussi intelligible. Il
est en quelque sorte parent de la pensée. Nous pensons également que ceux qui
essayent de demeurer les maîtres de ce monde (ou même seulement de le devenir
enfin) et ceux qui les servent dans cette tentative sont les plus mal placés
pour atteindre cette intelligibilité. Seule la réalité est qualifiée pour
comprendre la réalité.
Il se trouve
que les pauvres n’ont pas la parole. C’est aussi bien leur force que leur
faiblesse car personne ne sait ce qu’ils pensent, ce qu’ils vivent, ce qu’ils
veulent, pas même eux tant qu’ils n’ont pas encore élevé la voix. Leurs maîtres
le savent donc encore moins et finissent par être intoxiqués par leurs propres
mensonges. Ils ne disposent, pour savoir ce que pensent les pauvres, que de
leurs ridicules sondages. Or la réponse est dans la question. Ou bien de leurs
sociologues, tels ces Crozier et Boudon qui découvrent avec stupeur que les
pauvres déploient des trésors de ruse et d’intelligence pratique pour conserver
le statu quo de leur misère, comme en Russie en quelque sorte. Et pourquoi les
pauvres devraient-ils accepter avec enthousiasme la modernisation de leur misère?
Nous avons sur tous ces chiens de garde un très net avantage, un instrument
dont ils se sont eux-mêmes condamnés à ne pas faire usage : notre propre
misère. Voilà notre puissant télescope, voilà notre mont Palomar. Les chiens de
garde intellectuels se sont eux-mêmes privés de l’utilisation de ce puissant
instrument car, tout pauvres qu’ils soient, ils déploient des efforts comiques
pour ne pas le savoir. Toute leur activité s’épuise à s’inventer de mirobolants
privilèges. Leur mauvaise conscience ridicule n’a d’autre but que d’essayer de
garantir l’existence de ces privilèges fantomatiques. Tandis que les pauvres
ordinaires ne rêvent que de richesse, les pauvres honteux sont condamnés à ne
parler que de misère. La simple évocation de la richesse suffirait en effet à
leur dévoiler toute la cruauté de leur sort. A la rigueur, les riches
pourraient parler de la richesse. Mais ils ne le veulent pas. Ainsi, ceux qui
savent se taisent et ceux qui parlent ne savent pas.
Tant pour
Cauvin que pour Sahlins cependant ennemis déclarés de l’utilitarisme,
l’opposition entre une base matérielle et un ordre culturel ne fait pas de
doute, il y a bien d’une part l’économie, la production, une réalité matérielle
et d’autre part une superstructure culturelle (Au cœur des sociétés, p.
269). Pour Sahlins commentant Marx, " ce que les hommes
produisent et la façon dont ils produisent dépend du schème culturel des hommes
et des choses " (p. 203). Ce qui est d’ailleurs reculer pour
mieux sauter, car de quoi dépend ce schème culturel, qui l’a produit? Le monde
repose sur un éléphant, mais sur quoi repose l’éléphant? Sur une tortue
évidemment. Mais Sahlins ne songe pas un instant à nier que l’économie ou la
production existent. Tout au contraire, le but de Sahlins est de donner " une
explication culturelle de la production " (p. 214) où la base
économique " est le lieu principal de la production
symbolique " (p. 262) et " le symbolisme économique est
structurellement déterminant " (p. 272). Comme ça tout le monde est
content! Il s’agit donc de donner une explication de quelque chose qui n’existe
pas. Puisque l’explication matérialiste de Marx a échoué à expliquer cette
chose inexistante on va essayer maintenant une explication culturelle! On
reconnaît bien là le procédé tant prisé par les pairs de Sahlins et qui
consiste à ne parler que de ce qui n’existe pas pour mieux ne pas parler de ce
qui existe.
Sahlins
déplore seulement qu’aspects matériels et aspects sociaux soient séparés dans
la théorie laissant entendre par là que ces aspects existent aussi dans le
monde. " Ainsi il est évident – pour les sociétés bourgeoises comme
pour les sociétés dites primitives – que les aspects matériels ne sont pas
utilement séparés des aspects sociaux, comme si ceux-là étaient attribuables à
la satisfaction des besoins par l’exploitation de la nature et ceux-ci aux
problèmes des relations entre les hommes " écrit-il dans sa
conclusion. Or Sahlins ne fait rien d’autre que maintenir séparés dans la
théorie ces fantômes par l’effort même qu’il fait pour les réunir. Il voudrait
pour cela que la production matérielle soit le lieu d’existence de l’ordre
culturel et réciproquement que cet ordre soit l’organisation même de la
production matérielle (p. 79). Mais alors qu’il saisit parfaitement que si la
culture est un " effet nécessaire de quelque circonstance
matérielle ", cette culture est une apparence, il ne peut saisir que
si la culture est l’organisation même de la production matérielle, c’est cette
production matérielle qui est une apparence, une conséquence nécessaire de
quelque circonstance culturelle ainsi que le veut Bohr pour la physique. Ou
bien la culture est une apparence et la production est seule réelle et
substantielle, ou bien la culture est seule réelle et substantielle et la
production est une pure apparence contenue dans la culture. Culture et
production ne peuvent être séparées dans le monde puisque si l’une existe,
l’autre non. C’est donc Sahlins lui-même qui les maintient séparées dans
la théorie par son effort même pour leur donner une égale dignité d’existence.
Nulle part
Sahlins ne songe à nier l’existence d’aspects matériels dans le monde. Sahlins
a beau vilipender les " propositions scientistes " qui
expliquent les " pratiques culturelles comme effets nécessaires de
quelque circonstance matérielle " (p. 256) ses propres propositions
sont scientistes à la base puisqu’elles reconnaissent l’existence de
circonstances matérielles. D’ailleurs, pour qui aurait encore des doutes il
ajoute : " Il ne s’agit pas de négliger les forces et les
circonstances matérielles. " On ne peut être plus clair. On croirait
entendre un bureaucrate polonais s’adressant aux Polonais révoltés! Soyons
clairs nous aussi. Nous ne contestons pas que des aspects matériels existent
dans le monde puisque l’université de Chicago ou celle de Nanterre ou les
bureaucrates polonais existent. Mais ces aspects sont seulement les idées
matérialistes de ces bureaucrates et de ces universitaires et nulle autre chose
dans le monde. Il s’ensuit donc que les seules forces matérialistes qui agissent
dans le monde sont ces mêmes bureaucrates et ces mêmes universitaires. Nous ne
songeons donc nullement à négliger les effets sur le pauvre monde de ces
aspects et circonstances matérialistes. Et présentement nous négligeons si peu
ces forces que nous nous employons à les combattre.
Répondant à
Murdock, Sahlins écrit : " Cette conclusion selon laquelle la
culture n’existe pas est une double illusion car elle prend pour modèle de
toute vie sociale non pas la réalité de la société bourgeoise mais la conception
que cette société a d’elle-même; elle attache foi à l’apparence de la culture
occidentale contribuant ainsi à donner l’illusion qu’elle est réellement le
produit socialisé de l’activité pratique en négligeant la constitution
symbolique de cette activité. " (p. 125.) Très bien, à part qu’on se
demande où Sahlins peut bien pêcher cette " réalité de la société
bourgeoise ". Qui peut se vanter, aujourd’hui, de connaître cette
réalité, en fait la réalité de cette irréalité. Mais Sahlins si prompt à s’insurger
lorsque cette conception que la société bourgeoise a d’elle-même lui dit que la
culture n’existe pas sinon comme conséquence et fonction de l’économie, donc en
dernier ressort comme apparence, Sahlins donc croit tout ce que lui dit cette
même conception dès qu’il ne s’agit plus de sa chère culture. Pas un instant il
ne songe qu’économie, production et consommation puissent être des apparences
dans la conception que la société bourgeoise a d’elle-même. Il croit ainsi dur
comme fer qu’il existe une économie, une production, une consommation, une base
matérielle etc. La raison en est simple. La culture de Sahlins ne peut exister
que grâce à son faire valoir matérialiste. Comme il le dit d’ailleurs lui-même
puisque si sa chère culture constitue symboliquement ce qu’il appelle
l’activité pratique, si cette activité pratique n’existe pas, que constituera
donc, symboliquement ou non, sa chère culture? (Entendons-nous : ce que
Sahlins appelle improprement activité pratique n’est que le fantôme d’activité
tel que le conçoit la pensée matérialiste.) Si l’économie, la production, la
consommation ne sont que des apparences dans la conception que la société
bourgeoise a d’elle-même (c’est-à-dire la conception qu’ont ceux qui, dans
cette société, sont payés par elle pour élaborer cette conception et qui ne
sont pas tous des professeurs) que sera donc la culture censée constituer
symboliquement ces chimères? Autrement dit, si la base matérielle, l’économie,
la production et la consommation sont seulement des apparences, la chère
culture de Sahlins est aussi une apparence dans la même conception révisée
symbolique.
Cette querelle
des infra et des superstructures, cette querelle de savoir qui détermine quoi
ne peut évidemment avoir lieu que si les infrastructures existent. Plus
d’infrastructure, plus de superstructure. La " culture " de
Sahlins est ce que devient la communication dans la conception matérialiste
quand l’avancée de la communication dans le monde contraint cette conception à
se préoccuper de communication. C’est un mensonge particulier sur ce qui se
passe dans le monde au même titre que l’abhorrée " conception que la
société bourgeoise a d’elle-même " et qui postule l’existence de
l’économie, de la production, de la consommation et de leur supériorité sur la
" culture ". Sahlins revendique seulement la supériorité de
la culture sur la production et la consommation, comme Khomeiny et Chariati en
quelque sorte.
Ainsi l’ordre
culturel et symbolique est le digne pendant chimérique de la
" production " de la pensée utilitariste. Comme dans la
bonne vieille religion on voit s’opposer la spiritualité céleste et la
matérialité terrestre. Avec un humour involontaire Sahlins nous parle d’un
" lieu institutionnel privilégié du processus symbolique, d’où émane
une grille classificatoire imposée à la culture dans son entier ".
Croyez-vous qu’il veut parler de l’université où lui et ses collègues tentent
d’imposer, non pas à la culture mais au pauvre monde, leurs lubies symboliques?
Vous n’y êtes pas. Il veut parler de la production des marchandises.
En bon
structuraliste, Sahlins est bien capable de constater des oppositions là où un
autre type de pensée voit quelque chose d’amorphe. Il peut remarquer que ces
oppositions constituent un système mais comme tout structuraliste il est bien
incapable de se référer au système qui dans le monde a produit ce
système d’oppositions décelable par la pensée. Quand le doigt montre la lune,
l’idiot regarde le doigt. Quand la signification et le symbole dénotent la
communication, le structuraliste regarde la signification et le symbole. Il est
capable de remarquer que les hommes portent des pantalons et les femmes des
robes mais il écarte en passant le simple " gain
pécuniaire " dont la recherche est censée cacher au " producteur "
les arcanes symboliques du monde (p. 265). Ainsi la " quête d’un gain
pécuniaire " est quelque chose qui va de soi pour Sahlins et qui se
passe de toute explication tandis que la grave question de savoir pourquoi les
hommes portent des pantalons et les femmes des robes doit être résolue de toute
urgence. Et l’on sent bien la supériorité du professeur Sahlins sur le simple
" producteur " qui prend un intérêt symbolique pour une
simple quête de gain pécuniaire. En effet, qu’est-ce que Wall Street face à la
splendeur et à la puissance de l’université de Chicago? Et imagine-t-on
Malinowski expliquant l’étrange pratique de la Kula par un simple intérêt
manatique? Pour nous, à la suite de Marx, l’intérêt pécuniaire est aussi
étrange que l’intérêt manatique et constitue la véritable question qui doit
être résolue de toute urgence. Et bien entendu, pour toutes ces difficiles
questions manatiques nous préférons faire confiance aux
" producteurs " d’Iran, de Pologne ou de New York lors des
pannes d’électricité plutôt qu’au professeur Sahlins.
Ainsi, parmi
tous les traits culturels parfaitement triviaux de notre société (football,
robes et pantalons, viande de cheval et viande de bœuf, entrecôte et abats) qui
attirent l’attention de Sahlins, un seul, comme par hasard, ne semble
pas digne de son attention : l’argent, cet air que l’on respire. Pour
Sahlins, la société capitaliste repose sur un code symbolique (p. 232) et la
production est la réalisation (la Sainte Eucharistie peut-être) d’un système
symbolique (le Saint Esprit sans doute?) (p. 228), la substantialisation
(qu’est-ce que je vous disais) d’une logique culturelle (p. 232). Voilà un
hégélianisme qui n’ose pas dire son nom. Selon Hegel l’idée devient monde.
Selon Sahlins un code symbolique devient production. Selon Hegel, le monde est
la réalisation de l’idée. Selon Sahlins la production est la réalisation d’une
logique culturelle. Mais d’où vient l’idée? D’où vient le code symbolique? Nous
récusons ce genre d’hégélianisme. Pour nous, après Marx, la société capitaliste
repose sur l’argent et, c’est ce qui la distingue des autres types de
société, uniquement sur l’argent. A ce titre, la société capitaliste est une
pure rationalité aliénée. Ainsi, pour Sahlins, le système vestimentaire
constitue un vaste schème de communication au point de servir de langage dans
la vie quotidienne entre ceux qui peuvent ne pas se connaître (p. 253). Mais
pas l’argent!
Sahlins a
encore le front d’affirmer que " le matérialisme historique est
véritablement une conscience de soi de la société bourgeoise " (p.
210). Pour ce professeur, il va de soi que la pensée de quelques autres
professeurs et politiciens, la pensée de quelques individus payés pour penser
par les maîtres de ce monde puisse être la conscience de soi d’une société au
même titre que les mythes ou systèmes culturels de sociétés archaïques, mythes
et systèmes produits non par quelques individus stipendiés mais par une société
et l’histoire d’une société. Pour nous, l’argent est la conscience de soi de la
société bourgeoise, le compendium encyclopédique de cette société. Et cette
conscience est active, sujet.
Enfin, pour
faire bonne mesure, Sahlins projette sur le pauvre monde ses propres
prétentions matérialistes révisées symbolique. Ainsi :
" l’utilitarisme est la façon dont l’économie occidentale (quelle
économie occidentale?) disons même la société tout entière est vécue par le
sujet participant et pensée par l’économiste " (p. 211).
Manifestement Sahlins croit que tout le monde est aussi naïf que lui ou que les
économistes alors que ces fameux participants leur infligent régulièrement de
désagréables démentis. De même, un certain texte de Saussure laisserait
entendre à un monde occidental qui ne se doute de rien, que son apparente quête
de ce qui est matériel est médiatisé par le symbolique (p. 266). Mais d’où
Sahlins tient-il que le monde occidental croit poursuivre ce qui est matériel?
Qui ne se doute de rien dans ce monde ou fait semblant de ne se douter de rien
comme les bureaucrates polonais, sinon les universitaires comme Sahlins, tous
les bourreurs de mou matérialistes, sinon ceux qui croient aussi que ce monde
est médiatisé par le symbolique, médiatisé donc par une invention de
professeur. Mais certainement pas les foules de la fièvre du samedi soir et des
pannes d’électricité, d’Iran ou de Pologne qui ne considèrent pas, elles, que
l’intérêt pécuniaire est une question classée. Pour Sahlins, visiblement, le
monde occidental ne se compose que de professeurs et se résume donc au C.N.R.S.
et à l’université de Chicago. Si donc le C.N.R.S., l’université de Chicago, les
lecteurs du Monde et du Nouvel Observateur pensent que le monde
occidental court après ce qui est matériel, alors le monde occidental dans son
ensemble croit courir après ce qui est matériel. Mais quand l’université de Chicago
éternue, le monde ne se mouche pas.
Il ne faudrait
pas que notre sévérité à l’égard de Sahlins fasse se méprendre le lecteur. Nous
considérons les discussions soignées de Sahlins tout à fait dignes d’intérêt,
contrairement aux déjections de la plupart de ses collègues européens.
Signalons
encore un ouvrage intéressant : Henri Denis, L’économie de Marx,
Histoire d’un échec, P.U.F., 1980. Le professeur Denis fait confiance à
Hegel : " En ce qui nous concerne, il nous apparaît déjà assez
nettement, ainsi que nous l’avons montré dans cet ouvrage, que certaines thèses
développées par Marx en 1857 et 1858, et abandonnées par lui ensuite, devraient
être reprises en vue de formuler une théorie de la valeur qui serait une pure
application de la Logique hégélienne et donnerait donc le point de
départ adéquat d’une analyse dialectique de l’économie capitaliste. "
Et " Marx (...) exige l’avènement immédiat du règne absolu de la
raison. Cette revendication s’accompagne chez lui, comme chez beaucoup d’autres
" rationalistes ", d’une conception matérialiste de la
réalité qui est aussi éloignée que possible de l’idéalisme hégélien. En
dernière analyse, c’est ce matérialisme qui lui a interdit de poursuivre
l’élaboration, si remarquablement préparée, d’une analyse dialectique de
l’économie capitaliste. Pour ce motif, précisément, les réflexions auxquelles
nous invite ce que l’on peut bien nommer son aventure intellectuelle ont une
portée qui dépasse le domaine particulier de l’épistémologie économique, parce
qu’elles montrent le lien unissant les questions qui se posent dans ce domaine
avec le problème général de la nature de toute réalité. " Oui, le
problème général de la nature de toute réalité est bien le problème que nous
entendons traiter tant pratiquement que théoriquement. (Le professeur Denis est
le co-auteur, avec G. Cogniot, G. Besse et un certain R. Garaudy
de Les marxistes répondent à leurs critiques catholiques, Éditions
socialiniennes, 1957.)
La théorie
situationniste fut la première tentative à notre époque pour attaquer
l’utilitarisme et le matérialisme. Il est bien évident que c’est d’abord dans
la théorie situationniste qu’il faut attaquer aujourd’hui l’utilitarisme et le
matérialisme puisque, pour parler comme Hegel, ils se trouvent là dans un
élément supérieur. Nous sommes grandement aidés dans cette tâche par la
racaille intellectuelle qui fait ses délices de cet utilitarisme et de ce
matérialisme dans cet élément supérieur, là où justement ils peuvent faire
encore illusion sous leur forme situationnisée alors que toutes leurs formes
passées ont été désavouées. Il nous suffit donc d’attaquer ce que loue cette
racaille. De même c’est dans les discussions soignées de Sahlins, Denis, Sartre
et d’Espagnat qu’il faut attaquer l’utilitarisme et le matérialisme parce que
ces auteurs s’en proclament ennemis. On perdrait son temps à les attaquer
ailleurs. Nous ne saurions trop recommander la lecture de leurs ouvrages.
Jean-Pierre Voyer
*. P. Saligue, B.P. 431, 75830 Paris Cedex 17.