Polanyiyya.
La véritable invention du besoin
Le
besoin est le fondement de ce monde
Le besoin est la mine des riches
Le besoin est la condition des si vils innocents
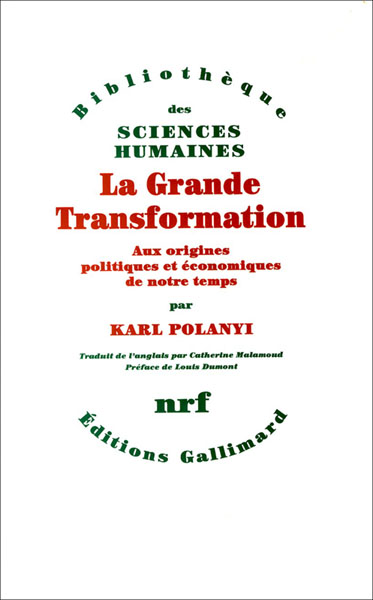
|
Avant que je ne lise Polanyi, je pensais que La Grande transformation était celle survenue après 1840 et l’abolition des lois sur les pauvres et sur les grains en Angleterre. Or il n’en est rien. Pour Polanyi, la grande transformation a lieu depuis 1929 après l’échec général du marché libre et de l’étalon or. Après lecture, je continue à penser que la véritable grande transformation est celle de 1840 : la chute de l’humanité dans le besoin à partir du foyer d’infection anglais. L’humanité est toujours plongée dans le besoin — c’est-à-dire dans l’inhumanité — plus que jamais ; elle le sera peut-être toujours. C’est pourquoi sa disparition ne serait pas une grande perte. |
C’est la meilleure : en recherchant dans ma
bibliothèque un ancien numéro de la Revue du Mauss, je tombe sur La
Grande transformation, rangée à côté d’Âge de pierre, âge d’abondance,
datée du 6 avril 1983 (donc dès sa parution). Je l’ai donc achetée deux fois.
Non seulement je l’avais déjà, mais je l’ai lue comme en témoignent l’index
établi sur les pages de garde, les annotations et les soulignements dans le
texte. J’avais ainsi souligné, dans la préface de Dumont : « Polanyi
constate que l’idée même d’économie est récente » et, évidemment,
« ayant critiqué l’économie comme idée, il a pensé à la conserver comme
chose ». Cela m’étonnais aussi que je ne l’aie pas lue à l’époque de sa
parution puisque cet ouvrage fut commenté dans le Bulletin du Mauss.
Cette lecture ne m’a donc laissé aucun souvenir. Comme quoi si l’on n’est pas
prêt à recevoir la grâce, on ne peut la recevoir et Dieu lui-même ne peut rien
pour vous. Ben Laden Populator est un grand maître. Je ne pouvais pas
deviner, en 1983, le sens de la phrase : « non pas dans le
domaine de la politique intérieure, mais dans celui de la politique
étrangère ; la puissance du socialisme apparaît de nos jours dans des
domaines de l’existence auxquels les préoccupations politiques traditionnelles
sont étrangères. » La puissance du socialisme, c’est la puissance de la
société et surtout pas « les préoccupations politiques
traditionnelles ». Il n’est pire ennemi de la société que « les
préoccupations politiques traditionnelles », c’est à dire les
pantalons. Les pantalons sont les ennemis de la société. Aux chiottes les
pantalons. Le Hamas est la société niée par les pantalons : la merde
occidentale s’est répandue en Palestine (c’est à dire la merde du dar el
maghreb. Les occupants de la Palestine et de l’Irak sont des maghrébins. Les
gens bons du Maghreb sont les meilleurs). Il nie donc la société des pantalons
et je l’approuve.
C’est la
preuve, également, que le vrai sujet du livre de Polanyi est la chute de
l’humanité dans le besoin, puisque, pour le reste, il ne m’apprenait rien,
en 1983, que je ne susse déjà. Quelle est la raison qui fit que je ne vis pas
que Polanyi exposait l’instauration difficile de cette institution qu’est le
besoin ? C’est que généralement je ne lis pas les livres dans l’ordre. Or
on ne peut voir que Polanyi expose méticuleusement l’instauration de
l’institution du besoin que si on lit le livre dans l’ordre. Donc : vous
non plus, vous n’avez pas lu le livre dans l’ordre, sinon j’en aurai entendu
parler.

Ma lecture de Polanyi me conforte dans mon interprétation du bombardement de New York. Oui le commerce fut d’abord au long cours, depuis des millénaires. Oui le commerce au long cours et les marchés locaux furent absolument séparés pendant des millénaires. Non les marchés nationaux ne furent pas engendrés par le développement des marchés locaux qui n’ont jamais manifesté la moindre tendance à s’étendre, pendant des millénaires. Oui la création de marchés nationaux (très réglementés) fut le fait des États (recherche de la puissance, Fourquet). Enfin le marché autorégulateur, invention anglaise, absolument nécessaire à la rentabilisation des machines mues par la machine à vapeur, put se saisir des sociétés en commençant par l’Angleterre. Or l’Arabie en est toujours au commerce au long cours et aux marchés locaux. Elle n’a pas de marché intérieur, ou si peu, parce qu’elle est tellement riche (ce qui ne signifie pas que ses habitants sont riches) qu’elle achète toute sa pacotille à l’étranger, y compris les téléphones et les avions, n’en déplaise à Naipaul et que les Arabes riches investissent à l’étranger. Donc, elle n’est pas « gérée en tant qu’auxiliaire du marché », les « relations sociales » ne sont pas « encastrées dans le système économique », elle ne doit pas « prendre une forme telle qu’elle permette au marché autorégulateur de fonctionner suivant ses propres lois » (que non, c’est toujours la charia là-bas). Elle est toujours le pays des bédouins. Donc l’Arabie est le pays qui peut engendrer des hommes tels que l’émir Ben Laden qui ne veulent pas que l’Arabie devienne à son tour la proie du marché autorégulé. C’est la polanyiyya, le rempart contre l’horreur anti-humaine (Polanyi) du marché autorégulé ou prétendu tel. Polanyi dit bien que « la société », s’est toujours défendue contre cette horreur. Pourquoi pas l’Arabie ? Pourquoi pas grâce à l’Islam ? L’émir Ben Laden est l’homme qui a exprimé cela, on sait de quelle manière. Seul un Arabe, et un Arabe très riche pouvait accomplir une telle chose. Du bon usage de la richesse !
Notez au passage que peu importe, en ces contrées, la nature de l’État, laïque (Syrie, Irak autrefois, Égypte, Turquie), religieuse (Iran, seule théocratie au monde) ou conforme à la religion à la façon des anciens États chrétiens (Arabie), la prétendue société civile est moins civile que partout ailleurs, c’est à dire moins soumise ou même pas soumise du tout au marché libre, cet enculisme. Les Américains ont démontré, à leur corps défendant, qu’en Irak la société est toujours tribale et religieuse. D’une manière plus générale, l’islam est la seule religion d’envergure qui demeure de nos jours un mode de vie pour des centaines de millions de personnes qui de ce fait ne sont pas tombées dans le besoin comme les enculés d’occidentaux à la suite des malheureux Anglais du XIXe siècle. Heil Polanyi ! et merci.
L’étonnant Polanyi dit que là où le syndicalisme a échoué, le courant vers le socialisme s’exercera non dans la politique intérieure mais dans la politique étrangère. Ben Laden et Armani Nedjad socialistes malgré eux ! Funny ! Ça nous change des tristes sires d’ici, des gros gras gris Strauss-Kahn. Il ne fait aucun doute que Ben Laden est plus socialiste que le gros gras gris Strauss-Kahn. Ce n’est pas difficile d’être socialiste à ce prix. Être socialiste, c’est défendre la société contre l’horreur anti-humaine du marché autorégulé. L’émir Ben Laden a inauguré une défense originale, internationale, après que toutes les autres ont échoué.
|
« En Europe occidentale, les intellectuels pensent d’une certaine manière diffuse que l’attiédissement intérieur du mouvement ouvrier indique que le socialisme décline et perd de son actualité, et ils ne comprennent pas que c’est l’horreur des poisons atomiques, la révolte des peuples de couleur et l’anarchie de l’économie mondiale qui sont la mesure du nouveau courant universel vers le socialisme, s’exerçant, non pas dans le domaine de la politique intérieure, mais dans celui de la politique étrangère ; la puissance du socialisme apparaît de nos jours dans des domaines de l’existence auxquels les préoccupations politiques traditionnelles sont étrangères. » (Polanyi, Notes marginales sur le renversement de la marée vers le socialisme, manuscrit inédit) |
Il ne faut pas confondre la société qu’il faut défendre avec la « société civile » puisque cette prétendue société civile sans citoyens (citoyens dans le ciel de l’État, prostitués dans la société dite civile par opposition à l’État. Ces grotesques citoyens le sont dans un État spécialement inventé pour faire le lit du marché) est précisément ce qu’est devenue la société en se conformant aux exigences du fonctionnement du marché, « une forme telle qu’elle permette au marché autorégulateur de fonctionner suivant ses propres lois », « un simple appendice du marché », la société pleine de prostitués qui doivent se prostituer pour satisfaire leurs besoins, le système des besoins (Hegel) ou, pour employer les termes mêmes de Polanyi : « La société économique est née, distincte de l’État politique », société « qui n’est pas autre chose que le système de marché » (LGT, p. 160). La société civile est la société économique. Polanyi attribue également à Ricardo et Hegel la découverte « de l’existence d’une société qui n’est pas soumise aux lois de l’État, mais qui, au contraire, soumet l’État à ses propres lois » (LGT p. 155). Même le singe Minc commande à l’État, c’est tout dire. Et Polanyi conclut comme Hegel : « la société des hommes courait désormais le danger d’être déplacée sur des fondations profondément étrangères au monde moral auquel le corps politique avait jusque là appartenu. »
Ce qui est excellent dans la minutieuse exposition de Polanyi, c’est qu’on assiste à l’institution du besoin. Tandis que le politique et l’économique ne sont que des catégories, le besoin est une institution au même titre que l’État, le besoin est un objet réel, le besoin est dans les faits.
|
« Une transformation a lieu dans l’Europe occidentale au long des siècles, elle est signalée de la façon la plus spectaculaire par l’émergence de nouvelles catégories de pensée, comme le politique et l’économique, et les institutions correspondantes. » (Dumont, Genèse et épanouissement de l’idéologie économique, « Introduction », page 23)
|
Avec Polanyi, nous assistons à son institution qui prit trois siècles. L’apparition du besoin coïncida avec l’apparition des pauvres et l’inflation galopante de leur nombre, alors inexplicable, depuis le XVIe siècle en Angleterre. Le besoin fut théorisé à la fin du XVIIIe siècle
— c’est à dire que fut trouvée la manière de l’exploiter pour faire du pognon : faire du pognon avec les pauvres et les indigents, comment rentabiliser le besoin au lieu de le secourir, fut le grand sujet des théoriciens de cette époque : « les scientifiques directeurs de workhouse étaient déroutés de se trouver incapables de faire de l’argent à partir des pauvres… Cette époque se termine à peu près avec la mort de Bentham (1832)… Une fois que l’organisation de marché a dominé la vie industrielle, tous les autres domaines institutionnels ont été subordonnés à ce modèle ; il n’y a plus de place pour ceux qui consacrent leur génie aux “artéfacts” sociaux » —
et sa rentabilisation assurée par l’abolition du système de Speenhamland et des lois Tudor et Stuart qui fut grandement aidée par le fait que le système de Speenhamland, qui était sensé secourir les pauvres (le droit à la vie), s’avéra être tout le contraire et fut une véritable catastrophe ; ce qui prouve en passant que la philanthropie est de la merde comme Marx le signala avec insistance. On voit Bentham se récrier contre Pitt qui voulait encore généraliser Speenhamland : « Soulager le besoin, c’est nuire à l’industrie » car c’est le besoin qui poussera les pauvres dans les fabriques. Aujourd’hui, le prostitué, ce libre individu, ce remarquable citoyen, est toujours soumis au besoin ce qui n’existait pas dans les sociétés antérieures. Le BESOIN est son maître et son seul maître. Polanyi ajoute : « du point de vue utilitariste, la tâche du gouvernement est d’accroître le besoin pour rendre efficace la sanction physique par la faim. » N’est-ce pas merveilleux : le besoin a remplacé le fouet. Il a fallu trois siècles pour que cela soit compris et appliqué. Le besoin est un résultat. Ces libres citoyens vivent donc sous la dictature du besoin. Ainsi personne
— précisément personne : plus de seigneur pour imposer la corvée, plus de maître pour menacer du fouet, plus de loi ni d’administration pour imposer l’obligation de travailler, plus de coercition du groupe pour imposer la générosité. Le prétendu libre individu est en fait soumis en permanence au besoin dans l’isolement total, personne vous dis-je. Le besoin est son élément, il vit dans le besoin comme d’autres dans le péché. Les pauvres du moyen-âge étaient parfois dans le besoin. Les prostitués modernes vivent dans le besoin. Nuance. le besoin est devenu pour eux une seconde nature. Ils sont des hommes dégénérés (privés de leur genre) pour lesquels le besoin est devenu un besoin ! Tous leurs besoins se résolvent dans le seul besoin de prostitution. Ce monde est le monde du besoin perpÉtuel. Le seul point sérieux développé par les situationnistes et qui demeurera est le suivant : vivre dans le besoin n’est pas une vie et le besoin est consubstantiel au marché autorégulé. Le besoin est la culture de ce monde, c’est à dire la négation de toute culture, une civilisation-imposture comme dit M. de Defensa. Voir à ce sujet, la fin du chapitre 13 de La Grande Transformation :
|
Les sauvages ignorent le besoin. Chez eux, « la misère est impossible » → |
|
Le tapin → |
personne, donc, ne les oblige à se prostituer, il font cela librement sous l’empire du besoin. Désormais, cet empire est soigneusement entretenu par la production permanente de besoins. Ce monde produit principalement des besoins. Il en crèvera. Bien fait.
L’Émir Ben Laden est remarquable comme homme et comme philosophe, il paye d’exemple : ce milliardaire vit sous la tente (comme Hannibal qui dormait par terre, enveloppé dans son manteau, parmi ses hommes) et dans le danger au service généreux, purement désintéressé, de la communauté. C’est un homme sans besoins mais bourré de qualités et… de dynamite. Le bombardement de New York, c’est la générosité qui attaque la pingrerie (célèbre tableau de Prud’hon). Les sociétés primitives étaient conduites par la générosité. La prétendue société de consommation est conduite par la pingrerie. Un sou est un sou, voilà sa devise. C’est la pingrerie généralisée, ce qui est inévitable puisque chacun est soumis au besoin implacable. Un corollaire est que l’homme qui ne connaît que le besoin ne connaît que son intérêt ou plutôt ce qu’il croit être son intérêt et qui n’est que sa perte. Voilà encore une question résolue par le développement de Polanyi, la question de l’intérêt. Comme disait le MAUSS : l’intérêt est-il intéressant ? Le protestantisme a sanctifié la pingrerie. Le prodigue ne saurait être l’élu du Seigneur. Je t’en foutrais de la société du spectacle, je t’en foutrais de la société de consommation. (Polanyi, chapitre 10, L’Économie politique et la découverte de la société)
Je lisais dernièrement la question d’un situ-gauchiste : « Pourquoi penser que l’islamisme salafiste opérant sur le territoire américain peut vraiment quelque chose contre le “nihilisme manchestérien” ? » (2 novembre 2004) Oh ! peu de chose : avec l’aide bénévole et empressée du président Bush, l’émir Ben Laden a mis les États-Unis à genoux, les États-Unis, le temple du nihilisme manchestérien. L’année prochaine, à New York. Quelle économie de moyens. L’émir est le déclencheur, the trigger, qui provoque l’avalanche catastrophique. Un éternuement du capitaine Haddock. L’émir ne m’en voudra pas de ce rapprochement puisque c’est un homme modeste. Si j’avais dit un éternuement de Dieu, c’eût été un sacrilège. De même Henri IV disait ja r’nie Cotton pour ne pas dire ja r’nie Dieu. Cependant, le Trigger récolte une popularité mondiale et la gloire tandis que le président des Etats-Unis récolte la honte. Le Trigger continuera à agir à peu de frais contre le nihilisme manchestérien. C’est une question de publicité. Polanyi a raison : les choses se règleront à l’international. Opérer sur le territoire américain, c’est opérer à l’échelle mondiale.
Puisque je règle mes comptes : le même ingénu demande à propos de ce qu’il nomme mon « impasse théorique » : « l’économie n’existe pas et ensuite... » Si l’économie n’existe pas il s’ensuit que Debord était un prétentieux connard qui s’habillait à Pompéi et qui parlait pour ne rien dire puisqu’il emploie plus de deux cent fois le terme économie en tenant celle-ci pour un objet réel dans un livre de moins de deux cent pages. C’est un tout petit détail mais considérable pour un situ-gauchiste. Mais c’est aussi le cas pour toux ceux qui parlent à tire larigot d’économie. Et ce n’est plus un détail. C’est ce qu’on nomme vulgairement désinformation, ou information déstructurée et déstructurante, ce que le crétin Debord nommait spectacle. Il s’agit certainement de la plus grosse désinformation qui ait jamais eu lieu en tout cas la plus longue puisqu’elle dure depuis 1820. Debord fut un désinformateur de première classe sans même besoin qu’il soit payé par la CIA. Non, un pur bénévole. Quant aux autres conséquences je ne m’y étendrais pas ici puisque ce n’est pas le sujet.
|
L’abolition de Speenhamland [1834] fut le vrai acte de naissance de la classe ouvrière moderne, que ses intérêts immédiats destinaient à devenir la protectrice de la société contre les dangers intrinsèques d’une civilisation de la machine. Mais, quoi que leur réservât l’avenir, ce fut ensemble que classe ouvrière et économie de marché apparurent dans l’histoire. La haine pour les secours publics, la méfiance envers l’action de l’État, l’accent mis sur la respectabilité et l’indépendance, restèrent des générations durant caractéristiques de l’ouvrier britannique. L’abrogation de Speenhamland fut l’œuvre d’une nouvelle classe qui faisait son entrée sur la scène de l’histoire : la bourgeoisie anglaise. Le corps des propriétaires fonciers (squires) ne pouvait accomplir la tâche que ces classes étaient destinées à remplir : transformer la société en économie de marché. Avant que cette transformation soit en bonne voie, il fallut abroger des douzaines de lois et en voter des douzaines d’autres. (La Grande Transformation, p. 142) |
M. de Defensa parle de civilisation-imposture, pseudo
civilisation. C’est, bien plus, comme on dit l’Anté-Christ,
l’anti-civilisation, l’anti-société, l’anti-substance humaine, le négatif de
l’humanité dans toute son horreur, la société saisie par la négation de la
société. Pas seulement satanic mill, mais satanic world, le monde
du diable. Impies ? Le mot est faible, Ben Laden est bien bon :
démoniaques, possédés. Méfiez-vous du singe anti-humain Minc : il mord.
Che vuoi ?
M. de Defensa parle de Sarközy défenseur de la société contre le free trade. Les Englishes n’en reviennent pas. Sarközy contre la con pète. La con pète leur pète à la gueule.
|
« Nicolas Sarkozy has underlined his determination to block
foreign takeovers of strategic French companies by fiercely condemning last
year’s acquisition of Arcelor, Europe’s biggest steel group, by Lakshmi
Mittal, the Indian billionaire, as a “waste”. » The presidential frontrunner voiced a sharp
protectionist twist to his industrial policy at a campaign rally in Lille on
Wednesday night. His comments are likely to shock many of his admirers in the
US and UK, who see him as France’s best hope for reform. » Blaming the euro for low wages, promising to
reintroduce “community preference” in the European Union and to combat
“social, monetary and ecological dumping”, Mr Sarkozy launched
an attack on “free trade”, which he called a “policy of naivety”. » “Look at the waste of Arcelor, which we sold off on the cheap because we believed that the steel industry was history. They got it wrong. They lied,” said Mr Sarkozy to a cheering crowd at Lille’s Palais des Congrès. “If I am president, then France will have a real industrial policy.” » (Financial Times) |
Cris d’orfraie de la pétasse anti-humaine Neelie Kroes. Grimpe-t-elle sur les tables aussi celle-là ?
|
Et pourtant, faire passer une civilisation industrielle sur une nouvelle base indépendante du marché, cela semble à beaucoup une entreprise trop désespérée pour qu’on y songe. Ils craignent un vide institutionnel ou, pire encore, la perte de la liberté. Faudra-t-il forcément qu’il en aille ainsi ? Une grande part de la masse de souffrances inséparable d’une période de transition est déjà derrière nous. Avec la dislocation sociale et économique de notre époque, avec les tragiques vicissitudes de la crise, les fluctuations de la monnaie, le chômage de masse, les changements de statut social, la destruction spectaculaire d’États historiques, nous avons vécu le pire. Sans en avoir conscience, nous payions le prix du changement. L’humanité est encore loin de s’être adaptée à l’utilisation des machines, et de grands changements sont encore à venir ; cependant, il est tout aussi impossible de restaurer le passé que de transporter nos difficultés sur une autre planète. Au lieu d’éliminer les forces démoniaques de l’agression et de la conquête, une tentative aussi futile assurerait en réalité leur survie, même après leur défaite militaire totale. La cause du mal aurait l’avantage, décisif en politique, de représenter ce qu’il est possible de réaliser, en opposition à ce qu’on est impuissant à réaliser, même avec les meilleures intentions. Et l’effondrement du système traditionnel ne nous laisse pas non plus dans le vide. Ce n’est pas la première fois dans l’histoire que des pis-aller peuvent contenir les germes de grandes institutions durables. (La GrandeTrasnformation, chapitre 21, « La liberté dans une société complexe » page 322) |
« Restaurer le passé », n’est-ce pas cette tentative aussi futile que prétendent imposer les gens bons en l’étendant au monde entier ? Les gens bons sont de grands enfants, mais avec de grosse couilles comme le lycéen July. Il me semble que Polanyi, en 1944 eut une inspiration prophétique : c’est dans la politique extérieure que se manifestera la défense de la société. Déjà de grandes nations se dressent contre la tentative futile : Russie (« Démocratie souveraine », Sourkov), Iran, Chine, Inde, et, fait plus étonnant, de simples particuliers bombardent New York tandis que des peuples étiques (sans « h ») résistent opiniâtrement à l’invasion que ses armes de géante empêchent de marcher. En terre d’islam il n’est nul besoin de restaurer le passé puisque c’est toujours le passé qui a lieu. La société arabe, la société musulmane se défendent. Et pourquoi se défendent-elles ? Parce qu’elles existent encore, pardi. L’Arabie n’est pas encore un pays peuplé de libres enculés comme l’Occident.
|
Nulle part, les tenants du
libéralisme économique n’ont vraiment réussi à rétablir la libre entreprise, qui
était condamnée à l’échec pour des raisons intrinsèques. C’est à cause de
leurs efforts
que le big business s’est installé dans
plusieurs pays d’Europe ainsi que, d’ailleurs, diverses nuances du fascisme,
comme en Autriche. La planification, la réglementation, le dirigisme qu’ils
voulaient voir bannis comme des dangers pour la liberté, ont alors été
utilisés par les ennemis jurés de celle-ci pour l’abolir totalement.
Pourtant, l’obstruction faite par les libéraux à toute réforme comportant
planification, réglementation et dirigisme a rendu pratiquement inévitable la
victoire du fascisme. La privation
totale de liberté dans le fascisme est, à vrai dire, le résultat inéluctable
de la philosophie libérale, qui prétend que le pouvoir et la contrainte sont
le mal, et que la liberté exige qu’ils n’aient point place dans une communauté
humaine. Rien de tel n’est possible ; on s’en aperçoit bien dans une
société complexe. Restent deux possibilités seulement : ou bien demeurer
fidèle à une idée illusoire de liberté et nier la réalité de la société, ou
bien accepter cette réalité et rejeter l’idée de liberté. La première
solution est la conclusion du tenant du libéralisme économique ; la
seconde celle du fasciste. Nulle autre, semble-t-il, n’est possible. Inévitablement,
nous arrivons à la conclusion que la possibilité /331/ même de la liberté est en
question. Si la réglementation est le seul moyen de répandre et de renforcer
la liberté dans une société complexe, et que pourtant faire usage de ce moyen
est contraire à la liberté en soi, alors une telle société ne peut pas être
libre. On voit bien qu’à la racine du dilemme se trouve
la signification de la liberté elle-même. L’économie libérale a imprimé une
fausse direction à nos idéaux. Elle a paru s’approcher de la réalisation d’espérances
intrinsèquement utopiques. Aucune société n’est possible, dont le pouvoir et
la contrainte soient absents, ni un monde où la force n’ait pas de fonction.
On se faisait des illusions en imaginant une société formée uniquement par le
vouloir de l’homme. C’était pourtant ce que donnait une conception de la
société fondée sur le marché, qui tenait pour équivalentes l’économie et les
relations contractuelles, et les relations contractuelles et la liberté.
Ainsi était encouragée l’illusion radicale qu’il n’y a rien dans la société
humaine qui ne provienne de la volition d’individus, et qui ne pourrait donc
être retiré à nouveau par leur volition. La vue était limitée par le marché qui
« fragmentait » la vie en secteur du producteur — celui-ci se
termine quand son produit atteint le marché — et secteur du consommateur pour
lequel tous les biens proviennent du marché. Le premier tire
« librement » son revenu du marché, l’autre l’y dépense
« librement ». La société
prise comme un tout restait invisible. Le pouvoir de l’État n’entrait
pas en ligne de compte, puisque le mécanisme du marché devait fonctionner
d’autant plus souplement que ce pouvoir était plus faible. Ni les électeurs,
ni les propriétaires, ni les producteurs, ni les consommateurs ne pouvaient
être tenus pour responsables de ces brutales restrictions de la liberté qui
survenaient en même temps que le chômage et la misère. Un honnête homme
pouvait s’imaginer qu’il était libre de toute responsabilité dans les actes
de coercition de la part d’un État que, personnellement, il rejetait ;
ou dans les souffrances économiques de la société dont il n’avait personnellement
tiré aucun avantage. Il « se suffisait à lui-même », il « ne
devait rien à personne » et n’était pas empêtré dans le mal attaché au
pouvoir et à la valeur économique. Le fait qu’il n’en était pas responsable semblait si évident qu’il
pouvait nier leur réalité au nom de sa liberté. (La Grande
Transformation, chapitre 21, « La liberté dans une société
complexe », page 330) |
Voilà donc ce qu’est la liberté dans ce monde : la liberté de gagner librement, la liberté d’acheter librement, cela au prix de la prostitution généralisée, libre prostitution évidemment, le tout sous l’empire du besoin. L’empire du besoin est présenté comme celui de la liberté. En 1971, je disais dans mon Reich mode d’emploi que c’est l’absence de la publicité qui permettait de découvrir l’existence et la nécessité de la publicité. Polanyi dit que c’est l’absence de la société, sa négation par le marché autorégulé, qui permet de découvrir l’existence de la société et sa nécessité. C’est sa cruelle absence qui se fait sentir tandis qu’avant l’établissement du besoin généralisé comme mode de vie, elle était le familier qui n’est pas pour autant connu. Une des définitions de la nécessité par Aristote : ce qui est nécessaire à la vie. La société est nécessaire à la vie de l’homme. Le comble est que le besoin passe aujourd’hui pour la nécessité, (notamment pour Marx : la liberté vient après la « nécessité », c’est à dire jamais), alors que cette nécessité est produite et reproduite en permanence. Le marché autorégulé est la négation de la société, la généralisation de la séparation. L’homme privé de la société est un sous-homme livré au besoin. Aujourd’hui, il suffit d’ouvrir les yeux pour le constater. Ça donne envie de bombarder.
Voilà donc la définition de ce fameux individu, libre, épris d’individualisme et d’égalité dont l’installation a demandé trois siècles : c’est une homme qui vit dans le besoin, un sous-homme donc, là où les anciens, fussent-ils même esclaves ou serfs, vivaient encore dans l’humanité. Ce prétendu individu libre est soumis à la nécessité en permanence. Il dépend absolument de la totalité mais il n’est relié à celle-ci que par le besoin. C’est son unique contact avec la totalité dont il dépend totalement et qui le domine totalement. De la totalité, il ne connaît que le besoin, ici et maintenant, au jour le jour. C’est un fétu. Je t ’en foutrais de la société de consommation, de la société d’abondance. Elle n’est qu’abondance de besoin, abondance de séparation, abondance de solitude.
L’interface du libre individu et de monde est le besoin et seulement le besoin. Le sous-homme est branché sur la totalité, c’est un périphérique, plug and play. L’utilitarisme est une doctrine. Mais, pour le sous-homme du besoin, c’est le monde lui-même qui est utilitaire. Le sous-homme du besoin ne connaît que l’utilité. Après ça, la magie de l’argent est facilement compréhensible. L’argent, en grande quantité, est ce qui met à l’abri du besoin, ce qui libère du besoin implacable.
|
Nous avons invoqué ce que nous croyons être les trois faits constitutifs de la conscience de l’homme occidental : la connaissance de la mort, la connaissance de la liberté, la /333/ connaissance de la société. La première, selon la légende juive, a été révélée dans l’histoire de l’Ancien Testament. La deuxième a été révélée par la découverte de l’unicité de la personne dans les enseignements de Jésus-Christ tels que les rapporte le Nouveau Testament. La troisième révélation nous est venue par le fait que nous vivons dans une société industrielle. Aucun grand nom ne s’y rattache ; peut-être Robert Owen est-il celui qui a été le plus près de devenir son porte-parole. C’est ce qui constitue la conscience de l’homme moderne. Les fascistes répondent à la reconnaissance de la réalité de la société en rejetant le postulat de la liberté. Le fascisme nie la découverte chrétienne de l’unicité de l’individu et de l’unité de l’humanité. Telle est l’origine de la disposition à dégénérer qui est en lui. Robert Owen a été le premier à reconnaître que les Évangiles ignoraient la réalité de la société. C’est ce qu’il appelait l’« individualisation » de l’homme selon le christianisme, et il semblait croire que c’était seulement dans une république coopérative que « tout ce qui est vraiment valable dans le christianisme » pouvait cesser d’être séparé de l’homme. Owen reconnaissait que la liberté que nous avons acquise par les enseignements de Jésus était inapplicable dans une société complexe. Son socialisme était la prise en charge de l’exigence de liberté dans cette société-là. L’ère post-chrétienne de la civilisation occidentale avait commencé, ère dans laquelle les Évangiles n’étaient plus suffisants, tout en restant la base de notre civilisation. La découverte de la société est donc soit la fin, soit
la renaissance de la liberté. Alors que le fasciste se résigne à abandonner
la liberté et glorifie le pouvoir qui est la réalité de la société, le
socialiste se résigne à cette réalité-là et, malgré cette réalité, prend en
charge l’exigence de liberté. L’homme atteint la maturité et devient capable
d’exister comme un être humain dans une société complexe. Pour citer encore
une fois les paroles inspirées de Robert Owen : « Si l’une
quelconque des causes du mal ne peut être supprimée par les pouvoirs nouveaux
que les hommes sont sur le point d’acquérir, ceux-ci sauront que ce sont des
maux nécessaires et inévitables ; et ils cesseront de se plaindre
inutilement comme des enfants. » |
Conclusion : le marché autorégulateur est l’ennemi de la société, de toutes sociétés. Ce n’est pas une question de classes. Polanyi montre que dans certaines circonstances, des classes réactionnaires et des classes progressistes peuvent lutter côte à côte pour défendre la société (voir ici). Même Dieu a dit Non le 11 septembre ! Pour sauter, les bédouins vont à Rhodes en avion ! « ils font présager que l’Islam, en pénétrant dans ce monde prolétarien [ il s’agit chez Toynbee de nations prolétaires et non d’individus ], dans cette couche inférieure de notre actuelle civilisation occidentale, pourra finalement entrer en ligne avec l’Inde, l’Extrême-Orient et la Russie pour leur disputer leur influence sur l’avenir par des moyens qui passent peut-être notre entendement. » (Toynbee, 1951)
Tout ce qu’il y a de civilisation dans « notre » civilisation qui est en fait une anti-civilisation, une civilisation-imposture, c’est la défense contre l’anti-civilisation, la défense contre le négatif. On comprend ainsi parfaitement la formule de M. de Defensa : « L’anti-américanisme est aujourd’hui la seule marque de civilisation qu’il nous reste. » A première vue, je ne comprenais pas bien, j’étais seulement séduit par la fermeté du propos. Grâce à Polanyi, je comprends tout. Si la marché libre (je préfère ce terme à autorégulé ou autorégulateur, puisqu’il n’est ni l’un ni l’autre) est l’anti-civilisation, les résistances qu’il suscite sont ce qui reste de civilisation (j’insiste sur le « ce qui reste », car cette résistance provient du souvenir du passé, du temps où les hommes vivaient dans l’humanité et non dans le besoin. Il faut bien que les hommes aient une notion, un ressouvenir, de l’humanité pour combattre l’anti-humanité. Hegel aurait donc raison : les choses avancent par le mauvais côté, par le négatif, par la destruction créative. Les mollah aussi ont raison : le marché libre est le grand Satan. Ce qui reste de piété consiste à le combattre. La destruction créative est créatrice de résistance. Les américanistes devraient être contents. Cette destruction est réellement créatrice.
Le cas de la société américaine est désespéré : 1) elle fut crée ex nihilo 2) elle fut crée détruite. Elle fut crée de telle sorte qu’elle ne puisse avoir lieu, par de fins renards parfaitement au courant de ce qui sa passait en Angleterre. Les États-Unis ne sont pas une nation mais un pur système des besoins, un monde utilitaire sous l’empire du besoin, né mort (« ce qui est mort et pourtant se meut en lui-même »), sans histoire et qui nie l’histoire. C’est pourquoi les Américains ne sont pas des nationalistes mais des patriotes (opposition patriotes-nationalistes selon Dumont). C’est pourquoi, je suppose, Fitzgerald écrit, dans Gatsby, que les américains préfèrent êtres des esclaves plutôt que des paysans, car paysans, ils le sont demeurés depuis le temps de « la frontière ».
La seule loi du marché libre, une fois établi l’empire du besoin (ce qui a demandé trois siècles, ce qui est la preuve écrasante que cela n’était pas évident et que c’était donc inexistant dans les siècles précédents. La thèse de P. est qu’il s’agit d’une grande nouveauté), est donc que ceux qui n’ont pas de capitaux, c’est à dire pas de machine à vapeur, en sont réduits à se prostituer pour survivre. Ils dépendent de la fabrique et la fabrique ne dépend pas d’eux. « Le free trade c’est Jésus-Christ, Jésus-Christ, c’est le free trade. » Ce à quoi Hayek, pardon, l’enfoiré Hayek, ajoute : « Quand on doit se prostituer, il faut être un vrai crétin pour tapiner sur un tapin où il n’y a plus de clients » en fonction de quoi il ajoute que « Les tapineurs et les tapineuses n’ont qu’à aller sur un autre tapin où il y a des clients qui les réclament avec impatience. Alors, le marché pourra être parfaitement autorégulé. » Autrement dit, s’il ne l’est pas, autorégulé, c’est seulement de la faute de la mauvaise volonté des tapineurs et des tapineuses. On entend encore ces choses proférées dans l’Alliance atlantique. Cela rappelle l’argument que, si les Forces d’Occupation Israéliennes n’ont pas pu envahir le Liban comme elles le projetaient, c’est parce qu’elles n’ont pas bombardé assez (alors qu’elles disposent de l’arme nucléaire ; mais aussi parce que les fantassins du Hezbollah utilisaient Lion noir, le cirage des braves). Même raisonnement pour les Américains en Irak. Il fallait bombarder plus. Que l’on compare avec l’élégance stratégique de l’émir Ben Laden et de ses followers : un tout petit bombardement aura suffi : le reste suit sous nos yeux étonnés (c’est à dire sous nos yeux qui dénotent l’étonnement par une mimique appropriée, il faut tout préciser de nos jours). Le bombardement est une excellente chose, mais il ne faut pas en abuser car on s’habitue à tout. L’effet de choc disparaît et la morne habitude quotidienne revient au galop, on s’organise, on vivote dans les décombres. Il faut ménager ses effets.
Le situationnistes, mais les marxistes aussi bien, se sont toujours empêtrés dans la fausse question des vrais besoins et des faux besoins. Il n’y a pas de vrais ni de faux besoins, mais seulement le besoin. Le besoin est un rapport social. Ce n’est pas les prétendus faux besoins qui seraient une invention moderne mais seulement le besoin. Le besoin était inconnu dans les sociétés anciennes. Le besoin est une invention moderne : Le besoin est la condition des si vils innocents, ce bétail, ce gibier. Les si vils innocents vivent dans le besoin ce qui n’est même pas le cas des bêtes. Les si vils innocents ne sont pas seulement infra-humains, mais infra-bestiaux : tout ce qui est produit dans le monde est destiné à les « nourrir » comme bétail et c’est comme prostitués qu’ils contribuent à la production de ce qu’ils consomment comme bétail. Le si vil innocent est prostitué et bétail, ni homme, ni bête, mais prostitué et bétail, homme déchu et bête déchue, le prostitué nourrit le bétail mais le prostitué et le bétail ne font qu’un. Longtemps je me suis demandé : prostitués ou bien bétail ? Les deux, mon capitaine. Dans la mécanique hamiltonienne, on traite séparément l’énergie cinétique et l’énergie potentielle étant donné que la première ne dépend que des vitesses et la seconde que des positions, mais ces énergies ne font qu’une dans la fonction hamiltonienne de l’énergie totale du système isolé. Ici, la bestialité et la prostitution de l’esclave moderne sont traitées séparément dans le monde de la servitude étant donné que la première dépend seulement de la consommation et la seconde seulement de la production, mais le prostitué et le bétail ne font qu’un dans l’esclave total. Prostitution et bestialité sont deux sous espaces de l’espace de l’esclavage total. Il est bien évident, dans ces conditions, qu’on ne peut être esclave dans l’un de ces espaces et libre dans l’autre. Merci Polanyi pour ces éclaircissements sur le statut de l’esclave moderne dans le merveilleux monde de la bière pression en bouteille. Le besoin est la négation parfaite de l’humanité. Vous pourrez satisfaire le besoin autant que vous voudrez, vous ne serez pas plus hommes. La négation du besoin ne consiste pas dans sa satisfaction. Tout au contraire, sa satisfaction assure sa reproduction perpétuelle. Le besoin est un rapport social. Le besoin est un phénomène social total. Il ne peut disparaître que si disparaît la société qui l’a produit.
Quand, vers 1978, je m’indignais que Marx ait soutenu que les hommes entrent en de certains rapports pour satisfaire leurs besoins, j’étais encore loin du compte. J’étais cependant sur la bonne voie puisque je soutenais déjà que la rareté est un résultat (la production de la rareté n’est autre que la production du besoin. Les sauvages — ou les Grecs — ignorent le besoin parce qu’ils ignorent la rareté), comme le prouva Sahlins avec éclat, un produit de ce monde qui pourtant prétend combattre une rareté originelle, ce qui est son alibi permanent, sa justification. Comme je le disais déjà, les commerçants s’autorisent du mal qu’ils ont déjà fait pour s’arroger le droit d’en faire d’autre encore pire.
Quelques
extraits
Polanyi
|
/70/ … Ce système autorégulateur de marché, c’est ce que nous entendons par « économie de marché ». Par rapport à l’économie antérieure, la transformation qui aboutit à ce système est si totale qu’elle ressemble plus à la métamorphose de la chenille qu’à une modification qui pourrait s’exprimer en termes de croissance et de développements continus. Comparons, par exemple, les activités de vente du marchand-producteur avec ses activités d’achat : ses ventes ne concernent que des produits manufacturés (artifacts) : qu’il parvienne ou non à trouver des acheteurs, le tissu de la société n’en sera guère touché. Mais ce qu’il achète, ce sont des matières premières et du travail, c’est-à-dire de la nature et de l’homme. En fait, la production mécanique, dans une société commerciale, suppose tout bonnement la transformation de la substance naturelle et humaine de la société en marchandises. La conclusion, bien que singulière, est inévitable, car la fin recherchée ne saurait être atteinte à moins ; il est évident que la dislocation provoquée par un pareil dispositif doit briser les relatins humaines et menacer d’anéantir l’habitat naturel de l’homme. |
|
La découverte la plus marquante de la recherche historique et anthropologique récente est que les relations sociales de /75/ l’homme englobent, en règle générale, son économie. L’homme agit, de manière, non pas à protéger son intérêt individuel à posséder des biens matériels, mais de manière à garantir sa position sociale, ses droits sociaux, ses avantages sociaux. Il n’accorde de valeur aux biens matériels que pour autant qu’ils servent cette fin. Ni le processus de la production ni celui de la distribution n’est lié à des intérêts économiques spécifiques attachés à la possession de biens ; mais chaque étape de ce processus s’articule sur un certain nombre d’intérêts sociaux qui garantissent en définitive que l’étape nécessaire sera franchie. Ces intérêts seront très différents dans une petite communauté de chasseurs ou de pêcheurs et dans une vaste société despotique, mais, dans les deux cas, le système économique sera géré en fonction de mobiles non économiques. Il est facile d’expliquer la chose en termes de survie. Prenons le cas d’une société tribale. L’intérêt économique de l’individu l’emporte rarement, car la communauté évite à tous ses membres de mourir de faim, sauf si la catastrophe l’accable elle-même, auquel cas c’est encore collectivement, et non pas individuellement, que les intérêts sont menacés. D’autre part, le maintien des liens sociaux est essentiel. D’abord, parce qu’en n’observant pas le code admis de l’honneur ou de la générosité, l’individu se coupe de la communauté et devient un paria ; ensuite, parce que toutes les obligations sociales sont à long terme réciproques, et qu’en les observant l’individu sert également au mieux ses intérêts « donnant donnant ». Cette situation doit exercer une pression continuelle sur l’individu, de façon à éliminer de sa conscience l’intérêt économique personnel, au point de le rendre incapable, dans de nombreux cas (mais nullement dans tous), de seulement saisir les implications de ses propres actes en fonction de cet intérêt. Cette attitude est renforcée par la fréquence des activités en commun comme le partage de la nourriture provenant des prises communes ou la participation aux dépouilles d’une expédition tribale lointaine et dangereuse. Le prix conféré à la générosité est si grand, quand on le mesure à l’aune du prestige social, que tout comportement autre que le plus total oubli de soi n’est tout simplement pas payant. Le caractère de l’individu a peu de chose à voir avec la question. L’homme peut être aussi bon ou méchant, social ou asocial, envieux ou généreux relativement à un ensemble de valeurs que relativement à un autre. Ne donner à personne de motif pour être jaloux, c’est en fait un principe général de la distribution /76/ cérémonielle, tout comme de faire publiquement l’éloge de celui qui obtient de belles récoltes dans son jardin (à moins qu’il ne réussisse trop bien, auquel cas on peut à bon droit le laisser dépérir avec l’illusion qu’il est victime de la magie noire). Les passions humaines, bonnes ou mauvaises, sont simplement orientées vers des buts non économiques. L’étalage cérémoniel sert à stimuler au maximum l’émulation, et la coutume du travail en commun tend à placer très haut les critères quantitatifs et qualitatifs. Tous les échanges s’effectuent comme des dons gratuits dont on attend qu’ils soient payés de retour, quoique pas nécessairement par le même individu — procédure minutieusement articulée et parfaitement préservée grâce à des méthodes élaborées de publicité, à des rites magiques, et à la création de « dualités » (dualities) qui lient les groupes par des obligations mutuelles —, et cela devrait par soi-même expliquer l’absence de la notion de gain, ou même de celle d’une richesse qui ne soit pas seulement constituée d’objets qui accroissent traditionnellement le prestige social. Dans cette esquisse des traits généraux qui caractérisent une communauté de la Mélanésie occidentale, nous n’avons pas tenu compte de son organisation sexuelle et territoriale — par référence à laquelle la coutume, la loi, la magie et la religion exercent leur influence —, car notre seule intention était de montrer la façon dont les prétendus mobiles économiques trouvent leur origine dans le cadre de la vie sociale. C’est en effet sur ce seul point négatif que s’accordent les ethnographes modernes : l’absence du mobile du gain ; celle du principe du travail rémunéré ; celle du principe du moindre effort ; et celle, en particulier, de toute institution séparée et distincte qui soit fondée sur des mobiles économiques. |
Le dieu Gain
|
Cela nous amène à notre thèse, qui reste encore à prouver à savoir, que les origines du cataclysme résident dans l’entreprise utopique par laquelle le libéralisme économique a voulu créer /54/ un système de marché autorégulateur. Pareille thèse semble investir ce système de pouvoirs presque mythiques : elle suppose, ni plus ni moins, que l’équilibre des puissances, l’étalon-or, et l’État libéral, ces principes fondamentaux de la civilisation du XIXe siècle, tenaient tous leur forme, en dernière analyse, d’une unique matrice commune, le marché autorégulateur. L’affirmation semble excessive, sinon choquante par son matérialisme grossier. Mais la particularité de la civilisation à l’effondrement de laquelle nous avons assisté était précisément qu’elle reposait sur des fondations économiques. D’autres sociétés et d’autres civilisations ont, elles aussi, été limitées par les conditions matérielles de leur existence : c’est là un trait commun à toute vie humaine - à toute vie, en vérité, qu’elle soit religieuse ou non religieuse, matérialiste ou spiritualiste. Tous les types de sociétés sont soumis à des facteurs économiques. Seule la civilisation du XIXe siècle fut économique dans un sens différent et distinct, car elle choisit de se fonder sur un mobile, celui du gain, dont la validité n’est que rarement reconnue dans l’histoire des sociétés humaines, et que l’on n’avait certainement jamais auparavant élevé au rang de justification de l’action et du comportement dans la vie quotidienne. Le système du marché autorégulateur dérive uniquement de ce principe. Le mécanisme que le mobile du gain mit en branle ne peut se comparer pour ses effets qu’à la plus violente des explosions de ferveur religieuse qu’ait connues l’histoire. Dans l’espace d’une génération, tout le monde habité fut soumis à son influence corrosive. Comme chacun le sait, il parvint à sa maturité en Angleterre, au cours de la première moitié du XIXe siècle, dans le sillage de la Révolution industrielle. Il atteignit le Continent européen et l’Amérique cinquante ans plus tard environ. En Angleterre, sur le Continent, et même en Amérique, des choix semblables donnèrent aux problèmes quotidiens une forme qui finit par aboutir à un modèle dont les traits principaux étaient identiques dans tous les pays de la civilisation occidentale. Pour trouver les origines du cataclysme, il nous faut nous tourner vers la grandeur et la décadence de l’économie de marché. La société de marché était née en Angleterre : pourtant, ce fut sur le Continent que ses faiblesses engendrèrent les complications les plus tragiques. Pour comprendre le fascisme allemand, nous devons revenir à l’Angleterre de Ricardo. Le XIXe siècle, on ne saurait trop le souligner, fut le siècle de /55/ l’Angleterre. La Révolution industrielle fut un événement anglais. L’économie de marché, le libre-échange et l’étalon-or furent des inventions anglaises. Dans les années vingt, ces institutions s’effondrèrent partout — en Allemagne, en Italie ou en Autriche, les choses furent simplement plus politiques et plus dramatiques. Mais quels qu’aient été le décor et la température des épisodes finaux, c’est dans le pays natal de la Révolution industrielle, l’Angleterre, que l’on doit étudier les facteurs à long terme qui ont causé la ruine de cette civilisation. |
Polanyi, La Grande Transformation. Suivez le conseil de Marx, lisez Balzac.
Un bon début
|
Notre thèse est que l’idée d’un marché s’ajustant lui-même était purement utopique. Une telle institution ne pouvait exister de façon suivie sans anéantir la substance humaine et naturelle de la société, sans détruire l’homme et sans transformer son milieu en désert. Inévitablement, la société prit des mesures pour se protéger, mais toutes ces mesures, quelles qu’elles fussent, compromirent l’autorégulation du marché, désorganisèrent la vie industrielle, et exposèrent ainsi la société à d’autres dangers. Ce fut ce dilemme qui força le système du marché à emprunter dans son développement un sillon déterminé et finit par briser l’organisation sociale qui se fondait sur lui. Cette explication de l’une des crises les plus profondes de l’histoire de l’humanité doit paraître bien trop simple. Rien ne peut avoir l’air plus absurde que de tenter de réduire une civilisation, sa substance et son éthos à un nombre immuable d’institutions ; d’en désigner une comme fondamentale ; et de partir de là pour démontrer que l’autodestruction de cette civilisation est inéluctable du fait d’une certaine qualité technique de son organisation économique. Les civilisations, comme la vie elle-même, naissent de l’interaction d’un grand nombre de facteurs indépendants qui ne sont pas, en règle générale, réductibles à des institutions bien circonscrites. Repérer le mécanisme institutionnel de la décadence d’une civilisation, voilà qui peut être tenu pour une entreprise désespérée. C’est pourtant ce que nous entreprenons. Ce faisant, nous adaptons consciemment notre but à l’extrême singularité du sujet. Car la civilisation du XIXe siècle fut unique précisément en ce qu’elle reposait sur un mécanisme institutionnel bien déterminé. Aucune explication ne saurait satisfaire qui ne rendrait pas compte de la soudaineté du cataclysme. Comme si les forces du changement avaient été contenues pendant un siècle, un torrent d’événements s’abat sur l’humanité. Une transformation sociale d’ampleur planétaire aboutit à des guerres d’un type sans précédent, au cours desquelles une vingtaine d’États se brisent avec fracas. Et la silhouette de nouveaux empires émerge d’un océan de sang. Mais ce fait d’une violence démoniaque ne fait que cacher un courant de changement rapide et silencieux qui engloutir souvent 1e passé sans même qu’une ride vienne un troubler la surface ! Une analyse raisonnée de la catastrophe doit rendre compte à la fois de cette action tempétueuse et de cette dissolution tranquille. (La Grande Transformation, page 22) |
Annexes
|
Rien
n’obscurcit aussi efficacement notre vision de la société que le préjugé
économiste. L’exploitation a été mise au premier plan du problème colonial
avec une telle persistance que ce point mérite une attention particulière. De
plus, l’exploitation, prise dans un sens évident du point de vue humain, a
été perpétrée si souvent, avec une telle persistance, et avec une telle
cruauté, par l’homme blanc sur les populations arriérées du monde, qu’on
ferait preuve, semble-t-il, d’une insensibilité totale si on ne lui accordait
pas la place d’honneur chaque fois que l’on parle du problème colonial. Mais
c’est justement cette insistance sur l’exploitation qui tend à dérober à
notre vue la question encore plus importante de la déchéance culturelle. Si
l’on définit l’exploitation, en termes strictement économiques, comme une
inadéquation permanente des taux d’échange, on peut douter qu’il y ait eu à
vrai dire exploitation. La catastrophe que subit la communauté indigène est
une conséquence directe du démembrement rapide et violent des institutions
fondamentales de la victime (le fait qu’il y ait ou non usage de la force
dans le processus ne semble pas du tout pertinent). Ces institutions sont
disloquées par le fait même qu’une économie de marché est imposée à une
communauté organisée de manière complètement différente ; le travail et
la terre deviennent des marchandises, ce qui, de nouveau, n’est qu’une
formule abrégée pour exprimer la liquidation d’absolument toute institution
culturelle dans une société organique. Des changements dans le revenu et le
chiffre de la population n’ont évidemment pas de commune mesure avec un
processus de ce genre. Qui, par exemple, se soucierait de nier qu’un peuple
autrefois libre et qui a été traîné en esclavage a été exploité, bien que son
niveau de vie, dans un certain sens artificiel, ait pu s’améliorer dans le
pays où ses membres ont été vendus, comparé à ce qu’il était dans la brousse
natale ? Et pourtant il reviendrait au même de supposer que les
indigènes des pays conquis ont été laissés en liberté et n’ont pas même dû
payer trop cher les cotonnades de qualité inférieure qu’on leur a imposées,
et que leur famine a été causée « simplement » par la dislocation
de leurs institutions sociales. On peut
citer l’exemple célèbre de l’Inde. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, les masses
indiennes ne sont pas mortes de faim parce qu’elles étaient exploitées par le
Lancashire ; elles ont péri en grand nombre parce que les communautés
villageoises indiennes avaient été détruites. Que cela ait été occasionné par
les forces de la concurrence économique, à savoir que des marchandises
fabriquées mécaniquement aient été, de façon permanente, vendues moins cher
que le chaddar tissé à la main, c’est vrai sans aucun doute ;
mais cela démontre l’inverse de l’exploitation économique, puisque le dumping
implique l’inverse d’un prix excessif. La source réelle des famines de
ces cinquante dernières années est le marché libre des céréales, combiné à un
manque local de revenus. Des récoltes insuffisantes ont naturellement fait
partie du tableau, mais en expédiant des céréales par chemin de fer, on a
trouvé moyen de secourir les zones menacées ; malheureusement, les gens
étaient incapables d’acheter les céréales à des prix qui montaient en flèche,
ce qui, sur un marché libre mais incomplètement organisé, était
obligatoirement la réaction à une pénurie. Autrefois, il y avait de petites
réserves locales pour parer aux récoltes insuffisantes, mais on avait cessé
de les faire, ou bien elles avaient été emportées dans le grand marché. C’est
pourquoi la /216/ prévention de la famine a
désormais pris le plus souvent la forme de travaux publics, pour permettre à
la population d’acheter aux prix plus élevés. Les trois ou quatre grandes
famines qui ont décimé l’Inde sous la domination britannique depuis la
révolte des Cipayes n’ont donc été la conséquence ni des éléments ni de
l’exploitation, mais simplement de la nouvelle organisation du marché du
travail et de la terre, qui a détruit l’ancien village sans résoudre en réalité
ses problèmes. Sous le régime du féodalisme et de la communauté villageoise,
« noblesse oblige », la solidarité de clan et la réglementation du
marché des céréales arrêtaient les famines ; mais sous le régime du
marché, on ne peut pas empêcher les gens de mourir de faim en suivant les
règles du jeu. Le terme « exploitation » ne décrit qu’assez mal une
situation qui n’est devenue réellement grave qu’après que le monopole
impitoyable de la Compagnie des Indes orientales a été aboli et que le libre-échange
a été introduit en Inde. Sous les monopolistes, la situation avait été assez
bien tenue en mains grâce à l’organisation archaïque des campagnes,
comportant la distribution gratuite de céréales, alors qu’avec la liberté et
l’égalité des échanges, les Indiens ont péri par millions. Du point de vue
économique, l’Inde peut en avoir bénéficié - et, à long terme, cela a
certainement été le cas - mais, du point de vue social, elle a été
désorganisée et jetée dans la misère et la déchéance. Dans certains
cas au moins, c’est le contraire de l’exploitation, si l’on peut dire, qui a
enclenché le contact culturel désintégrateur. La distribution forcée de
parcelles de terre aux Indiens d’Amérique du Nord, en 1887, a bénéficié à chacun d’eux
individuellement, selon notre manière de calculer. Mais cette mesure a
quasiment détruit l’existence physique de la race — le cas le plus frappant
de déchéance culturelle qu’on connaisse. Le génie moral d’un John Collier a
rétabli la situation presque un demi-siècle plus tard, quand il a insisté sur
la nécessité d’un retour aux territoires tribaux : de nos jours les
Indiens d’Amérique du Nord forment à nouveau, au moins en certains endroits,
une communauté vivante — et ce n’est pas l’amélioration économique, mais la restauration sociale qui a produit ce miracle.
Le choc d’un contact culturel dévastateur a été enregistré par la naissance
pathétique de la fameuse version de la Danse de l’Esprit (Ghost Danse), dans le jeu de main des
Pawnee, vers 1890, exactement à l’époque où l’amélioration des conditions
économiques rendait anachronique la culture /217/ aborigène de ces Indiens
Peaux-Rouges. En outre, les recherches ethnologiques démontrent également que
même le fait qu’une population augmente (ce qui est le second indice
économique) n’exclut pas nécessairement qu’il se produise une catastrophe
culturelle. En réalité, le taux de croissance naturel d’une population peut
être un indice, soit de vitalité culturelle, soit de dégradation culturelle.
Le sens originel du mot « prolétaire », qui rattache fécondité et
mendicité, exprime cette ambivalence de manière frappante. Le préjugé
économiste a été à la source à la fois de la grossière théorie de
l’exploitation des débuts du capitalisme et de la conception fausse, non
moins grossière, mais plus savante, qui a par la suite nié l’existence d’une
catastrophe sociale. Cette interprétation plus récente de l’histoire a
entraîné de manière significative la réhabilitation de l’économie du
laissez-faire. En effet, si l’économie libérale n’a causé nul désastre, alors
le protectionnisme, qui a privé le monde des bienfaits des marchés libres, a
été un crime gratuit. On s’est mis à regarder de travers le terme même de
« Révolution industrielle », parce qu’il donne une idée exagérée de
ce qui était, pour l’essentiel, un lent processus de changement. Tout ce qui
s’est passé, disent avec insistance ces spécialistes, c’est qu’en se
déployant progressivement, les forces du progrès technique ont transformé la
vie du peuple ; sans doute, bien des gens ont souffert de cette
transformation, mais, globalement, l’histoire a été celle d’une amélioration
continue. Cet heureux résultat est dû au fonctionnement presque inconscient
de forces économiques qui ont exécuté leur travail bénéfique en dépit des
interventions de partis impatients qui exagéraient les difficultés
inévitables de l’époque. Pareille conclusion revenait tout simplement à nier
qu’un danger eût menacé la société, et qu’il eût résulté de l’innovation
économique. Si l’histoire révisée de la Révolution industrielle était
conforme aux faits, le mouvement protectionniste aurait manqué de toute
justification objective et le laissez-faire aurait été justifié. L’illusion
matérialiste concernant la nature de la catastrophe sociale et culturelle a
ainsi étayé la légende selon laquelle les maux de l’époque ont été causés par
nos manquements au libéralisme économique. En bref, ce
ne sont pas des groupes ou classes isolés qui ont été à l’origine de ce qu’on
appelle le mouvement collectiviste, /218/ bien que le résultat ait été influencé de manière
décisive par le caractère des intérêts de classe en cause. En fin de compte,
ce qui a pesé sur les événements, ce sont les intérêts de la société dans son
ensemble, bien que leur défense ait incombé en priorité à un secteur de la
population de préférence à un autre. Il apparaît raisonnable de grouper notre
exposé du mouvement de protection, non pas autour des intérêts de classe,
mais autour de ce qu’il y avait d’essentiel dans la société, et que le marché
a mis en danger. |
Polanyi. La grande transformation, Chapitre 13, « Naissance du credo libéral »
|
Séparer le
travail des autres activités de la vie et le soumettre aux lois du marché,
c’était anéantir toutes les formes organiques de l’existence et les remplacer
par un type d’organisation différent, atomisé et individuel. Ce
plan de destruction a été fort bien servi par l’application du principe de la
liberté de contrat. Il revenait à dire en pratique que les organisations non
contractuelles fondées sur la parenté, le voisinage, le métier, la religion,
devaient être liquidées, puisqu’elles exigeaient l’allégeance de l’individu
et limitaient ainsi sa liberté. Présenter ce principe comme un principe de
non-ingérence, ainsi que les tenants de l’économie libérale avaient coutume
de le faire, c’est
exprimer purement et simplement un préjugé enraciné en faveur d’un type
déterminé d’ingérence, à savoir, celle qui détruit les relations non
contractuelles entre individus et les empêche de se reformer spontanément. Les
conséquences de l’établissement d’un marché du travail sont manifestes
aujourd’hui dans les pays colonisés. Il faut forcer les indigènes à gagner
leur vie en vendant leur travail. Pour cela, il faut détruire leurs
institutions traditionnelles et les empêcher de se reformer, puisque, dans
une société primitive, l’individu n’est généralement pas menacé de mourir de
faim à moins que la société dans son ensemble ne soit dans ce triste cas. Dans
le système territorial des Cafres (kraal), par exemple, « la misère est impossible ;
il n’est pas question que quelqu’un, s’il a besoin d’être aidé, ne le soit
pas » [1]. Aucun Kwakiutl « n’a
jamais couru le moindre risque d’avoir faim » [2]. 1. L. P. MAIR, An African Peuple in the
Tuentieth Century, 1934. 2. E. M. LOEB, « The
Distribution and Function of Money in Early Society » ; in Essays
in Anthropology, 1936. /221/ « Il n’y a pas de
famine dans les sociétés qui vivent à la limite de la subsistance [1]. » [ Les sauvages
ignorent ce qu’est le besoin. Chez eux, « la misère est
impossible ». Seuls les prostitués modernes, ces sous-hommes, le
connaissent. Le besoin est une invention récente. ] C’était
également un principe admis qu’on était à l’abri du besoin dans la communauté
de village indienne, et, pouvons-nous ajouter, dans presque n’importe quel
type d’organisation sociale jusqu’à l’Europe du début du XVIe siècle, quand les idées
modernes sur les pauvres proposées par l’humaniste Vivès furent débattues en
Sorbonne. C’est parce que l’individu n’y est pas menacé de mourir de faim que
la société primitive est, en un sens, plus humaine que l’économie de marché,
et en même temps, moins économique. Chose ironique, la première contribution
de l’homme blanc au monde de l’homme noir a consisté pour l’essentiel à lui
faire connaître le fléau de la faim. C’est ainsi que le colonisateur peut
décider d’abattre les arbres à pain pour créer une disette artificielle ou
peut imposer un impôt sur les huttes aux indigènes pour les forcer à vendre
leur travail. Dans les deux cas, l’effet est le même que celui des enclosures des Tudors avec leur
sillage de hordes vagabondes. Un rapport de la Société des Nations mentionne,
avec l’horreur qui convient, l’apparition récente dans la brousse africaine
de ce personnage inquiétant de la scène du XVIe siècle
européen, l’» homme sans maître » [2]. A la fin du Moyen Age, on
ne le rencontrait que dans les « interstices » de la société [3]. Mais il était
l’avant-coureur du travailleur nomade du XIXe siècle [4]. Or, ce que le
Blanc pratique aujourd’hui encore à l’occasion dans des contrées lointaines,
à savoir la démolition des structures sociales pour en extraire l’élément
travail, des Blancs l’ont fait au XVIIIe siècle à des populations blanches avec les mêmes
objectifs. La vision
grotesque de l’État de Hobbes — un Léviathan humain dont le vaste
corps est fait d’un nombre infini de corps humains — a été ramenée à peu de
chose par la construction du marché du travail de Ricardo : un flot de
vies humaines dont le débit est réglé par la quantité de nourriture mise à
leur disposition. 1. M. J. HERSKOVITS, The
Economic Life of Primitive Peupler, 1940. 2. R. C. THURNWALD, Black and
White in West Africa ; The Fabric of a New Civilization, 1935. 3. C. BRINKMANN, « Das
soziale System des Kapitalismus », Grundriss der Sozialökonomik,
1924. 4. A. TOYNBEE, Lectures on the Iuduttrial Revolution, 1887, p. 98. |
|
Du point de vue
économique, les méthodes de protection sociale anglaises et européennes ont
donné des résultats presque identiques. Elles ont réalisé ce qui avait été
prévu : l’éclatement du marché de ce facteur de production connu sous le
nom de force de travail. Ce
type de marché ne pouvait remplir son objet que si les salaires tombaient
parallèlement aux prix. Du point de vue des hommes, ce postulat
impliquait pour le travailleur une extrême instabilité de ses gains, une
absence totale de qualification professionnelle, une pitoyable disposition à
se laisser pousser çà et là n’importe comment, une dépendance complète à
l’égard des caprices du marché. Mises [l’enculé von Mises, note de
Heil Myself] prétendait avec raison que si les travailleurs « ne
se comportaient pas en syndicalistes, mais réduisaient leurs demandes et changeaient de domicile et
d’occupation selon les exigences du marché du travail [ ♫ de-ci, de-là,
cahin-caha, petit âne… (Véronique, Vanloo, Duval, Messager, 1898)
c’est des nomades qu’il nous faut, transhumance, des moutons, ouste,
circulez ], ils pourraient finir par trouver du travail ». Cela résume la situation dans
un système qui est basé sur le postulat du caractère de marchandise du
travail. Ce n’est pas à la marchandise de décider où elle sera mise en
vente, à quel usage elle servira, à quel prix il lui sera permis de changer
de mains et de quelle manière elle sera consommée ou détruite [ Merdre, c’est bien vrai, il ne
manquerait plus que ça ]. « Il n’est venu à l’idée de personne,
écrit ce libéral conséquent, qu’absence de salaire serait une meilleure
expression qu’absence de travail, /237/ car ce qui manque à la personne sans emploi, ce n’est
pas le travail, mais la rémunération du travail, » Mises avait raison, mais
il n’aurait pas dû se targuer d’être original ; cent cinquante ans avant
lui, l’évêque Whately disait : « Quand un homme sollicite du travail, ce n’est pas du
travail qu’il demande, mais un salaire. » [ C’est bien vrai ça aussi, la pute ne cherche
pas à baiser, elle cherche de l’argent ] Il est pourtant vrai,
techniquement parlant, que le chômage dans les pays capitalistes est dû au
fait que la politique et du gouvernement et des syndicats vise à maintenir un
niveau de salaires qui n’est pas en harmonie avec la productivité du travail
telle qu’elle est ». Car comment pourrait-il y avoir du chômage, demandait
Mises, sinon parce que les travailleurs « ne sont pas disposés à travailler
pour le salaire qu’ils pourraient obtenir sur le marché du travail pour la
besogne particulière dont ils sont capables et qu’ils sont disposés à
exécuter » ? [ Quels
cons ces travailleurs, quels salauds ] Voilà qui éclaire ce que
veulent dire en réalité les employeurs quand ils demandent la mobilité du travail et
l’élasticité des salaires [ Vieille
rengaine ] : c’est précisément ce que nous avons défini plus
haut comme un marché dans lequel le travail des hommes est une marchandise. L’objet
naturel de toute protection sociale était de détruire ce genre d’institution
et de rendre son existence impossible. En réalité, le marché du travail n’a
pu conserver sa fonction principale qu’à la condition que les salaires et les
conditions de travail, les qualifications et les réglementations fussent tels
qu’ils préserveraient le
caractère humain de cette marchandise supposée, le travail [ Soyez-donc comme des bêtes et
tout ira bien ]. Lorsqu’on prétend, comme on le fait parfois, que
la législation sociale, les lois des fabriques, l’assurance-chômage et,
par-dessus tout, les syndicats, n’ont pas fait obstacle à la mobilité du
travail et à l’élasticité des salaires, on donne à entendre que ces
institutions ont totalement échoué dans leur dessein, qui était exactement
d’interférer avec les lois de l’offre et de la demande en ce qui concerne le
travail des hommes, et à retirer celui-ci de l’orbite du marché. |
(Polanyi, fin du
chapitre 14, « Le marché et l’homme »)
|
Un seul homme s’est aperçu
de ce que signifiait cette épreuve [ l’instauration
d’un marché autorégulé ], peut-être parce que lui seul, parmi les
grands esprits de l’époque, possédait une connaissance intime et pratique de
l’industrie tout en étant ouvert à la vision intérieure. Aucun penseur ne
s’est jamais avancé plus loin que Robert Owen sur le territoire de la société
industrielle. Il est profondément conscient de la distinction entre société
et État ; bien qu’il ne montre aucun préjugé vis-à-vis de ce dernier,
comme le fait Godwin, il attend de l’État, purement et simplement, ce qu’on
peut lui demander qu’il intervienne utilement pour écarter le malheur de la
communauté, mais non pas, certainement pas, pour organiser /175/
la société. De la même manière, il ne nourrit aucune animosité contre la
machine, dont il reconnaît le caractère neutre. Ni le mécanisme politique de
l’État ni l’appareillage technique de la machine ne lui cache le phénomène :
la société. Il
rejette la manière animaliste de l’aborder, en réfutant ses limitations
malthusiennes et ricardiennes. Mais le pivot de la pensée d’Owen est qu’il se
détourne du christianisme, qu’il accuse d’« individualisation » [ le christianisme invente l’individualisme et prêche
l’amour du prochain ; le protestantisme invente l’enculisme et encule en
chantant des cantiques ], c’est-à-dire de placer la
responsabilité du caractère dans l’individu lui-même, et de nier ainsi la
réalité de la société et son influence toute-puissante dans la formation du
caractère. On trouve la signification véritable de l’attaque contre
l’« individualisation » dans son insistance sur l’origine sociale
des mobiles humains : « L’homme individualisé et tout ce qui est
vraiment valable dans le christianisme sont séparés au point d’être
totalement incapables de s’unir, pour toute l’éternité. » C’est pour
avoir découvert la société qu’Owen dépasse et va se situer par-delà le
christianisme. Il saisit cette vérité : parce que la société est réelle,
l’homme doit, en fin de compte, se soumettre à elle. On pourrait dire que son
socialisme est fondé sur une réforme de la conscience humaine qui doit être
obtenue par la reconnaissance de la réalité de la société. « Si l’une
quelconque des causes de malheur, écrit-il, ne peut être supprimée par les
pouvoirs nouveaux que les hommes sont sur le point d’acquérir, ceux-ci
sauront que ce sont des maux nécessaires et inévitables ; et ils
cesseront de se plaindre inutilement comme des enfants. » Owen a dû se
faire une idée exagérée de ces pouvoirs ; sinon, il n’aurait guère pu
donner à entendre aux magistrats du comté de Lanark que la société allait
sur-le-champ prendre un nouveau départ à partir du « noyau de
société » qu’il avait découvert dans ses communautés villageoises. Cette
imagination débordante est le privilège du génie, génie sans lequel
l’humanité ne pourrait exister, faute de se comprendre elle-même. Selon lui,
l’absence de mal dans la société a nécessairement des limites, qui tracent la
frontière d’un inaliénable territoire de liberté dont on voit alors
l’importance. Owen a le sentiment que ce territoire ne deviendra pas visible
avant que l’homme ait transformé la société à l’aide des nouveaux pouvoirs
qu’il aura acquis ; l’homme devra alors accepter ce territoire dans
l’esprit de la maturité qui ne connaît pas les plaintes puériles. Robert Owen
décrit, en 1817, la voie dans laquelle s’est engagé l’Occidental, et
ses mots résument le problème du siècle /176/ qui commence. Il montre les puissantes conséquences
des manufactures, « quand on les laisse à leur progression
naturelle ». « La diffusion générale des manufactures dans tout
un pays engendre un caractère nouveau chez ses habitants ; et comme ce
caractère est formé selon un principe tout à fait défavorable au bonheur de
l’individu ou au bonheur général, il produira les maux les plus lamentables
et les plus durables, à moins que les lois n’interviennent et ne donnent une direction
contraire à cette tendance. » L’organisation de l’ensemble de la société
sur le principe du gain et du profit doit avoir des résultats de grande
portée. Il formule ces résultats en fonction du caractère humain. Car l’effet
le plus évident du nouveau système institutionnel est de détruire le
caractère traditionnel de populations installées et de les transmuer en un
nouveau type d’hommes, migrateur, nomade, sans amour-propre ni discipline,
des êtres grossiers, brutaux, dont l’ouvrier et le capitaliste sont l’un et
l’autre un exemple. Généralisant, il en vient à dire que le principe en
question est défavorable au bonheur de l’individu et au bonheur général. De
graves maux vont en sortir, à moins qu’on ne fasse échec aux tendances
intrinsèques des institutions de marché il y faut une orientation sociale
consciente, rendue efficace par la législation. Oui, la condition des
ouvriers, qu’il déplore, est en partie due au « système des secours en
argent ». Mais, pour l’essentiel, ce qu’il observe est vrai aussi bien
des travailleurs de la ville que ceux de la campagne, à savoir qu’« ils
sont à présent dans une situation infiniment plus dégradée et plus misérable
qu’avant l’introduction de ces manufactures, du succès desquelles ils
dépendent désormais pour leur pure et simple subsistance ». Ici encore,
il touche au fond de la question en mettant l’accent non pas sur les revenus,
mais sur la dégradation et la misère. Et comme cause première de cette
dégradation, il indique, cette fois encore à juste titre, le fait que les
ouvriers dépendent de la manufacture rien que pour subsister. Il saisit que
ce qui apparaît d’abord comme un problème économique est essentiellement un
problème social. Du point de vue économique, l’ouvrier est certainement
exploité : dans l’échange, il ne reçoit pas ce qui lui est dû. Certes,
c’est fort important, mais ce n’est pas tout, loin de là. En dépit de
l’exploitation, l’ouvrier pourrait être financièrement plus à l’aise
qu’auparavant. Mais un principe tout à fait défavorable au bonheur de
l’individu et au bonheur général ravage son environnement social, son
entourage, son prestige dans la communauté, son /177/ métier ;
en un mot, ces rapports avec la nature et l’homme dans lesquels son existence
économique était jusque-là encastrée. La Révolution industrielle est en train
de causer un bouleversement social de proportions stupéfiantes, et le
problème de la pauvreté ne représente que l’aspect économique de cet événement.
Owen a raison d’affirmer que sans une intervention ni une orientation
législatives, des maux graves et permanents se produiront. A cette
époque, il ne peut prévoir que cette autodéfense de la société, qu’il appelle
de ses vœux, se montrera incompatible avec le fonctionnement même du système
économique. |
Polanyi, La Grande Transformation, fin du chapitre 10 : « L’Économie politique et la découverte de la société ».
Marx n’a pas su découvrir la société (la société civile, oui, puisqu’il était un lecteur de Hegel ; la société, non), il fut un naturaliste (comme le souligne Polanyi) et un individualiste méthodologique (comme le souligne Dumont). Cependant, Marx appréciait Owen. La société est un objet réel ; la production, la consommation, l’économie ne sont pas des objets réels, des objets, certes, réels, non. Une forêt est un objet réel, l’ensemble des arbres d’une forêt n’est pas un objet réel. Un objet non réel ne peut pas être une partie d’un objet réel. L’ensemble des arbres d’une forêt n’est pas une partie de la forêt (Descombes). L’ensemble des arbres de la forêt ne consiste pas dans les arbres de la forêt mais dans le concept …est un arbre de la forêt (Frege). Ni la production, ni la consommation, ni l’économie ne sont des parties de la société qui est un objet réel. La production ne produit rien, la consommation ne consomme rien. Les collections ne sont pas des individus collectifs.