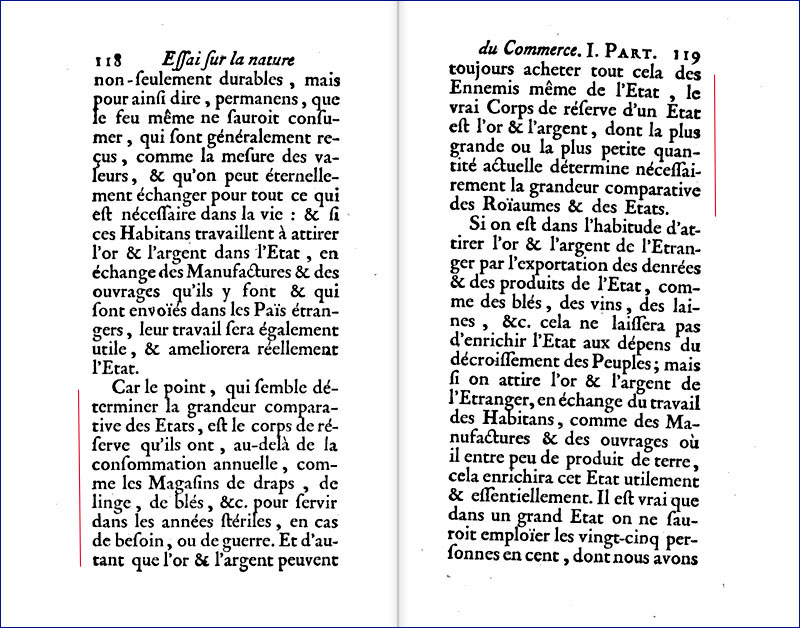|
Encyclopédie
des sciences philosophiques en abrégé (1830)
Traduction Gandillac, Gallimard, pages 262-267
§ 270
Quant aux corps dans lesquels le concept de
gravité est librement réalisé pour lui-même, ils ont pour déterminations
de leur nature différente les moments de leur concept. L’un d’entre eux
est ainsi le centre universel de la relation abstraite à soi-même.
A cet extrême s’oppose la singularité immédiate, qui-est-hors-d’elle-même
et qui-n’a-pas-de-centre, apparaissant à titre de corporéité également
autonome. Mais les corps particuliers, qui sont à la fois tout
aussi bien dans la détermination de l’être-hors-de-soi que dans celle de
l’être-en-soi, sont des centres pour eux-mêmes et se réfèrent au premier
comme à leur unité essentielle.
Remarque :
En tant
qu’ils sont les corps immédiatement concrets, les
corps planétaires sont les plus achevés dans leur existence.
On a coutume de considérer le Soleil comme le plus excellent, dans la
mesure où l’entendement préfère l’abstrait au concret, de même qu’aussi
bien l’on a plus haute estime pour les étoiles fixes que pour les corps
du système solaire. — La corporéité dénuée-de-centre, en tant qu’elle est
soumise à l’extériorité, se particularise auprès d’elle-même pour
constituer l’opposition entre le corps lunaire et le
corps cométaire.
On sait
bien que les lois du mouvement absolument-libre furent
découvertes par Kepler (128),
et cette découverte mérite
une gloire immortelle. Kepler
a démontré ces lois en ce sens qu’il a trouvé
l’expression universelle
convenant aux data
empiriques (§ 227). Tout le monde répète à présent que Newton aurait été le premier à trouver les preuves
de ces lois. Il n’a pas été facile de transférer indûment une gloire d’un
premier inventeur à un second. Là-dessus je ferai observer :
1) que
les mathématiciens accordent que les formules newtoniennes se déduisent
des lois képlériennes. Or la déduction tout immédiate est simplement celle-ci : dans la
troisième loi de Kepler, la constante est A³/T². Si on la pose sous la forme A.A²/T² et
qu’avec Newton l’on appelle A/T² la gravité universelle, l’expression qu’il
donne à l’effet de cette prétendue gravité se trouve-présente dans le
rapport inverse du carré des distances ;
2) que
la démonstration newtonienne de la proposition selon laquelle un corps
soumis à la loi de gravitation parcourt une ellipse autour du corps-central aboutit à une section conique en général,
alors que le principe qu’on serait censé démontrer est justement que la
trajectoire d’un tel corps n’est pas
un cercle ou
toute autre section conique, mais
qu’elle est seulement l’ellipse
[ce que démontrera
Bernoulli me semble-t-il ; Newton prouve la condition suffisante,
Bernoulli la condition nécessaire]. Au demeurant, contre cette
démonstration pour elle-même (Princ.
math., I, i, sect. II,
prop. I) (129) il y a
des objections à faire ; et au surplus cette démonstration, qui est
la base même de la théorie newtonienne, n’est plus utilisée en analyse.
Les conditions qui font de la trajectoire du corps une section conique déterminée sont, dans la
formulation analytique, des constantes,
et leur détermination se réduit à une circonstance empirique, laquelle est une
situation particulière du corps à un point déterminé du temps, et la
vigueur contingente d’un
choc qu’il aurait reçu originairement ; si bien que la circonstance
qui détermine la ligne courbe à être une ellipse reste extérieure à la
formule qu’il s’agit de démontrer, et qu’on n’a pas même l’idée d’en
donner une démonstration ;
3) que la loi de Newton concernant la
prétendue force de gravité n’est également mise en lumière qu’à partir de
l’expérience et par induction.
La seule
différence est celle-ci : ce que Kepler a exprimé, d’une manière
simple et sublime, sous la forme de lois du mouvement céleste, Newton en a fait la forme-réflexive d’une
force de pesanteur, cette même forme sous laquelle se présente,
dans le cas de la chute, la loi des grandeurs de cette chute. Si la forme
newtonienne n’est pas seulement commode, mais nécessaire, pour la méthode
analytique, il ne s’agit là que d’une différence de formulation
mathématique ; l’analyse s’entend depuis longtemps à déduire de la
forme des lois képlériennes l’expression newtonienne et les propositions
corrélatives (là-dessus je me tiens à l’exposé élégant de Francœur, Traité élémentaire de mécanique, livre II, chap. ii,
n. IV) (130). — Absolument parlant, l’ancienne manière utilisée pour
ce qu’on appelle une démonstration n’est qu’un tissu embrouillé, fait de lignes qui appartiennent à une construction
purement géométrique auxquelles l’on confère la signification physique de
forces autonomes, et fait de déterminations-réflexives sans contenu, cette force d’accélération et cette force d’inertie déjà mentionnées, et surtout le rapport
entre la prétendue gravité et d’autre part, la force centripète et la
force centrifuge, etc.
Les
remarques qu’on présente ici auraient besoin d’une plus large
confrontation que celle qui peut trouver place dans un abrégé. Des
propositions discordantes avec ce qui est admis apparaissent comme des
affirmations, et, contredisant à de si hautes autorités, comme quelque
chose de pire encore, des prétentions. Mais ce qu’on a exposé, ce sont
moins des propositions que des faits nus, et la réflexion qu’on réclame
porte seulement sur ceci : les différences et déterminations auxquelles
conduit l’analyse mathématique, et la démarche qui lui est imposée par sa
méthode, doivent être totalement différentes de ce qui est censé avoir
une réalité physique. Les présuppositions, la démarche et les résultats
requis et fournis par l’analyse restent totalement extérieurs aux
rapports qui concernent la valeur physique
et la signification physique
de ces déterminations et de cette démarche. C’est
sur ce point que devrait se porter l’attention ; il s’agit de
prendre conscience de la submersion de la mécanique physique sous une curieuse
métaphysique qui — face à l’expérience et au
concept — n’a d’autre source que les déterminations mathématiques dont on
vient de parler.
Il est
admis que, outre la base du traitement analytique, dont le
développement d’ailleurs a lui-même rendu superflu, ou pour mieux dire
rejeté beaucoup de ce qui appartenait aux principes essentiels de Newton
et à sa gloire, le moment, riche en contenu, qu’il a ajouté à la teneur
des lois de Kepler est le principe de perturbation, principe
dont on doit indiquer ici l’importance dans la mesure où il repose sur la
proposition selon laquelle ce qu’on nomme l’attraction est un effet de
toutes les parties singulières des corps en tant que ces derniers sont
matériels. Ce qui implique que la matière, absolument parlant, se pose à
elle-même son centre. Il faut donc considérer la masse du corps
particulier comme un moment dans sa détermination locale, et tous les corps du système se posent à eux-mêmes leur Soleil,
mais aussi les corps singuliers eux-mêmes, selon la situation relative à
laquelle ils arrivent les-uns-à-l’égard-des-autres en vertu de leur
mouvement universel, forment les-uns-par-rapport-aux-autres une relation momentanée de gravité, et ne se comportent pas
uniquement dans l’abstraite relation spatiale, la distance, mais se
posent à eux-mêmes, les-uns-avec-les-autres, un centre particulier, lequel cependant dans le système
universel, d’une part se dissout à nouveau, mais d’autre part, au moins
lorsqu’un tel rapport est durable (dans les perturbations réciproques de
Jupiter et de Saturne) lui reste soumis.
Si
maintenant, à partir de là, l’on indique quelques traits fondamentaux
concernant la manière dont les déterminations principales du mouvement
libre sont en corrélation avec le concept, cela ne saurait être, quant à
son fondement, développé de façon plus détaillée et ne peut être
qu’abandonné pour l’instant à son sort. Le principe est ici que la
démonstration rationnelle portant sur les déterminations quantitatives du
mouvement libre ne saurait reposer que sur les déterminations-conceptuelles de l’espace et du temps, des moments
dont le rapport (non extérieur pourtant) est le mouvement. Quand la science en
viendra-t-elle une bonne fois à prendre conscience des catégories
métaphysiques dont elle use et à y substituer comme fondement le concept
de la res ?
Que d’abord le mouvement soit de façon universelle
un mouvement qui
retourne en lui-même, cela
est inhérent à la détermination de particularité et de singularité en
général (§ 269) qui consiste pour les corps, à avoir, d’une part, un
centre en eux-mêmes et une existence autonome, d’autre part en même temps
leur centre dans un autre corps. Telles sont les
déterminations-conceptuelles sur lesquelles se fondent les
représentations de force
centripète et de force centrifuge, mais qui y sont inversées comme si
chacune d’elles existait pour elle-même de manière autonome en dehors de l’autre, et agissait
indépendamment, et qu’elles ne se rencontrassent l’une l’autre que dans
leurs effets, de façon extérieure,
par conséquent contingente.
Ce sont, on l’a rappelé, les lignes qui ne peuvent pas ne pas être tirées
pour la détermination mathématique, mais transformées en effectivités
physiques.
De plus ce
mouvement est uuiformément
accéléré (et — en tant
qu’il retourne à lui-même — par alternance uniformément retardé). Dans le mouvement comme mouvement libre, espace et temps réussissent à se faire
valoir pour ce qu’ils sont, pour des réalités distinctes, dans la détermination de grandeur du
mouvement (§ 267, remarque) et à ne point se comporter comme dans la
vitesse abstraite, simplement uniforme. — Dans la prétendue explication du mouvement uniformément accéléré et
retardé à partir de la diminution
et de l’accroissement alternés de la grandeur de la force centripète
et de la force centrifuge, la confusion qu’entraîne l’admission de
pareilles forces autonomes est à son comble. Selon cette explication,
dans le mouvement d’une planète de son aphélie à son périhélie, la force
centrifuge est inférieure
à la force centripète,
mais, en revanche, dans le périhélie, la force centrifuge est censée
devenir à nouveau immédiatement supérieure à la force centripète ;
pour le mouvement du périhélie à l’aphélie on admet de la même manière
que les forces sont dans le rapport opposé. On le voit, une telle opération,
par laquelle l’excédent atteint par une force vire brusquement en déficit au profit de l’autre force,
n’est rien qui soit emprunté à la nature des forces. Au contraire l’on ne
saurait éviter de conclure qu’un excédent atteint par une force au détriment
de l’autre ne pourrait que, non seulement se conserver, mais aboutir à la
pleine annihilation de l’autre force, et le mouvement ou bien, par excès
de force centripète, passer au repos, ou bien, par excès de force
centrifuge, devenir mouvement en ligne droite. On se contente de
raisonner ainsi puisque le corps, à partir de son périhélie, s’éloigne
davantage du Soleil, la force centrifuge s’accroît de nouveau ;
puisque, à l’aphélie, il est le plus loin du Soleil, c’est là que cette
force est la plus grande. On présuppose ce non-sens métaphysique tant
d’une force centrifuge que d’une force centripète ; mais à ces
fictions de l’entendement aucun entendement ne s’applique davantage et
aucun ne se demande comment une telle force, alors qu’elle est autonome,
peut d’elle-même tantôt se rendre et se laisser rendre
plus faible que l’autre, tantôt se rendre, et se laisser rendre plus
forte. — A examiner de plus près cet accroissement et cette diminution,
alternés et sans fondement, on trouve dans l’éloignement moyen par
rapport aux apsides des points où les forces sont en équilibre ; qu’ensuite ces forces échappent à cet
équilibre est quelque chose d’aussi immotivé que la soudaineté du virage
dont on a parlé plus haut. On découvre sans peine, absolument parlant,
que, dans ce mode d’explication, le remède apporté à un inconvénient par
le moyen d’une autre détermination entraîne des confusions nouvelles et
plus grandes. — Une confusion analogue intervient dans l’explication du
phénomène qui consiste en ce que le pendule oscille plus lentement à
l’équateur. Ce phénomène est attribué à la force centrifuge qui est
censée ici s’accroître ; on peut aussi facilement l’attribuer à la
plus grande force de gravité en tant que cette dernière retiendrait plus
fortement le pendule vers la ligne perpendiculaire du repos.
Quant à la forme
de la trajectoire, le cercle ne peut être saisi que comme la
trajectoire d’un mouvement simplement uniforme. Il est bien pensable,
pour reprendre le mot dont on use, qu’un mouvement qui s’accroît
ou diminue uniformément emprunte, lui aussi, la forme circulaire.
Mais que cela soit pensable ou possible ne signifie que la possibilité
d’une représentation abstraite, qui laisse de côté le déterminé,
c’est-à-dire ce qui importe, et qui est, non seulement superficielle,
mais fausse. Le cercle est la ligne qui retourne sur elle-même et où
tous les rayons sont égaux ; c’est dire qu’il est parfaitement
déterminé par le rayon ; c’est là l’unique déterminité, et
cette dernière est la déterminité totale. Mais dans le mouvement
libre, où détermination spatiale et détermination temporelle
interviennent dans leur diversité, entrent dans un rapport
qualitatif l’une avec l’autre, ce rapport ne peut que ressortir, auprès du
spatial lui-même, comme une différence de ce spatial, laquelle de la
sorte requiert deux déterminations. Ainsi la forme de la trajectoire
revenant en elle-même est essentiellement une ellipse (131). — La
déterminité abstraite qui constitue le cercle apparaît également de telle
sorte que l’arc ou angle compris entre deux rayons est indépendant
d’eux, est en face d’eux une grandeur pleinement empirique. Mais,
dans le mouvement déterminé par le concept, la distance par rapport au
centre et l’arc parcouru en un temps ne peuvent être saisis que dans une unique
déterminité, ne peuvent que constituer un tout ; des
moments du concept ne sont pas en situation de contingence l’un par
rapport à l’autre ; ainsi se présente une détermination spatiale
bi-dimensionnelle, le secteur. L’arc est de la sorte essentiellement
fonction du rayon vecteur et, comme inégal dans des temps égaux, entraîne
avec lui l’inégalité des rayons. Que la détermination de l’espace par le
temps apparaisse comme une détermination bi-dimensionnelle, comme détermination
plane, cela est en corrélation avec ce qu’on a dit plus haut
(§ 267), dans le cas de la chute, à propos de l’exposition de
la même déterminité une fois comme temps dans la racine, l’autre fois
comme espace dans le carré. Ici pourtant le retour en
elle-même de la ligne du mouvement limite au secteur la quadratique de
l’espace. — Tels sont, comme on le voit, les principes universels sur
lesquels repose la loi de Kepler selon laquelle dans des temps égaux
sont découpés des secteurs égaux (132).
Cette loi ne
concerne que le rapport de l’arc au rayon vecteur, et le temps est ici
une unité abstraite dans laquelle les divers secteurs sont égalisés, car
elle reste le déterminant à titre d’unité. L’autre rapport est le rapport
entre le temps, non à titre d’unité, mais à titre de quantum en général,
à titre de temps de révolution, et d’autre part la grandeur de la
trajectoire ou, ce qui est la-même chose, la distance à l’égard du
centre. C’est comme racine et carré que nous avons vu temps et espace se
comporter l’un par rapport à l’autre dans le cas de la chute, du
mouvement semi-libre, déterminé d’un côté certes par le concept, mais de
l’autre côté déterminé de l’extérieur. Or dans le mouvement absolu, dans
le royaume des mesures libres, chaque déterminité acquiert sa
totalité. A titre de racine, le temps n’est qu’une grandeur purement
empirique et, en tant que qualitatif, il n’est qu’une unité abstraite.
Mais, à titre de moment de la totalité développée, il est en même
temps auprès d’elle unité déterminée, totalité pour soi, il se produit
et, par là, se met en relation avec lui-même ; en tant qu’il
est ce qui est en soi sans dimension, il n’atteint dans sa production
qu’à l’identité formelle avec lui-même, au carré ; l’espace,
au contraire, en tant qu’il est le un-hors-de-l’autre positif, atteint à
la dimension du concept, du cube. Leur réalisation conserve ainsi
en même temps leur différence originaire. Telle est la troisième loi de Kepler, le rapport du
cube des distances aux carrés des temps ; — loi qui a tant de
grandeur parce qu’elle a tant de simplicité, et qu’elle représente
immédiatement la raison de la res. En revanche la
formule newtonienne, qui fait d’elle une loi concernant la force de
gravitation, montre le gauchissement et l’inversion de la réflexion qui
reste à mi-chemin.
|