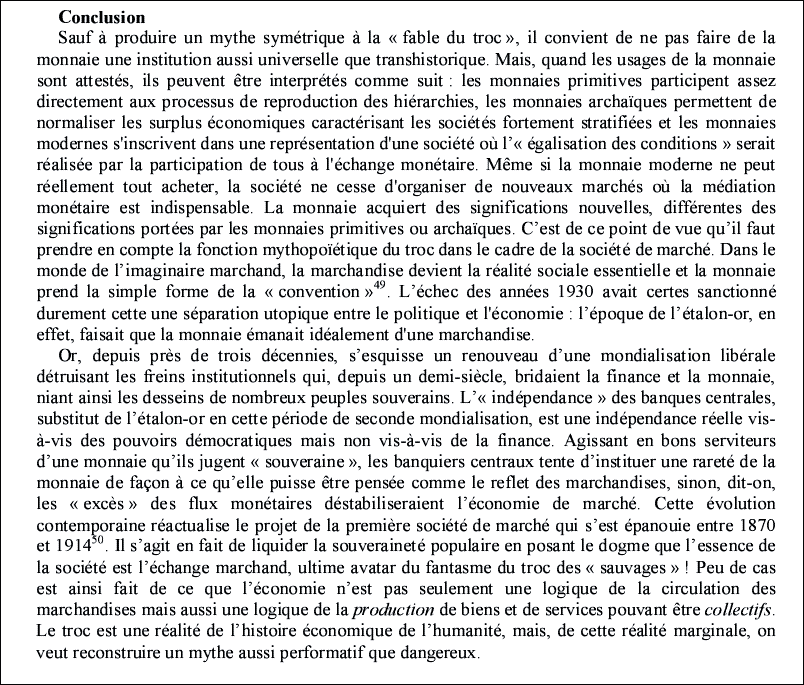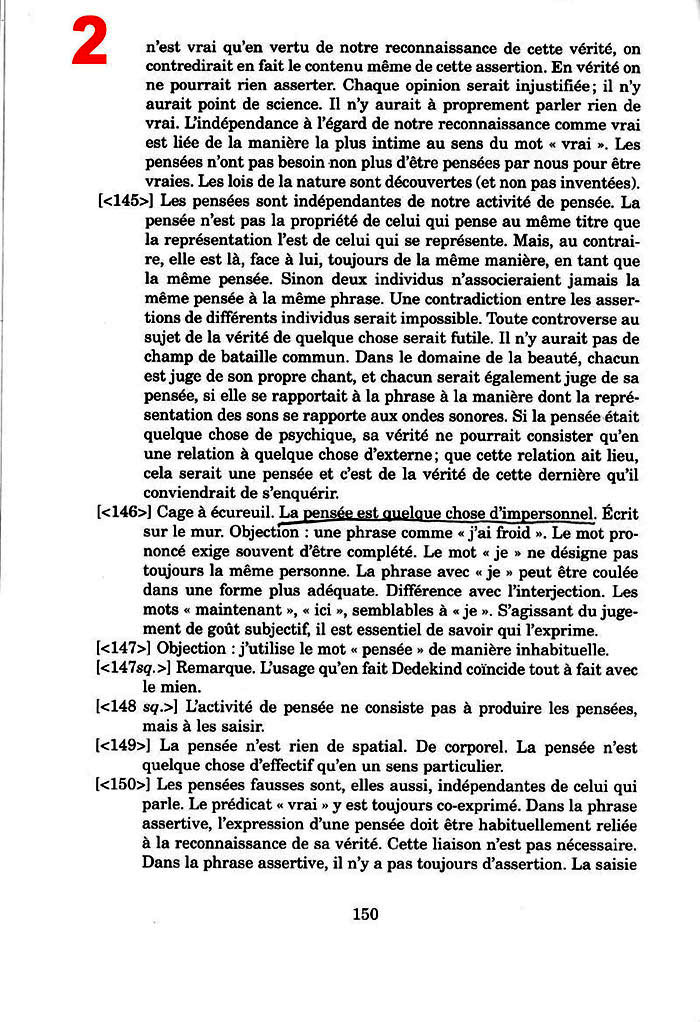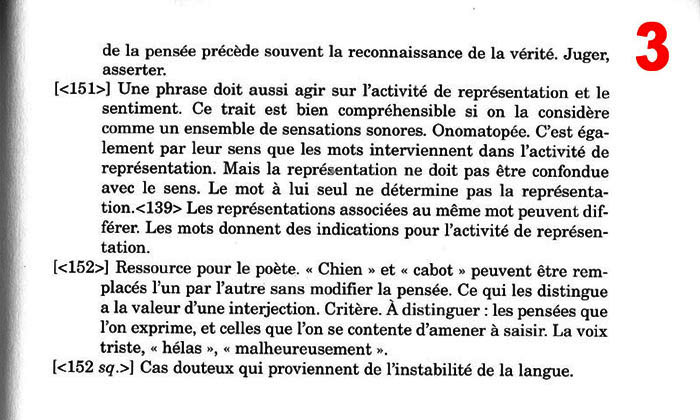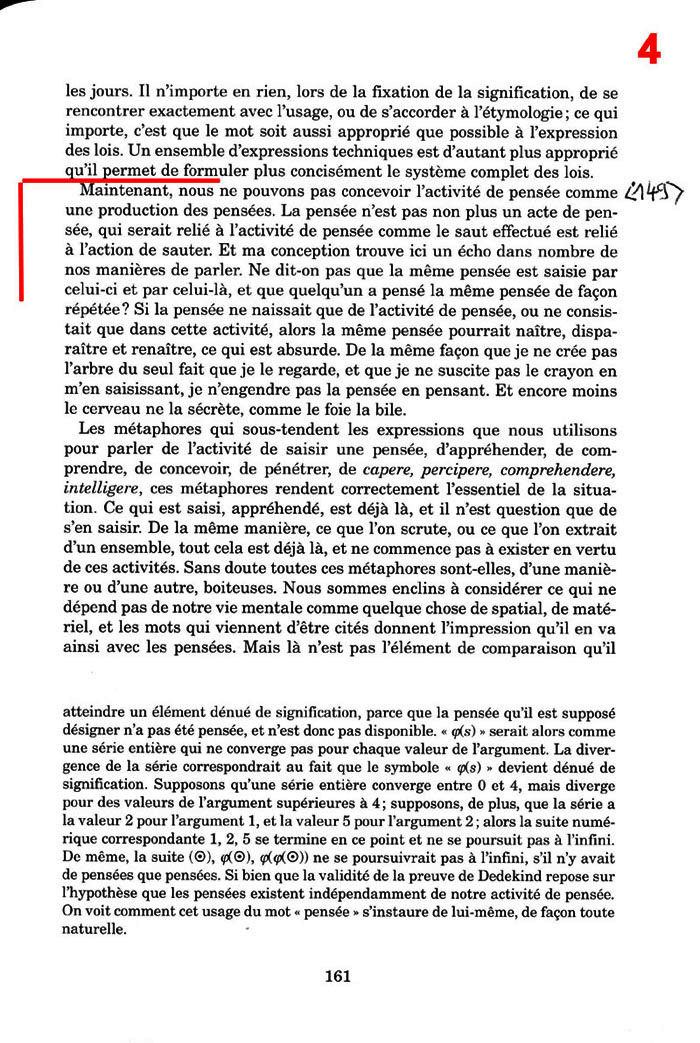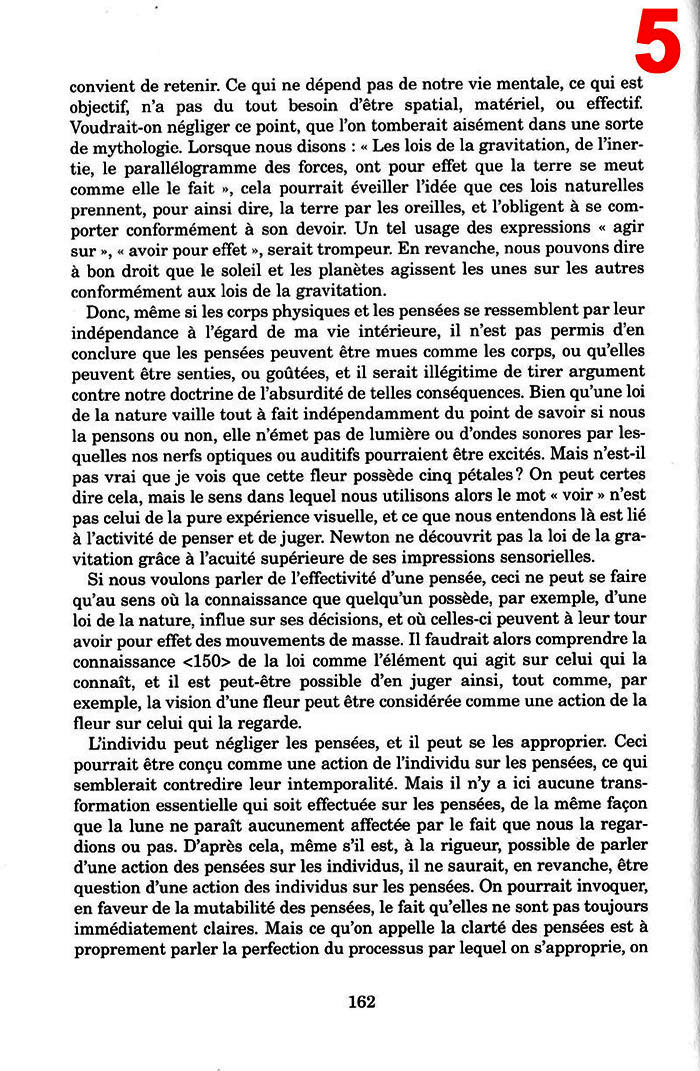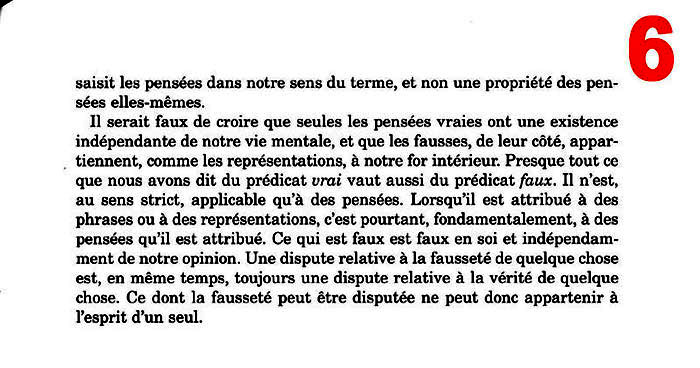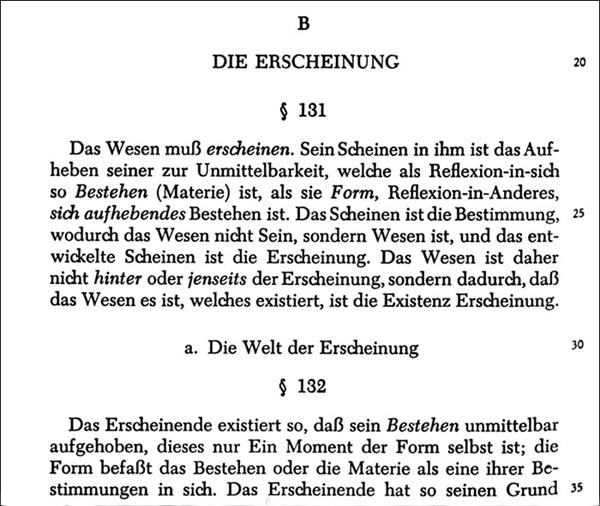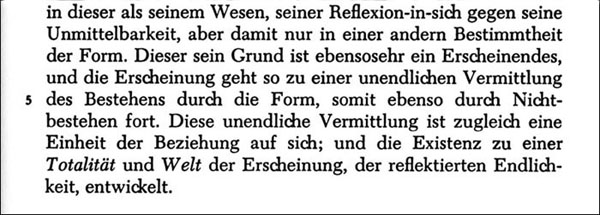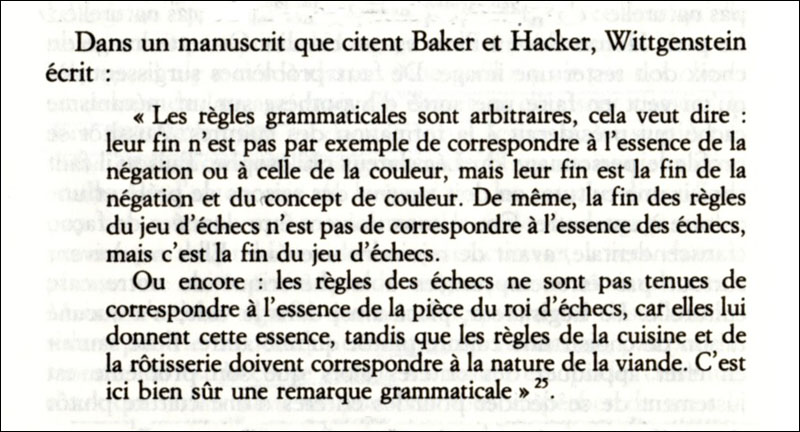NOTES 7
Pour imprimer réduire à
85 %
|
Le problème, c’est les économistes Paul
Krugman conchie les économistes Péché d’hypostasie. Au nom du père, du fils, du
Saint esprit et du marché par Paul Craigs Essais
de Karl Polanyi Une remarque de Heil Myself Le
troc et la monnaie dans la pensée de Polanyi par Jérôme Maucourant Bernard
Guerrien conchie les économistes Durkheim conchie les économistes La
science des mondes imaginaires contre la science des mondes réels par Wladimir Yéfimov Réponse
à un correspondant par Heil Myself |
|
L’apparition n’est pas un phénomène La théorie de l’Erscheinung
dans la Wissenschaftslehre Laz - Bolzano Stratégie
quantique Immarigeon La
matière et les forces ne sont pas des choses mais des abstractions
Bitbol Wittgenstein et Peirce Tiercelin Comment se fixe la
croyance Pierce Comment rendre
nos idées claires Pierce Le
phénomène chez Charles S. Peirce Tarski
et la suppositio materialis Pierce et les scolastiques Tiercelin Esprit objectif et
esprit subjectif Descombes |
La prétendue théorie de la valeur d’Aristote
La pensée et l’intelligence non verbale Serge Carfantan
Questions de logique Gilles Plante
Le problème, c’est les économistes
Ceux qui prétendent que l’ensemble des institutions économiques
est lui-même une institution économique commettent la même faute que ceux qui
prétendraient que l’ensemble des chiens est un chien. C’est le péché
d’hypostasie.
L’ensemble des institutions économiques est une institution
logico-mathématique.
|
L’économie n’est pas une
forme de vie, la production ne produit rien, la consommation ne consomme rien,
l’économie n’économise rien quoique les économiseurs pullulent, riches ou
pauvres (Cf. propos d’un économiseur ♦). Économie, marché, production,
consommation ne sont pas des objets réels. Jusqu’à présent, les objets réels qui ont
lieu passent l’entendement. L’emploi
de ces hypostases n’est qu’un cache misère, une dissimulation de l’ignorance.
C’est le phlogistique. Le mot phlogistique prétendait être un nom, il
prétendait nommer un objet réel. Or il ne nommait rien. Ce mot avait un sens,
cependant, il ne nommait rien (Quine). C’est le cas ici : ces mots
prétendent être des noms, prétendent nommer des objets réels, or ils ne
nomment rien. Tant que ne seront pas décrites « les interactions
humaines » (Craigs ne parle pas d’interaction des individus, notez
bien), l’ignorance sur ce sujet sera totale. Les interactions humaines ne sont pas des actions
interindividuelles mais des actions médiées par la collectivité : les
interactions humaines n’ont pas lieu entre individus mais par l’intermédiaire
de la collectivité, ne serait-ce qu’à cause du langage et cela partout et
toujours, même seul, au repos, dans une chambre à Gaza. Le savoir absolu,
selon Hegel, c’est le savoir qui se connaît. Le monde est savant mais il
l’ignore. Il est habité par des ignorants qui ignorent qu’ils le sont. Le
monde qui se connaîtrait du fait de ses habitants ignorants qui cesseraient
de l’être, ce n’est pas demain la veille. Je suis très content d’être du même
avis qu’un adjoint au Trésor durant le premier mandat du Président Reagan et
ancien rédacteur en chef adjoint au Wall Street Journal.
|
|
Essais de Karl Polanyi. Remarque Page 18,
sous la plume de Maucourant, (« Préface »), je lis : « L’économie
étant un aspect de la vie sociale, son étude présuppose celle de l’organisation sociale dans son
ensemble. » Ça commence mal : l’économie n’est aucun aspect de
l’organisation sociale. Il est parfaitement légitime de classer certains
actes, certaines institutions dans la classe « économique » (plutôt
que dans la classe affaire), mais cela n’autorise en rien à prétendre qu’il
existerait « une économie » qui serait un aspect de la vie sociale. Seuls sont des aspects de la vie sociale les faits classés
économiques (et non un prétendu objet réel « économie ») et le fait
qu’ils soient classés « économiques » ne fournit aucune aide à la
compréhension de ces faits classés « économiques ». Je prétends
qu’aujourd’hui, leur connaissance est nulle et je suis bien placé pour le
savoir puisque je ne sais rien sur eux, mais seulement sur le fait qu’il
n’existe aucun objet réel qui aurait pour nom « économie ». Contrairement à vous, je sais que je ne sais rien de ces faits
et c’est pourquoi je sais aussi que vous n’en savez rien (Cf. plus bas), car, si vous en
saviez quelque chose, vous le diriez, au lieu de répéter économie, économie,
économie. Meuh ! Il y a des entités, faits, actes ou institutions qu’il
est plus ou moins légitime et commode de classer comme économiques ou
alimentaires, mais ces faits, actes ou institutions sont, logiquement, des
individus qui ne présupposent aucunement de l’existence d’un individu
collectif (un chose sociale de
Durkheim) « économie ». Nous en sommes toujours là. C’est désolant.
Décidément deux siècles de propagande économique par ces fumiers
d’économistes vous l’ont bien mis dans le cul, y compris le cul de Polanyi et
celui de Marx. Des actes, des institutions, des faits pourraient constituer
un super individu collectif, une super institution qui serait une partie du
monde ou une partie des sociétés s’ils étaient des parties de cette
institution qui serait elle-même partie de la société ; alors qu’ils ne
sont présentement que des éléments d’un classement, que des éléments
d’une classe. Or, les classes ne sont pas des objets réels, ce
qui signifie qu’elles ne sont pas des parties du monde, ni des parties
des sociétés. Si vous pensez que les faits, actes, institutions économiques
ne sont pas des éléments d’une classe mais des parties
d’une institution qui serait alors « l’économie », il ne vous reste
plus qu’à le démontrer. Je vous attends là. Jusqu’à présent cela n’a jamais
été fait, depuis deux cents ans. Au lieu d’apprendre des mathématiques échevelées, vous
feriez mieux d’apprendre un peu de logique moderne. Un ensemble ne peut être partie que d’un
autre ensemble et aucunement un partie du monde, il peut être également un
élément d’un ensemble auquel cas il n’est pas une partie de cet
ensemble ; un élément d’un ensemble n’est pas une partie de cet ensemble
mais il peut être, à titre individuel une partie du monde. Ce n’est pas très
compliqué la logique. L’expression correcte pour dire qu’une société ne peut
exister sans économie et que « même un enfant sait cela »
est : Il ne peut exister de société dans laquelle il n’existerait pas
d’actes alimentaires. Les hommes, comme les animaux doivent s’alimenter et ce
n’est donc pas que les hommes doivent s’alimenter qui fait qu’ils soient des
hommes et pas seulement des animaux, mais le fait qu’ils vivent en société. Il faut être un enfant pour croire qu’une société ne peut
exister sans économie. Toutes les sociétés depuis qu’il en existe ont existé
sans économie. Sans économie, ce sont
les économistes qui n’existeraient pas, l’économie est leur soupe,
leur aliment. Ils ne font qu’aller à la soupe. En 1818, le super crétin J-B
Say inventa d’un seul coup l’économie, l’économie et les économistes quoique
les comparses de Turgot se nommassent déjà entre eux « les
économistes ». En 1820 fut créé pour lui une chaire d’économie au
Collège de France, me semble-t-il. Puis, ça continue : « Dans notre société, l’économie constitue un système qui… ». Un système ? Parfait ! Description s’il vous plaît. Un système que l’on ne peut décrire n’est aucun système. Le système de Ptolémée et le système concurrent de Copernic étaient parfaitement descriptibles et ont donné lieu à de magnifiques modèles en bronze ou en laiton. Un ensemble n’est pas descriptible. Un tas de cailloux est un système. Il est parfaitement descriptible au caillou près. Un ensemble de cailloux n’est pas et ne peut-être un tas de caillou. Il n’est pas un système. Il n’est pas descriptible. Réciproquement, un tas de caillou ne peut être un ensemble de cailloux, une classe, par exemple la classe des graviers 15-25 ou 15-30. On peut voir dans la carrière un gros tas de gravier 15-30, mais nul ensemble de gravier 15-30. D’ailleurs l’ensemble des graviers 15-35 a un cardinal gigantesque, il concerne la totalité des carrières dans le monde (et même de l’univers), rien que ça. Que dire de l’ensemble des grains de sable 1-1,5. |
Le troc
et la monnaie dans la pensée de Polanyi par Jérôme Maucourant →
Note 9 : « Socialistische Rechnungslegung », article, 1922 (Repris dans Essais de Karl Polanyi, Le Seuil, 2008, je ne sais pas encore où). Remarquable : la monnaie est l’introduction des nombres dans le monde. Donc, certains nombres sont des objets réels. Surtout pas les « nombres réels » ainsi nommés par opposition aux nombres imaginaires ; mais la monnaie. Aujourd’hui la monnaie (l’argent) a rejoint son concept : aujourd’hui l’argent n’est plus que nombres. Ces nombres sont des grandeurs, mais notez bien, seulement pour l’argent et non pour le boudin. De même le nombre longueur du boudin est une grandeur, mais seulement pour le boudin, seulement pour la famille des corps cylindriques à diamètre constant. (Le diamètre du boudin est une constante universelle.) L’argent n’est pas une chose qui permettrait de mesurer d’autres choses. Je vois cette stupidité (l’argent mesure de la valeur) écrite à peu près partout. Voulez-vous m’expliquer aussi ce qu’est une réserve de valeur. Voulez-vous m’expliquer ce qu’est un étalon de valeur. Le mètre étalon est un étalon de longueur. Ainsi, le franc serait un étalon de valeur. Mais pour cela il faudrait que la valeur soit une grandeur, que la valeur soit un nombre, ce qu’elle n’est pas. Or les prix, eux, sont non seulement des nombres, mais des grandeurs pour l’argent. Donc, de même que le mètre est l’étalon de longueur pour le système métrique, le franc est l’étalon des prix en France et la livre l’étalon des prix en Angleterre. De même que l’on peut convertir des mètres en yard, on peut convertir des francs en livres sterling [mais ce n’est qu’une illusion de proportionnalité car le rapport du franc à la livre n’est pas une constante]. La longueur de mon jardin est de soixante-dix mètre et le prix d’un mètre de boudin est dix francs ; mais cependant le nombre prix du boudin n’est pas une grandeur pour le boudin. Le nombre prix n’est une grandeur que pour l’argent. Si le prix double, la masse de l’argent double ; alors que le prix du boudin peut doubler sans que la longueur du boudin, ni son volume, ni sa masse ne doublent (le théorème de Lebesgue est donc violé). Seul le nombre longueur du boudin est une grandeur pour le boudin. Donc, l’argent ne mesure rien du tout, l’argent ne mesure pas le boudin, ni la valeur du boudin. Le seul rapport dans l’échange marchand, c’est l’échange lui-même et ce rapport n’est pas un quotient (du latin quotiens, combien de fois), une mesure. L’échange marchand n’est ni une mesure, ni une égalité, ni une équation ; il ne résulte pas non plus d’une mesure mais de la publication du prix ; et la publication de ce prix est la valeur. Ce monde repose donc sur la publicité des prix, sur la communication des prix, ainsi que je pressentais déjà dans mon Reich mode d’emploi en 1971. Je disais que la valeur était l’absence de la publicité. En effet, la valeur qui est la publicité des prix a absorbé toute publicité ce qui fait que la publicité est absente partout ailleurs : ♫ pour les Belges y’en a plus, ce sont des mecs foutus. Dans ce monde il n’y a de publicité que des prix ce qui entraîne une déshumanisation totale. Que de mots ressassés par des têtes sans cervelles, machinalement, sans jamais se soucier de la grammaire du mot, depuis deux cents ans. Je lis un texte de Jérôme Blanc dans lequel je relève la phrase : « L’usage étalon de la monnaie consiste à égaliser des quantités de divers types de biens à des fins précises. » C’est n’importe quoi. Au contraire, l’usage de l’étalon ne consiste pas à égaliser des quantités inégales, il consiste à rendre des quantités inégales échangeables et non pas égales. Au contraire les prix, les nombres attachés par une étiquette aux différents biens, permettent d’échanger des quantités inégales de biens différents sans que personne ne soit lésé. Ce sont les prix qui doivent être égalisés et non les quantité inégales qui demeurent inégales. Les prix permettent la justice (Heil ! Aristote) dans les échanges. Polanyi, nous rapporte que certains peuples échangent par exemple du blé et des arachides par volumes égaux, ne sachant (ou ne voulant) pas faire autrement. Bien évidemment une partie est lésée. Les prix permettent d’échanger blé et arachide selon des quantités différentes, selon des quantités inégales telles qu’aucune partie ne soit lésée. Attention à la grammaire, non de Dieu. Sinon, à quoi bon ouvrir la bouche, à quoi bon écrire quoi que ce soit. Sinon : de quoi parle-t-on, de quoi sont les pieds, de quoi sont les robinets ? Regardez l’usage, bordel ! |
|
Ce qu’ils ont fait comme mal, ces crapules d’économistes qui vont à la soupe. (Guerrien explique : ce qui leur importe le plus est de publier des articles. Ils ne sont pas les seuls). Lisez les articles de Guerrien, ils en valent la peine. |
|
Ce texte a cent ans. Je ne dirai pas que les choses n’ont pas
changé depuis, puisqu’elles ont empiré avec la stupide lignée des
marginalistes équilibristes. C’est du délire. À qui profite le délire ? |
« La science
des mondes imaginaires contre la science des mondes
réels » →
par Wladimir Yéfimov (Revue permanente du MAUSS)
Les économistes sont des nuisibles qui vont à la soupe.
Non seulement on peut se passer du mot « économie » (au sens de the economy)
mais on doit se passer des économistes, ces mangeurs de soupe. Article
un peu confus et répétitif (la première moitié seulement, la seconde est
splendide) et très long mais aussi très intéressant. Prenez la peine de le
lire. Il faut souffrir un peu pour l’amour de la science. Si vous voulez
éviter toute peine, lisez directement le chapitre « La science des
mondes imaginaires contre la science des mondes réels ». Il les allume tous, ces
salauds. C’est un régal.
Jevons et Walras sont deux TDC. La « science » économique est une grosse merde qui sort par les TDC comme il se doit. La soupe ressort par l’autre bout du triste sac. Conclusion : l’économie (the economy) est un monde imaginaire (un paradis sans vierges, mais seulement des putes, males ou femelles) qui n’occupe aucune place dans le monde sinon dans le bla bla des économistes. L’économie n’est pas. Elle n’existe que dans le bla bla des économistes. Yéfimov dit que les économistes voient les institutions comme un arrière plan de l’économie alors qu’il faudrait dire au contraire que les institutions sont au premier plan. C’est très bien mais c’est insuffisant : au premier plan de quoi puisque l’économie n’est pas ? Les institutions sont tout ce qui existe, le premier plan comme le dernier. D’économie point. Aux chiottes la prétendue réalité économique, aux chiottes. Qu’attendez-vous ? Heil Schmoller ! |
|
|
Comme je tenterai de le
montrer dans le chapitre suivant, la réalité économique est une réalité
fondamentalement institutionnelle : elle repose sur
l’institution de la valeur ♦,
convention qui peut être posée de manière tacite ou bien délibérée. La
réalité communicationnelle, de son côté, est purement naturelle (untel
parle à untel, untel se montre à untel). Si l’argent n’était par lui-même qu’un
phénomène manatique, il serait impossible d’expliquer pourquoi donner tel
petit bout de papier (description naturelle), c’est acheter quelque chose
avec un billet de 500 francs (description institutionnelle, économique).
Par conséquent, le phénomène communicationnel de prestige qui est selon vous censé se trouver à la place de la réalité économique me semble au contraire reposer pour une bonne part sur des phénomènes économiques ♦ : c’est parce que ce petit bout de papier est un billet de 500 francs, autrement dit qu’il est une « grande » richesse (i.e., valeur économique) que je puis en mettre plein la vue de ma boulangère en payant une simple baguette avec. (Une certaine obsession pour cette forme particulière de prestige signale sans doute la société occidentale moderne.)
Je suis pour ma part persuadé, à la suite d’Aristote et de Marx, que la pratique de l’échange marchand répond à la nécessité pour l’homme de pourvoir à ses besoins ♦. Les hommes échangent parce qu’ils ne sauraient survivre isolés ♦♦. C’est dans cette nécessité que réside la cause finale de l’institution de la valeur : aucun échange n’est pensable sans valeur attribuée aux biens échangés. Mais pour pouvoir échanger, les hommes doivent fixer une certaine valeur aux objets, y attacher un certain prix. Les
hommes, donc, doivent
s’associer ♦ pour pourvoir
à leurs besoins. Ceci n’exclut toutefois pas, ensuite, la naissance progressive
d’échanges de biens destinés à la satisfaction de besoins non vitaux (et
ainsi le développement d’un certain luxe) au sein d’une société : je
ne crois pas que Marx ait jamais prétendu que l’homme échange dans le
seul but de subvenir à ses besoins organiques, mais uniquement qu’il commence à
échanger pour subvenir à ses besoins ♦♦*.
|
Monnaie, séparation marchande et rapport salarial
André Orléan – version du 04/02/06 Article
pour l’ouvrage collectif « Où en est la régulation ? » (…) 1. Considérations générales à propos du rapport monétaire Avec Michel Aglietta, dans
différents livres12, nous nous sommes appliqués à démontrer
que pour penser l’économie marchande, il faut partir de la monnaie, parce que
la question monétaire est la question théorique essentielle, celle qui
conditionne toutes les autres. C’est dans cet esprit que nous avons
écrit : « L’analyse que ce livre cherche à développer part de l’hypothèse qu’il n’est d’économie marchande que monétaire. Nous voulons dire par là que tout rapport marchand, même dans sa forme la plus élémentaire, suppose l’existence préalable de monnaie. Ou bien encore, d’une manière plus concise et directe, le rapport marchand est toujours un rapport monétaire. C’est ce que nous appellerons dorénavant “l’hypothèse monétaire” » (La monnaie entre violence et confiance, 2002, p. 35). C’est là une hypothèse dont il est difficile d’exagérer l’audace
dans la mesure où toutes
les approches concurrentes, orthodoxes comme hétérodoxes, y compris
marxistes, ont en commun de procéder à l’inverse pour penser la monnaie à
partir de la marchandise. Cette dernière manière de penser est même
si ancrée dans nos habitudes conceptuelles qu’il nous a semblé utile, avant
d’entrer dans la rigueur de l’analyse formelle, de proposer au lecteur,
dans le cadre de la présente section, quelques remarques qui lui
permettront de donner un contenu intuitif à cette hypothèse énigmatique,
mais pour nous centrale, de « primauté de la monnaie ». Du côté des producteurs, il s’agit simplement de rappeler que la
production des marchandises est toujours une production orientée vers la
valeur abstraite, une production dont le but est l’appropriation de cette
valeur et rien d’autre. Sans
cette idée de valeur abstraite présente ex ante dans l’esprit des
producteurs, il n’y aurait simplement pas d’offre de marchandises.
Ou, pour le dire autrement, le concept d’une production de masse dans une
économie structurée par le troc est une contradiction dans les termes ♦.
Elle dénoterait de la part des producteurs une profonde incompréhension du
monde réel qui les entoure, pour ne pas dire une totale
irrationalité : en effet quel sens y aurait-il à produire ce qui ne
peut être écoulé ? Du côté des consommateurs, il s’agit de souligner à
quel point l’accès à la valeur abstraite s’impose comme la plus urgente des
nécessités, celle qui prime toutes les autres parce qu’il y va de
l’existence même des acteurs. On ne saurait en trouver meilleur exemple que
les situations de crise durant lesquelles, pour une raison ou une autre,
comme dans le cas du « coralito » argentin en décembre
2001, les sujets économiques se trouvent privés de leurs moyens de paiement
habituels. La réaction à une telle situation est immédiate et violente :
on assiste à une ruée vers les substituts monétaires, à savoir des signes
acceptés par le plus grand nombre, parce qu’il n’est pas d’autres moyens
dans une économie marchande pour survivre. L’urgence du besoin monétaire se
donne ici à voir sous sa forme la plus extrême. Il se peut, dans certaines
configurations, que ces substituts soient eux-mêmes des marchandises, mais
c’est toujours en tant qu’elles font l’objet d’une acceptation généralisée
qu’elles sont désirées, et non en tant que valeurs d’usage spécifiques. ♦ La question du troc est une question
difficile qui demanderait d’importants développements. Soulignons
simplement qu’entre le troc théorique et les phénomènes observés de troc,
il peut exister des différences majeures. Pour le comprendre, on peut se
reporter à l’analyse que Pépita Ould-Ahmed (2006) a consacrée au troc en
Russie. Elle y montre que ce troc s’organise dans un cadre monétaire. Elle
écrit, par exemple : « L’utilisation même de marchandises comme
moyen d’acquittement des dettes n’est possible que parce que le rouble est
l’unité de compte socialement reconnue en laquelle s’expriment ces
marchandises ». On est loin d’un troc bilatéral strict faisant
l’impasse sur la monnaie. Ce qui affleure dans ces deux situations est la thèse selon laquelle,
dans une économie où la production se trouve distribuée dans les mains
anonymes d’une infinité de producteurs-échangistes souverains, la relation
de chacun au groupe dans son entier se construit par la médiation de la
valeur abstraite. Bien évidemment, cette thèse n’est nullement étrangère à
la pensée de Marx. Cependant, ce qui, à mes yeux, pose problème chez cet
auteur est sa manière de penser cette valeur abstraite. Il la voit comme
une « substance commune » aux marchandises, déjà objectivée, en l’occurrence
le travail socialement nécessaire pour les produire. Cette stratégie théorique
qui pense l’échange marchand comme résultant d’un principe de
commensurabilité définissable antérieurement à l’échange n’est pas
propre à Marx. Elle est commune à de nombreux courants économiques.
C’est ce qu’on appelle une « théorie de la valeur ♦. »
Si ces théories peuvent différer dans la manière dont chacune pense la
valeur ♦♦, il est dans leur logique propre de
construire un cadre théorique au sein duquel la monnaie ne joue qu’un rôle
parfaitement accessoire. En effet, la seule mobilisation du principe de
valeur ne suffit-elle pas à fournir une réponse aux deux questions
essentielles que pose l’échange marchand ? À la question
« Pourquoi les biens s’échangent-ils ? », cette théorie
répond : « Parce qu’ils contiennent de la valeur » tandis
qu’à la question : « Selon quel rapport les biens
s’échangent-ils ? », elle répond « Selon le rapport de leurs
valeurs ». En conséquence, la monnaie ne s’y introduit qu’après coup,
c’est-à-dire après que toutes les questions essentielles ont trouvé leur
réponse. On ne saurait mieux dire son inutilité conceptuelle. Ni
l’échangeabilité en elle-même, ni la détermination des rapports
quantitatifs à travers lesquels celle-ci se manifeste ne dépend d’elle. Au
mieux, dans ces approches, la monnaie n’a qu’une utilité
instrumentale : rendre plus aisées des transactions dont la logique
lui échappe totalement puisqu’elle relève entièrement du principe de
valeur. Dans la section de son Histoire de l’analyse économique qu’il
consacre à « La valeur », Schumpeter est conduit à la même
conclusion : « Cela implique que la monnaie est en fait un simple moyen technique qui peut être négligé chaque fois que les problèmes fondamentaux sont en cause, ou que la monnaie est un voile qui doit être enlevé pour découvrir les traits dissimulés derrière elle [on dirait du Say qui disait en substance que, finalement, les produits s’échangeaient avec des produits ; deux siècles, donc, de stupidité, de mangeurs de soupe ; le crétin Bastiat : « Je montrerai comment tout se réduit à un troc de services. »]. Ou, en d’autres termes encore, cela implique qu’il n’y a pas de différence théorique essentielle entre une économie de troc et une économie monétaire » (Schumpeter, Histoire de l’analyse économique, Gallimard, tome II, p. 288). ♦ Une théorie de la valeur bien construite se manifeste par un système d’équations qui détermine les rapports d’échange de tous les biens sans faire intervenir la monnaie. Le système sraffaien nous en fournit une illustration exemplaire. L’équilibre général à la Arrow-Debreu en est une autre expression. Marx lui-même, dans Le Capital, n’utilise pas d’expression algébrique mais les schémas de reproduction du livre II sont de ce type. On trouvera un tel système d’équations déterminant les valeurs des marchandises dans un cadre marxiste chez Michel Aglietta (Régulation et crises du capitalisme, 1997) aux pages 57-58. ♦♦ Pour certains, comme Marx et Ricardo, la valeur a pour fondement le travail ; pour d’autres, comme les modernes, l’utilité. La stratégie alternative que nous allons proposer trouve son
fondement dans l’idée que l’objectivation de la valeur abstraite ne
préexiste pas aux échanges marchands mais qu’elle en est l’enjeu le plus
fondamental. Autrement dit, s’il faut, en effet, considérer la quête de la
valeur abstraite comme ce qui caractérise les relations marchandes, comme
ce qui motive au plus profond les sujets économiques parce qu’il y va de leur
existence même, pour autant il est erroné de supposer que cette valeur
abstraite se présente aux acteurs sous une forme déjà objectivée, à la
manière d’une substance naturelle. Il faut tout au contraire penser qu’un
des enjeux les plus essentiels de la lutte marchande pour l’appropriation
de la valeur abstraite consiste précisément en la détermination de la forme
socialement légitime que celle-ci doit revêtir, ce qu’on appellera
« monnaie ». Dans cette perspective, la situation marchande « originelle »
est dominée par les conflits entre projets monétaires concurrents. On est ici aux antipodes des
situations « originelles » de troc considérées par les théories
de la valeur. C’est l’acceptation unanime d’une même représentation
monétaire de la valeur abstraite qui, dans notre cadre théorique, constitue
la condition de possibilité de l’économie marchande.
(…) CONCLUSION Dans notre perspective, la monnaie est l’institution économique
primordiale, condition d’existence et de développement des rapports marchands.
C’est par elle que se définit l’espace économique. Ou dit encore autrement,
c’est la vénération
collective de la monnaie perçue comme la forme socialement reconnue et
légitimée de la richesse qui est l’acte premier de la société marchande.
Il s’agit, en conséquence, de penser le lien monétaire comme étant le lien
essentiel, celui à partir duquel les échanges marchands peuvent se
développer. Pour autant, cette idée d’essentialité du fait monétaire ne doit
pas prêter à malentendu. Il ne s’agit nullement de défendre la thèse selon
laquelle les déterminations monétaires auraient une quelconque supériorité,
par exemple, sur les déterminations politiques ou salariales. Pourtant
Jacques Sapir (Les trous noirs de l’économie, 2000) va même jusqu’à
nous prêter l’idée que la monnaie serait « le pivot unique des
économies et des sociétés modernes » (p. 195). Nous espérons que
l’analyse des relations entre monnaie et État comme celle des relations
entre monnaie et salariat auront complètement dissipé cette incompréhension.
En effet, tout au long de ces analyses, il est apparu avec force que chaque
ordre de phénomènes, monétaire, politique ou capitaliste, était considéré
comme possédant sa propre logique et devant composer avec les autres sans
qu’a priori l’un soit supposé l’emporter sur les autres. C’est ainsi que nous avons
insisté sur le fait que le capitalisme ne pouvait en rien être pensé comme
une extension de l’ordre monétaire. L’idée de captation va même plus
loin puisque, sur fond d’autonomie des logiques politique et monétaire,
elle accorde au politique une certaine capacité à contrôler le monétaire.
En résumé, notre conception de l’architecture institutionnelle du
capitalisme ne s’écarte pas radicalement de celle proposée par la théorie
de la régulation, à savoir l’articulation de cinq formes institutionnelles
fondamentales. Pour bien comprendre l’idée d’essentialisme, il convient de
la resituer dans son vrai contexte, à savoir l’analyse des économies
marchandes et l’opposition
aux théories de la valeur. Elle se résume alors à la thèse selon
laquelle, dans l’ordre marchand, la monnaie est première. Cette proposition peut
sembler évidente, mais il faut rappeler à quel point elle ne l’est pas, à
quel point elle s’oppose à tout ce qui est dit sur la monnaie par presque
toutes les autres théories, depuis Marx lui-même jusqu’à l’économie
orthodoxe contemporaine.
Tout notre effort théorique a précisément tenu en cela de construire une
théorie de l’économie marchande qui place en son centre le rapport
monétaire. A contrario, les autres économistes partent toujours du
rapport aux marchandises pour ne penser la monnaie que dans un second
temps, par exemple, comme une technique de transaction plus efficace que le
troc. Pour désigner cette dernière perspective d’analyse, celle qui voit
dans la monnaie un instrument permettant de faciliter les échanges, je
parlerai d’une approche instrumentale de la monnaie. Dans cette perspective
instrumentale, ultra-majoritaire en économie, la monnaie est seconde et
inessentielle puisqu’elle n’est pas nécessaire à ce qu’existe une économie
marchande qui peut parfaitement fonctionner grâce uniquement au troc,
même si c’est de manière moins efficace. La monnaie permet simplement à
l’économie marchande d’être plus efficace. Cette inessentialité de la
monnaie ne trouve pas de meilleure illustration que l’idée même de neutralité monétaire qui
signifie que les rapports d’échange dans une économie monétaire sont les
mêmes que ceux qui prévaudraient dans une économie de troc. Patinkin
écrit : « Au sens strict, la neutralité de la monnaie n’existe
que si la transformation pure et simple d’une économie de troc en une
économie monétaire n’affecte pas les prix relatifs et l’intérêt
d’équilibre » (p. 96). On ne saurait mieux dire que la monnaie ne compte pas. (…) |
Un texte remarquable d’André
Orléan →
Orléan
conchie les économistes
|
L’APPROCHE
INSTITUTIONNALISTE DE LA MONNAIE : André Orléan Version du 3 avril 2007
« La monnaie est un rapport social » [Marx l’avait dit : « L’argent est un rapport social »] : telle est, résumée sous sa forme la plus succincte et la plus schématique, l’idée directrice qui commande à toute la réflexion institutionnaliste dans le domaine monétaire. Par cette proposition quelque peu énigmatique, il faut simplement entendre que la monnaie n’est pas une marchandise ou un instrument facilitant les échanges, mais le lien institutionnel qui met en relation les producteurs les uns avec les autres et qui, par ce fait même, rend les échanges possibles. Au regard de cette perspective d’analyse, la monnaie constitue le rapport premier, au fondement de l’ordre marchand. On ne peut qu’insister sur l’originalité de cette thèse institutionnaliste si contraire aux traditions les mieux ancrées de l’économie standard. En effet, celles-ci procèdent de manière toute différente puisque leur point de départ théorique n’est pas la monnaie mais le principe de Valeur ♦. Si ce principe peut connaître des définitions concurrentes (utilité, temps de travail socialement nécessaire, travail commandé, travail incorporé et d’autres encore), il s’agit, dans tous les cas, d’aller au-delà des apparences monétaires et des prix nominaux, pour penser les liens objectifs qui lient entre elles les activités marchandes de production et de consommation, à partir de quoi sont déduites les Valeurs intrinsèques de toutes les marchandises. Or, une telle approche ne peut que reléguer la monnaie à un rôle accessoire. En effet, par construction, toutes les questions essentielles lui échappent : ni l’échangeabilité en elle-même, ni la détermination des rapports quantitatifs à travers lesquels celle-ci se manifeste ne sont plus de sa compétence [il n’y a pas du tout de rapport quantitatif (de quotient, de mesure) entre les quantités échangées, le seul rapport entre les quantité échangées, c’est l’échange. Il n’empêche que ces quantités sont déterminées (elle le seraient si elles étaient tirées au sort) et que se pose la question de leur détermination. Attention à la w-grammaire]. Dans un tel cadre, il ne reste plus à la monnaie qu’un rôle parfaitement secondaire : rendre plus aisées [tout l’utilitarisme sordide des économistes, (la soupe, la soupe) est exprimé dans ce « plus aisé »] des transactions dont la logique lui échappe totalement parce qu’elle relève tout entière du principe de Valeur. En un mot être l’instrument des échanges. Pour désigner une telle conception de la monnaie, nous parlerons d’une approche instrumentale de la monnaie. C’est en grande partie une telle approche qui domine aujourd’hui l’économie néoclassique [cette grosse salope]. Mais la même vision instrumentale se retrouve dans toutes les démarches qui fondent leur compréhension de l’économie sur le concept de valeur. Il faut choisir entre une approche par la monnaie ou une approche par la Valeur. Marx nous en fournit une nouvelle illustration. ♦ Notons que le terme « valeur » est ambigu puisqu’il renvoie à deux réalités distinctes : la valeur théorique telle qu’elle est mise en avant par les théoriciens de la valeur et la valeur, au sens usuel, par exemple lorsqu’on dit que les marchandises ont de la valeur. Pour les distinguer nous écrirons « Valeur » pour la première et « valeur » pour la seconde. Considérons le chapitre premier du Capital au moment où Marx commente Aristote s’interrogeant sur le sens de l’égalité « 5 lits = 1 maison » (59). Aristote note à propos de cette situation : « l’échange ne peut avoir lieu sans l’égalité, ni l’égalité sans la commensurabilité ». Dans son commentaire, Marx souligne le « génie » d’Aristote parce qu’il a su comprendre que l’échange monétaire reposait sur un rapport d’égalité. Cependant, confronté au défi de rendre intelligible cette égalité, Aristote hésite car, à ses yeux, « il est impossible en vérité que des choses si dissemblables soient commensurables entre elles ». Il finit par conclure que : « l’affirmation de l’égalité ne peut être que contraire à la nature des choses ; on y a seulement recours pour le besoin pratique ». Autrement dit, l’égalité marchande serait d’une nature purement conventionnelle. Tel n’est pas le point de vue de Marx. Selon ce dernier, si Aristote se montre incapable de percer le mystère de l’égalité des marchandises, c’est parce qu’il vit en un temps où les rapports esclavagistes masquent l’égalité des forces de travail humaines. En effet, pour Marx, il y a bien quelque chose que ces deux marchandises ont en commun, une substance qui fonde leur commensurabilité, à savoir le travail humain : l’échange se fait au prorata du « temps de travail socialement nécessaire » à leur production. Telle est la conception marxienne de la Valeur. Elle est ce qui détermine les rapports d’échange, antérieurement à toute présence monétaire. À partir de quoi, la monnaie est pensée comme la marchandise élue pour devenir « l’équivalent général » grâce auquel la Valeur trouve sa forme universelle. Notre propre conception s’oppose à Marx et à
l’hypothèse de Valeur pour suivre la piste ouverte par Aristote [encore lui !]. À nos
yeux, il n’y a nulle substance derrière l’échange des biens mais seulement
la monnaie et le désir illimité et unanime dont elle fait l’objet. Aussi,
loin qu’il faille lire les égalités « 1 maison = 10
♦ Marx
écrit : « Nous
connaissons maintenant la substance de la valeur : c’est le travail.
Nous connaissons maintenant la mesure de sa quantité : c’est la durée
du travail » (Le Capital, Livre I, sections I à IV,
Paris, Flammarion, coll. « Champs », 1985, p. 45). ♦♦ Soulignons que notre approche critique l’approche de la Valeur pour ce qui est de sa compréhension de la commensurabilité des marchandises mais que notre approche monétaire ne dit rien sur la détermination des prix qui reste à être explicitée alors que la théorie de la Valeur proposait également une explicitation de cet aspect. Autrement dit, l’approche institutionnaliste pose la dépendance universelle de tous les acteurs marchands à l’égard de la monnaie comme le fait théoriquement essentiel, celui qui demande à être compris. C’est l’adhésion de tous à la monnaie en tant que forme « socialement reconnue et légitimée de la richesse » (Aglietta et Orléan, La monnaie entre violence et confiance) qui confère son statut à la monnaie. C’est à partir de là que l’on peut expliciter toutes ses propriétés. Il s’ensuit une démarche très différente de celle usuellement suivie par la théorie économique : notre conception a pour signe distinctif de chercher à saisir la réalité de la monnaie, non pas dans la classique énumération de ses fonctions, comme il est fait traditionnellement, mais dans sa capacité à recueillir l’assentiment généralisé du groupe social et à l’exprimer de manière objectivée. L’accent mis sur cette capacité de la monnaie à faire unanimité et, ce faisant, à construire la communauté marchande en lui procurant son unité et son identité, se révèle avec force dans des formules comme « la monnaie, expression [à mon humble avis, il serait préférable de dire « manifestation »] de la société comme totalité » (Aglietta et alii, La monnaie souveraine) ou encore « la monnaie, opérateur de totalisation » (Orléan, La monnaie entre violence et confiance). Autrement dit, la monnaie est, dans l’ordre marchand, ce par quoi la société est rendue présente et s’impose à tous les individus sous la forme objectivée du tiers médiateur [je vous l’avais bien dit : c’est une eucharistie. Du temps qu’il existait, Dieu n’était autre que le tiers médiateur. Marx a dit : « L’Argent est la vraie communauté »]. (…) |
L’apparition
n’est pas un phénomène
Certes, il est faux que les corps rouges plongés dans le noir n’aient plus la propriété de réfléchir telle portion du spectre du visible et d’absorber le reste ; mais il est faux de dire que les corps rouges sont rouges dans le noir car dans le noir les corps rouges ne peuvent pas réfléchir une partie du spectre du visible puisqu’il n’y a plus du tout de spectre dans le noir (Johnny ne chantait-il pas : ♫ Noir c’est noir ?) Ils ont la propriété de provoquer du rouge quand on les regarde, mais ils n’ont pas le loisir de l’exercer dans le noir ou en plein jour quand on ne les regarde pas. D’ailleurs Pierce dit très bien qu’une qualité est une possibilité et, dans le noir, les corps rouges conservent la possibilité d’absorber et de réfléchir même s’il n’y a rien à absorber et à réfléchir. Mais là n’est pas vraiment le problème. Le problème est que le rouge consiste dans son apparition. Pas d’apparition, pas de rouge. Le rayonnement réfléchi ou absorbé est bien là, mais le rouge n’y est pas s’il n’y a pas apparition. Le rouge n’est pas un rayonnement et aucun rayonnement n’est rouge. Le rouge est une couleur et non pas un rayonnement. Simplement, quand paraît le rouge, on peut toujours lui associer un certain spectre. Il y a parallélisme. Heil Lebniz ! Ceux qui demandent si un arbre fait du bruit en tombant s’il n’y a personne pour l’entendre, ou qui demandent si un objet rouge est rouge s’il n’y a personne pour le voir, ne comprennent pas ce qu’il disent. En vérité ils disent : y a-t-il audition quand il n’y a pas audition ou y a-t-il apparition quand il n’y a pas apparition ou plus généralement y a-t-il manifestation quand il n’y a pas manifestation. Quand il n’y a pas audition, il n’y a pas de bruit ou de son, tandis qu’il y a dans tous les cas où l’on peut entendre du bruit, une onde de matière. Meuh. Le chat de la voisine est dichromique, le pigeon est pentachromique, l’homme est trichromique et parfois, à cause de certaines malformations, mono ou bichromique. La répartition et la densité des cônes sur la rétine est variable d’un individu à un autre (Wikipédia). Il n’est pas certain que chacun voie le même rouge que son voisin mais le rayonnement associé, lui, est toujours le même, pour tous, et le corps absorbant-réfléchissant aussi. Un très simple test permet de prouver qu’un daltonien et un non daltonien ne voient pas de la même manière le vert et le rouge : le daltonien ne distingue pas le vert et le rouge. Ceci est la preuve que le rouge et le vert dépendent de ceux qui le voient tandis que le spectre électromagnétique n’en dépend pas. Une machine, jamais, n’abolira l’apparence. |
|
n Lecture de David
Lewis : Convention Lappar jition David Lewis : Convention, « Introduction » en français, enfin → Le tournant cognitif
en économie André
Orléan, Revue d’économie politique, 2002, n°112 → « Par delà la notion de rationalité » Patrick Mardellat, Revue d’économie politique, 2006, n°50 → → David Lewis et la
rationalité des conventions Batifoulier, Merchiers, Urrutiaguer. Version imprimable (9 pages .PDF
corps 12), Revue de philosophie économique, 2002, n°6,
pp. 37-56, Vuibert.
→ Langages et langage David Lewis, traduction Zeitlin Edith et Quéré Louis. « Langages et langage ». In : Réseaux, 1993, volume 11 n°62. pp. 9-18. (Version imprimable)
♣ Notes
de traduction. Familiarité : afin de distinguer acquaintance
(connaissance, les amis et connaissances) de knowledge (connaissance,
savoir). Le plus simple et le plus près du texte serait de traduire par accointance,
familiarité et fréquentation (Littré). Les italiques en gras
sont des traducteurs. ♣♣ [for the sake of
coordination] : pour la coordination elle-même ; pour le
plaisir de la coordination ; par attrait pour la
coordination. Attrait est bien car la coordination est devenue… un
attracteur (en fait une contrainte, une coerciction). Par préférence
est bien aussi car on trouve la même raison dans le paragraphe qui
suit : « satisfaire ses propres préférences » parmi lesquelles
figure, supposons-nous, la préférence pour la coordination. ♣♣♣ Conformation : nous traduisons conformity par un néologisme. Conformité signifie aussi bien « qualité de ce qui est
conforme » que « soumission » (à Dieu notamment), mais le
second sens est vieilli et peu usité en français. Pour éviter toute
équivoque, nous employons donc conformation au sens de action de se conformer et non pas au
sens courant : structure
de ce qui est. Le contexte donne le
sens de cet emploi néologique. Nous aurions aussi pu créer le néologisme
horrible de « conformatisation ». ♦ Commentaire : la coordination est comme
le cadavre qui envahit tout, dans la pièce de Ionesco (Amédée) : la
coordination finit par prendre toute la place. Il n’y a, à la fin, plus
aucune place pour une autre solution. La coordination est devenue
coercition. Il y a un saut qualitatif. Ce qui n’est pas attendu est
interdit. L’attente, devenue palpable, exerce une pression d’interdiction
sur chacun. ♦♦ et
interdit toute action qui n’est pas attendue : il y a coercition. Voilà
qui fait pièce à la prétendue servitude volontaire. « Soyez résolus à ne
plus servir, et vous voilà libre. » dit La Boëtie (§ 15). Cette
formule vaudrait s’il n’y manquait un seul mot mais essentiel :
l’adverbe ensemble. « Soyez résolus ensemble à ne plus
servir, et vous voilà libre. » Mesrine résolut, seul, de ne plus servir
et il mourut libre. Dans la conformation telle que décrite par Lewis, ce sont
des hommes séparés qui se conforment et leur conformation ne se contente pas
de conserver leur séparation, elle interdit à quiconque (à chacun d’eux,
donc) de ne pas ce conformer. La séparation est donc renforcée, verrouillée.
La puissance des multitudes ne s’exerce qu’au détriment des multitudineux.
C’est la multitude qui écrase le multitudineux. Leur nombre écrase les
multitudineux tandis que le nombre des hoplites (10.000 à 14.000) terrifie
leurs ennemis (60.000 à 100.000) car les hoplites possèdent leur nombre.
Certes, ils se conforment, mais librement : ils élisent leur officiers,
ils votent avant chaque combat. Ce n’est pas le tyran qui écrase la
multitude, c’est la multitude qui écrase les multitudineux. Le tyran ne fait
que jouir de la multitude (ce qu’
expose très bien la Boëtie d’ailleurs. À part ça, quel style, quelle langue
splendide. On parlait ainsi il y a quatre cents ans. Précision, vitesse,
clarté. Quelle classe !) Quand la liberté est perdue, elle tombe au fond
d’un puits très profond et c’est tout une histoire pour la tirer de là. Sa
restauration demande des efforts surhumains tandis que sa perte n’en a
demandé aucun. Keynes parlerait de trappe à liberté : c’est plus
facile d’y tomber que d’en sortir. ♦♦♦ Qu’est ce que le Common Knowledge ? c’est : chacun sait que
chacun sait que 2, autrement dit : chacun sait que chacun sait que
chacun s’attend à ce que chacun se conforme. Il y a connaissance universelle
(chacun sait que chacun sait) de l’universalité de l’attente (chacun s’attend
à ce chacun se conforme). On peut aussi bien écrire : tous savent que
tous savent que tous s’attendent à ce que tous se conforment. |
n Lecture de
Bolzano
[zBolzano]
● Une erreur de Sebestik
Dans Logique
et mathématique chez Bernard Bolzano, p. 308, je lis :
Un tas de pièces de monnaie ne forme pas un ensemble mais… un tas. Un tas de quoi que ce soit est « soumis » aux lois de la physique, un ensemble non. En tant qu’ancien chef de chantier, je sais très bien faire la distinction entre un tas et un ensemble. Si Bolzano est parti des systèmes, des tas (un tas est un système), il est parti par le mauvais bout. C’est pourquoi il n’a pas abouti. Il n’existe pas de système avec zéro pièces. Il existe un ensemble avec zéro élément. L’exemple de la montre est judicieux. Une montre est un système et ses composants sont des pièces ou des sous-systèmes de pièces. Si nous considérons le monde comme une montre, je dis que l’économie, la production, la distribution, la consommation ne sont pas des pièces ou des sous-systèmes de cette montre, mais seulement des classes de faits, des classements. L’économie n’économise rien, la production ne produit rien, la distribution ne distribue rien, la consommation ne consomme rien. Il s’agit là de ces grandes idées générales qui ne demandent aucun effort et dont Tocqueville, fine mouche, disait que les peuples démocrachiques se gargarisent. Je lis souvent des gens qui vont jusqu’à concéder que, non, l’économie n’est pas un système indépendant, de même que les pièces de la montre ne sont pas indépendantes. C’est une roublardise : l’économie n’est aucun système, indépendant ou non. La question n’est pas celle de l’indépendance ou de la non indépendance de l’économie, mais la question de son existence réelle (chosique). Meuh ! Cela fait deux siècles de bla bla sur l’économie ceci, l’économie cela, etc. Mais aucun de ces horlogers bla-blateurs n’a été capable ne serait-ce que d’esquisser une description de ce système ou d’en énoncer les lois. Leur prétendu système est un système avec zéro pièces, un système vide, c’est à dire « une notable quantité d’importance nulle ». Le mot économie ne sert qu’à dissimuler leur ignorance. Je suis aussi ignorant qu’eux et que quiconque du système réel, du système qui a lieu ; mais, moi, je le sais. Il est certain que des systèmes ont lieu, encore faut-il être capable de les décrire. Le système de Ptolémée était faux, mais il avait au moins le mérite d’être parfaitement décrit et de ce fait… parfaitement réfutable. D’ailleurs il fut réfuté. ● Pourquoi l’arbre perçu ne peut pas brûler ? Parce que le
prétendu arbre perçu n’est pas une espèce d’arbre mais une espèce de
perception et que les perceptions ne brûlent pas. « Perçu » n’est pas un attribut
déterminant de l’arbre mais un attribut modificatif de la perception (Bolzano). Quant à l’arbre qui brûle, il
ne s’agit pas d’une espèce de perception mais d’une espèce d’arbres :
les arbres qui brûlent. Ainsi « brûlant » n’est pas un attribut
déterminant de la perception mais un attribut modificatif des arbres. Si l’on
tient le participe « perçu » (ou « vu ») pour une qualité
de l’arbre, cela conduit au paradoxe suivant : l’arbre est perçu quand
il n’est pas perçu. Ou bien on soutient que « perçu » n’est pas une
qualité de l’arbre. Dans ce cas l’arbre n’est pas perçu quand il est perçu. Notez que les perceptions ont
lieu dans le monde. L’arbre est perçu dans le monde, à sa place et
comme il est. J’aime assez la détermination négative de
« l’intérieur » par Bolzano. Qu’est-ce que « être
dehors » ? C’est être dans l’espace. Donc, qu’est-ce qu’être à
l’intérieur ? C’est être hors de l’espace (et non pas à l’intérieur du
corps, que ce soit dans le cerveau ou le trou du cul). Donc à l’intérieur il
n’y de place pour rien du tout et c’est pour cela que les arbres paraissent
où ils sont. Je suppose que ce sont ces considérations qui ont poussé Leibniz
à son étonnante expérience de pensée du moulin (Monadologie, § 17) et à conclure que les perceptions avaient
lieu dans des points logiques, qui n’occupent aucun espace et sont sans porte
ni fenêtres : les monades ou substances simples. Husserl s’est pris les
pieds dans le tapis.
● La chimère qui n’est pas un homme et qui n’est pas un non-homme à la lumière de Bolzano. [zBolzano]
♦ désigne, dénote. Effectivement, si « non homme » était un nom, il devrait désigner un nombre colossal, peut être une infinité, d’objets — remarquez au passage la traîtrise de la grammaire de l’expression « désigner un nombre colossal d’objets » : ce sont chacun des objets que le nom est censé désigner et non pas leur nombre colossal. Pour déjouer cette traîtrise, Bolzano écrirait : « désigner des objets en nombre colossal ». Ce nombre d’ailleurs est le cardinal de l’ensemble des objets ; mais l’ensemble des objets ne consiste pas dans ces objets, il consiste dans son signe de classe — ; mais « non homme » n’est pas un nom (une fois de plus Aristote avait raison quoiqu’il ait tort aussi car « homme » non plus n’est pas un nom mais un signe de classe ; mais il fallut néanmoins attendre plus de deux mille ans pour atteindre la notion de signe de classe, un concept). Si l’on dit : la Chimère appartient à la classe des non hommes, tout va bien. Le mot « être » n’a pas le sens, ici, d’exister réellement ou non ; mais d’avoir ou de ne pas avoir telle qualité (propriété : on a une propriété, on n’est pas une propriété). Bolzano dirait : la Chimère n’a pas l’humanité. ce qui supprime les équivoques du terme « être » (Aristote était parfaitement au fait de cette distinction). La solution est que ce qu’Aristote prend pour des noms sont en fait des signes de classe (des concepts ou expressions conceptuelles). Une classe est l’extension d’un concept ou signe de classe. Qu’y a-t-il de choquant à ce qu’un concept ait une extension gigantesque, par exemple tout ce qui existe sauf les hommes. Ce n’est choquant que si l’on croit que les concepts « homme » et « non homme » sont des noms. Or Bolzano nous dit que le concept « homme » n’est pas une représentation mais une pure signification. Une représentation – par exemple le nom propre Socrate, sujet de la proposition : « Socrate est une homme » – a non seulement un sens (une signification ― Stuart Mills dit que non) mais une dénotation (une désignation). Bolzano nous dit que le concept « homme » est une pure signification, ce qui signifie qu’un concept (un signe de classe) n’a pas, contrairement à une représentation, aussi une désignation (une dénotation). Un concept (un signe de classe) est une pure signification parce qu’il n’a pas de dénotation, parce qu’il ne désigne rien ; tandis qu’une représentation (le nom propre Socrate) a non seulement une signification (un sens ― son sens est de représenter Socrate) mais aussi une désignation (une dénotation). La proposition « Socrate est un homme » est
une représentation, elle a un sens et une dénotation. Dans le cas présent
elle dénote le vrai (pour Frege, le vrai est un objet). Le nom propre
« Socrate », sujet de la proposition est aussi une représentation,
il a un sens et une dénotation. Le signe de classe « est un homme »
n’est pas une représentation mais une pure signification. Il ne dénote rien.
De cette manière on évite le déplaisant paradoxe suivant : Frege dit que
dans une proposition, tout ce qui n’est pas fonction (signe de classe) est
objet. La proposition est un objet, le nom propre est un objet ; mais
pas le signe de classe. Or Frege écrit, par exemple : « Considérons
le concept F ». « le concept F » est un nom propre qui dénote
un objet ! Le concept F serait donc lui aussi un objet. Eh bien soit.
Disons donc avec Bolzano : le
nom propre et la proposition sont des représentations, le
concept F est une pure signification. Ne distinguons pas objet et
concept, mais représentation et pure signification et le tour est joué. EN SOI C’est d’ailleurs parce que le concept ne désigne rien (qu’il est pure signification) qu’il nous évite d’avoir recours au triangle général de Locke, un triangle ni isocèle, ni équilatéral, ni scalène, ni droit, dont les côtés ne mesurent ni quelques dizaines de centimètres, ni quelques années lumières, authentique couteau sans lame auquel il manque le manche. Le concept « triangle » ne désigne rien. Le concept « triangle » est le triangle tout court. Jan Sebestik nous donne son interprétation du terme « en soi » chez Bolzano : « en soi » = « tout court » ♦. Le concept « triangle » est en soi parce qu’il est le concept du triangle « tout court », du triangle en soi, du triangle pur, du triangle purgé de toutes ses particularités, abstraction sublime : il a trois angles, point final. Le terme en soi, chez Bolzano, n’a donc rien à voir avec l’usage qu’en fait Kant. De même, le concept « vert » pris pour exemple par Bolzano dans ses Contributions est le vert en soi, ni Véronèse, ni caca d’oie, ni forestier, ni vert de gris, ni vert d’eau, etc.
La solution proposée par Occam est décevante : selon lui la Chimère ne peut pas être un homme parce qu’elle n’est rien (res nulla). Donc comment pourrait-elle être quelque chose. Si j’ai bien compris, selon lui, puisqu’il existe un chat, un chat peut donc être un non-homme. Or « un chat est un non homme » ne signifie pas que le chat est quelque chose, mais signifie que le chat est quelque chose qui n’a pas l’humanité, qui ne possède pas la qualité « humanité ». C’est ainsi que s’exprime le méticuleux (il a étudié les scolastiques) Bolzano. Il ne dit pas : « la chimère est un non-homme », il dit : « la chimère ne possède pas la qualité humanité », « la Chimère n’a pas l’humanité. Voilà la vraie solution. Heil Bolzano ! La grammaire du verbe être nous trompe et dissimule la logique. Aussi, pour éviter cela, Bolzano ne dit pas « Socrate est un homme », mais « Socrate a l’humanité ». ● Sens et dénotation (Frege) L’objet Allah a une seule dénotation mais
99 signes, 99 sens (pas nécessairement puisque un même sens peut
avoir plusieurs expressions), plus le signe présentement exposé ici même et
son sens, et bien d’autres encore, je suppose. Il se peut qu’un unique objet
ait une seule dénotation, mais une infinité de signes, de noms propres avec
chacun un sens différent, et, pour corser l’affaire, un même sens a parfois
plusieurs expressions. « L’étoile du soir » n’a pas le même sens
que « l’étoile du matin », ni le même que « la planète
Vénus ». Cependant la dénotation, l’objet, est le même. Enfin, « Il
n’est pas dit pour autant qu’une dénotation corresponde toujours au sens. Les
mots “le corps céleste le plus éloigné de la terre” ont un sens mais ont-il
une dénotation ? » Autrement dit : « l’univers »
(qui a un sens : tout ce qui existe) a-t-il une dénotation ?
● Dualité
La négation du « et » n’est pas « ou » mais le
« ou » des négations : NOT (A et B) =
NOT A ou NOT B. On dit que « et » est non pas
le contraire de « ou » ; mais le dual de
« ou » et réciproquement (De
la symétrie dans le calcul et dans les idées). C’est beau la logique. DOC 2012-10-14 [b-Lecomte] |
|
La théorie de l’Erscheinung
dans la Wissenschaftslehre n SUR LA DOCTRINE KANTIENNE DE LA CONSTRUCTION DES
CONCEPTS PAR LES INTUITIONS – [zBolzano]
Bolzano → Bolzano
critique de Kant, Jacques Laz, Vrin 1993. Le vendredi 8 août 2003 je commandai ce livre. Amazon me répondit qu’il
était indisponible. J’ai fait une nouvelle tentative, le livre est là. J’ai
perdu huit ans par négligence. Fendez-vous de deux cents balles et lisez ce
livre de toute urgence. C’est un long commentaire du texte publié ci-dessus. C’est un régal. Pendant la
guerre, la pensée continue. Je vais bientôt faire un commentaire de ce
commentaire. Ce n’est pas demain la veille que je pourrai lire Théorie de la
Science traduit en français (en effet puisque c’était hier : Gallimard,
novembre 2011).
Conclusion: l’en soi est le savoir collectif. Il n’est de savoir que collectif. [Réparé →]
|
Stratégie quantique par jph-immarigeon →
[Réparé] DOC 2011-03-05
|
|
« Nous pouvons poser des questions de ce type : est-ce la matière qui existe et la force qui est l’une de ses propriétés, ou inversement la matière est-elle un produit de la force ? Aucune des questions précédentes n’a cependant le moindre sens, car ces concepts ne sont que des images de pensée qui ont pour but de représenter correctement ce qui apparaît. » Boltzmann « Selon Helmoltz la matière et la force sont deux abstractions, à partir d’un processus naturel unifié qui ne distingue pas, de lui-même, entre les choses et leurs relations dynamiques. La matière n’est rien d’accessible sans les forces qu’elle exerce, et les forces rien d’indépendant de la matière qui est leur source » « Si une caractéristique des
phénomènes nous permet de raccorder de manière univoque deux points
successifs, et de les considérer comme s’ils relevaient d’une seule entité
persistante ayant parcouru une trajectoire continue entre eux, alors nous
disons qu’il y a là une particule matérielle. » [Bitbol
paraphrasant Hertz] * * * /17/ … L’idée se répand à la fin du dix-neuvième siècle que la force, comme la matière, est avant tout un instrument pour penser les phénomènes ; et que ce qui doit être jugé est la cohérence et la pertinence empirique du système des instruments de pensée des sciences, plutôt que l’existence réifiée de ce à quoi ces instruments semblent renvoyer. C’est déjà dans une certaine mesure le cas chez Helmholtz, pionnier dans la formulation des principes de conservation de l’énergie. Selon lui, la matière et la force sont deux abstractions, à partir d’un processus naturel unifié qui ne distingue pas, de lui-même, entre les choses et leurs relations dynamiques. La matière n’est rien d’accessible sans les forces qu’elle exerce, et les forces rien d’indépendant de la matière qui est leur source*. L’une comme les autres ne sont que des pôles artificiellement distingués, à des fins de notation symbolique, dans un formalisme permettant de maîtriser et d’anticiper les effets naturels. Le dualisme de la matière et des forces, des relata et des relations dynamiques, n’est que l’ombre portée d’une articulation duale de la pensée s’efforçant de produire une structure formelle apte à prédire les phénomènes du mouvement. ____________________________ * W. Helmholtz, Sur la conservation de la force, 1847, cité et traduit par B. Pourprix et J. Lubet, in L’Aube de la physique de l’énergie. Helmholtz rénovateur de la physique. Cette mutation historique de la force en abstraction conceptuelle, de la relation dynamique en projection d’un rapport de connaissance, se manifeste avec encore plus de vigueur et de lucidité chez Ludwig Boltzmann. « Nous pouvons, /18/ écrit-il, poser des questions de ce type : est-ce la matière qui existe et la force qui est l’une de ses propriétés, ou inversement la matière est-elle un produit de la force ? Aucune des questions précédentes n’a cependant le moindre sens, car ces concepts ne sont que des images de pensée qui ont pour but de représenter correctement ce qui apparaît*. » La dernière phrase de ce texte reste cependant ambivalente. Elle affirme que le schéma dual de la matière et des forces, des sources et des relations dynamiques, pourrait représenter correctement ce qui apparaît. Mais qu’entend-on exactement par là ? Y a-t-il une seule représentation correcte, ce qui semble lui assurer une forme de fidélité, ou bien plusieurs représentations acceptables, ce qui affaiblit la quête d’isomorphisme au profit d’une simple demande de guidage fiable des interventions expérimentales et technologiques ? ____________________________ *. A. Danto, S. Morgenbesser (éd.), Philosophy
of Science, Meridian
Books, 1960, p. 245. Heinrich Hertz a tiré les ultimes conséquences de ces analyses corrosives conjointes des concepts d’entités matérielles et de relations dynamiques, et de cette mise au premier plan corrélative des « images de pensée ». Suivons sa démarche dans les Principes de la mécanique, publiés à titre posthume en 1894. Cet ouvrage commence par enlever toute portée ontologique au concept de corps matériel en le reconduisant au procédé de son identification : « Une particule matérielle, écrit Hertz, est une caractéristique par laquelle nous associons sans ambiguïté un point donné de l’espace à un temps donné, avec un point donné à tout autre temps*. » Si une caractéristique des phénomènes nous permet de raccorder de manière univoque deux points successifs, et de les considérer comme s’ils relevaient d’une seule entité persistante ayant parcouru une trajectoire continue entre eux, alors nous disons qu’il y a là une particule matérielle. La chose matérielle devient le corrélat de l’acte consistant à la réidentifier, au lieu que la réidentification ne serve à mettre en évidence l’existence permanente de la chose matérielle. La chose matérielle est désinvestie de la prétention à l’existence propre qu’elle tenait de sa mise en œuvre prolongée dans l’appareil conceptuel de la mécanique. À partir de là, c’est en /19/ dehors de toute préoccupation ontologique que peut se déployer une réflexion sur les « images de pensée » utilisées par la physique. Comme l’écrit Hertz dans l’une des pages les plus célèbres de la philosophie des sciences : « Nous formons pour nous des images artificielles internes ou des symboles des objets externes, et la forme que nous leur donnons est telle que les relations logiques entre les images sont en retour une image des relations nomologiques entre les objets représentés**. » Ici, l’image se borne à représenter des relations légales entre les objets symbolisés, et rien d’inhérent à ces derniers. Car, poursuit Hertz, aucun moyen ne nous est donné de juger de l’adéquation empirique d’une image de quoi que ce soit d’autre que de ces relations. ____________________________ *.
H. Hertz, Principles of Mechanics, Dover Phoenix, 2003, p. 45. **. Ibid., p. l. Mais l’image scientifique ne se contente pas d’être restreinte à un réseau relationnel ; elle n’est même pas la représentation unique d’un tel réseau*. Hertz montre qu’une image alternative, se passant complètement du concept de force, et mettant en chantier un nouveau système de relations entre les seules variables de masses, de positions spatiales et de temps, est au moins aussi appropriée que l’image dynamique héritée de Newton. Ainsi, ce ne sont pas seulement les objets archétypaux, mais aussi leurs relations archétypales (les forces), qui se voient dénier tout poids ontologique. Différentes images de réseaux relationnels mécaniques, aussi bien celles qui incluent les forces que celles qui ne les incluent pas, peuvent être appropriées. Cette multiplicité et cette flexibilité des images scientifiques adéquates est encore amplifiée par le fait que, la plupart du temps, ces images ne mettent pas seulement en scène des relations directement rapportées aux phénomènes, mais aussi des relations formelles qui, de ce point de vue, apparaissent en surplus (elles ne se rapportent qu’indirectement aux phénomènes, à travers des règles d’inférence). ____________________________ *. « Différentes images des
mêmes objets sont possibles et ces images peuvent différer sous plusieurs
aspects » (H. Hertz, ibid.). Hertz
déduit de ces deux constats liés (celui de la sous-détermination de l’image
par l’expérience, et celui de la présence en elle de relations en surplus)
que le contenu de l’image est contraint par nos règles intellectuelles
d’élaboration des /20/ représentations, au moins autant que par
l’exigence de son adéquation empirique. Ainsi s’achève le processus amorcé
par Boltzmann
de désolidarisation entre les relations de l’image et les relations des
choses. Les relations de l’image sont avant tout nos relations ;
elles sont déterminées dans une large mesure par la syntaxe interne de nos
systèmes symboliques, au lieu de l’être par une contrainte sémantique
externe univoque. Les forces ne sont pas les relations de la nature, mais
l’un des outils conceptuels qui peuvent être utilisés afin de composer une
reconstruction relationnelle adéquate des phénomènes. |
Voilà qui explique pourquoi je souris quand je lis, à propos de Searle : « comment une réalité mentale, un monde de la conscience, de l’intentionnalité s’ajustent-ils à un monde entièrement constitué de particules dans des champs de forces ? » et ici : It’s pallelism stupid ! Le monde n’est pas constitué de particules et de champs de forces car : « Mais l’image scientifique ne se contente pas d’être restreinte à un réseau relationnel ; elle n’est même pas la représentation unique d’un tel réseau », alors pourquoi particules et champs seraient la seule représentation possible alors que le seul phénomène de la mécanique en possède au moins trois : Newton (matière et forces), Lagrange (espace de configuration) et Hamilton (espace des phases) ? Le terme « représentation » est particulièrement bien choisi : ce que Searle prend pour la constitution du monde n’est qu’une représentation.
|
Wittgenstein et Peirce par Claudine Tiercelin → Comment
se fixe la croyance (1878) par Charles S. Peirce →
n Comment
rendre nos idées claires (1878) par Charles S. Peirce →
|
n Le phénomène chez Charles S. Peirce
|
|
Théorie
des catégories : la phanéroscopie ♦
I. LE PHANERON (Collected Papers 1.284) La phanéroscopie est la
description du phaneron ;
par phaneron, j’entends la totalité collective de tout
ce qui, de quelque manière et en quelque sens que ce soit, est présent à
l’esprit, sans considérer aucunement si cela correspond à quelque chose de
réel ou non. Si vous demandez présent quand et à
l’esprit de qui, je réponds que je laisse ces questions
sans réponse, n’ayant jamais eu le moindre doute que ces traits du phaneron
que j’ai trouvés dans mon esprit soient présents de tout temps et à tous
les esprits. La science de la phanéroscopie telle que je l’ai développée
jusqu’ici s’occupe des éléments formels du phaneron. Je sais qu’il y a une autre
série d’éléments imparfaitement représentés par les catégories hégéliennes.
Mais je n’ai pu en rendre compte d’une façon satisfaisante. ♦ Ou
phénoménologie. C’est vers
1904 que Peirce substituera phanéroscopie
à phénoménologie.
Il n’en continuera pas moins à parler indistinctement du phaneron
et du phénomène. [NdT] (Conférences des Adirondack, 1905.) ____________________ (CP 1.285) Les philosophes anglais ont employé assez
communément le mot idée dans un sens proche de celui que je donne
à phaneron. Mais ils en ont de diverses manières trop restreint
la signification pour qu’elle se superpose à ma conception (si cela peut
s’appeler une conception), donnant en outre à leur mot une connotation
psychologique que je prends grand soin d’exclure. Le fait qu’ils ont l’habitude de dire qu’» il n’y a pas
d’idée » comme ceci ou cela, en même temps qu’ils décrivent avec
précision le phaneron en question, rend leur terme fatalement impropre à
mon dessein ♦. ♦ Il est en effet contradictoire de soutenir à la fois, comme le font les philosophes anglais, que l’idée, définie comme phaneron, est tout ce qui est, quel qu’il soit, et que « ceci ou cela » n’est pas une idée. [NdT] (CP 1.286) Il n’y a rien d’aussi directement observable que
les phanerons ; et puisque je n’aurai besoin de me référer qu’à ceux
(ou leurs semblables) qui sont parfaitement familiers à chacun, le lecteur
pourra contrôler l’exactitude de ce que je vais dire à leur sujet. En fait,
il devra répéter réellement pour lui-même mes observations et
expérimentations, sans quoi je ne parviendrai pas plus à me faire
comprendre que si j’avais à parler des effets de la décoration chromatique
à un aveugle de naissance. Ce que j’appelle phanéroscopie est
cette étude qui, s’appuyant sur
l’observation directe des phanerons et généralisant ses observations, distingue
plusieurs grandes classes de phanerons, décrit les caractéristiques de
chacune d’elles, montre que, bien qu’elles soient si inextricablement
mêlées qu’aucune d’elles n’est isolable, il est cependant manifeste que
leurs caractères sont tout à fait différents, puis prouve d’une manière
irréfutable que la totalité de ces grandes catégories de phanerons se
ramène à une très courte liste, et procède enfin à la tâche laborieuse et
difficile d’énumérer les principales subdivisions de ces catégories. (CP 1.287) Il apparaîtra clairement de ce qui a été dit que la
phanéroscopie ne se rapporte pas du tout à la question de savoir dans
quelle mesure les phanerons qu’elle étudie correspondent à des réalités.
Elle s’abstient religieusement de toute spéculation concernant les
relations que pourraient entretenir ses catégories avec les faits
physiologiques, cérébraux ou autres. Elle n’entreprend pas, mais évite au
contraire avec soin, de donner des explications hypothétiques de quelque
sorte que ce soit. Elle scrute simplement les apparences directes et essaie
de combiner la précision du détail avec la généralisation la plus large
possible. Le chercheur doit s’efforcer de n’être point influencé par la
tradition, l’autorité, les raisons qui le porteraient à supposer ce que les
faits doivent être, ou par des idées fantaisistes de quelque genre que ce
soit ; il doit s’en tenir à l’observation honnête et obstinée des
apparences. Le lecteur, de son côté, doit répéter pour lui-même les
observations de l’auteur et décider en se fondant sur ses propres
observations si la description des apparences que donne l’auteur est
correcte ou non. (Logic viewed as Semiotics, deuxième introduction Phaneroscopy,
v. 1904.) III. La
priméité est la catégorie du sentiment et de la qualité b) Qualité. (CP 1.422) Qu’est-ce qu’une qualité ? Avant de répondre à cette
question, il y a lieu de dire ce que la qualité n’est pas. Ce n’est pas
quelque chose qui dépende, en son être, de l’esprit, que ce soit sous la
forme du sens ou sous celle de la pensée. Ce n’est pas non plus quelque
chose qui dépende, en son être, du fait qu’une chose matérielle la possède.
Que la qualité dépende du sens, est la grande erreur des conceptualistes.
Qu’elle dépende du sujet dans lequel elle se réalise, est la grande erreur
de toutes les écoles nominalistes. Une qualité est une pure potentialité
abstraite ; et l’erreur de ces écoles est de soutenir que le potentiel
ou possible n’est rien que ce que l’actuel le fait être. C’est l’erreur qui
consiste à affirmer que seul le tout est quelque chose, et que ses parties
constitutives, aussi essentielles qu’elles soient pour lui, ne sont rien.
La réfutation de cette position consiste à montrer que personne ne la
soutient ni ne peut la soutenir longtemps au nom du bon sens. Aussitôt que
la fusillade de la controverse cesse, on fait appel à d’autres conceptions.
Et d’abord, affirmer que la qualité de rouge dépend de celui qui la voit
actuellement, à telle enseigne que les choses rouges ne sont plus rouges
dans l’obscurité, c’est aller à l’encontre du sens commun. Je demande aux
conceptualistes voulez-vous vraiment dire que dans l’obscurité, il n’est
plus vrai que les corps rouges soient capables de transmettre la lumière à
l’extrémité inférieure du spectre ? Voulez-vous dire qu’un morceau de
fer qui ne subit actuellement aucune pression a perdu son pouvoir de
résister à la pression ? S’il en est ainsi, vous devez soutenir ou
bien que ces corps, dans les circonstances supposées, assument les
propriétés opposées ou bien qu’ils deviennent à cet égard indéterminés. Si
vous soutenez que le corps rouge, dans l’obscurité, acquiert le pouvoir
d’absorber les ondes les plus longues du spectre, et que le fer acquiert le
pouvoir de se condenser à basse pression, alors, outre que vous adoptez une
opinion qui ne repose sur aucun fait, vous admettez toujours que les
qualités existent bien qu’elles ne soient pas actuellement perçues —
seulement vous transférez cette croyance sur des qualités en l’existence
desquelles vous n’avez aucune
raison de croire. Si, cependant, vous soutenez que les corps deviennent
indéterminés en ce qui concerne les qualités dont vous ne percevez
pas actuellement qu’ils les possèdent, alors, puisqu’il en est ainsi à tout
moment pour la vaste majorité des qualités de tous les corps, vous devez
soutenir que les généraux existent. En d’autres termes, c’est aux choses
concrètes que vous ne croyez pas ; quant aux qualités, c’est-à-dire
aux généraux ♦ — qui est un autre
mot pour la même chose — non seulement vous y croyez, mais vous croyez
qu’elles seules composent l’univers. La logique vous oblige donc à dire que
le corps rouge est rouge (ou a quelque couleur) dans l’obscurité, et que le
corps dur a quelque degré de dureté quand aucune pression ne s’exerce
sur lui. Si vous tentez d’échapper à la réfutation en distinguant entre les
qualités qui sont réelles, comme les qualités mécaniques, et les qualités
qui ne sont pas réelles, les qualités sensibles, vous pouvez en rester là,
puisque vous avez accordé le point essentiel. Cependant, tous les
psychologues modernes vous diront que votre distinction est insoutenable.
Vous oubliez peut-être qu’un réaliste admet pleinement qu’une qualité
sensorielle n’est qu’une possibilité de sensation ; mais il pense
qu’une possibilité reste possible quand elle n’est pas actuelle. La
sensation est requise pour son appréhension ; mais aucune sensation ni
faculté sensorielle ne sont requises pour la possibilité, qui est l’être de
la qualité. Ne mettons pas la charrue avant les boeufs, ni l’actualité produite
avant la possibilité, comme si celle-ci impliquait ce qu’elle ne fait que
produire. Une réponse semblable peut être faite aux autres nominalistes. Il
est impossible de soutenir logiquement qu’une qualité n’existe que
lorsqu’elle est actuellement inhérente à un corps. S’il en était ainsi,
seuls les faits individuels seraient vrais. Les lois seraient des
fictions ; et, en fait, le nominaliste n’aime pas le mot
« loi », et lui préfère « uniformité », pour exprimer
sa conviction que dans la mesure où la loi exprime seulement ce qui pourrait arriver, mais n’arrive pas, elle est sans
valeur. Si, cependant, aucune loi, en dehors de celles qui expriment des
faits actuels, ne subsiste, le futur est entièrement indéterminé et par
suite est général au plus haut point. En vérité, il n’existerait rien que
l’état instantané ; alors qu’il est facile de montrer que si nous
pouvons nous permettre d’appeler des éléments fictions, l’instant est la
première chose à appeler fiction. Mais j’avoue que je ne prendrai pas la
peine de répondre en détail à une doctrine si monstrueuse et qui à juste
titre, pour le moment, n’est pas à la mode. ♦ Il y a deux types de généralité la généralité de la possibilité qui est premiére et la généralité de la pensée qui est troisième. [NdT] (CP 1.423) Voilà pour
ce que la qualité n’est pas. Et maintenant qu’est-ce qu’elle est ? Nous ne nous soucions pas de la signification
que les usages linguistiques peuvent attacher à ce mot. Nous avons déjà vu
clairement que les éléments des phénomènes appartiennent à trois catégories
qualité, fait et pensée. La question que nous avons à considérer est de
savoir comment il faut définir la qualité pour que cette division reste
vraie. Pour nous en assurer, il nous faut considérer comment les qualités
sont appréhendées et à quel point de vue elles deviennent absolues dans la
pensée, et noter la nature de ce qui se révélera et devra se révéler dans
ce mode d’appréhension. (CP 1.424) Il y a un point
de vue sous lequel l’univers entier des phénomènes apparaît n’être fait de
rien d’autre que de qualités sensibles. Quel est ce point de vue ?
C’est celui que nous adoptons quand nous nous occupons de chaque partie
comme elle apparaît en elle-même, en sa propre talité, sans prêter
attention aux connexions. Le rouge, l’aigre, le mal de dent sont chacun
d’eux sui generis et
indescriptibles. En eux-mêmes, c’est tout ce qu’il y a à dire d’eux.
Imaginez à la fois un mal de dent, un mal de tête fou, un doigt écrasé, un
cor au pied, une brûlure et une colique, non pas nécessairement comme
existant à la fois — laissez cela dans le vague — et faites attention non
aux parties de l’imagination, mais à l’impression qui en résulte, cela
donnera une idée d’une qualité générale de peine. Nous voyons que l’idée
d’une qualité est l’idée d’un phénomène ou d’un phénomène partiel considéré
comme une monade, sans référence à ses parties ou composantes, et sans
référence à quoi que ce soit d’autre. Nous ne devons pas considérer si ce
phénomène existe ou s’il est seulement imaginaire, parce que l’existence
dépend du fait que son sujet a une place dans le système général de
l’univers. D’un élément séparé de toute autre chose et ne se trouvant nulle
part si ce n’est en lui-même, on peut dire, quand nous en venons à
réfléchir sur son isolement, qu’il est purement potentiel. Mais nous
n’avons même pas à nous occuper d’une quelconque absence déterminée
d’autres choses ; nous devons considérer la totalité comme une unité.
Nous pouvons appeler cet aspect d’un phénomène son aspect monadique. La qualité est ce
qui se présente sous l’aspect monadique. (CP 1.425) Le phénomène peut être tout ce qu’il y a de plus complexe et de plus hétérogène. Cette circonstance ne produira pas de différence particulière dans la qualité. Elle la rendra plus générale. Mais une qualité n’est pas en elle-même, en son aspect monadique, plus générale qu’une autre. L’effet qui en résulte n’a pas de parties. La qualité en elle-même est indécomposable et sui generis. Quand nous disons que les qualités sont générales. sont des déterminations partielles, sont de pures potentialités, etc., tout cela est vrai des qualités après réflexion sur ces qualités ; mais ces choses n’appartiennent pas à l’élément-qualité de l’expérience. (CP 1.426) L’expérience est
le cours de la vie. Le monde est ce que l’expérience inculque. La qualité
est l’élément monadique du monde. N’importe quoi, aussi complexe et
hétérogène soit-il, a sa qualité sui
generis, sa
possibilité de sensation, si seulement nos sens voulaient y répondre. (...) (The Logic of Mathematics
An ttempt to Develop my Categories from Within, v. 1896.) |
-
n Tarski et la suppositio materialis par Claude Panaccio →
Ce texte de lecture agréable permet de comprendre l’usage des termes significacio, suppositio personalis et suppositio materialis et facilitera la lecture de l’article ci-dessous. [b-Pierce] |
|
n Pierce et les
scolastiques par Claudine Tiercelin → |
|
|
L’apparence confère l’existence
aussi bien à ce qui est qu’à ce qui n’est pas. Il n’y a pas, dans le monde,
de classes, d’ensembles, de nombres, etc. Cependant le monde est
classé : nulle chose sans classe, c’est-à-dire nulle chose sans nom
commun. Le nom commun est l’expression conceptuelle de Frege. Le néant n’est
pas par définition. Cependant il existe, puisqu’il se manifeste. Il peut
exister sans être grâce à la manifestation. Cf. Wittgenstein : les
règles du jeu d’échec par opposition aux règles de la cuisine. Il n’y a pas
de « jeu d’échec » dans le monde, seulement des joueurs d’échecs et
des parties ; les règles du jeu d’échec font le jeu d’échec. Tandis
qu’il y a de la viande dans le monde et les règles de la cuisine ne font pas
la viande (si vous faite rôtir de la volaille au four, plutôt qu’à la broche,
mettez votre volaille à four froid – conseil de Guy Martin –. Avis aux
apprentis cuisiniers). La viande a une nature, les échecs n’en ont pas. La
chose, la réalité (la chosité) est ce qui possède et l’être, et l’existence.
La notion de « chose en soi » est contradictoire puisque la chose
en soi n’a que l’être et non pas l’existence. Elle n’est donc pas une chose. Vous pouvez changer les règles
de cuisson de la viande, vous ne pouvez pas changer la nature de la viande
quoique vous puissiez la changer en nourrissant les vaches avec de la farine de
cadavres de vaches. Mais ça, c’est de la science, ce n’est plus de la
cuisine.
|
Divers
|
La prétendue théorie de
la valeur d’Aristote La prétendue « théorie de la
valeur » d’Aristote signé d’un Z qui signifie Zébu → Albert le Grand et le
concept de valeur par Sylvain Piron → Cet article, dont vous trouverez ici un extrait imprimable, est remarquable : il donne totalement raison à Paul Jorion et à moi-même quand nous soutenons que bien loin d’avoir manqué le concept de valeur, ainsi que le prétend fâcheusement le camarade Marx, Aristote le conjure. Du temps d’Aristote, les hommes avaient encore besoin les uns des autres, le cordonnier avait besoin du maçon et réciproquement, etc. De nos jours les hommes n’ont pas même besoin d’objets, comme on le prétend couramment, ils ont seulement et obligatoirement besoin d’argent (ils sont tombés dans le besoin d’argent). « Le besoin d’argent a remplacé tous les besoins » avec des conséquences catastrophiques et ça, le camarade Marx l’avait bien compris puisque la formule est de lui. Mais pour diverses raisons il n’a pas pu en tirer les conséquences. Il faut donc travailler dur pour reprendre la question où Marx l’a laissée. Je ne connais pas de travaux, y compris les miens, qui soient satisfaisants sur ce point. On peut parler, à ce sujet, d’ignorance totale. Mon seul avantage est de connaître cette ignorance. Meuh ! Cf. La prétendue « théorie de la valeur » d’Aristote qui me fit découvrir le texte de Piron : « “Ce n’est qu’à partir du milieu du XIIIe siècle que le concept de valeur fait son entrée en philosophie, à la faveur de la lecture du cinquième livre de l’Éthique.” (p. 7). D’un point de vue contextuel, il est ainsi important de saisir que, contrairement à la mesure dans l’échange (“proportion diagonale”) dont parle Aristote, les scolastiques parleront de la mesure des biens échangés, car l’utilisation monétaire dans les cités médiévales n’est plus celle qu’en faisaient les cités grecques d’Aristote. Ce renversement déplace alors le concept de justice dans les échanges de la philia (besoin et reconnaissance d’un besoin mutuel, “amitié”) vers l’abstraction de la valeur, où la relation et même les individus disparaissent au profit du bien. » Je notais dans mon Enquête que ce qui caractérise une marchandise est qu’il s’agit d’un objet pré-échangé, un objet qui porte avec lui la notion de son échange et cela du fait d’une institution. C’est un fait collectif. La discussion qui suit l’article signé Zébu me semble
intéressante. J’en mets donc une
version comprimée sur deux colonnes corps 11,5 pour impression
(101 pages) à la disposition des amateurs. J’espère que la voiture de
Cécile est enfin réparée. Ces assureurs sont des voleurs. Que le Turc les
empale. |
La pensée et
l’intelligence non verbale par Serge
Carfantan →
[b-pensée]
Dernièrement, je lisais la lettre sur les aveugles de Diderot et je me demandais : comment font les sourds muets pour penser. |
Questions de logique par Gilles Plante →
[b-Plante
Gilles]
Supposition et imposition ; présentation et
description, Russel et Aristote. Il y a des erreurs de raisonnement dans ce
papier mais il est néanmoins intéressant. Notamment confusion de la relation
d’appartenance et de la relation d’inclusion ou de subordination. Un élément
d’un ensemble n’est pas une partie de l’ensemble. Frege est l’inventeur du
singleton quand-même. (e-Studium Thomas d’Aquin) |