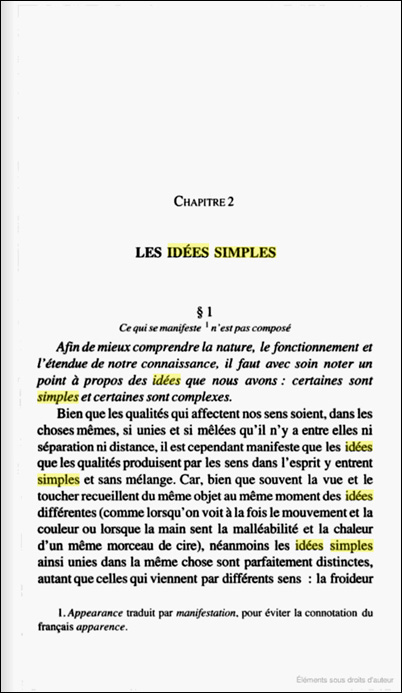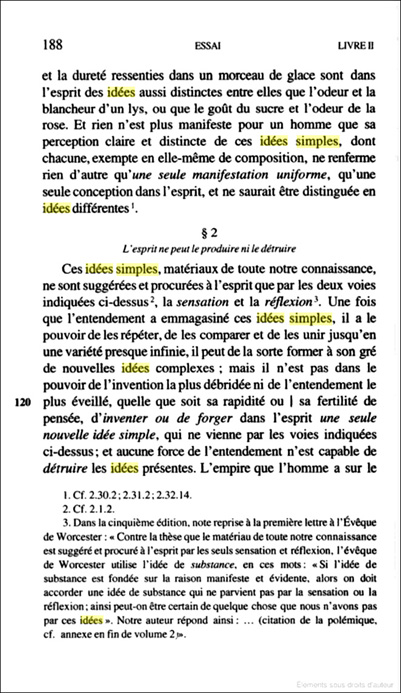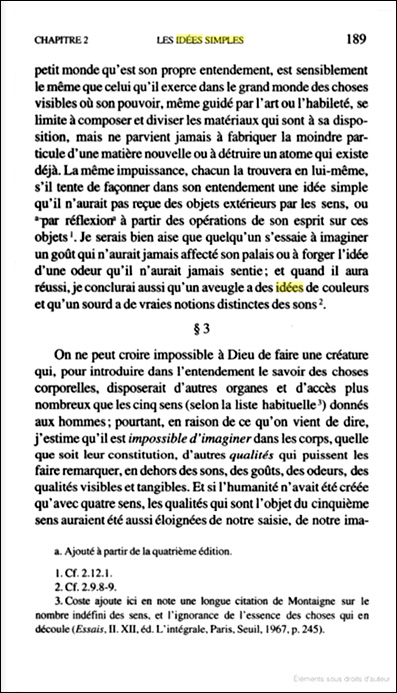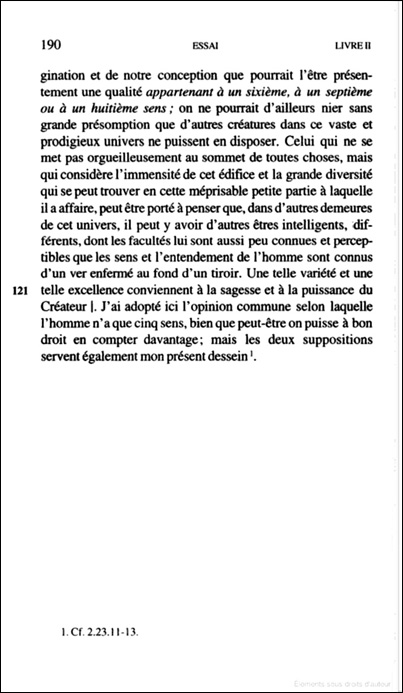Impression corps 12 :
échelle 85 %
LE CONSENSUS HUMAIN
DÉCIDE-T-IL DU VRAI ET DU FAUX ?
Vincent Descombes
Colloque international de Nice
« Wittgenstein : 1951-2001 »
Septembre 2001
L’Apparition et le
phénomène
L’apparition (le phénomène comme phénomène) n’est pas
un phénomène « Le phénomène comme
phénomène n’est pas un phénomène » Commentaire de Descombes (Le consensus humain…) Commentaire de Searle It’s parallelism, stupid ! L’amer Locke. L’esprit a-t-il un trou du cul ? La matière et les forces ne sont pas des choses mais des abstractions
|
|
Avertissement : afin
de ne pas caviarder ce texte et le rendre ainsi illisible, je définis ici le
symbole ♠ qui signifiera :
« …n’existe pas. …est un lockisme. Ainsi que Durkheim
le disait de Locke, vous n’avez aucune connaissance de ce
prétendu objet, vous n’en avez qu’une certaine idée et cette idée a pris la
place des faits. » — selon
Locke, les idées pénètrent dans notre esprit par le trou du cul.
Ce que je reproche à Locke n’est pas
de faire rentrer les idées par cet orifice incongru, mais de considérer
l’esprit comme un sac dans lequel les idées pénètrent. Kant (via Hume) est infesté de lockisme. Husserl lui-même est infesté :
« l’arbre perçu “en tant que tel” » n’est autre que… la sensation
qu’il ne faut, selon Husserl, surtout pas confondre avec l’arbre tout court.
Husserl avait des sensations de rouge — Husserl critiquant les
empiristes anglais (Méd. cart.) disait : je sais comment ça se fait, ça
se fait à coup de théories. C’est exactement ça. Hélas, Husserl lui-même l’a
fait à coup de théories. Je choisis l’as de pique en l’honneur de On emploie couramment impression
au sens de constatation douteuse, non certaine, menacée par l’erreur (Cf.
Littré). C’est fâcheux, car l’apparition, fut-elle illusoire, n’en est
pas moins miraculeuse, comme les autres apparitions, ce qu’avait parfaitement
compris Husserl : — l’apparition
n’est pas du monde, même si elle a
lieu dans le monde. Le plus remarquable,
c’est que, du fait que l’apparition confère l’existence aux essences, le
monde est un monde d’existences. Si l’apparition n’est pas du monde, c’est
bien parce qu’elle n’apparaît pas, car le monde est fait d’existants. L’apparition
n’a ni l’être, ni l’existence puisqu’elle n’apparaît pas. C’est d’ailleurs
pourquoi Sartre intitula son plus célèbre ouvrage L’Être et ne Néant.
Ce qui n’a ni l’être, ni l’existence ne peut être que le néant. — mais qu’il ne sut exprimer, c’est-à-dire dire :
comprendre n’est pas savoir. Le 19 juin 1959, j’ai compris
que l’apparition ne pouvait pas apparaître, mais j’ai mis vingt ans pour
pouvoir le dire, et donc le savoir, et cela grâce à un coup de
chance et à Hegel. Le mérite de Hegel est grand, car, comme je le notais
ailleurs, en lisant Henri Troyat, je n’aurais eu aucune chance. Chacun comprend
le temps, mais personne ne sait dire ce qu’il est. Chacun comprend le
sens mais personne ne sait dire ce qu’il est. Rappel : l’apparition n’apparaît pas, la sensation n’est
pas sensible, la manifestation n’est pas manifeste, l’audition n’est pas
audible (la voix s’entend effectivement mais exactement comme le
pet s’entend et qui de plus sent), la vision n’est pas visible, le
toucher n’est pas tangible, l’odorat n’a pas d’odeur, En fin de texte, vous trouverez les paragraphes de Wittgenstein, Husserl, Durkheim et de Locke cités dans cet article et dans mes notes. Descombes utilisant déjà les [crochets], je mettrai mes propres interventions « en passant » [en italiques]. |
LA QUESTION D’UN IDÉALISME DE WITTGENSTEIN
LE RÔLE DE L’ACCORD DANS LA PRATIQUE COMMUNE DU LANGAGE
L’OBJECTION D’IDÉALISME
LINGUISTIQUE
LA DOCTRINE DE L’IDÉALISME CLASSIQUE (ESSE EST PERCIPI)
L’IDÉALISME
LINGUISTIQUE COMME MÉTAPHYSIQUE DE L’IDÉALITÉ LINGUISTIQUE
DE CERTAINES ENTITÉS
DE L’ IMPRESSION
♠ À LA CONVENTION
CRITIQUE DE L’IDÉALISME
LINGUISTIQUE
Pour certains lecteurs de
Wittgenstein, dont je suis, la meilleure façon de mesurer la portée de son
œuvre dans l’histoire de la philosophie est de dire qu’il a mené à bien une
révolution en philosophie qui avait commencé avec Frege. En combattant le
psychologisme, Frege n’a pas seulement opéré une distinction salutaire entre la
logique et la psychologie,
l’étude des inférences valides et l’étude des capacités et des expériences
mentales, il a aussi séparé la logique de la théorie de la
connaissance. Une chose est d’examiner ce qui est impliqué par une
proposition, donc d’en donner le sens, autre chose est de déterminer si nos
facultés cognitives nous procurent les moyens de vérifier cette proposition. On
donne parfois à cette révolution frégéenne le nom de « tournant
linguistique » ♣,
voulant dire par là qu’avant cette révolution, les questions philosophiques
étaient considérées comme devant s’organiser sous l’hégémonie de la théorie de
la connaissance ♣♣,
alors qu’après cette révolution, ce sont les questions relatives au sens et au
langage qui ont une priorité. La théorie critique de la connaissance demande
(faisant par là écho au sceptique) : quelle raison avons-nous de juger que
nos prétentions cognitives sont justifiées ? Elle cherche cette
justification dans un savoir préalable qui soit lui-même garanti contre toute
contestation. Mais la question de la justification d’une assertion ou d’une
prétention cognitive ne peut pas être la première question à poser. Avant de
justifier la prétention à savoir telle ou telle chose, il faut être capable
d’énoncer ce que l’on prétend savoir dans un langage dont on puisse expliquer
les règles d’emploi.
|
♣ Il convient de signaler que ce précepte est pris chez beaucoup d’auteurs dans des significations qui sont tout à fait indépendantes de la pensée de Frege et de son orientation. ♣♣ Ou « épistémologie » au sens
anglais du terme. |
Wittgenstein, selon une partie
au moins de ses interprètes, a poursuivi cette révolution et l’a mené à bien
sur le terrain de la philosophie de l’esprit elle-même, en posant la question
de savoir dans quel langage un
philosophe du point de départ radical pourrait décrire et identifier ce qu’il
estime être le fondement primordial de toutes ses assertions ultérieures.
Lorsqu’on pose cette question d’un langage de l’expérience immédiate ou d’un
vocabulaire pour parler des données privées, on met en lumière un présupposé
tacite de toute l’entreprise des théories criticistes de la connaissance, à
savoir : la possibilité d’un langage privé ♣.
|
♣ « Qu’en
est-il alors du langage qui décrit mes expériences internes, et que moi seul
peux comprendre ? Comment est-ce que je désigne mes sensations♠ par des mots ? » (Recherches
philosophiques, trad. fr. F. Dastur, M. Élie, L-L. Gautero,
D. Janicaud, É. Rigal, Paris. Gallimard, 2005, § 216). |
L’importance de l’œuvre de Wittgenstein, dans cette optique, est sa contribution à un changement de régime en philosophie. Avant ce changement de régime, il était généralement admis que la question la plus radicale pour un philosophe était : comment le savez-vous ? comment répondez-vous au sceptique ? Après, la question cardinale est plutôt : que savez-vous ? Comment exprimez-vous ce que vous savez ?
Dans un cours de
Cambridge ♣,
Wittgenstein note que les philosophes semblent croire que la question la plus
importante à poser à propos d’une assertion quelconque est : Comment le savez-vous ? (How do you
know it ?) Le philosophe traditionnel estime que sa tâche est
de justifier la prétention à savoir quelque chose sur le monde extérieur ou
même l’idée commune qu’il y a un monde extérieur.
|
♣ Cours que nous connaissons par
les notes d’A. Ambrose et de M. Macdonald Wintgenstein’s
Lectures, Cambridge 1932-1935, éd. Alice Ambrose, Oxford, Blackwell,
1979, traduit sous le titre Les cours de Cambridge 1932-l935, trad. fr. É. Rigal. Mauvezin,
T.E.R. 1992. Voir p. 43 [28]. |
Mais, poursuit Wittgenstein, la première chose à déterminer n’est pas celle-là. Le premier pas n’est pas d’examiner comment vous pouvez savoir ce que vous prétendez savoir, il est de dire ce que vous savez, quand vous le savez ou quand vous dites le savoir. Avant toute entreprise de justification de ce que nous croyons savoir, précisons ce que nous savons, ce que nous disons savoir. Cette opération discursive suppose que nous puissions l’énoncer dans un langage intelligible. Or il se découvre vite qu’en expliquant ce que je sais — en expliquant le sens de la proposition par laquelle j’énonce ce que je sais — je détermine déjà, non pas bien sûr la justification appropriée que je puis en donner en telle occasion particulière, mais le type de raisons qu’il me faudrait pouvoir donner pour me justifier. Ainsi, dans cette mise au point, les questions de justification ne sont pas du tout méconnues — ce qui serait du dogmatisme —, mais elles sont subordonnées aux questions de sens.
On sait que, pour d’autres
lecteurs de Wittgenstein, le tournant linguistique tel qu’il s’opère chez ce
dernier relève malgré tout de l’idéalisme ♣. Il ne s’agit plus, sans doute, d’un idéalisme
classique, comme celui qu’on définit en termes mentalistes : être, c’est être perçu. Mais d’un
idéalisme nouveau, qu’on appelle parfois « idéalisme linguistique »,
une doctrine dont la devise pourrait être : la vérité d’une proposition se décide dans le consensus humain. Tel
serait selon cette interprétation le sens ultime du principe wittgensteinien de
l’autonomie du langage et de ses règles, autrement dit de l’autonomie de la
grammaire.
|
♣ Pour
une telle interprétation, voir par exemple : B. Williams,
« Wittgenstein and Idealism » (repris dans Moral Luck, Cambridge,
Cambridge University Press, 1981). Parmi les textes qui discutent cette
interprétation, on citera : E. Anscombe, “The Question of
Linguistic Idealism (1976), dans Philosophical Papers, Oxford,
Blackwell, 1981, t. 1, p. 112-133 ; N. Malcolm,
« Wittgenstein and Idealism » (1982), repris dans son livre Wittgensteinian
Themes. |
Il va de soi que, si cette dernière vue était juste, on serait fondé à parler d’un idéalisme linguistique de Wittgenstein, de sorte que toute l’interprétation du « tournant linguistique » que je viens d’évoquer — comme passage d’un régime épistémologique à un régime linguistique ou grammatical — serait invalidée. Il faudrait alors opposer sur ce point Wittgenstein à Frege, et non les rapprocher. D’où l’intérêt de considérer ce que dit Wittgenstein, non pas sur une doctrine connue sous l’étiquette « idéalisme linguistique » — l’expression n’existait pas de son temps, elle n’apparaît qu’ensuite dans la littérature secondaire qui lui est consacrée —, mais tout à la fois sur l’idéalisme classique et sur l’idée qu’on pourrait fonder des assertions sur un consensus humain.
LE
RÔLE DE L’ACCORD DANS
J’ai tiré ma définition de l’idéalisme linguistique de deux remarques des Recherches philosophiques. Voici ce qu’écrit Wittgenstein :
241. « Dis-tu donc que l’accord entre les hommes décide du vrai et du faux ? » — C’est ce que les hommes disent qui est vrai et faux ; et c’est dans le langage que les hommes s’accordent. Cet accord n’est pas un consensus d’opinion, mais de forme de vie.
242. Pour qu’il y ait compréhension mutuelle au moyen du langage, il faut qu’il y ait non seulement accord sur les définitions, mais encore (si étrange que cela puisse paraître) accord sur les jugements. Cela semble abolir la logique, mais il n’en est rien. — C’est une chose de décrire une méthode de mesure, et c’en est une autre de trouver et de formuler les résultats d’une mesure. Mais ce que nous nommons « mesurer » est également déterminé par une certaine constance dans le résultat des mesures.
L’interlocuteur que se donne
Wittgenstein réagit ici à ce qui vient d’être avancé au terme d’un long
développement sur la notion de règle ♣. Wittgenstein vient de dire que, quand quelqu’un
connaît effectivement une règle, l’application se fait d’elle-même, qu’elle va
de soi, ce qui peut créer l’impression♠
(ou plutôt l’illusion [exactement,
oui, bravo]) que la règle s’applique toute seule par un mécanisme
psychique mystérieux. Il a donné en particulier deux illustrations. La première
concerne les noms de couleur : on demande à quelqu’un d’aller chercher un
objet rouge. S’il sait la règle gouvernant l’application du mot
« rouge », il part à la recherche d’un tel objet et, lorsqu’il en
voit un, le rapporte. Il n’a pas besoin pour cela de comparer l’objet qu’il
juge être rouge à un
échantillon mental, une idée qu’il consulterait dans sa tête. La
deuxième illustration est tirée du milieu des mathématiciens : on
n’assiste pas chez eux à des conflits d’appréciation sur la correction des
résultats obtenus par les calculs.
|
♣ Ou
plutôt la notion d’une conduite qui consiste à « suivre une
règle ». De même qu’il est plus facile d’éclaircir l’expression
« expliquer le sens d’un mot » que de dire en quoi consiste le sens
d’un mot, puisque ce n’est ni la chose, ni une image mentale associée au
signe linguistique, de même il vaut mieux examiner l’expression « suivre
une règle » plutôt que de demander sur le mode formel ce qui fait qu’une
règle est une règle. |
En fait, tout le monde est d’accord pour savoir si tel objet est rouge ou si telle addition est correcte. L’interlocuteur qui s’exprime au § 241 tire de cette observation l’impression [OK] que Wittgenstein vient d’avancer une thèse — une thèse renversante — sur la nature de la vérité. Wittgenstein aurait souscrit à la doctrine qu’on a qualifiée par la suite d’« idéalisme linguistique ». Il reviendrait à un accord humain, à une Übereinstimmung entre les humains, et non pas à la chose dont on parle, de décider si une proposition est vraie ou fausse. Thèse idéaliste, car c’est nous qui décidons. Idéalisme linguistique, car le principe invoqué pour justifier de telles vérités n’est plus la nature de l’esprit ou de la conscience humaine, mais les nécessités d’un langage de communication, que Wittgenstein compare ici à un système de mesure. Pour s’entendre sur le système de mesure, il faut accepter les résultats. Pour s’entendre sur les définitions, il faut accepter les jugements.
L’OBJECTION
D’IDÉALISME LINGUISTIQUE
Il est intéressant que Wittgenstein fasse parler un interlocuteur qui formule, en ce point, une objection. Dans le texte, aucun nom n’est donné à la position ainsi évoquée. Le lecteur peut toutefois se faire à lui-même deux réflexions. D’abord, que c’est une position qui pourrait trouver des partisans, par exemple chez certains héritiers de la révolution copernicienne ou certains pragmatistes. Ensuite, qu’une telle position a pu être attribuée à Wittgenstein lui-même. Mieux : que lui-même s’attend à ce que, justement, elle lui soit attribuée.
Par ailleurs, il est permis de se demander si Wittgenstein ne réintroduit pas au § 242 ce qu’il vient de rejeter au § 241. D’abord, nous lisons que l’accord porte sur le langage, pas sur les opinions (car on peut énoncer des opinions contradictoires dans un même langage). Mais, ensuite, nous lisons que l’accord sur le langage, autrement dit sur les définitions, ne suffit pas : si des gens croyaient s’entendre sur les définitions des mots, mais s’ils étaient sans cesse en conflit lorsqu’ils formulent des jugements à l’aide de ces mots, nous devrions nous demander s’ils parlent le même langage.
À suivre ce raisonnement, on pourrait donc dire : c’est un fait que nous avons un langage commun; or la condition de possibilité de ce fait est que nous reconnaissions des vérités communes; mais, dans ce cas, le fondement par lequel nous justifions la validité de ces opinions communes n’est pas qu’elles soient confirmées par la réalité, c’est qu’elles sont nécessaires au fonctionnement du langage comme instrument de communication.
D’où une interprétation des derniers écrits de Wittgenstein qui a ses partisans : le cœur de la pensée du second Wittgenstein est la critique du solipsisme. Cette critique permet de surmonter l’idéalisme du sujet singulier, du moi, autrement dit le solipsisme individuel, mais elle laisse entière la question de l’idéalisme comme tel, si du moins il est possible de concevoir un idéalisme du sujet collectif, du nous, donc un solipsisme communautaire.
Lorsque Wittgenstein parle de l’idéalisme — par quoi il entend l’idéalisme classique —, c’est toujours pour le critiquer. Si la position qui fait du consensus un critère du vrai était bel et bien une forme d’idéalisme, on devrait pouvoir transposer à cette nouvelle doctrine ce que Wittgenstein disait de l’idéalisme classique : tant le diagnostic (quelle est la confusion qui conduit à cette réduction ?) que le remède (quelle est la distinction à rétablir ?).
Je poserai donc
deux questions :
(1) Qu’est-ce
que Wittgenstein reproche à l’idéalisme, au sens de l’école philosophique que
lui-même désigne ainsi ?
(2) Est-ce
que les arguments anti-idéalistes de Wittgenstein portent seulement contre une
version classique, monologique, potentiellement solipsiste, de la
doctrine ? Ou bien est-ce qu’ils s’appliquent, mutatis mutandis, à
l’idéalisme linguistique ?
Wittgenstein
emploie en général le mot « idéaliste » dans le sens le plus
traditionnel pour désigner une position qui rend incertaine, voire douteuse ou
fausse, l’existence d’un monde extérieur :
Les erreurs philosophiques les plus graves se produisent toujours lorsqu’on veut appliquer notre langage ordinaire — physicaliste — dans le domaine du donné immédiat.
Lorsqu’on demande par exemple : « la boîte existe-t-elle encore lorsque je ne la regarde pas ? », la seule réponse correcte serait : « certainement si personne ne l’a emportée ou détruite ». Naturellement, le philosophe ne se contenterait pas de cette réponse, mais ce serait une façon tout à tait correcte de réduire à l’absurde la question posée. Toutes nos façons de parler sont tirées du langage physicaliste normal. On ne peut les utiliser dans la théorie de la connaissance ou la phénoménologie sans jeter une lumière trompeuse sur l’objet (Remarques philosophiques § 57)
Ce texte porte
bien sur l’idéalisme, même si le mot n’y est pas, puisqu’il s’agit de
l’existence des choses du monde extérieur (Cf. Fiches § 413-414). La question posée par le philosophe idéaliste porte sur des existences.
On notera qu’il ne s’agit pas de l’existence au sens du logicien ou du
mathématicien (celle dont il est question dans une formule comme « il
existe au moins un objet qui correspond à telle description »). Il s’agit
bien plutôt de l’existence dont s’occupe le métaphysicien, autrement dit, pour
fixer les idées, de l’être au sens où cette notion de l’être entre dans la
définition de la vie par Aristote : être, pour les vivants, c’est
vivre. On pourrait dire ici de la même façon être, pour une boîte
— ou encore exister comme boîte pour un assemblage matériel —, c’est
avoir une organisation de ses parties qui permet de servir de contenant dans
des manipulations telles que le transport, l’entreposage, etc. Faute de cette
organisation (l’assemblage des parois), la boîte est détruite (même si les
matériaux subsistent).
J’ai ici défini, bien sûr, la boîte comme
objet physique, pas la boîte comme « objet de représentation♠ ♦ », celle pour qui l’esse se
réduit au percipi. Wittgenstein attire notre attention sur cette
confusion favorisée par le fait que nous parlons dans les deux cas de « la
boîte que je vois ». Il ne le fait pas en opposant des modes
d’existence, mais plutôt des jeux de langage, ce qui lui permet de
souligner qu’il y a un ordre de préséance entre ces « jeux » lorsque
nous voulons parler des
apparences ♦ , nous
devons reprendre, dans une application secondaire, le vocabulaire des objets
physiques, et par conséquent nous devons déjà savoir utiliser ce dernier dans
son application primaire à des objets physiques. Or il y a une différence
grammaticale, syntaxique, entre ces deux applications du vocabulaire des objets
physiques. Selon la grammaire de l’objet physique, on pourra
demander : est-ce que la boîte que tu vois est lourde, est-ce qu’elle est
solide, est-ce qu’elle passera par l’escalier ? Selon la grammaire de l’objet intentionnel de la
perception ♦, ces questions n’ont aucun sens : un objet purement visuel ♦ ne pèse rien, ne peut pas être manipulé, etc.
Ici, on ne peut s’empêcher de penser au célèbre paradoxe husserlien :
« un arbre perçu
ne peut pas brûler » ♣.
|
♣ « D’un
arbre tout court, on peut énoncer qu’il brûle, mais un arbre perçu “en tant que
tel” ♦ ne peut pas brûler (...) » (La Crise des sciences
européennes et la phénoménologie transcendantale. § 70. Gallimard, 1976, p. 372). C’est
Husserl lui-même qui parle d’un paradoxe de l’objet intentionnel |
|
♦ L’arbre perçu en tant que tel — c’est à dire l’arbre en tant qu’il est perçu et non plus seulement l’arbre en tant qu’il est arbre (il s’agit en fait de l’arbre existant en opposition à l’arbre étant. L’arbre existant n’est autre que l’arbre apparaissant) —, c’est notre vieille connaissance : le phénomène en tant que phénomène de Hegel (Phénoménologie). Hegel nous dit que « le phénomène en tant que phénomène est le supra sensible » [Cf. FORCE AND THE UNDERSTANDING]. Or le supra sensible a pour caractéristique principale de ne pas être sensible, c’est la moindre des choses. Donc le phénomène en tant que phénomène n’apparaît pas, donc le phénomène en tant que phénomène n’est pas un « apparaissant » (un phénomène en grec). Si au lieu du terme phénomène, par lequel les traducteurs français de Hegel s’entêtent à traduire Erscheinung [Cf. commentaire du lexique de Lefebvre], on emploie la traduction correcte : apparition, cela donne : l’apparition en tant qu’apparition n’apparaît pas. Hegel ajoute : l’intérieur naît du phénomène. Le prétendu objet intentionnel n’est pas un objet. Ainsi l’arbre perçu en tant qu’il est perçu n’est pas perçu. Remarquons que lorsque Kant
veut dire phénomène (pour des raisons qui m’échappent) il écrit phénomène
(50 fois environ dans Husserl nous dit des sottises. Husserl est un malade qui aurait dû consulter le Dr Wittgenstein. Quant à Frege, il nous dit que lorsque la forêt brûle, ce sont les arbres qui brûlent (les champignons aussi) et non pas l’ensemble des arbres (ni l’ensemble des champignons) quoique tous les arbres soient brûlés. Étant donné qu’il n’y a pas
d’objet intentionnel de la perception, il n’y pas non plus de grammaire de
l’objet intentionnel de la perception. Tout cela est du charabia. |
L’IDÉALISME LINGUISTIQUE COMME MÉTAPHYSIQUE
DE L’IDÉALITÉ LINGUISTIQUE DE CERTAINES ENTITÉS
Je viens de
définir l’idéalisme comme une doctrine qui assigne à certaines entités un autre
statut existentiel que celui qu’elles ont selon le sens commun : leur véritable statut ne
serait pas l’existence indépendante (je veux dire, indépendante de nos actes
mentaux), mais l’idéalité. L’idéalité dont parlaient
Berkeley et la philosophie classique peut être qualifiée de mentale. Pour qu’il
soit intéressant de parler d’un idéalisme linguistique, il faudra donc trouver
une opération philosophique analogue chez ceux qui le professent. Il faudrait
que le statut de certaines entités soit en question, que l’on puisse leur
refuser l’existence indépendante et leur concéder seulement une idéalité
linguistique (et non plus mentale). Ces entités n’existeraient pas si nous
n’avions pas un langage pour les nommer.
L’idéalisme
sémiotique, connu aujourd’hui sous le nom de « poststructuralisme » [Cf.
Le même et l’autre et « La querelle de
l’humanisme »], a soutenu qu’il en était ainsi de toutes les classifications naturelles. Cette philosophie, issue d’une
interprétation philosophique de la linguistique de Saussure, paraît incarner
une sorte de nominalisme extrême : les individus existent en dehors du langage, mais chacun
d’eux n’existe qu’à titre d’individu. Dès qu’on parle d’un individu comme étant
un arbre ou un cheval, on substitue à l’individu ineffable une entité signifiée
qui est un pur « effet de langage ».
Il n’y a aucune
raison d’attribuer à Wittgenstein une telle doctrine. Il n’y a d’ailleurs
aucune raison non plus de soutenir soi-même une telle doctrine, à moins de
partager l’idée selon laquelle toutes les différences réelles sont des
différences d’individu à individu. En revanche, comme l’a montré Elizabeth
Anscombe (dans son étude sur Wittgenstein et l’idéalisme linguistique), on peut dire que Wittgenstein a soutenu que le langage jouait un rôle
constitutif, et pas seulement descriptif, dans d’autres domaines, comme ceux
des signes, des coutumes, des droits, des règles. Le meilleur exemple serait
celui des jeux : il n’existerait pas quelque chose comme le jeu d’échecs
si l’on ne disposait pas d’un langage pour parler des échecs et fixer les
règles du jeu d’échecs. De même que le pur objet visuel n’existe en acte que
s’il est visuellement perçu, de même une règle, ou une norme juridique,
n’existent que si elles sont déclarées comme des règles ou des normes.
Toutefois, la
portée d’un tel idéalisme est locale, puisqu’il porte sur des réalités que
personne ne désire vraiment traiter comme des entités indépendantes de nous. Ce
n’est pas cette idéalité linguistique des règles ou des normes humaines qui est
visée par la thèse générale selon laquelle le consensus humain décide du vrai
et du faux.
Wittgenstein a eu
l’occasion de s’expliquer sur un éventuel idéalisme de sa part — dans son sens
du terme —, lorsqu’il a cherché dans un cours (dans un cours de Cambridge donné
pendant l’année universitaire 1932-33) à
dissocier ses idées de celles du cercle de Vienne. « Le sens d’une
proposition est sa méthode de vérification ». Comme on sait, ce dicton qui
a servi de slogan au positivisme logique a son origine chez Wittgenstein
lui-même (P.M.S. Hacker, Insight an illusion,
1972 ; Wittgenstein, : Meaning and Mind, 1993). Ce dernier ne répudie nullement l’idée en question, qu’il formule
ainsi : « si vous voulez connaître le sens d’une phrase, demandez
comment la vérifier » (Les Cours de
Cambridge, 1932-1935, p. 44 [29]). Toutefois,
explique-t-il, on s’est mépris sur son idée selon laquelle il y a une connexion
entre sens et vérification. On l’a interprété dans un sens qui en fait une
doctrine idéaliste. « There is a mistaken conception of my view
concerning the connection between meaning and vérification which turns the view
into idealism [Il y a une conception erronée de ma conception du
rapport entre sens et vérification, qui transforme cette conception en
idéalisme]. »
Voici son
exemple. Je lis dans le journal que c’est l’équipe de Cambridge qui a gagné la
régate (boat race). Je vérifie donc la proposition
« Cambridge a gagné la régate » en lisant les résultats dans le
journal. Par conséquent, l’énoncé : « J’ai lu le résultat de la
régate dans le journal » est ici ce qui vérifie l’énoncé :
« Cambridge a gagné la régate ». Pourtant, le sens de
« Cambridge a gagné la régate » n’est pas donné par « J’ai lu le
résultat de la régate dans le journal ». Par exemple, si quelqu’un se
réjouit que Cambridge ait gagné la course, cela ne veut pas dire qu’il se
réjouisse que j’aie lu le résultat dans le journal. Wittgenstein reproche donc à la sémantique
positiviste de pratiquer une réduction illégitime.
En quoi consiste,
selon Wittgenstein, la méprise des Viennois ? On a cru qu’il s’agit
d’opérer une réduction alors qu’il s’agissait plutôt de mettre en
évidence une relation interne, une connexion grammaticale.
La méthode de vérification ne donne
pas le sens de la
proposition, mais elle contribue a l’expliquer. Par exemple, il fait partie du
sens de « Cambridge a gagné la régate » que cela s’applique à quelque
chose dont on peut être le témoin, qui peut être rapporté dans le journal,
qu’on peut y lire, etc.
Wittgenstein met ici en cause le désir d’expliquer une chose en termes
d’autre chose. « The mistake here is in trying to explain
something in terms of something else [L’erreur est ici qu’on
essaie d’expliquer quelque chose en termes de quelque chose d’autre]. »
Erreur, car la chose à expliquer n’a pas la même grammaire que celle à laquelle
on voudrait la réduire. Et c’est dans de tels cas qu’il est approprié de parler
d’idéalisme. L’idéalisme est de dire qu’une chaise se réduit à quelque chose de
plus directement donné, par exemple à des données visuelles. Une chaise ne
serait rien de plus que la coordination d’une série des « idées de chaise »
— le mot « idée » étant pris au sens de l’empirisme anglais —,
des apparences visuelles de chaise, des « aspects visuels♠ » de chaise. Pourtant, la grammaire du mot
« chaise » n’est pas celle de « aspect visuel d’une chaise♠ » : je peux m’asseoir sur la chaise, pas sur l’aspect visuel
d’une chaise♠ ♦. Il n’en reste pas moins que
l’explication du mot « chaise » peut passer par le fait qu’une chaise
offre à l’observateur des aspects visuels♠ :
si nous acceptions de parler de chaises pour des objets invisibles, nous
aurions changé le sens du mot.
|
♦ Et pour cause puisque jamais n’exista, et jamais n’existera, d’aspect visuel d’une chaise autre que les représentations des peintres et les plans des menuisiers. Cela dit, vous pouvez vous asseoir sur le tableau ou le plan, et même les brûler. « aspect visuel♠ » est le nom d’une classe. À ce titre, c’est un objet, mais seulement à ce titre. Quand à la rugosité, par exemple, elle s’apprécie aussi bien par la vue que par le toucher. Vous pouvez même, afin d’apprécier sa rugosité, poser sur la chaise ce délicat organe que l’on nomme le popotin. Cet aspect appartient donc à deux classes. Aspect rugueux est une propriété de la chose, aspect visuel♠, non. D’ailleurs, comme Descombes le dit lui-même, « aspect visible♠ » signifie seulement que la chaise n’est pas invisible (contrairement aux portes en verre qui tombent, violemment, sous le toucher, après quoi votre nez devient douloureux. C’est votre nez qui est douloureux, ce n’est pas la douleur qui est douloureuse), autrement dit qu’elle apparaît. La chaise appartient à la classe des objets visibles, des objets qui tombent sous la vue mais aussi à la classe des objets contondants. Enfin on ne peut comparer la
rugosité qui est une propriété de la chaise avec le « vue »
de « la chaise est vue », car qu’elle soit vue n’est pas une
propriété de la chaise. La propriété correspondante est
« visible », « classe des objets visibles ». L’embarras
provient de la polysémie prolifique du verbe être. |
En ce sens, la sémantique positiviste est idéaliste. Elle réduit une chose à son idée, elle pose que « a boat race = the idea of a boat race [une régate = l’idée d’une régate] ». Elle ne tient pas compte de la différence entre la grammaire de « Cambridge a gagné » et celle des diverses phrases qui pourraient servir à donner des justifications d’une assertion sur la victoire de Cambridge.
Qu’il y ait, si l’on veut,
une phénoménologie de la chaise ou une description possible du « mode de donation visuelle d’une
chaise♠ » ♦ n’autorise aucun phénoménisme quant aux
choses : ce serait confondre la connexion
entre les deux propositions « Voici une chaise » et
« Ceci m’a l’air d’une chaise » avec une équivalence. De même, il y a une connexion grammaticale entre
« Gagner la régate » et « assister à la régate » ou
« figurer dans le journal comme le vainqueur de la régate », mais pas
une équivalence sémantique qui autoriserait de remplacer ces expressions les
unes par les autres ♣
.
|
♣ Cf. Les Cours de Cambridge,
p. 44 [28-29] : « Comment la signification d’une
phrase portant sur le passé pourrait-elle être donnée par une phrase portant
sur le présent ? […] Ma
réponse consiste à nier que la vérification donne la signification. Elle
détermine simplement la signification, c’est-à-dire qu’elle détermine son
emploi, ou sa grammaire ». |
|
♦ Balivernes et
charabia : c’est donc bien cela, ce malade de Husserl prétendait voir la
vision. Cette tentative est condamnée par l’expérience de pensée du moulin de
Leibniz, § 17 de La Monadologie. |
On remarquera que le lecteur lit dans son journal quelque chose comme : « Cambridge a gagné la régate ». S’il comprend ce qu’il lit, il peut offrir comme vérification de cet énoncé le fait qu’il l’a lu dans le journal (et la vérification vaut ce que vaut le journal cité). Le lecteur ne lit pas dans le journal un énoncé du genre : « Il est écrit dans le journal que Cambridge a gagné la régate. » Et, même si c’est ce qu’il y lisait, il lui faudrait malgré tout comprendre la phrase initiale sur la victoire de Cambridge pour comprendre l’énoncé de sa preuve. La portée de cette remarque apparaîtra dans un instant.
DE L’IMPRESSION♠ À
« Tu dis : “ceci est rouge”, mais comment décide-t-on si tu as raison ? » (Fiches. § 429). Partout où il y a assertion, il y a — semble-t-il — la possibilité d’une erreur, et donc la possibilité de demander quelle est la justification particulière. Cette considération est justement ce qui donne naissance aux théories de la connaissance : avons-nous une garantie contre la possibilité d’une erreur générale ?
En réalité, il n’est pas vrai que nous devions justifier toutes nos assertions par des preuves. User d’un mot sans avoir une justification, ce n’est pas en user à tort (Recherches philosophiques § 289.)
Si je dis « Je sais qu’il pleut » ou « Voici une chaise », on peut me demander une justification. Mais est-ce que toutes les réponses pertinentes que je peux faire à une telle demande sont des justifications ? Non, car il arrivera que je réponde en expliquant pourquoi je n’ai pas besoin d’une justification. Dans ce cas, je n’aurai pas une justification à donner, mais cela ne voudra pas dire que mes « prétentions cognitives » seront illégitimes, que j’aurai tort d’assurer que je sais.
Par exemple, je sais qu’il pleut à Paris (où je ne me trouve pas à présent), car je viens de l’apprendre (par la radio, par ma femme à qui je viens de téléphoner, etc.). Mais supposons que je dise : « Je sais qu’il pleut, car je le vois en regardant par la fenêtre. » Dans un tel cas, je n’ai pas donné une preuve dont je me serais servi moi-même pour conclure qu’il pleut. J’ai fait savoir, tout au contraire, que je n’avais pas besoin de preuve pour savoir s’il pleut.
Il en va ici de « Je
vois qu’il pleut » comme de la réponse « Je me souviens qu’il a
plu » à la question « Comment savez-vous qu’il a plu la nuit
dernière ? ». Si je voulais donner une preuve du bien-fondé de mon
dire (« II a plu la nuit dernière »),je pourrais par exemple faire
remarquer que le sol est mouillé. Mais je ne prouve rien en disant que je m’en
souviens. Le souvenir n’est pas une donnée présente, qui serait à ma
disposition dans un lieu
mental privé (dans un module de la mémoire), et dont je me servirais
pour fonder mon assertion sur le passé. Dire que je me souviens qu’il a plu, ce
n’est pas prouver qu’il a plu par une trace mentale, alors que dire qu’il a plu puisque le sol est mouillé, ce
serait effectivement prouver la pluie par une trace physique. En faisant appel à mes souvenirs personnels,
j’explique en réalité pourquoi je suis en position d’asserter la proposition
« Il a plu » sans avoir besoin pour cela de faire appel à quelque
justification que ce soit ♣.
|
♣ Cela
ne veut pas dire que ma prétention à être en position de savoir du fait de ce
que je perçois ou de ce dont je me souviens soit infaillible ni qu’on ne
puisse pas la contester. Parfois. je devrais admettre que j’ai mal vu ou que j’ai
cru a tort me souvenir d’un épisode passé. |
On risque donc de confondre
les raisons que je donne à titre de preuves pour justifier mon assertion et les
raisons que je donne pour me dispenser de fournir des preuves. Telle est
justement la méprise qui conduit d’abord à se poser le problème insoluble d’une
transition de la
représentation♠ ♦ à la réalité extérieure à cette
représentation♠,
et ensuite aux réductions tentées en vue de construire une solution
« immanente » après l’échec d’une solution « transcendante » ♦♦
|
♦ C’est à dire de la proposition et non d’une
prétendue représentation visuelle. L’apparition d’une chose est une
apparition et non pas une représentation. Il n’y a pas de
représentation dans ce cas. Encore du charabia lockiste. Et si la chose
apparaît, l’apparition n’apparaît jamais. Meuh ! Merde à Locke ! Il
n’est de représentation qu’au sens de Bolzano ou au sens des peintres et de
leur tableaux, des architectes et des ingénieurs et de leurs plans. ♦♦ Transcendance au
sens de Sartre dans De la transcendance de l’ego, qui signifie :
l’égo est un objet comme un autre, comme une table ou comme une chaise,
transcendant donc, et non pas immanent. Comme pour tout objet réel, les
manifestations de l’ego sont intermittentes. Les apparitions des choses sont
intermittentes. On ne s’étonne pas des apparitions et des disparitions des
tables, des chaises, etc. Pourquoi devrait-on s’étonner des apparitions et
disparitions de l’égo. J’ai mis en ligne, afin de le commenter, un texte de Kripke où celui-ci, ainsi
que Hume, auquel il se réfère, tirent des conclusions erronées de ces
apparitions et disparitions et font un reproche injustifié à Descartes. Je
vais commenter ça bientôt.
|
Si l’on voulait interpréter
« Je vois qu’il pleut » comme une preuve qu’il pleut — et non comme
une explication de ce qui me permet d’être en position de savoir qu’il pleut —
on se heurterait aussitôt au problème d’un langage originel pour les données privées♠, les impressions♠ ♦. Il me faudrait en effet pouvoir
décrire cette impression. Mais lorsque je cherche à décrire une impression,
tout ce que j’arrive à dire, c’est : « J’ai l’impression visuelle♠ ♦♦ qu’on a lorsqu’on voit qu’il pleut. » Ma
capacité à décrire mon impression♠
suppose donc que je puisse dire « Il pleut » sans mentionner mes
impressions♠.
|
♦ Sartre montre
dans ♦♦ Je dirais de Wittgenstein — ou plutôt : je dirais du locuteur inconnu cité ici par Descombes — ce que Durkheim dit de Locke : il ne sait rien de prétendues impressions visuelles mais a seulement connaissance d’une idée (idée stupide) des impressions visuelles. Tout cela est une vue de l’esprit dénuée de sens. Et que dire de ces gens qui écrivent ici ou là qu’ils ont ou qu’ils ont eu une impression de rouge. Non sens. Stupidité. Tout cela n’est pas gai après plus de deux mille ans de philosophie. L’expression correcte dans ce cas serait : « j’ai vu ce qu’on voit quand il pleut. », ce qui est la réponse du berger à la bergère : à question stupide, réponse stupide. Comme le dit la sagesse populaire : « On voit rouge » et non pas « On a une sensation de rouge♠ ». De même les gens qui ont la jaunisse voient tout jaune mais n’ont pas pour autant « une sensation de jaune♠ ». Merde à la fin ! La sensation de rouge♠ est une bête aussi fabuleuse et inexistante que la chimère. Je n’ai jamais, de ma vie, rencontré cette bête. Certaines gens prétendent la rencontrer tous les jours. Farceurs ! Remarquons enfin que la
tournure « J’ai vu ce qu’on voit quand il pleut. » n’a aucun
rapport avec le conventionnalisme car elle ne se soucie pas le moins du monde
de ce que vous voyez quand il pleut. Vous voulez sortir. Je regarde par
la fenêtre et je dis : « Il pleut. » Vous prenez votre
parapluie. C’est tout. C’est une forme de vie. Peu importe ce que vous voyez
(ou entendez, ou touchez) quand il pleut. Vous et moi vivons dans un savoir
commun. Les animaux vivent dans la prairie ou dans la forêt. Les hommes
vivent dans un savoir quoiqu’ils soient ignorants. Ils ignorent, notamment,
qu’ils vivent dans un savoir. De même, le monde est savant, mais il l’ignore. |
Comme l’écrit Wittgenstein (Recherches philosophiques § 355) : on dit que nos impressions sensibles♠ peuvent nous tromper, mais l’important n’est pas là, il est que si elles peuvent nous tromper, « nous comprenons leur langage ». Lorsque mes impressions visuelles♠ me disent [voilà qu’elles parlent à présent. C’est magique] — à tort ou à raison — qu’il pleut, je comprends ce qu’elles disent [c’est Siegfried qui comprend soudain ce que disent les oiseaux ! C’est merveilleux], et je le comprends parce que je comprends la phrase française : « Il pleut ».
Au lieu de répondre « Je
sais que c’est rouge parce que je vois du rouge » [et non pas « j’ai une sensation
de rouge♠ »], le sujet pourrait
aussi répondre : « Je sais que c’est rouge parce que je sais quel est
le nom de cette couleur en français ». Une telle réponse, écrit
Wittgenstein, serait correcte (Recherches
philosophiques, § 381). Mais si nous interprétions cette
réponse comme une justification de l’assertion, nous ne ferions que remplacer
une fausse justification par une autre fausse justification. Au lieu de
chercher une justification derrière
dans les impressions privées♠ [il ne peut pas y avoir de langage privé pour la bonne et suffisante
raison qu’il n’y a pas d’impressions, sensations etc privées] ♦, nous
la chercherions dans une convention.
|
♦ Les impressions privées n’existent pas, ne sont que des vues de l’esprit. Et quand il y a quelque chose que l’on peut dire privé à juste titre, il s’agit simplement d’objets et non d’impressions ou de sensations. Et, comme pour toute
manifestations d’objets, les manifestations de ces objets ne se manifestent
jamais, seuls se manifestent les objets. Ces manifestations ont lieu dans le
monde. Les apparitions des choses ont lieu dans le monde. C’est là
l’apport essentiel de Husserl (Cf. la célèbre description du pommier) et
Sartre lui rend justice pour cela, mais il est bien obligé de constater que
Husserl n’a pas su s’arrêter au bon moment : il a voulu voir la vision
(c’est à dire le pommier en tant que pommier perçu) et écrivit pour cela des
volumes et des volumes de sottises, sottises pieusement reprises par des
générations d’imbéciles. |
Nous pouvons imaginer un idéaliste classique qui aurait décidé de transformer sa théorie de la connaissance en idéalisme linguistique. Convaincu par les arguments contre l’objet privé, averti des confusions entourant le recours à des données immédiates de la conscience, il renonce à justifier l’énoncé sur le non-moi « Il pleut » par l’énoncé sur le moi « Il m’apparaît qu’il pleut et je ne trouve pas de raison particulière de douter que cette apparence soit véridique ». Mais il ne renonce pas à l’idée qu’il doit donner une justification ultime de son assertion. Il nous renvoie maintenant à une garantie que donnerait le jeu de langage ou le consensus dans ma langue, dira-t-il, ou dans ma communauté, on dit que quelqu’un sait de quelle couleur est l’objet s’il lui attribue la même couleur que les autres; on dit qu’il sait s’il pleut, ou encore qu’il sait employer « Il pleut » conformément à la règle, lorsqu’il dit lui-même « Il pleut » en accord avec le jugement des autres, ou de la majorité des autres.
À cela, Wittgenstein objecte, comme toujours, qu’une philosophie descriptive ne trouve pas trace de cet appel à la communauté dans la démarche d’un sujet qui dit : « Ceci est rouge », ou bien : « Il pleut ». Je sais le français, cela veut dire seulement que je sais appliquer les règles, pas que je fais dépendre ma réaction de ce qu’une majorité des francophones diront dans le cas en question. Sans doute, si tout le monde disait autrement que moi, je serais stupéfait. Mais, dans le cas où le désaccord se reproduirait régulièrement, la conclusion que je devrais tirer ne serait pas que je me suis trompé, mais plutôt que nous ne parlons plus la même langue.
CRITIQUE
DE L’IDÉALISME LINGUISTIQUE
Est-il éclairant de signaler
les aspects idéalistes de la théorie
conventionaliste de la vérité ? Cela n’est éclairant que si l’on
peut transposer au nouvel idéalisme le diagnostic et le remède qu’on avait appliqué à la forme
classique. Ce dernier se caractérisait par le fait qu’il tentait de donner une
réponse à une question insoluble : comment atteindre un au-delà des apparences lorsqu’on ne
dispose pour tout point de départ que des apparences ♣ ?
|
♣ Cf. la question qui récapitule au
fond toute la querelle de |
Il y a dans la question posée
une confusion entre deux jeux de langage. Dans le cas de l’idéalisme
phénoménologique, on
confondait décrire les objets et décrire l’expérience ♦. Dans
le cas de l’idéalisme linguistique, on confond, selon la comparaison de
Wittgenstein au § 241 des Recherches,
l’opération d’instaurer un système de mesure (de fixer par
exemple l’unité de mesure) et l’opération d’appliquer ce système.
|
♦ Exactement.
Husserl a voulu décrire la vision. Peine perdue. La vision n’est pas visible.
Plus généralement : la manifestation ne se manifeste pas. |
On a vu comment l’idéalisme classique procédait, selon Wittgenstein, d’une confusion favorisée par l’ambiguïté de l’expression « l’objet que je vois » (est-ce l’arbre qui peut brûler, l’objet physique, ou est-ce l’objet intentionnel, le donné visuel♠ [chimère] ?). De même, dans l’idéalisme linguistique, la confusion est facilitée par le fait que c’est la même phrase, par exemple « ceci est rouge » ou « ceci est une chaise », qui sera utilisée :
1) Tantôt pour décrire, à l’aide d’une forme de description déjà instaurée, déjà mise en circulation, un objet particulier (ce rideau est rouge, ce meuble est une chaise).
2) Tantôt pour fixer le sens (l’usage) du mot, pour choisir et isoler un échantillon qui fera office, désormais, de « paradigme ». Comment est-ce quand c’est rouge ? On montre un échantillon de rouge, et non pas un échantillon d’apparence de rouge♠ [ce qui est impossible puisque l’apparence n’apparaît pas. Comment montrer quelque chose qui n’apparaît pas ?]. Wittgenstein l’illustre par le dialogue suivant :
« Ceci me semble
rouge » — « Et comment est-ce, rouge ? » —
« Ainsi. » Et il faut ici indiquer le bon paradigme (Fiches
§ 420).
La distinction de ces deux jeux, celui de l’accord sur la
définition (détermination du paradigme ou de la mesure) et celui de l’accord
sur le jugement, est précisément ce qui permet de parler d’une comparaison de
la proposition avec la réalité [la
proposition est la représentation et elle seule], et donc de sortir
des paradoxes du
représentationisme [merde
à l’amer Locke !] :
Qu’une proposition empirique soit vraie et une autre fausse, cela ne fait pas partie de la grammaire. Appartiennent à la grammaire toutes les conditions (la méthode) nécessaires pour comparer la proposition à la réalité. Autrement dit, toutes les conditions nécessaires pour la compréhension du sens (Grammaire philosophique, § 45).
Sans doute, si les gens cessaient d’être d’accord sur le
fait que ceci (que je vous montre tout en parlant) est de la même
couleur que l’échantillon conventionnel, ou que ceci (que je vous
montre) a la même longueur que l’unité conventionnelle de mesure, ce serait un
désastre : nous n’aurions plus véritablement un langage commun ou un
système de mesure commun. Toutefois, cet accord dans l’application, cette
constance dans les résultats, Wittgenstein ne les fonde nullement sur la
convention, sur l’accord humain, mais il les renvoie à la nature des
choses : « C’est toujours par la grâce de la nature que l’on sait
quelque chose » (De
J’avais annoncé deux questions, il est temps de voir quelles sont les réponses.
1) Qu’est-ce que Wittgenstein reproche à l’idéalisme ? Il lui reproche de commettre la faute philosophique qu’il caractérise ainsi : persister à demander le pourquoi d’un acte ou d’une pratique, alors que la seule réponse correcte, la seule réponse intelligible, a déjà été donnée. Par exemple, je réponds « J’ai vu qu’il pleuvait » pour expliquer comment je pouvais affirmer qu’il pleuvait, ou je réponds « J’ai appris à parler ainsi » pour expliquer que je qualifie de « rouge » les objets rouges. Au-delà de cette réponse par la pratique et l’apprentissage, ce qui bien entendu ne saurait suffire au théoricien critique de la connaissance, il n’y a plus que de fausses réponses à une fausse question. Ces justifications par l’impression privée♠ ou par la convention humaine ne justifient rien, non pas parce qu’elles seraient encore beaucoup trop « transcendantes » alors que nous devions répondre avec des données « immanentes », mais parce qu’elles reposent sur une assimilation fallacieuse d’un jeu de langage à un autre.
2) Est-ce que l’argument construit par Wittgenstein contre l’idéalisme du sujet individuel vaut aussi contre un idéalisme communautaire ? Oui, s’il est transposé ainsi : l’erreur est de confondre le jeu de langage qui détermine a priori les conditions dans lesquelles une expression descriptive de notre langage sera comparée à la réalité et le jeu de langage dans lequel nous utilisons ces expressions avec la prétention qu’elles soient vraies ou fausses. Ainsi, la réponse de Wittgenstein au reproche d’avoir fait du consensus humain ce qui décide du vrai tient bien finalement dans la distinction :
C’est ce que les hommes disent qui est vrai et faux ; et c’est dans le langage que les hommes s’accordent (Recherches philosophiques, § 241).
[ Pages 191
à 205 in Wittgenstein état des lieux, éditeur Élisabeth Rigal,
Vrin, 2008 ]
|
Remarques
philosophiques 57. L'emploi du mot « je » est une des formes de représentation les plus fallacieuses de notre langage, en particulier là où celui-ci a recours au « je » pour re-présenter l'expérience vécue immédiate – comme dans : « Je vois une tache rouge. » Aussi serait-il riche d'enseignement de remplacer cette façon de s'exprimer par une autre dans laquelle l'expérience vécue immédiate ne serait pas re-présentée à l'aide du pronom personnel; parce que ce faisant on pourrait voir que cette re-présentation n'est pas essentielle aux faits. Non que la re-présentation nouvelle soit en quelque sens que l'on veuille plus correcte que la première, mais son utilité, sa seule utilité, serait de montrer clairement ce qu'est d'un point de vue logique l'essentiel de la re-présentation. Les pires erreurs philosophiques apparaissent toujours lorsque l'on veut appliquer notre langage ordinaire – physique – au domaine du donné immédiat. Si l'on demande par exemple : « La caisse existe-t-elle encore si je ne la regarde pas ? », la seule réponse correcte serait « Assurément, si personne ne l’a prise ou détruite. » Naturellement le philosophe ne se satisferait pas de cette réponse mais c’est tout à fait à juste titre qu’elle entraînerait ad absurdum sa façon de poser la question. Toutes nos formes de discours sont issues du langage physique normal et ne sont pas à employer en théorie de la connaissance ou en phénoménologie, à moins de jeter un éclairage faux sur l'objet. La simple formulation « je perçois x » est déjà issue d’une façon de
s’exprimer liée au monde physique et x sera ici un objet physique – par
exemple un corps. Il est déjà faux d'utiliser cette tournure en
phénoménologie où x se réfère forcément à un donné. Alors en effet « je », comme « perçois », ne peuvent
non plus avoir le même sens que plus haut. Fiches 413.
L’un est un réaliste convaincu, l’autre un idéaliste convaincu, et ils
éduquent leurs enfants en conséquence. Pour une chose aussi importante que
l’existence ou la non-existence du monde extérieur, ils ne veulent rien
apprendre de faux à leurs enfants. Que leur
apprendra-t-on ? À dire notamment ceci : « Il y a des objets
physiques », et éventuellement le contraire ? Si quelqu’un
ne croit pas aux fées, non seulement il n’a pas besoins d’apprendre à ses
enfants « Il n’y a pas de fées », mais encore il pourra se
dispenser de leur apprendre le mot “fée”. En quelles circonstances
devront-ils dire : « Il y a... », ou « Il n’y a
pas... » ? Uniquement s’il leur arrive de rencontrer des gens qui
croient le contraire. 414. Mais l’idéaliste
enseignera à ses enfants le mot « chaise », car il veut leur apprendre
à faire ceci ou cela, par exemple à aller chercher une chaise. Qu’est-ce qui
différencie alors ce que disent des enfants éduqués à la manière idéaliste de
ce que disent des enfants éduqués de manière réaliste ? La différence
est-elle seulement celle d’un cri de guerre ? 429. Tu dis : « Ceci est rouge », mais comment décidera-t-on si tu as raison ? N’est-ce pas l’accord des hommes entre eux qui en décide ? — Mais est-ce que je fais appel à cet accord dans mes jugements sur les couleurs ? Les choses se passent-elles ainsi : je fais voir un objet à un certain nombre de personnes ; un mot appartenant à un certain groupe de mots (celui qu'on appelle les mots de couleurs) vient à l'esprit (fällt ein) de chacune d’entre elles ; et si “rouge”, par exemple, est celui qui est venu à l'esprit de la majorité des observateurs (à laquelle je n'appartiens pas nécessairement moi-même), le prédicat “rouge” appartient légitimement à l’objet. Une telle technique pourrait en effet avoir son importance. Recherches philosphiques 216.
« Une chose est identique à elle-même. » — Il n’y a pas de plus bel
exemple de proposition inutile, et néanmoins liée à un jeu de la
représentation. Comme si nous insérions en imagination la chose dans sa forme
propre, et comme si nous constations qu’elle lui convient. Nous pourrions dire aussi : « Toute chose se convient à elle-même ». — En d’autres termes : « Toute chose s’insère dans sa propre forme. » En même temps qu’on regarde une chose, on imagine un espace qui lui serait réservé, dans lequel elle s’insérerait parfaitement. Cette tache ● « convient-elle » au blanc qu’il y a autour
d’elle ? — Mais c’est exactement ce qui aurait semblé se produire si, au lieu de la tache, il
y avait eu d’abord un trou et qu’ensuite la tache s’y insère parfaitement.
Mais, par l’expression « elle convient », on ne se contente pas de
décrire cette image. On ne se contente pas de décrire cette situation. « Toute
tache de couleur convient parfaitement à ce qui l’entoure » est une
forme plutôt spécialisée du principe d’identité. 265.
Soit un tableau — par exemple un dictionnaire — qui n’existerait que dans
notre imagination. Au moyen d’un dictionnaire, nous pouvons justifier la
traduction du mot X par le mot Y. Mais parlerons-nous encore de
justification si le tableau ne peut être consulté qu’en imagination ? —
« C’est alors une justification subjective. » —Mais une
justification consiste à en appeler à une instance indépendante. —
« Pourtant je peux bien aussi en appeler d’un souvenir à un autre. Par
exemple, si je ne sais pas si j’ai bien noté l’heure de départ d’un train,
pour le vérifier, je me remets en mémoire l’image de la page de l’indicateur
des chemins de fer. N’avons-nous pas affaire ici à un cas
analogue ? » — Non, car ce processus doit effectivement susciter le
souvenir juste.
S’il n’y avait pas de
possibilité de vérifier la justesse de l’image que nous nous faisons de cette page, comment
la justesse du premier souvenir pourrait-elle être établie ? (Comme si
quelqu’un achetait plusieurs exemplaires du quotidien du matin pour s’assurer
que la vérité y est écrite.) Consulter un
tableau en imagination n’est pas plus consulter un tableau que la
représentation du résultat d’une expérimentation imaginée n’est le résultat
d’une expérimentation. 289.
« Quand je dis “J’ai mal”, je suis en tout cas justifié à mes propres
yeux. » — Que veut dire cette affirmation ? Veut-elle
dire : « Si les autres pouvaient savoir ce que j’appelle “avoir
mal”, ils admettraient que j’ai employé le mot correctement » ? Employer un
mot sans justification ne signifie pas l’employer à tort. 355.
Ce qui est ici en question n’est pas que les impressions des sens puissent
nous tromper, mais que nous comprenions leur langage. (Et ce langage, comme
tout autre langage, repose sur la convention.) 381.
Comment puis-je reconnaître que cette couleur est le rouge ? — Une
réponse pourrait être : « J’ai appris le français. » Grammaire philosophique Traduit de l’allemand par Marie-Anne
Lescourret 45.
L’interprétation des signes écrits et des signes sonores au moyen
d’explications ostensives n’est pas l’utilisation du langage, c’est une partie de la théorie
du langage. L’interprétation s’effectue encore au niveau général, comme
préalable à toute utilisation. On peut
concevoir l’explication ostensive comme une règle de traduction d’un langage
gestuel dans un langage verbal. Si je dis « la couleur de cet objet
s’appelle “violet” », pour que la dénomination puisse avoir lieu, il me
faut d’abord désigner la couleur par l’indication « la couleur de cet
objet ». Car je pourrais dire aussi: « C’est à toi de déterminer le nom
de cette couleur », et il faut que celui qui donne le nom sache à qui le donner ‘(où
le placer dans le langage). Que cette
proposition d’expérience soit vraie, cette autre fausse, cela ne relève pas de la grammaire. Ce qu’on
trouve en elle, ce sont toutes les conditions (la méthode) de comparaison de
la proposition avec la réalité, c’est-à-dire toutes les conditions de la
compréhension (du sens). Dans la
mesure où la signification des mots se manifeste dans la satisfaction de
l’attente, dans l’accomplissement
du vœu, dans l’exécution de l’ordre, etc., elle apparaît déjà dans
une présentation verbale de l’attente, etc. Elle est donc entièrement
déterminée par la théorie du langage. Dans ce qui s’est laissé prévoir, dont
on pouvait déjà parler avant que le fait n’intervienne. Husserl
La crise des sciences européennes
et la phénoménologie transcendantale 70. LES DIFFICULTÉS DE L’« ABSTRACTION » PSYCHOLOGIQUE. (PARADOXE DE L’« OBJET INTENTIONNEL », LE PROTO-PHÉNOMÈNE INTENTIONNEL DU « SENS ».) La
psychologie ne peut pas atteindre son thème avec la même facilité que la
science de la nature atteint le sien, c’est-à-dire en pratiquant une
abstraction opposée à la sienne aussi et aisément réalisable, l’abstraction
de tout ce qui est corporel, comme l’autre opère l’abstraction de tout ce qui
est de l’esprit. L’accès à la compréhension de soi est encombré pour elle,
même une fois reconnue la nécessité de l’épochè phénoménologique, par
d’extraordinaires difficultés et même par des paradoxes déconcertants qui
doivent être éclaircis et surmontés les uns après les autres. C’est ce qui
doit désormais nous occuper. Le comble de la difficulté consiste dans le
paradoxe des objets intentionnels en tant que tels. Nous entamerons la
question en demandant que sont devenus tous les objets donnés dans la
« conscience » des sujets dans différents modes de validité, les
objets qui étaient posés avant l’épochè comme réellement étants (ou étants
sur le mode du possible, ou aussi bien non-étants), maintenant que dans
l’épochè du psychologue la prise de position à l’égard de toute position de ce
genre doit être inhibée ? Notre réponse est que l’épochè précisément
libère le regard non seulement pour les intentions (les « vécus
intentionnels ») qui se déroulent dans la vie purement intentionnelle,
mais également pour ce que ces intentions posent chaque fois comme valide
en-elles-mêmes, dans leur propre teneur de sens, en tant que leur objet, et
pour la façon dont elles le font : selon quelles modalités de validité,
donc selon quelles modalités d’être, dans quelles modalités subjectives de
temps, présent perceptif, passé du souvenir, c’est-à-dire ancien présent
perceptif, etc. ; avec quelle teneur de sens, quel type d’objectivité,
etc. L’intention et l’objectivité intentionnelle en tant que telle, mais
aussi dans le « comment de ses modes de donnée », cela devient,
d’abord dans la sphère des actes, un thème d’une richesse débordante. Il se
prolonge
bientôt en un prudent élargissement des concepts et des problèmes
corrélatifs. C’est pourquoi la proposition que j’avance dans mes « Idées pour une
phénoménologie pure et une philosophie phénoménologique » [Cf. § 89] et qui, séparée du
contexte qui est le sien dans cet ouvrage, c’est-à-dire l’exposition de
l’épochè phénoménologique, pouvait paraître choquante, cette proposition est parfaitement
correcte : d’un
arbre tout court on peut énoncer qu’il brûle, mais un arbre perçu « en
tant que tel » ne peut pas brûler [un arbre peut être perçu dans le jardin, mais il n’y a
pas pour autant d’arbre perçu, il n’y a pas de perçu comme tel.
Le prétendu arbre perçu est un lockisme : c’est un retour subreptice de
la représentation, de la sensation. Husserl a mis la représentation dans le
jardin. C’est du théâtre en plein air, mais c’est toujours du théâtre] ;
je veux dire qu’énoncer cela à son sujet, c’est faire un contresens ;
car on exige alors de ce qui est une composante d’une pure perception, qui
n’est pensable que comme moment de l’essentialité propre d’un sujet
égologique, de faire quelque chose qui ne peut avoir de sens que pour un corps
en bois : brûler. Le psychologue, aussi longtemps qu’il s’en tient à la
pure description, a pour seul objet-tout-court les sujets égologiques et ce
qui « dans » ces sujets égologiques eux-mêmes (mais alors grâce
seulement à cette épochè) peut être éprouvé comme ce qui leur est propre de
façon immanente, pour devenir ensuite le thème d’un travail scientifique plus
poussé. Mais il trouve là partout non seulement des intentions, mais encore,
contenus corrélativement en elles, sur un mode de l’« être-contenu »
conforme aux nécessités d’essence et d’une nature absolument unique, les
« objets intentionnels ». Ceux-ci ne sont pas des morceaux réels de
l’intention, ils sont ce qu’elle vise, ce qui fait chaque fois son sens, et
ce selon des modalités qui n’ont de sens que, précisément, pour quelque chose
comme un « sens ». De ce qui est visé dans les visées, de ce dont
on a conscience dans les vécus de conscience, de ce qui est intentionné dans
les intentions — tous termes dont il faut absolument faire usage au sein d’une
psychologie phénoménologique en les prenant dans la plus extrême extension de
leur sens — on ne doit pas simplement parler il faut que tout cela devienne
plutôt, et méthodiquement, le thème d’un travail psychologique. La première
façon est celle de la psychologie des data. Même Hume (comment aurait-il pu
l’éviter ?) parle d’impressions de... de perceptions de... (d’arbres, de
pierres, etc.) et la psychologie a continué à faire de même jusqu’à
aujourd’hui. C’est justement par cette cécité à l’égard de « l’être-là-dedans »
intentionnel, à l’égard de « l’avoir-quelque-chose-en tête », comme
dit au contraire, et fort bien, la langue, que la psychologie s’est fermé la
possibilité d’une analyse effectivement intentionnelle, et, à l’opposé, celle
d’une thématique de la synthèse intentionnelle — c’est-à-dire rien de moins
que le thème d’ensemble de la recherche psychologique dans son essentialité
propre, la recherche descriptive. Dans la vie extra-psychologique c’est
devenu une habitude que de s’intéresser tantôt à ce que font les gens et à ce
qui leur arrive, tantôt au « sens » que cela a (à ce qu’on « a
dans la tête »); et dans la sphère des sciences également nous avons,
dans une certaine délimitation de l’intérêt, la thématique de l’interprétation
du sens, par exemple en philologie, dans le perpétuel retour réflexif et
interrogatif qu’elle fait sur ce qu’avait en vue celui qui a fait un certain
usage des mots dans son discours et se demande quelle était son expérience,
sa visée en idée et en pratique, bref ce qu’il avait en tête. Mais c’est
seulement lorsque, avec une cohérence universelle, on ne veut rien voir
d’autre ,que cet « avoir-en-tête », dans tous ses modes subjectifs
et dans la concrétude universelle de la vie qui donne le sens et qui le possède,
dans sa synthèse omni-englobante pour tous les sens et toutes les donations
de sens, c’est seulement alors qu’on obtient des problèmes purement
psychologiques, mais jamais de façon isolée. En d’autres termes seul celui
qui vit dans l’épochè universelle et possède grâce à elle l’horizon universel
de la pure « vie du dedans », de la vie intentionnelle en tant
qu’opératrice de sens et de validité, seul celui-là possède aussi la
problématique effective et authentique, et, je le souligne de nouveau, absolument
close sur soi, de l’intentionalité — laquelle problématique étant celle de la
psychologie pure appartient donc ensuite à toutes les sciences qui s’occupent
du psychique (la science psycho-physique et la science biologique). Le
psychologue possède cette problématique à partir de sa sphère originelle,
mais celle-ci n’est jamais isolable pour lui. En éprouvant sa sphère de
conscience originelle et ce qui prolifère sur elle, comme un ensemble
subsistant qui ne manque jamais en elle, il a aussi toujours déjà, si peu que
d’abord il y prête attention, un horizon universel inter-subjectif. Naturellement
l’épochè, en tant qu’exigence méthodologique fondamentale expresse, ne
pouvait être que l’affaire d’une réflexion tardive, celle d’un homme qui
déjà, dans une certaine naïveté et dans une situation historique donnée,
s’est trouvé pour ainsi dire entraîné dans l’épochè et s’était approprié déjà
un morceau de ce nouveau «monde du dedans », en quelque sorte un champ
de proximité prélevé sur lui, où un horizon lointain se trouve obscurément
préindiqué. Ainsi n’est-il parvenu que quatre ans après la conclusion des Recherches logiques à la conscience de-soi
expresse, et cependant encore imparfaite, de sa méthode. Mais du coup
surgirent également les problèmes extraordinairement difficiles qui se
rattachent à cette méthode même, à l’épochè, à la réduction et à leur
compréhension phénoménologique propre ainsi qu’à leur extraordinaire
signification philosophique. Plutôt que
d’entrer ici dans le traitement de ces difficultés, et donc dans
l’explicitation complète du sens de l’épochè et de la réduction
psychologiques, revenons encore expressément sur une différence dans l’usage
de ces deux mots, différence prise jusqu’ici dans l’ensemble de notre exposé
pour allant-de-soi. Dans la psychologie pure, c’est-à-dire descriptive au
sens vrai, l’épochè est le moyen pour rendre éprouvables et thématisables
dans la pureté de leur essentialité propre les sujets qui, dans la vie
mondaine naturelle, sont éprouvés et s’éprouvent eux-mêmes comme pris dans
des relations intentionnelles-réales à des objets mondainement réaux. Ainsi
deviennent-ils pour le théoricien psychologue absolument hors-du-coup des
« phénomènes » en un sens nouveau et particulier — et c’est ce
changement d’attitude qui s’appelle ici réduction
phénoménologico-psychologique. IDEEN I
§ 89.
— ÉNONCÉ NOÉMATIQUEE Il est clair que tous ces énoncés descriptifs, quoiqu’ils puissent rendre le même son que des énoncés concernant la réalité, ont subi une radicale modification de sens ; de même la chose décrite, tout en se donnant comme « exactement la même », est radicalement changée, en vertu pour ainsi dire d’un changement de signe qui l’invertit. C’est « dans » la perception réduite (dans le vécu phénoménologique pur) que nous découvrons, comme appartenant indissolublement à son essence, le perçu comme tel qui demande à être exprimé comme « chose matérielle », « plante », « arbre », « en fleur », etc. Les guillemets sont manifestement significatifs, ils expriment ce changement de sens, la modification radicale de signification que le mot a subie parallèlement. L’arbre pur et simple (schlechthin), la chose dans la nature, ne s’identifie nullement à ce perçu d’arbre comme tel [le perçu d’arbre n’est rien d’autre que le retour subreptice de la représentation] qui, en tant que sens de la perception, appartient à la perception et en est inséparable. L’arbre pur et simple peut flamber, se résoudre en ses éléments chimiques, etc. Mais le sens – le sens de cette perception, lequel appartient nécessairement à son essence – ne peut pas brûler, il n’a pas d’éléments chimiques, pas de force, pas de propriétés naturelles (resalent). Tout ce qui est un trait distinctif du vécu sous forme purement immanente et réduite, tout ce qui ne peut être par la pensée détaché du vécu tel qu’il est en soi et qui dans l’attitude éidétique se transpose ipso facto dans l’Eidos, est séparé par un abîme de tout l’ordre de la nature et de la physique, et non moins de celui de la psychologie; et même cette image, parce qu’elle relève du naturalisme, n’est pas assez forte pour indiquer la différence. Le sens de la perception appartient également, cela va de soi, à la perception avant la réduction phénoménologique (à la perception au sens de la psychologie). On peut donc ici apercevoir clairement en même temps comment la réduction phénoménologique peut acquérir aux yeux du psychologue l’utile fonction méthodologique de fixer le sens noématique, en le distinguant strictement de l’objet pur et simple, et d’y reconnaître un facteur qui appartient de façon inséparable à l’essence psychologique du vécu intentionnel – ce vécu étant désormais conçu comme réalité naturelle (real). De part et d’autre, dans l’attitude psychologique aussi bien que dans l’attitude phénoménologique, il ne faut pas perdre de vue que le « perçu » en tant que sens n’inclut en soi aucun élément (et donc ne tolère point que lui soit attribué sur le fondement de « connaissances indirectes » aucun élément) qui « n’apparaisse réellement » dans la chose qui dans un cas donné apparaît à la perception; et il l’inclut exactement sous le même mode, avec la même façon de se donner que celle avec laquelle cette chose accède à la conscience dans la perception. Sur ce sens, tel qu’il est immanent à la perception, peut à tout moment se diriger une réflexion originale et le jugement phénoménologique est seulement tenu de se conformer dans une expression fidèle à ce qui est saisi en elle. Durkheim
Les
règles de la méthode sociologique Chapitre II,
I. Règles
relatives à l'observation des faits sociaux En définitive, la réforme qu’il s’agit d’introduire en sociologie est de tous points identique à celle qui a transformé la psychologie dans ces trente dernières années. De même que Comte et M. Spencer déclarent que les faits sociaux sont des faits de nature, sans cependant les traiter comme des choses, les différentes écoles empiriques avaient, depuis longtemps, reconnu le caractère naturel des phénomènes psychologiques tout en continuant à leur appliquer une méthode purement idéologique. En effet, les empiristes, non moins que leurs adversaires, procédaient exclusivement par introspection. Or, les faits que l’on n’observe que sur soi-même sont trop rares, trop fuyants, trop malléables pour pouvoir s’imposer aux notions correspondantes que l’habitude a fixées en nous et leur faire la loi. Quand donc ces dernières ne sont pas soumises à un autre contrôle, rien ne leur fait contrepoids ; par suite, elles prennent la place des faits et constituent la matière de la science. Aussi ni Locke, ni Condillac n’ont-ils considéré les phénomènes psychiques objectivement. Ce n’est pas la sensation qu’ils étudient, mais une certaine idée de la sensation. C’est pourquoi, quoique, à de certains égards, ils aient préparé l’avènement de la psychologie scientifique, celle-ci n’a vraiment pris naissance que beaucoup plus tard, quand on fut enfin parvenu à cette conception que les états de conscience peuvent et doivent être considérés du dehors, et non du point de vue de la conscience qui les éprouve. Telle est la grande révolution qui s’est accomplie en ce genre d’études. Tous les procédés particuliers, toutes les méthodes nouvelles dont on a enrichi cette science ne sont que des moyens divers pour réaliser plus complètement cette idée fondamentale. C’est ce même progrès qui reste à faire à la sociologie. Il faut qu’elle passe du stade subjectif, qu’elle n’a encore guère dépassé, à la phase objective.
An Essay Concerning Human Understanding Book
II/Chapter II 1. Uncompounded appearances. The
better to understand the nature, manner, and extent of our knowledge, one
thing is carefully to be observed concerning the ideas we have ; and that is,
that some of them are simple and some complex. Though
the qualities that affect our senses are, in the things themselves, so united
and blended, that there is no separation, no distance between them ; yet it
is plain, the ideas they
produce in the mind enter by the senses simple and unmixed. For,
though the sight and touch often take in from the same object, at the same
time, different ideas ; – as a man sees at once motion and colour ; the hand
feels softness and warmth in the same piece of wax : yet the simple ideas
thus united in the same subject, are as perfectly distinct as those that come
in by different senses. The coldness and hardness which a man feels in a
piece of ice being as distinct ideas in the mind as the smell and whiteness
of a lily ; or as the taste of sugar, and smell of a rose. And there is
nothing can be plainer to a man than the clear and distinct perception he has
of those simple ideas ; which, being each in itself uncompounded, contains in
it nothing but one uniform appearance, or conception in the mind, and is not
distinguishable into different ideas. |
|
Littré : Idée. Représentation qui se fait de quelque chose dans l’esprit, soit que cette chose existe au dehors, ou qu’elle soit purement intellectuelle. / Représentation, le mot est lâché. Les remontrances de Hume, à Descartes je suppose, sont assez plaisantes : « Malheureusement, toutes ces assertions positives sont contraires à l’expérience même qu’on allègue en leur faveur ; et nous n’avons aucune idée du moi de la manière ici expliquée. » Nous avons ici seulement idée de l’idée, de la sensation etc. et d’expérience, point. Comme dit Durkheim, l’idée a remplacé les faits. Et ça se dit empiriste ! (du moins on le dit). Nul phénomène ici, mais seulement fantasmagorie. C’est bien d’un bourgeois, ça, c’est à dire d’un individu (Weber nous dit que les sauvages sont bien moins cons sur ce sujet). Voilà un exemple flagrant de la nécessité de commencer par la question « que savons nous ? » Plutôt que par « Que pouvons nous savoir ? » et « Comment pouvons nous le savoir ? » Nous savons, point ! Il faut commencer par-là. Il fallut cependant deux, trois, quatre mille ans pour en parvenir à cette évidence. Il fallut, en un mot, que fût inventé le bourgeois, c’est à dire l’individu, ce triste con… et trois siècles d’errance bourgeoise. L’ensemble des arbres d’une forêt n’est pas une partie de la forêt. Bien mieux : les arbres ne peuvent grandir ensemble. Les chats peut-être, les hommes certainement. Encore mieux : non seulement ils le peuvent mais ils ne peuvent faire autrement. (Je ne veux pas du tout dire qu’ils sont obligés de vivre dans la même boîte, comme des rats dans un laboratoire — ça, c’est bon pour les prétendus écologistes, qu’ils crèvent, ces connards —, je veux dire qu’ils sont obligés de se promener ensemble. Allez, faites un effort.) Je place mes pièces pour faire un échec et mat. |