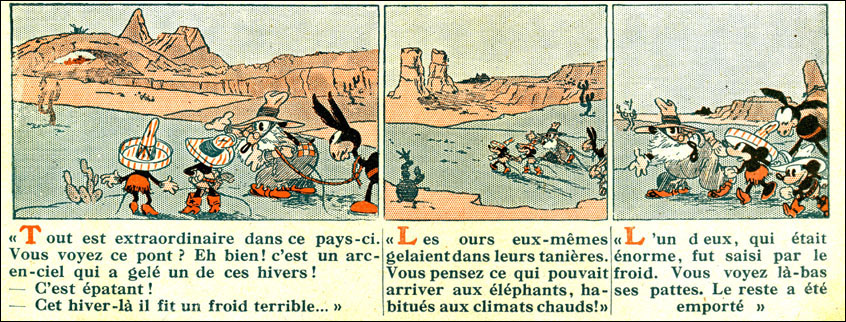/77/
LE CAPITALISME
EXISTE-T-IL ?

par François Fourquet
La Revue du M.A.U.S.S. semestrielle, n° 9, 1997
En posant cette question
incongrue, mon ambition est philosophique : déchosifier l’économie.
Et le capitalisme par la même occasion. Je suis bien téméraire : le MAUSS,
en posant la question de savoir comment on peut être anticapitaliste, nous
aurait-il conviés à parler d’une chimère : le capitalisme.
Pour la pensée de gauche, et
je me considère comme de gauche, je mesure tout ce que mon propos a d’iconoclaste. Il s’agit bien de briser une
icône. Non que je sois animé d’un désir militant de dénoncer les chimères de
gauche pour chanter, avec la droite, les couplets du béni-oui-oui libéral. Je
suis très concerné, comme nous tous, par la pauvreté dans les pays riches, par
les débats sur la fin du travail et sur le revenu inconditionnel. Je suis très
concerné par l’inégalité du monde, par la misère du Sud, par la violence de
l’exploitation, par la souffrance de ceux qui les subissent. Je suis très
concerné par la disparition progressive des sociétés et des cultures anciennes.
Je suis très concerné par la détérioration de notre planète Terre et la crainte
que nous ne l’épuisions à force d’exploiter ses ressources non renouvelables.
Je suis très concerné par la perte de sens vécu par les hommes concrets au
moment où pourtant s’offre à l’humanité un moment prometteur d’unité et,
pourquoi pas, de paix et de bonheur, toute guerre bannie entre les nations,
entre les civilisations : car tout en me sentant français, voire en me
sentant basque, je me sens avant tout cosmopolite, citoyen du monde.
Alors, pourquoi mettre en
doute l’existence du capitalisme,
si commodément responsable de l’ensemble de ces menaces et de ces maux ?
Tout simplement parce que je n’y crois plus ; pas plus qu’à l’autonomie
de la sphère économique.
Je ne fais que poser la question de l’existence, sans y répondre de manière
péremptoire. Je suis devenu prudent. On peut se tromper. Pour m’être si souvent
planté, pour avoir cru dur comme fer à l’existence de ce qui m’est apparu plus
tard comme des chimères collectives ou personnelles, je fais attention.
Je ne crois plus trop à la rationalité de notre entendement ; mais je sens bien active en moi cette
faculté particulière de la raison qui est de mettre en doute les évidences les
mieux établies. En cela, je suis cartésien jusqu’à la moelle, tout autant que
kantien.
Mais je suis aussi, institutionnellement,
universitaire et professeur d’économie, et on trouvera léger,
voire affecté, que je mette en doute l’existence de ce qui fait mon gagne-pain
et ma reconnaissance sociale. C’est pourtant le cas. J’assume ! C’est que
je crains qu’en reprenant l’héritage idéologique dont est chargé le mot
« capitalisme », nous n’héritions en même temps de l’aveuglement
propre à cet héritage. Dès sa naissance, le mot, « capitalisme »
(sous la forme où il a été inventé par Marx — le « mode de
production capitaliste »), avait une fonction politico-morale : dénoncer les maux de la société issue de la
révolution industrielle pour annoncer le nouveau mode de production porteur des
espérances humaines, le socialisme. La prophétie d’un paradis terrestre à venir
impliquait la définition de la société moderne comme enfer à détruire : et
cette destruction espérée, c’était la révolution socialiste.
Comme Marx était convaincu de
la scientificité de sa méthode, il ne pouvait présenter ces maux que comme des
contradictions objectives conduisant à la destruction endogène du mode de
production capitaliste ; et
le socialisme non comme un espoir, mais comme le fruit inéluctable, la
conséquence scientifiquement
/78/ nécessaire de cet effondrement, de la même manière que le
capitalisme était lui-même nécessairement sorti des entrailles de la société
féodale.
Seulement, voilà : je me
suis rendu compte, il y a bien longtemps, que le socialisme n’existait pas,
sinon dans l’imagination du mouvement socialiste et communiste ; et que le
socialisme dit « réel » n’était précisément pas du socialisme, mais
une espèce de moderne despotisme oriental. J’en ai tiré la conclusion : le
capitalisme est le repoussoir moral-politique du socialisme ; or le
socialisme n’existe pas non plus ; donc le capitalisme n’existe pas.
« Le capitalisme n’est intelligible que s’il est dénonçable, et seulement
alors », écrivais-je (1974, p. 125). Dans la logique du mouvement
socialiste, la création d’une entité fantastique et mauvaise était
indispensable pour déclencher l’indignation morale. Car comment pourrait-on
avoir envie de changer le monde si l’on n’est pas convaincu qu’il est
intrinsèquement mauvais ?
C’est toute la question ! Depuis cette époque, j’ai été attiré par
une position subjective : il n’est pas nécessaire de dénigrer le monde
pour le faire évoluer. Au contraire, les émotions morales (personnelles et
collectives : indignation, ressentiment) mises en jeu dans la dépréciation
du monde sont les moins propres à susciter les énergies susceptibles de le changer.
C’est un paradoxe philosophique insoluble, indépassable intellectuellement,
mais tout à fait observable pratiquement. Je n’essaierai de convaincre
personne, d’abord cela ne sert à rien, ensuite ce n’est communicable que
d’expérience à expérience.
Dans cet article non plus, je
ne cherche à convaincre personne. Il n’y a rien à prouver. Comme je fais partie
d’un réseau dont j’apprécie l’amitié et l’intelligence collective, je dis où
j’en suis intellectuellement, c’est tout. Je cherche à partager et non pas à
convaincre. J’ai beau faire, je n’arrive pas à voir dans le capitalisme autre
chose qu’un mirage. Nous pouvons très bien travailler à améliorer les choses
sans pour autant nous embarrasser de mythes qui déclenchent en nous
inconsciemment des émotions inutiles, et qui par conséquent nous asservissent
et nous empêchent de faire librement ce que nous avons à faire. Et voilà
tout !
UN
PROBLÈME PHILOSOPHIQUE
Je ressens un sentiment de malaise latent face à la
représentation qu’on donne souvent du capitalisme comme entité substantielle
fonctionnant selon des lois autonomes, bien que, admet-on, elle soit associée
aux autres « sphères » de
la société. Mon but est de suggérer que l’économie et le
capitalisme n’existent pas . En tout cas, pas comme une partie de la réalité sociale
existant en soi et pourvue d’une sorte d’autonomie, de capacité
d’autodétermination, obéissant à des lois de fonctionnement et de développement
propres. Il existe certes des institutions, des groupes, des flux qui font
l’objet d’un ensemble
disparate et souvent conflictuel de politiques
économiques. La résultante de ces
politiques est un ensemble nouveau, irréductible, imprévisible. même par les États
majeurs de la planète : l’économie mondiale.
|
« Mon but est de suggérer que l’économie et le capitalisme n’existent pas. En tout cas, pas comme une partie de la réalité sociale… » Donc, selon cet auteur, l’économie (je laisse pour l’instant de côté le capitalisme, il attendra bien un peu) l’économie n’est pas une partie de la réalité sociale. Cela correspond tout à fait à la définition qui est donnée dans les dictionnaires : économie, ensemble de… Un ensemble ne saurait être une partie que d’un autre ensemble mais jamais d’une chose. Par exemple (exemple dû à M. Descombes et à Frege avant lui) l’ensemble des arbres d’une forêt n’est pas une partie de la forêt. Et c’est bien le moindre si l’économie n’existe pas. Bien. « Il existe certes des institutions, des groupes, des flux qui font l’objet d’un ensemble disparate et souvent conflictuel de politiques économiques. » 1) Un ensemble ne saurait « avoir un objet » constitué d’institutions, de groupes et de flux. Ce sont ces institutions, groupes, flux qui sont directement les objets de politiques économiques. 2) Ensemble disparate signifie que ses éléments (institutions, groupes, flux, doctrines etc. appartiennent à des ensembles non inclus dans l’ensemble disparate mais tels que leurs intersections avec l’ensemble disparate ne sont pas vides. Ainsi, toutes les instituions, groupes, flux etc. ne sont pas l’objets des politiques considérés. Seuls certains le sont. Il s’agit seulement d’un classement comme le dit si bien M. Fourquet dans son livre Richesse et puissance. Et c’est tout ce que l’on peut dire. Ces institutions, groupes, flux etc. sont dits, à juste titre, économiques parce qu’ils sont l’objet de politiques économiques. Point final. « La résultante de ces politiques est un ensemble nouveau, irréductible, imprévisible. même par les États majeurs de la planète : l’économie mondiale. » Aussi nouveau, irréductible, imprévisible que soit l’ensemble résultant de ces politiques, il n’en demeure pas moins un ensemble et de ce fait, il n’est, lui aussi, aucune partie du monde. Ainsi définie, l’économie-monde n’est aucune partie du monde et donc n’existe pas plus que n’existe l’économie. Elle existe seulement comme un ensemble, seulement comme une classe. Si elle existe, alors elle n’est pas un ensemble, mais une institution, par exemple, et elle doit être décrite. Sinon, son nom est seulement un nom qui ne préjuge pas de son existence. Son nom sert seulement à masquer l’ignorance qu’on en a. |
Cette affirmation ontologique radicale sera nuancée
par la suite, puisqu’il faut bien se servir des mots de la langue et qu’aux
mots « économie »,
« capitalisme », doit bien correspondre quelque
« chose » dans la réalité humaine. Je m’efforcerai de préciser dans
quel sens ces mots peuvent signifier /79/ une expérience historique, une
série d’événements survenus dans l’espace/temps concret de l’histoire des
hommes. L’enjeu épistémologique, mais aussi pratique, est simple : seul existe le tout ; et le tout est immédiatement
planétaire. Mais il est aussi multiple et polyvalent. Les activités,
institutions ou flux qu’on sélectionne, qu’on rassemble et qu’on fait entrer de force dans un récipient
verbal appelé « économie » n’ont aucune sorte d’intelligibilité
propre en dehors de leur relation au tout, puisqu’ils n’existent pas de manière
séparée.
|
« Cette affirmation ontologique radicale sera nuancée par la suite, puisqu’il faut bien se servir des mots de la langue et qu’aux mots « économie », « capitalisme », doit bien correspondre quelque « chose » dans la réalité humaine. » Pour l’économie, la correspondance est simple : l’économie est l’ensemble (oui, l’ensemble) des objets traités par la science économique et des objets des politiques nommées à juste titre « économiques », que ce soient celles des États ou celles des féroces rentiers d’affaire qui demandent quinze pour cent de retour sur investissement et qui savent parfaitement quoi faire pour y arriver comme on peut le constater tous les jours depuis 1989. « L’enjeu épistémologique, mais aussi pratique, est simple : seul existe le tout ; et le tout est immédiatement planétaire. Mais il est aussi multiple et polyvalent. Les activités, institutions ou flux qu’on sélectionne, qu’on rassemble et qu’on fait entrer de force dans un récipient verbal appelé « économie » n’ont aucune sorte d’intelligibilité propre en dehors de leur relation au tout, puisqu’ils n’existent pas de manière séparée. » Je n’ai rien à ajouter, c’est magnifique. Je souligne particulièrement : « Les activités, institutions ou flux qu’on sélectionne, qu’on rassemble et qu’on fait entrer de force dans un récipient verbal appelé « économie » [ce que M. Fourquet nommait ailleurs un « classement »] n’ont aucune sorte d’intelligibilité propre en dehors de leur relation au tout, puisqu’ils n’existent pas de manière séparée. » J’ajoute simplement que les féroces rentiers d’affaire (qui existent, eux, plutôt deux fois qu’une) qui demandent quinze pour cent de retour sur investissement, ainsi que leurs nombreux stipendiés propagandistes vomis chez nous par l’ENA et les écoles de commerce et qu’on peut admirer tous les jours à la télévision et dans le poste de TSF où ils agitent sans cesse et péremptoirement le mot « économie », n’ont cure de l’intelligibilité. L’intelligibilité, ils se la mettent où vous pensez. Il leur suffit que ça marche. Ils savent parfaitement comment faire et ça réussit complètement. Ce n’est heureusement pas le cas de M. Fourquet et je l’en félicite. Ce n’est pas mon cas non plus. Seule m’intéresse l’intelligibilité pour parler comme le Sartre de la Critique de la raison dialectique. |
Pourtant, la plupart des économistes, et beaucoup de
sociologues, sont convaincus que l’économie
forme un ordre autonome au sein de la société. L’origine de cette croyance
remonte à l’âge classique, lorsque s’est formée la
science économique
en tant qu’« économie politique [1] ». Mais, à l’époque, et chez Adam
Smith encore (1776), l’économie politique n’était qu’une branche de la
science politique ou science de l’homme d’État ; il n’était pas question de lui donner un statut autonome,
et encore moins de faire de l’économie
un objet séparé de la société. Ce n’est qu’avec Jean-Baptiste Say que s’opéra
cette mutation surprenante qui s’est achevée avec la désignation de l’économie comme économie de marché, sphère autonome au sein de la société (voire
déterminante), et de la science économique comme
science positive indépendante des autres sciences sociales (voire leur modèle
scientifique, grâce à la possibilité de soumettre le
calcul économique marchand à la
formalisation mathématique).
|
Donc, pour notre auteur, l’économie n’est pas un ordre autonome au sein de la société. Très bien. Mais ce n’est pas seulement la plupart des économistes
et beaucoup de sociologues qui sont convaincus que l’économie forme un ordre autonome
mais la multitude de robots que l’on entend dans les postes de télévision et
de TSF, qu’on lit dans les journaux. D’ailleurs, il y a un paradoxe à dire que des robots sont
convaincus puisqu’ils ne sont en fait que programmés dans des écoles spéciales
(il ne faut pas oublier le robot Debord,
grand apôtre de l’économie) et cela depuis une date bien précise :
1960 (Ian Hacking). |
Karl Polanyi fut un des premiers à rendre compte de
cette transformation en décrivant l’émergence historique du libéralisme et son
échec dans le premier tiers du XXe siècle, puis en proposant une distinction éclairante entre deux
sens du mot économie,
substantiel et formel [2]. Je rejoins, je crois, la route de Polanyi,
puisque depuis longtemps je récuse comme lui l’assimilation /80/ de l’économie à l’économie marchande, et explore une piste menant à la nature politique
de l’économie moderne
dans son fonctionnement institutionnel réel :
une façon peut-être polanyienne de réinsérer (to embed) l’économie dans la société, non
plus ancienne, mais contemporaine. Ainsi, le libéralisme n’aurait été qu’une
parenthèse imaginaire dans l’histoire des sociétés humaines.
|
Amazon m’indique que ma commande de The Great Transformation est expédiée. Je vais enfin lire Polanyi. Les mots importants ici me semblent : fonctionnement institutionnel réel (ce qui a lieu donc). Je ne vois pas comment on peut affirmer à la fois que l’économie n’existe pas et récuser l’assimilation de l’économie à l’économie marchande. Il me semble qu’il y a là une rechute de grippe grammaticale. Je verrai cela bientôt (c’est fait) →. |
Cet article est donc pour moi l’occasion de me confronter à mes difficultés, d’énoncer clairement mes intuitions et de les soumettre à la critique de la communauté des chercheurs en sciences sociales.
C’EST LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE QUI
CRÉE L’ÉCONOMIE
|
Comment peut-on écrire que c’est la politique économique qui crée l’économie alors que l’on a écrit que c’était le crétin Jean-Baptiste Say ? La politique économique produit un certain état du monde mais certainement pas l’économie. |
L’économie
entretient une relation particulière avec le « capitalisme »,
considéré depuis Marx et Weber comme la forme moderne de l’économie dans la société
industrielle [3]. Pour moi, le capitalisme n’est
jamais qu’un mythe politique et scientifiques [4].
|
Comment peut-on écrire que l’économie entretient une relation particulière avec le « capitalisme » alors que l’on a écrit que l’économie n’existe pas ? Forte poussée de fièvre grammaticale. Au contraire, c’est le capitalisme qui entretient une relation particulière avec l’économie puisque celle-ci fut inventée par un thuriféraire du capitalisme et entretenue puis widespreadée par ses lointains continuateurs. Le capitalisme a besoin de propagande, il entretient donc une relation particulière avec sa propagande. Plutôt que de propagande, il s’agit en fait de désinformation. On ne vante pas la marchandise, on se contente d’affirmer qu’elle existe, et cela certainement de bonne foi. Il n’y a de meilleur désinformateur que le désinformateur de bonne foi. C’est la définition du virtualisme par M. de Defensa : le propagandiste qui croit à sa propagande, tel J-B Say. Mon avis est que le capitalisme est le nom d’une époque (de même que « la Régence » ou « le Directoire », par exemple), époque qui commence vers 1840 et qui voit, pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, les commerçants se charger eux-même de l’exploitation des esclaves rebaptisés pompeusement citoyens. Un fabricant, le propriétaire d’un satanic mill, Engels par exemple, est avant tout un commerçant puisque « ses » produits le sont pour la vente, selon la définition empirique de la marchandise par Polanyi. Il y a donc hypostase, péché d’hypostase, exactement comme pour l’« économie ». |
La consistance du capitalisme est parfois définie par sa capacité d’autoreproduction [5]. Or la reproduction est impensable sans un appareil politique et une quasi-subjectivité qui opère cette reproduction [6]. Je ne vois /81/ pas comment on peut se représenter l’économie comme purement marchande, sans État, sans institution fondamentale de la souveraineté politique [7]. D’abord, il n’y a d’économie que pour un quasi-sujet, individu, classe ou humanité. Et, parmi ces quasi-sujets, se détache un sujet privilégié plus consistant que d’autres : l’État [8], responsable de la richesse collective, donc de la politique économique, à côté d’autres responsabilités souveraines ou fonctions : la guerre, l’unité religieuse ou culturelle, la justice, la santé et l’éducation publiques, etc. [9]
L’économie, dès lors, apparaît de nos jours non pas comme
une chose ou une « structure » spécifique ordonnée par ses
lois, mais banalement comme l’objet d’une politique économique, un ensemble de relations, de flux, d’institutions traités par l’État
dans le cadre de sa gestion politique. En ce sens, mon approche est
nominaliste, comme elle le fut jadis à propos des équipements collectifs ou des
catégories nosographiques de l’hygiène mentale : la chose n’existe pas avant le mot, avant qu’elle ne soit
nommée par l’État au moment où il élabore une politique visant la chose ; cette idée est un aspect de ce
que j’appelle la théorie étatique de la connaissance [10].
|
Le spectacle est le spectacle de l’économie NON ! c’est exactement le contraire : l’économie « apparaît » (en fait, c’est comme l’arlésienne, on en parle tout le temps comme d’une chose, mais on ne la voit jamais) de nos jours comme une chose (sinon, quel serait le but de cet article qui entend « déchosifier » l’économie ?) comme l’objet d’une politique économique et non pas comme elle est, c’est à dire soit comme un ensemble, soit comme une politique économique. Elle est réputée être une chose, une institution, alors qu’elle n’est qu’un ensemble, un classement comme dit judicieusement Fourquet dans Richesse et puissance. C’est ça le spectacle de l’économie. Voilà donc le spectacle de l’homme à la théorie exacte et à la petite quéquette : le spectacle est le spectacle de l’économie. Funny ! Il n’y a pas d’économie, il n’y a qu’un spectacle de l’économie. C’était simple, il suffisait d’y penser. Je suis étonné de ne pas y avoir pensé plus tôt (04-03-2007), après tant d’années de recherches (mais si, j’y avais déjà pensé lors de ma lecture de Frege comme en témoigne cette note). Merci surintendant Fourquet. C’est ce qu’il y a d’étonnant avec la philosophie analytique, il suffit de le dire pour être guéri instantanément : lève-toi et marche. L’État, mais aussi bien les féroces rentiers d’affaire, qui existent, eux, ne traitent pas un ensemble, mais chacune des relations, flux et institutions qui les intéressent. Ils sont nominalistes dans leur pratique avant que le surintendant Fourquet n’ait songé à l’être. Il ne faut pas confondre les maîtres et les propagandistes payés par les maîtres. |
/82/ Mais l’État est partagé entre deux aspects de ses responsabilités, deux manières d’envisager cette politique, deux points de vue : intérieur (national) ou extérieur (mondial). La politique extérieure de puissance prévaut sur la politique intérieure d’abondance pour les citoyens, d’égalité, de justice sociale ou territoriale [11]. De cette donnée, que l’on peut observer empiriquement dans l’histoire, résulte que la politique économique est d’abord une politique extérieure. Elle apparaît en effet comme un aspect de la politique tout court, ensemble des mesures prises par l’État pour valoriser la puissance nationale (il est là pour ça) ; la puissance économique n’est jamais qu’un aspect de la puissance nationale.
Ainsi, même intérieure, la politique économique est internationale. Par suite, l’économie nationale, qui est son objet spécifique, s’élargit à l’ensemble du monde, se confond avec l’ensemble des relations « économiques » entre les institutions nationales et les institutions étrangères. L’objet « économie » se dissout en quelque manière dans l’ensemble de l’économie mondiale. Le moindre phénomène national est immédiatement mondial, pour /83/ peu qu’on étudie avec finesse les circonstances et conditions de son existence même.
L’économie nationale n’est donc en aucune manière limitée par le territoire national : illusion d’une représentation spatiale de l’économie définie trompeusement par l’ensemble des relations, institutions et flux intérieurs au territoire national. « Intérieur » et « extérieur » sont des mots qui n’ont de sens que par référence à un ensemble spatialement fermé, ce qui est le cas du territoire cerné par des frontières ; mais si on scrute cet espace, on y discerne le monde tout entier. Et le monde détermine le local comme le tout détermine les parties.
Dans cette perspective, la vue se brouille, l’économie nationale se dissout, en quelque sorte, elle disparaît. L’économie est d’emblée mondiale, et ce qu’on nomme « économie nationale » n’est qu’un aspect de cette économie mondiale dans la mesure où celle-ci est reliée aux institutions ou groupes nationaux, qu’ils soient ou non physiquement situés sur le territoire national [12]. À ce stade du raisonnement, nous pouvons définir l’économie comme l’ensemble des objets des politiques économiques de tous les États du monde, et non pas comme la somme des économies nationales. Mais, bien sûr, ces États ne sont pas sur le même plan : toujours, l’un domine, les autres font avec cette dominance, s’y résignent ou lui résistent. Et la politique économique du pays dominant (aujourd’hui l’Amérique) tient lieu de politique économique dominante, comme on le voit avec le système des changes flottants ou la globalisation productive, financière et commerciale.
En s’étendant à l’échelle mondiale, l’économie ne se transforme pas pour autant en « chose ». Son unité et sa cohérence ne lui viennent pas de ses lois propres, mais de la circonstance qu’elle existe comme objet d’un complexe de politiques économiques s’ajustant plus ou moins efficacement à travers les conflits entre forces inégales subordonnées à la principale d’entre elles. Il n’y a pas de totalité sans pouvoir. La monnaie du monde, par exemple, n’existe pas en soi, bien qu’on puisse palper un dollar. Elle n’existe que comme création des politiques monétaires des États. Le résultat de ces actions communes échappe très souvent au contrôle des États, même les plus puissants, même l’État leader de l’économie-monde, encore que ce dernier, dans la mesure où il capte les forces subordonnées, maintienne vaille que vaille l’unité relative du monde.
Il est donc difficile de considérer l’économie en général (sans préciser si elle est nationale ou mondiale) comme une entité autonome, et autoreproductive, un « ordre » ou une « infrastructure », qu’elle soit ou non déterminante en dernière instance.
/84/
L’ÉCONOMIE
MONDIALE PRÉCÈDE LES ÉCONOMIES NATIONALES
Pour
nous aider à démêler les fils enchevêtrés et voir plus clair dans cette affaire, faisons appel aux historiens.
Historiquement les économies nationales ont été créées par fragmentation d’un espace politique considérablement étendu, autrefois unifié par un empire puis fragmenté par une sorte de catastrophe civilisationnelle tout à fait improbable, un événement cosmique qui s’est déroulé sur plusieurs siècles : la décomposition ou écroulement sur lui-même de l’Empire romain (implosion conjuguée avec les assauts des Barbares). Et au Moyen Âge, ni les empereurs ni les papes n’ont réussi à reconstituer ledit empire sous leur autorité.
D’autres événements sont
concomitants. D’abord la séparation, en Europe
médiévale, du commandement politique et de l’autorité spirituelle, tous deux
candidats à la direction de la chrétienté, et tous deux neutralisés par leur
rivalité. L’empire et l’Église en sont sortis disqualifiés au profit d’autres
partenaires. Cet échec mutuel a engendré un dispositif d’une grande nouveauté dans l’histoire de l’humanité : la laïcité, qui eut d’énormes conséquences [13].
Ensuite
la formation, dans les décombres de l’empire, des premiers royaumes soutenus par le pape contre l’empereur, mais
qui se retournèrent contre lui et formèrent plus tard, par leurs guerres
permanentes — des guerres civiles
européennes en quelque sorte — les
premiers États-nations de la modernité.
Ces États-nations furent les inventeurs des
politiques économiques mercantilistes dans l’effort même d’affirmer leur
puissance. Autre conséquence encore :
l’avènement des cités-États italiennes
politiquement souveraines, échappant à la mainmise des grandes puissances territoriales
(papauté, empire, royaumes) et porteuses de la civilisation urbaine,
commerciale et maritime héritée de l’antiquité gréco-romaine. En un mot, porteuses
du premier « capitalisme » médiéval. De cette conjoncture
improbable naquit ce que Fernand Braudel,
dès 1949, nomma « économie-monde », ensemble spatio-temporel de
grande dimension, à dominante économique, dont il étudia les forces et l’histoire singulière
à travers la succession de ses capitales,
les « villes-mondes », de Venise à Amsterdam et à
Londres. Ces villes furent les
centres qui attirèrent et redistribuèrent une bonne partie des richesses de l’Europe, puis de la planète.
Le
capitalisme est le nom donné à l’ensemble des institutions et groupes humains
(la bourgeoisie, si l’on veut) engendrés au cours de la construction de l’Europe, gérant la production des ressources
matérielles de l’humanité européenne
et la circulation de ces « richesses ». Le capitalisme, selon Braudel /85/
du moins, ne couvrait pas toute l’économie ; il n’en
était que l’étage supérieur, au-dessus
de la civilisation matérielle et de l’économie
de marché. Il en était la partie la
plus agile, la plus apte à faire du profit (en jouant des différences de potentiel à l’échelle de la planète)
et la plus secrète dans ses affaires
(pratique obstinée du monopole). Ce capitalisme n’était pas une abstraction
(«mode de production »), il
était formé de dynasties marchandes haut placées dans la hiérarchie sociale,
généralement installées dans la ville monde,
et considérant le monde entier comme un champ de profit. La souveraineté des cités-États et donc leur indépendance
politique vis-à-vis des États et empires territoriaux fut, je crois, le
fondement historique de l’émancipation de la
richesse marchande mondiale et put, par la suite, donner l’illusion d’une
autonomie de l’économie de
marché par rapport à la sphère politique
mondiale.
Or,
chez Braudel ou Wallerstein, les rythmes de l’histoire et l’espace aux limites
floues de l’économie-monde européenne se confondent avec ceux de la civilisation occidentale.
En effet, loin d’être indépendante des autres
dimensions de la société européenne, l’économie-monde suppose toutes ces dimensions
(religieuse, politique, culturelle, scientifique ou technique, etc.) et ne se
comprend pas sans elles. Cette conclusion me conduit à me demander si l’économie-monde n’est pas, tout simplement, la manifestation dite « économique » de la civilisation occidentale.
LE CAPITALISME EST L’ASPECT
ÉCONOMIQUE
DE LA CIVILISATION OCCIDENTALE
Depuis un peu plus d’un siècle,
nous disposons avec le mot « civilisation »
d’un concept-cadre permettant de conserver les avantages de la notion d’économie-monde
(une formation sociale au-dessus
des États et les incluant) tout en examinant la fusion de toutes
les dimensions d’une société sans
privilégier obligatoirement l’économie.
Dans ce concept, la place de l’économie n’est pas désignée, il
faut la construire.
Cette place n’est
pas celle d’une structure autonome. Les
institutions économiques,
certes, les entreprises par exemple, sont des quasi-sujets qui disposent d’une relative capacité de décision.
Rien n’est mécanique du moment que la
subjectivité humaine est en cause. Mais de l’autonomie relative des groupes et
institutions, on ne peut nullement inférer l’existence d’un ordre économique autonome et articulé avec les autres ordres [14] « Ordre » ♦ /86/
implique une organisation spécifique et séparée ; alors que, dans la conception d’une civilisation, seule la
civilisation (ou la société globale) fonctionne et se reproduit de manière
autonome. Et encore, comme on va le voir, cette autonomie est elle-même sujette
à caution. Dans une société étendue à l’échelle d’une civilisation, tout est
dans tout d’une certaine manière, et pourquoi pas réciproquement ? Chaque individu, chaque groupe
fonctionne bien de manière autonome, mais l’unité se fait par la conscience
pratique d’une appartenance à un ensemble supérieur. Cette appartenance conditionne
d’ailleurs de manière invisible le fonctionnement autonome des parties. Sans
elle, sans le sentiment « d’en
être », qu’il soit ou non
conscient, rien ne marcherait et tout s’écroulerait ; les crises seraient insurmontables.
|
♦ Je me permets d’ajouter des guillemets à « Ordre » sinon il faudrait écrire « Ordre [qui] implique une organisation spécifique…. » Je lis : « Parler d’ordre implique une organisation spécifique et séparée. » Il faut lire ce genre de texte soigneusement étant donné l’incalculable nombre d’approximations et confusions qui ont cours, dans le monde, sur ces questions épineuses. Comme dit Popu : « C’est la bouteille à l’encre. » |
Dans ce parcours historique, je suis tombé sur une difficulté logique : si, d’après mes propres prémisses, l’économie n’est rien d’autre que ce qui apparaît au regard de l’État menant une politique économique, qu’était-ce donc que l’économie avant la formation d’un État européen capable de se poser un problème de politique économique ? L’aporie s’énonce ainsi : l’économie n’apparaît qu’avec l’État sujet d’une politique économique ; or l’État n’émerge vraiment qu’au XIVe siècle ; donc l’économie n’existe pas avant le XIVe siècle, bien qu’au dire des historiens le marché et la circulation monétaire mondiale, eux, soient apparus bien avant.
La notion de civilisation présente l’avantage de constituer une unité historique intelligible située au-dessus des États, caractérisant une société étendue aux dimensions de l’Europe et comprenant les sociétés nationales formées au Moyen Âge et à la Renaissance. C’est un concept opérationnel. Cette démarche de recherche, explicitée par Toynbee (1934), est aussi celle par laquelle Wallerstein (1980) a justifié l’emprunt de la notion d’économie-monde : voir plus loin et plus haut que les États-nations.
Bien qu’on puisse la considérer sous de multiples aspects (y compris esthétiques, spirituels, etc.), la civilisation n’en forme pas moins un ensemble cohérent identifiable entre tous, quelles que soient les affinités qu’on puisse lui trouver avec d’autres civilisations. Une communauté humaine, étendue au-delà des États et existant avant eux, s’est formée lentement, inconsciemment presque, s’imposant aux États eux-mêmes par un mouvement en profondeur affectant individus, institutions, groupes, mentalités, tout en étant fabriquée par eux. Un mouvement autonome produisant un « ordre spontané » (expression par laquelle Hayek désigne l’ordre du marché). « Europe » fut le nom donné à cette communauté.
Un autre fait historique suggère l’unité de cette communauté humaine caractérisée par sa civilisation : l’existence à un moment donné d’une seule capitale de fait, soit pour les marchés et les monnaies (la ville-monde de Braudel), soit pour la culture, soit pour tel autre élément civilisateur. Mais aucune capitale proprement politique ne s’est détachée, ce qui eût été le cas si un bâtisseur d’empire avait durablement imposé sa domination à l’Europe. Une des originalités de la civilisation de l’Europe, à la différence des empires orientaux, c’est la consistance et la vitalité d’un cercle de villes /87/ proches de la ville-centre de l’économie-monde, complétant l’hégémonie de celle-ci par des apports précieux sans lesquels la ville-monde ne serait pas leader : ainsi Milan ou Florence par rapport à Venise, Paris par rapport à Londres, etc.
Cette caractéristique me conduit à m’interroger sur la nature quasi politique de la ville-monde, pourtant définie seulement économiquement. La civilisation occidentale (née en Europe) est aussi originale que les autres, mais certains traits caractéristiques lui ont permis de dominer les autres, jusqu’à présent du moins. Et par conséquent d’étendre à l’ensemble du monde (par la force brutale mais plus souvent par l’attraction) les institutions et coutumes que nous qualifions d’« économiques », et auxquelles, depuis Marx, une tradition de gauche a donné le nom de « capitalisme ».
LA PLURALITÉ DES CIVILISATIONS :
LE TEMPS DU MONDE
Très vite la notion de civilisation trouve une limite à sa valeur opératoire. Si Spengler considérait les civilisations comme des sortes d’individus historiques doués de quasi-subjectivité et de vie (naissance, apogée, vieillissement et mort), il n’en est pas de même des historiens qui, avec et depuis Toynbee, ont utilisé cette notion. Les civilisations naissent et se développent à plusieurs, et la personnalité de l’une ne peut se comprendre sans les influences reçues de et données à toutes les autres. En allant jusqu’au bout de cette idée, on s’aperçoit que les civilisations du globe se sont lentement engendrées les unes avec les autres, ou les unes contre les autres, ce qui revient au même. Et cela dès le paléolithique [Varagnac, 1959].
« Quelque chose » lie les unes aux autres les civilisations ou même les cultures primitives. Mais quoi ? Un fil ténu, même pas, un filigrane, une vibration, un je-ne-sais-quoi auquel pas un économiste ne prêterait attention tant sa traduction marchande est infinitésimale : peut-on inférer quoi que ce soit de la présence, à Mohendjo-Daro, d’un tesson de céramique provenant de Sumer ‘? Comment l’intangible pourrait-il peser sur la balance de la richesse matérielle ?
Autre observation : plus près de nous, les capitales de l’économie-monde ont toutes été des ports situés au départ des routes maritimes mondiales conduisant aux ports des autres économies-mondes. On dirait que la relation extérieure détermine la situation géographique de la ville-monde à l’intérieur de sa propre civilisation.
Partout, toujours, dans la
dialectique de l’intérieur et de l’extérieur, prévaut la relation à l’extérieur, à l’ensemble du
monde, comme si ce cordon ombilical avec la matrice du globe, avec l’humanité
tout entière, télécommandait la vie intérieure dune civili. Le tout a
historiquement précédé la partie ;
l’humanité a atteint le, quatre coins du globe il y a environ deux millions
d’années, avec l’exploration planétaire de l’homo habilis. Et aujourd’hui
le tout prévaut toujours sur la panique. Cela suggère qu’au delà /88/ de la diversité et de l’autonomie (évidentes)
des civilisations, l’histoire de l’humanité est une, puisque l’histoire
(l’existence dans le temps et l’espace concrets) d’aucune de ses parties n’est
intelligible sans ses relations avec toutes les autres. Chaque civilisation a
son temps, ses rythmes, ses ruptures et ses continuités, c’est vrai ; mais au-delà de ces temps, non,
au cœur de ces temps diversifiés et décalés, bat un rythme commun, un « temps du monde » qui n’est pas transcendant, mais immanent. C’est ce qui
explique l’effort démesuré de certains historiens pour saisir l’histoire de
l’humanité dans sa quasi-totalité, dans la longue durée de l’espace planétaire
(Toynbee, Braudel).
De ce point de vue, « capitalisme » est le nom donné à l’immense
mouvement d’unification des civilisations accéléré depuis la fin du Moyen Âge.
La « mondialisation » qui se déroule sous nos yeux est
l’accélération d’une accélération.
L’Économie
mondiale est politique
Une autre conclusion reste à tirer. Elle est difficile à formuler : en l’absence d’une autorité
politique unique, c’est-à-dire d’un champ politique mondial identifié, reconnu
et institutionnalisé, la politique mondiale se joue à travers les dimensions
ordinaires de la communauté mondiale, et en particulier à travers l’économie mondiale. En l’absence
d’État mondial, le monde s’unifie par l’économie. Les firmes multinationales, je crois, tout en étant
les déléguées intéressées des nations où se situe leur siège (en particulier
l’Amérique), n’en sont pas moins porteuses de cette promesse d’unification
mondiale. L’économie capitaliste
ne cesse jamais d’être politique dans son essence.
Ici, le mot « politique » est à prendre au sens fort : ce qui fait que les hommes,
au-delà de leur diversité, forment une communauté humaine unique. Et vivent une
aventure unique. « Politique » ici désigne le champ virtuel
d’une autorité collective responsable des « politiques » à mener pour préserver
l’humanité et, pour reprendre un terme économique,
assurer son « bien-être », lequel dépend d’effets externes
impossibles à prendre en compte par les entreprises et les nations séparément.
« Politique » au sens fort indique l’existence d’une souveraineté, donc
d’une citoyenneté mondiale.
De fait, c’est la ville-monde, « économique »,
qu’elle soit ou non en même temps capitale culturelle (mais elle n’est jamais
très loin de celle-ci, pour autant qu’il en existe une seule), qui a tenu et
tient lieu de capitale mondiale. De fait, aujourd’hui, New York capitale de l’économie-monde, [fort
heureusement bombardée depuis, précisément pour cette raison. Il ne faudrait
pas prendre les Bédouins pour des cons] est le siège des Nations-Unies,
autorité politique mondiale seulement symbolique, seulement virtuelle.
Depuis le miracle grec, la civilisation occidentale s’est détachée des
autres, pilotée par des peuples indo-européens. Son parcours fut brutalement /89/
interrompu par la catastrophe romaine. Cette coupure improbable fut la chance
de l’Europe, et sans doute la cause lointaine de sa conquête du monde. Même
aujourd’hui, en dépit des défis portés par des peuples orientaux ou arabes, le leadership
occidental reste assuré à travers l’hégémonie américaine. Sûrement pas pour
toujours, mais pour longtemps encore.
Néanmoins cette hégémonie a une configuration originale, bien qu’ancienne
dans l’humanité : celle d’un
leadership qui fonctionne moins par le glaive que par la culture, moins par la
force militaire que par l’attraction et la reconnaissance de sa position
dirigeante par la plupart des autres peuples relevant d’autres civilisations.
Cette configuration combine une culture commune au moins sur un registre opérationnel de
communication — une culture qui parle anglais et qui fait du commerce —
et une pluralité politique d’États symboliquement souverains en conflit permanent, violent ou pacifique,
militaire ou économique.
Cette matrice est classique dans l’histoire, comme le montre Toynbee, et
Baechler l’a très bien utilisée pour expliquer les origines du capitalisme.
Mais elle est particulièrement active dans le lent processus de fragmentation
de l’Empire romain et de floraison, vers l’an mille, du printemps du monde.
Depuis le succès de Venise la succession des leaderships s’est poursuivie sans
que jamais aucune instance parvienne à imposer un empire universel en Europe,
malgré les essais de Charles Quint, Napoléon ou Hitler.
Ainsi, l’humanité, aujourd’hui mise en relation intime par des moyens de
communication et de culture d’une puissance et d’une rapidité sans commune
mesure avec ce qui s’était fait jusqu’au XXe
siècle, est, de fait, unie, ou en voie d’unification. Mais en droit, cette
unité n’a aucune traduction institutionnelle efficace, sinon les organismes
internationaux péniblement mis en place depuis 1919, mais dont on sait bien que
ce n’est pas eux qui ont le pouvoir.
L’hypothèse avancée ici est qu’en l’absence d’un État politique mondial,
dont la création n’est d’ailleurs pas nécessairement souhaitable si l’on mesure
les dangers d’un empire mondial, l’aspiration politique de l’humanité s’exprime
à travers tous les canaux ; la
négociation des compromis indispensables à la coexistence de ses composantes
s’opère sur tous les champs, se « joue » sur tous les terrains de jeux.
Ce qu’on appelle « économie mondiale » est l’un de ces terrains de
jeux. Le principal, disent certains observateurs, mais est-ce si sûr ? Tout entière traversée par des
rapports de forces en conflit permanent, l’économie-monde, devenue aujourd’hui véritablement mondiale,
constitue certes un terrain privilégié d’ajustement permanent de ces rapports.
Cela ne signifie nullement que le « capitalisme
situé à l’étage supérieur de cette économie-monde ait une existence autonome, ni qu’il
soit mu par une « logique », c’est-à-dire par des lois de
fonctionnement ou d’évolution indépendantes des loi, de la puissance en
général. La puissance ne se divise pas, elle se déploie sur tous les
registres à la fois et imprègne tous les rapports mondiaux. Elle tait feu de
tout bois. C’est en ce sens qu’un rapport
mondial, même strictement économique en /90/ apparence, est un « rapport social total » au sens du « fait social total »
de Mauss : toute la
configuration mondiale est active au cœur de ce rapport.
On peut espérer, d’un point de vue humaniste, que ces affrontements et ces influences, perpétuellement remis en cause par la vie même du monde, ne déboucheront pas un jour sur un conflit militaire dont l’humanité aurait lieu de craindre d’y disparaître tout entière, brûlée par le feu nucléaire ou les radiations consécutives. Mais rien, aucune transcendance, ne garantit cet espoir. Tout est toujours possible, partout, à chaque instant.
NOTES
1. /79/
Économie politique : expression inventée au XVIIe siècle par Antoine de Montchrétien, l’économie politique n’est pas une science, mais un savoir-faire étatique
(par opposition à l’économie domestique), au sens où la stratégie n’est
pas une science, mais un art de la guerre. C’est Jean-Baptiste Say qui, à ma
connaissance, fut le premier (en 1826) à parler d’une « économie
des sociétés » : ici, « économie » perd sa signification pratique
d’art de bien gérer la richesse nationale pour prendre son sens moderne de
partie objective de la société, et devenir bientôt une véritable chose sociale dans des
expressions du type « les
États-Unis ont réussi à faire atterrir en douceur leur économie » [mais
pas toujours leurs navettes spaciales]. Depuis, le
mêne mot sert à désigner l’objet réel et la science de cet objet, d’où une
agaçante ambiguïté. Sur ce problème sémantique, voir Richesse et puissance, chap. 17, « Naissance de la
science économique », et « Une économie politique planétaire »,
La Revue du MAUSS
semestrielle n° 3, 1er semestre 1994. p. 251.
2. Économie substantielle, économie formelle. Le sens substantiel désigne l’activité universelle par laquelle les hommes se procurent leurs moyens d’existence matériels (livelihood) grâce à la transformation de la nature pour en extraire matière et énergie assurant la subsistance biologique (ce sens est proche de la « civilisation matérielle » de Fernand Braudel). Le sens formel désigne l’activité rationnelle d’agencement des moyens en vue de fins en milieu de rareté (correspondant à la célèbre définition de Lionel Robbins, 1932). Polanyi dénonce l’assimilation de l’économie (substantielle) à l’économie de marché dont s’inspire la définition formelle, alors que dans le passé existèrent de nombreuses sociétés sans marché, qui pourtant devaient bien, elles aussi, se procurer leur subsistance [Polanyi, 1977, p. 19]. (Je remercie Alain Caillé de m’avoir indiqué ce livre et invité à lire ce passage).
3. /80/ Capitalisme et économie. Pour Marx
(1857), le « mode de production
capitaliste » est propre à la
société bourgeoise. Il s’avance dans l’histoire, détruit le féodalisme et
s’effondrera de ses propres contradictions internes, laissant la place au
socialisme. Pour Sombart (1927) le capitalisme est un « individu historique »
quasi subjectif, qui a connu sa jeunesse et sa maturité, et connaît désormais
sa vieillesse : il est, comme
pour Marx, condamné à mourir. Pour Braudel, le capitalisme n’est que la partie
supérieure sophistiquée de l’économie marchande [1967, p. 437 ; 1979, vol. I, p. 8]. Cf. plus loin dans
cet article la partie intitulée « L’économie mondiale précède les économies nationales ». Pour Baechler, « toute
économie est de marché [
... ] Il n’y a pas d’économie
sans marché » [1995, p. I, 189], et « le capitalisme est
l’état de l’économie
qu’elle doit atteindre lorsque rien ne vient entraver sa loi, c’est-à-dire la
loi de l’efficacité » ♦
[ibid., p. 227].
La thèse de Baechler, d’une très
grande portée historique, institue une relation organique entre la genèse du
capitalisme et celle de la démocratie politique. Elle ne sera pas abordée dans
cet article, mais plus tard ;
car une réflexion sur les origines de notre modernité devra nécessairement
intégrer cette « théorie
politique du capitalisme moderne »
ibid., p. 1, 41].
|
♦ Hum ! Pour la clarté, Baechler
aurait dû écrire : « le capitalisme est l’état que l’économie doit
atteindre lorsque rien ne vient entraver sa loi », le capitalisme pur
selon l’enfoiré Hayek. Cet enfoiré était du genre à enfoncer des aiguilles
désinfectées sous les ongles, comme le
distingué Posner, si cela s’avérait nécessaire pour atteindre le
capitalisme pur. Ces enfoirés sont très à cheval sur la morale (aujourd’hui,
les micro-ondes savamment ajustées, vont rejeter les aiguilles désinfectées
dans la préhistoire de la civilisation WASP). Il me semble que pour Polanyi, l’économie n’est rien
d’autre que le marché libre qu’il définit axiomatiquement ainsi :
a) est une marchandise ce qui est produit pour la vente, b) quoique
non produite, la terre est traitée comme une marchandise, c) quoique,
dans les temps héroïques, la monnaie ne soit produite (que Polanyi nomme
monnaie-marchandise par opposition à monnaie fiduciaire) que pour l’achat,
elle est aussi traitée comme une marchandise, d) quoique non produit, le
travail est traité comme une marchandise et le travailleur comme un produit
(la ressource humaine !). De cela il s’ensuit nécessairement :
destruction de la nature, destruction de l’humanité. Remède proposé par
Polanyi à l’anti-humanité du marché libre : pas d’aiguilles sous les
ongles mais retirer du marché la terre, la monnaie et le travail et ne
conserver dans le marché que les marchandises proprement dites. |
4. Le capitalisme est un mythe. [le mot « capitalisme » ne désigne pas une réalité objective, mais le mauvais objet de l’idéal historique socialiste. Il tire son sens plein (et sa charge affective) de son opposition distinctive au socialisme (son avenir espéré) et au féodalisme (son passé de l’âge sombre) [Cf. Fourquet 1974, p. 125 ; 1988, p. 86 ; 1989, p. 31, ainsi que l’introduction du présent article].
5. Reproduction du capitalisme : Beaud, 1989, p. 151. C’est ce passage qui fut le point de départ de cet article. Michel Beaud est l’auteur de plusieurs livres sur l’histoire du capitalisme et l’économie mondiale contemporaine [1981 ; 1987 ; 1989] ; je poursuis avec lui, depuis des années, un dialogue amical.
6. Un quasi-sujet est une institution représentative d’un groupe, d’une profession, d’une classe, d’une nation, bref d’un ensemble collectif [Pardon, pas un ensemble, pas une collection d’individus, mais une collectivité. La collectivité est présente en chacun de ses membres, contrairement à la collection, elle est de ce fait dotée d’un intérieur. Durkheim dirait que c’est ce qui permet à chacun de se surpasser. La subjectivité d’une collectivité n’est pas une illusion mais une réalité. Elle permet à dix-mille hoplites, par leur simple détermination, sans qu’ils aient à faire un geste, de mettre en fuite soixante-mille soldats esclaves (Anabase)] auquel une personne, un chef, une équipe dirigeante [Non nécessaire chez les hoplites, ce qu’étaient incapables de comprendre les Perses. L’assassinat, au mépris de l’hospitalité, du général en chef et de son État major ne servit à rien. Les Grecs se contentèrent d’élire immédiatement d’autres officiers et à Xénophon échut le commandement de l’arrière garde. Choix judicieux, on en parle encore de nos jours] prête sa pensée, sa parole et sa volonté, donnant ainsi l’illusion d’une subjectivité de l’institution [Les institutions ne sont pas des ensembles, des classements]. La subjectivité est d’un côté illusoire : une institution, une nation ne pensent pas et n’ont pas de volonté, on ne les rencontre pas dans la rue [Mais la nation est présente chez chacun des nationaux. On ne rencontre pas la nation dans la rue (sauf pour les Écossais à cause du kilt. Je vous signale que Mauss se vantait de déterminer la nationalité d’un passant à sa gestuelle) puisqu’elle est dans le cœur des nationaux et les nationaux pensent, eux, et ils ne font pas que penser. C’est le sens véritable de l’Eucharistie. Les mythes ont toujours un fondement.] Ce sont des fictions pratico-inertes, comme dit Sartre ♦, il n’existe physiquement que des individus [Mais la collectivité est présente chez chaque individu, c’est l’Eucharistie permanente]. D’un autre côté, ces ensembles [ne sont donc pas des ensembles] sociaux ont une consistance ontologique, ils sont réels en quelque manière, ils ont une /81/ existence sociale, ils interviennent, agissent ou réagissent : ce sont des quasi-sujets [Ce ne sont pas des quasi sujets, ce sont les seuls sujets qui soient véritablement sujet. Hegel disait Volksgeist. Il n‘est de sujet véritable que collectif. Toute décision prise par un individu, fut-il Napoléon, est prise dans une collectivité. Voyez comme Napoléon soignait ses bulletins. Petite anecdote dont j’ai oublié la source : lors de la retraite d’Espagne, alors que Napoléon marchait dans la neige fondante — terrible Espagne — parmi ses soldats, ceux-ci maugréaient : « On lui fout un coup de fusil. » Cependant, ils ne le firent pas.]. La notion de quasi-sujet recoupe assez bien la notion juridique de « personne morale », à moins que l’association soit seulement de fait. Mais le quasi-sujet est plus que juridique, il est vivant, il déploie des degrés variables de subjectivité, d’énergie, d’activité, d’influence et d’efficacité sociale, etc. Alain Caillé a formalisé une intuition de ce genre dans un article de 1990 [repris in La Démission des clercs, 1993], « Plaidoyer pour un holisme subjectiviste : sujets individuels et sujets collectifs », [Cf. 1994, p. 261].
|
♦ si je ne me trompe, le pratico-inerte chez Sartre n’est pas une fiction. D’après ce que j’ai compris, le pratico-inerte est du savoir congelé dans le monde comme les pattes géantes de mammouth dans Mickey chercheur d’or. La nationale 10 sait comment aller de Chartres à Tours mais elle sait aussi comment aller de Tours à Chartres. Pour exprimer cela autrement, cet inerte est le résultat d’une pratique qui demeure gravé dans le paysage, pour les siècles des siècles. Sartre, matérialiste borné (« Qu’est-ce qui unifie ? C’est la matière ») et individualiste méthodologique enragé croit pouvoir passer de la dyade et de la triade (le tiers unificateur) à tous les rapports entre les hommes. « Les relations réciproques et ternaires sont le fondement de tous les rapports entre les hommes, quelque forme qu’ils puissent prendre ultérieurement. » (CRD 191) Or quand chacun sait que tous savent que chacun sait que Brigitte est bien connue (bien connue : c’est à dire connue de nom de tous ou de chacun), le rapport est établi d’un seul coup, c’est un savoir foudroyant, c’est une situation. Dans ces conditions d’individualisme méthodologique, il faut quelque chose pour unifier les pratiques des individus : c’est le pratico-inerte : « pour qu’il y ait quelque chose comme une réciprocité ; il est vrai qu’il ne suffit pas de la matérialité dialectique [ ! k’esse k’c’est qu’ça ] de chacun il faut aussi une quasi-totalité à tout le moins, or cette quasi-totalité existe, nous la connaissons, c’est la matière ouvrée en tant qu’elle se fait médiation entre les hommes [la RN 10] ; sur la base de cette unité négative et inerte, la réciprocité [vraiment ?] paraît : ce qui signifie qu’elle apparaît toujours sur une base inerte d’institutions et d’instruments par quoi chaque homme est déjà défini et aliéné. » (CRD 191) Voilà ce qu’est le pratico-inerte, c’est la matière ouvrée. Il est évident que je ne partage pas cette conception : la nationale 10 n’aliène personne (elle contraint et de ce fait permet, elle n’aliène pas) ne serait-ce que parce que l’aliénation n’a rien à voir avec les personnes mais avec ce qui suscite des actes. C’est ce qui suscite des actes qui, seul, peut devenir étranger. Qu’est-ce qui suscite des actes dans ce monde ? Donc, rien de moins fictionnel pour le matérialiste borné Sartre que le pratico-inerte, c’est à dire la matière ouvrée. Rien de moins fictionnel pour un matérialiste borné que la matière ouvrée. Rien de moins fictionnel que l’institution « nationale 10 ». D’ailleurs Sartre reconnaît qu’ayant eu une overdose d’idéalisme dans l’Être et le néant, il fait amende honorable et va se jeter dans le matérialisme comme un forcené. C’est Charybde et Scylla. Sartre a dit assez de conneries comme ça pour ne pas lui en faire dire qu’il n’a pas dite. Ne touchez pas à mon frère de bibliothèque. |
7. /81/ Nature du politique. « Politique » signifie en premier lieu un domaine spécifique de la société, celui étudié par la science politique enseignée à Sciences po : les élections, les institutions, les partis politiques, les relations internationales officielles, etc. Mais « politique » a un autre sens : la synthèse des fonctions de la souveraineté (religieuse, guerrière et économique, cf. note 9). Politique est alors quasiment synonyme de « souverain ». C’est l’adjectif qui correspond au substantif « puissance » ou « grande puissance », et dont on a fait un nouveau substantif. Cette distinction entre un sens étroit et un sens large, qui est essentielle, correspond en gros à celle qu’opère Alain Caillé (Cf. note 13) entre « la » politique (celle de Sciences po) et « le » politique, la synthèse de toutes les relations, en quelque sorte indivisible, au sens du « bien collectif indivisible » de l’économie publique. Il y a une raison à cette superposition de deux significations : l’État est la clé de voûte des institutions politiques (premier sens) et en même temps le représentant symbolique de la souveraineté ou puissance souveraine (deuxième sens).
8. L’Etat historique apparaît dans mon analyse comme une sorte de
substance a-historique, bien que cette conception me soit étrangère. L’État
moderne, né au cours du Moyen Âge, est foncièrement différent de l’État des
cités grecques ou même de I’Etat romain, qui lui a servi pourtant de modèle
hiérarchique par l’intermédiaire de l’Église.
9. Les
responsabilités souveraines ou fonctions. Pour synthétiser ces
responsabilités, j’utilise depuis quelques années la trifonction proposée par Georges
Dumézil à partir d’une analyse des mythes indu-européens : la religion (incluant la justice), la guerre et la
richesse. J’ai décrit cette appropriation de la découverte dumézilienne dans « Économie et souveraineté », La Revue du MAUSS n°
10, 4e trimestre 1990.
10. Théorie
étatique de la connaissance. Je désigne ainsi le fait que l’État
réduit à lui-même ne connaît qu’une forme de connaissance : les catégories générales et reproductibles, la hiérarchie
des instances, le quadrillage du territoire, les normes reproductibles et, tout
en bas, l’individu-citoyen abstrait du droit civil. C’est une forme de
connaissance extrêmement rigide mais néanmoins efficace pour le disciplinement
des forces. Ces « formes
sociales a priori » de /82/
la connaissance nous ont été inculquées en famille et à l’école ; elles régissent à notre insu
notre représentation de la société. En fait, il n y a pas d’autre raison que la raison d’État. La
raison prend modèle sur la hiérarchie, la rigidité et l’univalente des
institutions d’État. La raison comme l’État ignorent l’espace fluide, le temps
qui coule, la durée, le mouvant, le fluant, le fugitif, le singulier, la
coupure, le réseau, le rhizome, l’ambivalent, le contradictoire, l’émotionnel,
l’intuitif, toutes ces visions du vivant que Bergson nous a appris à aimer, qui
sont en nous-mêmes, et qu’à force d’éducation nationale nous avons fini par
oublier. L’État est utilitariste par essence et par fonction, il
instrumentalise tout ce qu’il touche, et c’est probablement lui qui, en voulant
mobiliser des masses d’hommes dans une perspective de puissance, a inventé le calcul économique rationnel et a inspiré la
philosophie utilitariste. La théorie néoclassique elle-même, quel
paradoxe ! utilise les modes de pensée d’État (les individus de
même taille, la série, l’équilibre, la rationalité de l’action conforme à un
but). L’État est incapable de penser différemment. Seules des sources
jaillissant de ses bords, de ses marges, de son ailleurs, bref de la société
civile, peuvent inspirer un autre mode de connaissance et d’autres instruments
de mesure et d’appréciation [Cf.. « Une économie politique
planétaire », p. 273].
Cette critique de la raison laisse intacte la fonction sceptique de la raison, la
faculté qui permet à l’homme de mettre en doute les dogmes de l’autorité
religieuse.
11. /82/ L’extérieur prévaut sur l’intérieur. Cette affirmation est le fruit d’une longue maturation déclenchée en 1976 par une découverte concernant les origines du terme « productif », si essentiel à l’économie politique naissante au XVIIe siècle. A l’époque, les grandes puissances européennes (Hollande, Angleterre, France) se faisaient une guerre acharnée pour la suprématie mondiale. Elles faisaient feu de tout bois ; la production et le captage des richesses étaient un atout majeur dans ces guerres, et la comptabilité nationale naissante une manière de calculer les ressources respectives des protagonistes. « Productif de quoi ? » m’étais-je demandé ; et la réponse vint, comme une évidence : « De puissance ! » Or la puissance implique immédiatement l’arène internationale. Je demande donc au lecteur d’accepter pour un postulat ce qui, à mes yeux, est une condition indispensable à1’analyse des sociétés, quelle que soit la discipline. Soit on les considère d’un point de vue intérieur : la société nationale ou locale est sur le devant de la scène, le monde extérieur fait de la figuration (les coulisses du théâtre), et le spectateur a l’impression que les acteurs sont sujets de leur histoire. En réalité, les choses importantes se passent dans les coulisses ; et lorsqu’on place cette relation extérieure sur le devant de la scène, lorsque le monde joue le premier rôle, les choses se remettent en place et, souvent, ce qui était énigmatique du point de vue intérieur s’éclaire du point de vue mondial.
12. /83/ Économie nationale, économie territoriale. Cette précision fait allusion à une distinction proposée par Michel Beaud [1989, p. 166] entre l’économie nationale territoriale, enfermée dans ses frontières, et l’économie nationale/mondiale, qui inclut toutes les extensions économiques mondiales de la nation, par exemple les firmes multinationales. Cette idée a été creusée et actualisée par Yves Hanoteaux dans sa thèse récente, Les Espaces de l’économie mondiale, université de Paris VIII, 1996.
13.
/84/ La laïcité est le résultat d’un long processus de séparation
du spirituel et du temporel, de l’Église et de l’État, du religieux et du
politique. L’État a grandi avec l’appui intéressé de l’Eglise sans que
pourtant celle-ci parvienne à dominer l’ordre politique européen [voir Richesse et puissance, p. 44, « Naissance des États-nations »]. Cette séparation politique concrète est probablement à
l’origine du désenchantement du monde analysé par Weber et Gauchet.
14.
/85/ L’économie comme ordre autonome. Je pointe ici (entre
autres) une idée d’Alain Caillé qui, dans La Démission des clercs [1993, Cf..
note
6], pense à la fois l’autonomie des ordres de la société et leur fusion
lors des grands moments féconds de l’histoire, lorsque la société retrouve son unité à la
faveur de l’émergence du politique,
du pouvoir de souveraineté — conception qui me convient tout à fait. Alain Caillé
pose une question radicale :
les sciences sociales ne découpent-elles pas la réalité sociale en
tranches pour « des raisons
méthodologiques qui, en se faisant oublier comme telles et en
s’hypostasiant, tendent à faire passer les distinctions opérées par l’esprit pour des distinctions présentes dans la réalité
même ? » [p. 299]. C’est bien le problème !
[Cf. le
compte rendu paru dans la Revue du MAUSS semestrielle n° 6, 2e semestre 1995, p. 265].
|
BIBLIOGRAPHIE BAECHLER
Jean, 1995, Le Capitalisme. 1. Les origines. 2. L’économie
capitaliste, Folio-Histoire. Gallimard. BEAUD
Michel, 1981, Histoire du capitalisme, Seuil-Points. BRAUDEL.
Fernand, 1967, Civilisation matérielle et capitalisme, Armand Colin. CAILLÉ
Alain, 1993, La Démission des clercs. La crise des sciences
sociales et l’oubli du politique, La Découverte. FOURQET
François, 1974, « L’idéal historique », Recherches n° 14 (réédité dans la collection 10/l8 en 1976). MAUSS Marcel,
[ 19231 1950, « Essai sur le Don », in Sociologie et
anthropologie, PUF (réédition 1973). POLANYI Karl, 1977, The Livelihood of Man, (édité par) Herry W.
Pearson, Academic Press, New York, San Francisco, Londres. TOYNBEE Arnold. [1934-1954] 1972, A study of History a new edition
revised and abridged by the author and Jane Caplan, Oxford University Press
and Thames and Hudson Ltd. Traduction
française : L’Histoire, Pavot & Rivages, 1996. VARAGNAC
André (sous la direction de). 1959, L’Homme avant l’écriture, Armand Colin (préface de Fernand Braudel). WALLERSTEIN Immanuel, [1974] 1980, Le Système du monde
1. Capitalisme et économie-monde
1450-1610, Flammarion. |