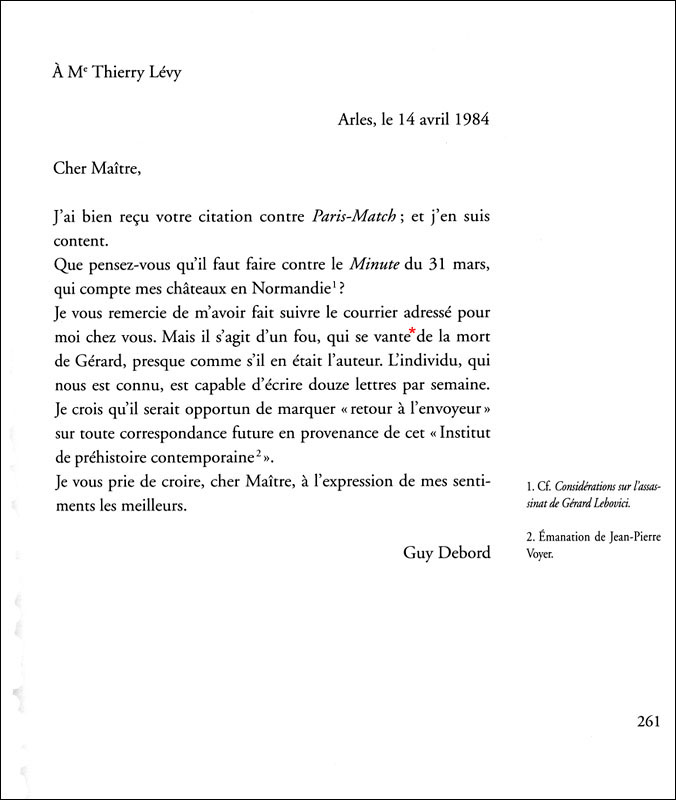Debord est un homme
que je corrige toujours
It’s
clean
Posted by Jean-Pierre Voyer sur
le Debord off on April 09, 2000
Debord
n’avait qu’un seul but, comme toute sa vie en témoigne : être
indiscutable. De ce point de vue, sa réussite est incontestable. L’homme qui
disait « tout ce qui est discutable doit être discuté » était le
mieux placé pour apprécier ce genre de choses. Il a ainsi contribué, dans toute
la mesure de ses moyens qui n’étaient pas négligeables, à l’obscurité de la fin
d’un siècle.
J’ai toujours pris au
sérieux ce qu’écrivait Debord. Comme chacun peut le constater, je continue. Il
aura au moins trouvé en moi un lecteur, chose rare, de nos jours, selon Tocqueville.
Occurrences du terme image dans la Société
du spectacle
La peste soit des malcomprenants
Réponse du berger à la
bergère aux seins flasques
La société du spectacle est très peu
spectaculaire
Note critique de la traduction par Thierry Simonelli
Ce con
espérait que j’allais rentrer sous terre
|
Dans une lettre de Debord à Lebovici du 29 juin 1978, je relève,
à propos des lettres que j’adressais alors à Lebovici : « Il faut
tout publier, et tout oublier. » Or tout publier, il ne le fit et tout oublier, il ne le put
comme en témoigne la lettre suivante, du même à J-F Martos en date du
5 novembre 1986 (huit ans plus tard !), Correspondance avec
Debord, J-F Martos, page 89 : « Cher Jeff, …Atlas va être
un fou encore plus gênant que Voyer… » (Atlas ! je suis donc
Prométhée). Quel aveu ! Ainsi, pauvre fou que je suis, j’ai donc gêné
Debord (et beaucoup gêné, notez bien, ce qu’implique le « encore
plus gênant »). J’en suis fort aise. Que voulez-vous, tout le monde
ne peut pas bombarder New York. Ainsi, en 1978, Debord écrivait à son
compère : « Le pitre ne fait plus rire. ». Vraiment ? |
Very
funny ! Voici donc enfin l’accusé de réception. Il n’a retourné aucune lettre, il les a toutes
lues, voire bues, sinon en quoi l’aurais-je gêné ? Comme je le lui ai dit
dans l’une d’elles, il s’était condamné lui-même au silence. Il ne pouvait pas
me répondre, quoique je disse, car me répondre, c’eût été reconnaître que
j’existais alors que son but, ainsi qu’en témoigne sa lettre du 29 juin, était
de me faire disparaître, après tant d’autres, selon son habitude. Ce fut
un bonheur que d’abreuver d’exquises insanités, pendant seize ans, des
adversaires qui s‘étaient eux-mêmes condamnés au silence après avoir tenté de
m’y réduire. C’est ce qui me distingue de ces gens d’ailleurs : je réponds
toujours, à mon heure, évidemment. Me faire disparaître puis m’oublier, il
échoua aux deux.
Un fou
capable d’écrire douze lettres par semaine !
Après Prométhée, voici les
travaux d’Hercule
* Notez le charabia : on peut se vanter
d’être l’auteur ou la cause de la mort de quelqu’un,
mais on ne peut se vanter de sa mort, seulement s’en réjouir ou la déplorer.
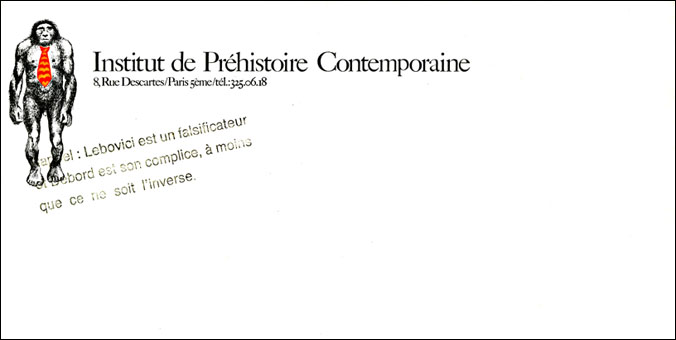
Ma méthode constante dans cette affaire
C’est
celle de Pascal (mâtinée d’Aristophane) face aux jésuites
|
Il y a beaucoup de choses qui méritent d’être moquées par l’ironie, de peur de leur donner du poids en les combattant sérieusement. Rien n’est plus dû à la vanité que la risée et c’est proprement à la vérité à qui il appartient de rire, parce qu’elle est gaie, et de se jouer de ses ennemis, parce qu’elle est assurée de la victoire. Il est vrai qu’il faut prendre garde que les railleries ne soient pas basses et indignes de la vérité. J’estime que la petite quéquette de M. Debord et la carotte entre les fesses grises et poilues de M. Lévy ne sont ni basses ni indignes puisque ni Aristophane, ni James Joyce, qui sont nos Pères à nous, n’ont craint d’y recourir. J’ajouterai qu’on n’est jamais trop goujat avec les goujats ; mais surtout, quand on est obligé d’user de quelques railleries, l’esprit de vérité porte à ne les employer que contre les erreurs ; au lieu que l’esprit de bouffonnerie se rit de ce qu’il y a de plus sacré. La ridicule épitaphe de ton complice n’est pas ridicule en elle-même : elle ne déparerait pas le tombeau d’un grand seigneur tandis qu’elle participe d’un comique involontaire sur la tombe d’un bouffon qui de plus avait les pieds plats. Les lettres que j’ai faites jusqu’ici ne sont qu’un jeu avant un véritable combat. Je n’ai fait encore que me jouer et te montrer plutôt les blessures qu’on peut te faire que je ne t’en ai fait. Et comment aurais-je pu te traiter autrement, puisque ce serait t’autoriser que de te traiter sérieusement. Quoi ! faut-il employer la force du concept et de la tradition pour montrer que c’est tuer son ennemi en trahison que de lui donner des coups d’épée par derrière, et dans une embûche. Qui oserait dire que la vérité doit demeurer désarmée contre le mensonge, et qu’il sera permis à ses ennemis d’effrayer ses fidèles par des paroles fortes, et de les réjouir par des rencontres d’esprit agréables ; mais que les situationnistes ne doivent écrire qu’avec une froideur de style qui endorme les lecteurs. Il est vrai que si l’on devait juger tes phrases en les pesant, elles triompheraient de toutes autres car elles sont d’une lourdeur inégalable, aussi enflées que ton gros foie d’ivrogne ostentatoire [ Heil Myself ! à Debord, 26
décembre 1993 ] |
Visiblement, cet homme s’y croyait : il semble avoir vécu chaque minute de sa vie sous le regard de la postérité. Mais voilà ! je suis aussi sur la photo où, pour les siècles des siècles et devant l’Éternel, je le tiens par sa petite quéquette.

Photo
attique à figures rouges du Ve siècle avant J-C
κωδάριου,
ληκύθιον,
θυλάκιον

Une
autre plus récente dans la Palestine occupée (déjà ! nom de Dieu)
John Hurt as Jesus
Les mœurs situationnistes enfin dévoilées
Non, les
situationnistes n’étaient pas seulement des ivrognes. On peut, dans le
cinquième volume de la correspondance de Debord, découvrir de nombreuses
illustrations de leurs mœurs sordides. Si ce n’était sinistre, ce serait
burlesque. Avec force références à la désaliénation et à la générosité Debord
consommait de la chair fraîche et je vous laisse le soin de constater en quels
termes il en parlait à son pourvoyeur, le fait accompli, sous le prétexte que
les jouvencelles n’avaient pas été à la hauteur de gens aussi intelligents qu’eux,
ni su saisir la chance qui leur était offerte de les mériter, eux, personnes
éminemment libérées de tous tabous ! Tel quel ! Quel gros con !
Je n’ai jamais rien dit dans ma vie que je ne puisse prouver, y compris
l’inexistence de l’économie, notamment quand j’ai qualifié Debord de vieux
pédé. Pédéraste ne signifie pas seulement, comme on le pense communément,
qui se tape des petits garçons mais, selon le Socrate du Banquet de
Platon, un devoir pédagogique. Et c’est ce devoir pédagogique qu’invoque Debord
dans sa correspondance quand il évoque tous les avantages que les donzelles
pourraient retirer de la fréquentation de sa personne admirable. Mais de
quelle manière ! Allez-y voir vous-mêmes puisque c’est désormais possible.
Malgré les conseils de Socrate, il confond élargissement de l’esprit et
élargissement du cercle des fillettes. D’ailleurs, avant, je n’avais que des
preuves verbales, maintenant c’est public. A croire que ce sont ses pires
ennemis qui publient cette correspondance ; plutôt des crétins pénétrés de
la croyance en la supériorité de leur intelligence. Il ne nous font grâce
d’aucune chaude pisse du grand homme, notamment de celle que lui refile
« la lycéenne Isabelle C. » qu’il vient de recevoir dans un paquet
cadeau. Les lettres d’amour de Debord ressemblent à des notices
prophylactiques. Il écrivait aux donzelles disgraciées (en fait elles lui
avaient peut-être simplement dit : « vieux con ») comme il
écrivait aux situationnistes qu’il voulait « supprimer ». Comment
peut-on être aussi goujat ? Lettres d’amour d’un garçon d’écurie ! en
fait d’un petit bourgeois qui s’essaye péniblement à la débauche sous contrôle
idéologique. Tout est dévoilé. Vieux cochon qui se prenait pour un libertin. La
laideur et la noirceur de l’âme s’y peignent elles-mêmes dans un style sinistre
de platitude. Bien que Buffon n’ait jamais écrit la célèbre phrase « Le
style c’est l’homme », cette phrase est ici pleinement vérifiée dans le
contresens habituel : tel style, tel homme. On n’est jamais assez goujat
avec les goujats. Aujourd’hui encore, je me paye sur la bête. Un mystère est
éclairci. Je me suis toujours demandé ce qu’avait bien pu être l’I. S.
pour engendrer une telle ribambelle de goujats gauchistes unis dans une même
haine des dictionnaires. C’est simple : c’est Debord qui les a créés à son
image. Je suis comme le docteur Sigmund Freud qui recommandait chaudement à
quiconque la Gestapo, je vous recommande chaudepissement la lecture du
volume V de la correspondance de Guy « Imminente Foudre »
Debord. Tout sur le personnage.
Quel grand original, ce
Debord
Thèse n° 40 de la
Société du spectacle
Le développement des forces productives a été l’histoire réelle inconsciente qui a construit
et modifié les conditions d’existence des groupes humains en tant que condition
de survie, et élargissement de ces conditions : la base économique de toutes leurs entreprises. Le secteur de la
marchandise a été, à l’intérieur d’une économie naturelle,
la constitution d’un surplus de la survie. La production des marchandises,
qui implique l’échange de produits variés entre des producteurs indépendants, a
pu rester longtemps artisanale, contenue dans une fonction économique marginale où sa vérité quantitative est encore masquée.
Cependant, là où elle a rencontré les conditions sociales du grand commerce et
de l’accumulation des capitaux, elle a saisi la domination totale de l’économie. L’économie tout entière est alors devenue ce que la
marchandise s’était montrée être au cours de cette conquête : un processus
de développement quantitatif. Ce déploiement incessant de la puissance
économique sous la forme de la
marchandise, qui a transfiguré le travail humain en travail marchandise, en
salariat, aboutit cumulativement à une abondance dans laquelle la question
première de la survie est sans doute résolue, mais d’une manière telle qu’elle
doit se retrouver toujours : elle est chaque fois posée de nouveau à un
degré supérieur. La croissance économique libère
les sociétés de la pression naturelle qui exigeait leur lutte immédiate pour la
survie, mais alors c’est de leur libérateur qu’elles ne sont pas libérées.
L’indépendance de la marchandise s’est étendue à l’ensemble de l’économie sur laquelle elle règne. L’économie transforme le monde, mais le transforme seulement en
monde de
l’économie. La pseudo nature dans laquelle le travail humain s’est
aliéné exige de poursuivre à l’infini son service, et ce service, n’étant jugé
et absous que par lui-même, en fait obtient la totalité des efforts et des
projets socialement licites, comme ses serviteurs. L’abondance des
marchandises, c’est à dire du rapport marchand, ne peut être plus que la survie
augmentée.
Cet
homme qui ne se corrigeait jamais a néanmoins baissé sa culotte
devant Antoine Gallimard. Spectacle horrible !
J’enfonce
le clou
Ah! Qu’il est doux le petit bruit du marteau qui enfonce le clou du
cercueil
Janvier 2005
J’entends encore,
aujourd’hui, plus de dix ans après les faits, le raisonnement suivant :
« Certes, Debord a écrit(1) dans le numéro douze de la
revue de l’Internationale Situationniste "On t’a dit que tu n’auras
plus jamais un livre d’un situationniste", mais puisqu’en 1992 Debord n’était
plus situationniste,(2) Gallimard n’eut donc aucun
livre d’un situationniste et Debord ne s’est pas parjuré. »
Or en 1967, La Société du
spectacle, publiée chez Buchet, — le premier de ses livres que Debord accepta(3) qu’il fût réédité par Gallimard en 1992 — était bien
le livre d’un situationniste. En quoi le fait que Debord, en 1992, ne soit plus
situationniste entraîne-t-il que le livre de Debord La Société du spectacle
ne soit plus le livre d’un situationniste en 1992 alors qu’il l’était en
1967 ?
Le jugement du sévère
professeur Gottlob Frege est sans appel : s’il était vrai, en 1967, que le
livre de Debord La Société du spectacle était le livre d’un
situationniste, cela est vrai pour l’éternité, c’est une vérité
éternelle (Frege prend pour exemple la population de l’empire allemand à un
moment donné : quel que fut ce nombre à ce moment, s’il est connu, c’est
une vérité éternelle. Vous l’aurez remarqué, les idées de Frege, contrairement
à celles de Debord, ne vieillissent pas, elles sont d’une éternelle jeunesse).
DONC
Gallimard a bien obtenu de
Debord la permission de publier le livre d’un situationniste. Le Debord
de 1992, situationniste ou non, désavoue le Debord de 1969. Le Debord de 1992
est un renégat. Remarquez bien qu’il ne renie pas une doctrine ou une religion,
ce qui peut être parfaitement honorable, il renie sa propre parole.
Crapules, merdeux, imbéciles
qui prenez les gens pour des cons et qui ne considérez que ce qui vous arrange.
Vous vous dorlotez, vous êtes pleins de tendresse pour vous-même. Vous êtes le
client roi. Vous êtes tous des téléologues.
MAIS
La question n’est pas là,
évidemment. La racaille pro situ, qu’elle le fasse exprès, par mauvaise foi, ou
non exprès, par sottise, est toujours à côté de la question. Les mots
importants ne sont pas « On t’a dis que tu n’auras plus jamais un livre
d’un situationniste. », mais les mots concernant non plus Claude mais
Antoine Gallimard : « un dénommé… ce con… raclure de bidet… le
merdeux qui espère hériter… ».
Ce qui est déshonorant pour
Debord n’est pas qu’il a dit au père d’un homme qu’il a grossièrement
insulté : « On t’a dit que tu n’aurais plus un livre d’un
situationniste »(4) mais qu’il a accepté de
laisser publier non seulement un de ses livres, mais tous, par un homme(5) qu’il avait grossièrement insulté, ce qui n’a rien à
voir avec le fait qu’en 1992 Debord fut ou ne fut plus situationniste.
En quoi le fait que Debord ne
fut plus situationniste en 1992 peut-il entraîner que Debord n’ait pas
grossièrement insulté Antoine Gallimard et son père en 1969 ? Qui pourra
m’expliquer cela ? Jésuites ! Les situationnistes s’envolent, les
injures restent. Debord est un Rodomont.
Racaille prositu abîmée dans
la sottise et la mauvaise foi. Pour l’éternité
Debord est un renégat, pour l’éternité Debord est un matamore(6) menaçant d’enfourcher sa
jument Imminente Foudre : les faits ont eu lieu. Le moment venu,
Debord fila doux. Même si on l’a
grossièrement insulté, on ne dit pas non
à Gallimard. Cela dit(7) il n’y a aucun déshonneur à
être publié par Gallimard plutôt que par Tartempion, sauf si on l’a, auparavant,
grossièrement insulté. Capito ?
1. à destination de Claude Gallimard,
alors directeur des éditions Gallimard et dont le fils, prénommé Antoine, est
aujourd’hui l’actuel directeur.
2. ce qui demeure à prouver d’une part et
d’autre part si, en 1992, Debord n’était plus situationniste, c’est qu’il était
un renégat, mais passons.
3. cette fois c’est vrai, il n’a pas
demandé ou fait demander, comme chez Lebovici, on le lui proposa.
4. en effet
puisque entre temps le pauvre Claude Gallimard creva.
5. le fils du père : Claude père
d’Antoine implique (Þ) Antoine fils de Claude. C’est ça la logique,
le maniement de propositions toujours vraies. C’est ce que la racaille pro situ
est incapable de faire.
6. il lui revenait donc de
traduire Manrique, fils d’un célèbre tueur de Mores.
7. ce qui semble hors de portée de la
compréhension de la racaille gauchiste. Voilà à quoi se résume la logique
gauchiste : si t’es riche, t’es con ; si t’es flic, t’est
salaud ; si t’es édité chez Gallimard t’es un vendu ; mais pas d’être
directeur temporaire du Palais de Tokyo ou directrice d’Art Press ou
pigiste chez Nova Press ou même intermittent du spectacle.
Affaire
Anders-Debord
Histoire
du baudet qui osa regarder un cardinal.
AVIS
1) Je ne reproche pas à Debord d’avoir plagié
(puisque le plagiat est nécessaire et que le progrès l’implique : j’en
fournis un exemple, de ma propre facture, un
peu plus haut), mais de le nier (donc de mentir puérilement) quand
un malheureux baudet le lui fait respectueusement remarquer.
2) Ensuite je ne me contente pas d’affirmer
que Debord a plagié, je prouve qu’il a plagié.
3) Mais la tache de sang intellectuelle de
Debord est d’avoir dissimulé, avec son complice Lebovici, le livre d’Anders
pendant trente ans, alors qu’il avait, depuis 1971, tous les moyens de le
révéler aux lecteurs français, exactement ce qu’il reprochait à la canaille
intellectuelle à propos de Rizzi. C’est donc encore un jugement ad hominem :
je juge les gens selon leurs propres critères proclamés.
Résumé : Je reproche donc à
Debord exactement ce qu’il reprochait aux enculés intellectuels qui ont
dissimulé Rizzi tout en s’en inspirant. Il y ajoute en outre le ridicule d’enfourcher
sa grande jument Imminente foudre quand un malheureux baudet le lui fait respectueusement remarquer.
Fiche Wikipédia par
Thierry Simonelli, Docteur en philosophie (Université de Paris 4 - Sorbonne)
et Master en psychologie clinique (Université de Paris 7 - Denis Diderot).
Anders, un auteur (obscur, n’est-ce pas ? au moins écrit-il lisiblement)
dissimulé pendant cinquante ans au lecteur français.
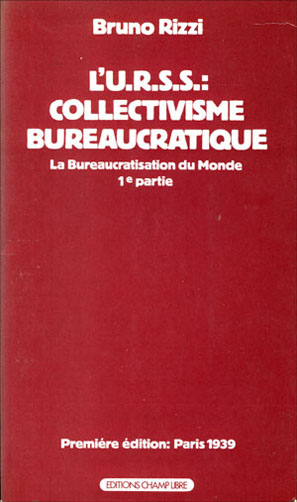

Rappel
préliminaire
7 août
2004
On pouvait lire, sur la
quatrième de couverture de l’article de Bruno Rizzi, L’U.R.S.S :
collectivisme bureaucratique, paru en 1976 aux éditions Champ Libre,
extrait de son livre La Bureaucratisation du monde, paru en 1939, à
Paris, à compte d’auteur : « D’autres ont pillé Rizzi avec une
assurance d’autant plus tranquille que ceux-là préféraient l’ignorer. Les rares
détenteurs du livre si bien disparu(1) qu’il n’en existe même pas un exemplaire à la bibliothèque nationale(2), en ont tiré discrètement parti pour trancher du
chercheur de pointe(3), et aimeraient ne pas
perdre cette réputation(4) : depuis 1968, les divers
experts en contestation qui détiennent
un stand chez presque tous les éditeurs français ont exhumé toutes sortes d’écrits
moins brûlants, mais jamais Rizzi(5) qu’ils n’ignoraient pas tous(6). »
1. jamais paru en français pour le cas de Anders, mais ce livre
a connu huit éditions en Allemagne
2. aucun exemplaire à la bibliothèque du Congrès
pour Anders
3. exactement comme Debord pour Anders,
donc
4. mauvaise, je suppose dans le cas de
Debord
5. jamais Anders dans le cas de Champ Libre
auquel les moyens ni les bons traducteurs ne manquaient
6. la meilleure, dans le cas de Anders, au
point que Debord peut en citer un passage de mémoire trente-deux ans après la
première publication à Munich en 1956
Farceurs, fumiers,
canailles. Une fois de plus, je les juge ad hominem, en citant leurs
propres paroles. Salauds.
_________________________________________________
CANAILLE
DISSIMULATEUR DE SOURCES
La dissimulation des sources est le crime suprême dans les sciences. On
ne peut comparer d’une part, le « détournement » de Platon, Socrate,
du cardinal de Retz, de Mme du Châtelet, de la comtesse de Ségur, etc., tous
auteurs parfaitement connus et, d’autre part, la dissimulation de sources
strictement inconnues, en français du moins, et surtout proclamées par
M. de Bord, pour sa défense, a posteriori, une fois le crime
dévoilé, comme émanant d’un auteur obscur (au sens d’inconnu selon les critères
médiatiques — huit éditions de l’ouvrage dans son pays d’origine, traduction
immédiate d’un des essais composant le livre dans la revue Dissent
aux USA, en 1956 lors de la parution de l’ouvrage, excusez du peu —, car,
selon les critères scientifiques, contrairement à l’obscur mais très médiatisé
Debord, Anders est parfaitement clair) et donc de ce fait auteur négligeable.
Il piqua d’ailleurs une hénaurme colère quand un innocent baudet osa le
comparer à un tel obscur auteur. L’insolent baudet osait donc regarder un
cardinal !
La pierre de Rosette, avant que d’être connue par l’égyptomania et
surtout déchiffrée, était parfaitement obscure (dans les deux sens du terme).
Elle était donc, selon les critères de M. de Bord parfaitement
négligeable. M. Anders sera donc notre pierre de Rosette qui va nous
permettre enfin de comprendre les hiéroglyphes de M. de Bord, car, non
seulement M. Anders écrit un excellent allemand, mais ses traducteurs
écrivent un excellent français et un excellent anglais. On va donc, grâce à
lui, comprendre le de Bord de la troisième dynastie, juste retour des choses.
Debord, plagiaire honteux,
lui qui, sous l’inspiration de Lautréamont,
porta le plagiat au summum de l’art
sous le nom de détournement
et s’en faisait gloire :
« Le plagiat est nécessaire,
le progrès l’implique »
La question traitée ici
n’est pas que Debord a connu l’ouvrage de Anders, qu’il l’a plagié, qu’il s’en
est inspiré, ce que je prouve ci-dessous (contrairement à Baudet, je le
prouve. Pourtant comme l’a relevé Le Manach dans ses Artichauts, Baudet
avait tous les moyens de le prouver, c’est-à-dire traduire et citer le texte) ;
mais : d’une part, qu’il le nie, c’est à dire qu’il mente avec la dernière
énergie comme le prouve l’affaire Bidet versus Imminente Foudre ;
et, d’autre part et surtout, qu’il a dissimulé un ouvrage aussi intéressant
alors qu’il avait tous pouvoirs à Champ Libre, exactement donc ce qu’il
reproche à ceux qui ont dissimulé l’existence de Rizzi. Ainsi, quand je lui ai
demandé comment il avait trouvé le « concept » de spectacle, il me
répondit qu’il l’avait trouvé lui-même. Quand bien même cela serait
— ce qui est douteux puisque
en 1957, lorsque Debord parle de spectacle, il parle du théâtre et du cinéma
qui tombent en désuétude : « La construction de situations commence
au-delà de l’écroulement moderne de la notion de spectacle » (notons en passant
que si la non intervention est bien le principe du spectacle et si la non
intervention est aussi le principe du monde moderne, cela n’implique pas pour
autant que ce monde soit un spectacle, ni même qu’il contienne des spectacles
mais seulement que le libre prostitué ne peut intervenir qu’en tant que
prostitué, ce qui n’est pas intervenir. C’est la prostitution qu’il faut
abolir), tandis que Anders a déjà publié en 1956 la notion de cours du monde
comme un spectacle arrangé et de mensonge devenu vrai. Ensuite, la
notion de mise en spectacle de la consommation n’intervient chez Debord qu’en
1962, dans un numéro de la revue où par ailleurs il cite la revue Dissent
qui a publié l’essai de Anders en anglais —
il a dissimulé qu’un auteur
qu’il connaissait traitait de la même question. Comme il connaissait également
l’existence d’une traduction en anglais, j’aurai donc pu lire, bien que je ne
lise pas l’allemand, Anders en anglais dès 1971
— j’ai d’ailleurs lu l’Analyse
caractérielle de Reich en 1971 à New York, où je voyageais pour le compte
de Debord, puisque ce livre était indisponible en France du fait d’un conflit
entre les héritiers de Reich et l’éditeur Payot —
ce qui m’aurait permis de
voir La Société du spectacle d’un autre œil et de gagner vingt ans dans
mes recherches. J’aurais pu commencer à attaquer Debord dès mon retour des
Etats-Unis au lieu de passer vingt ans à chercher une définition implicite,
c’est à dire une définition cachée, comme les axiomes d’Euclide sont une
définition cachée de l’espace selon Poincaré. S’il y a une définition implicite
du « spectacle » dans le livre de Debord, elle est vraiment bien
cachée puisque je n’ai pas réussi à la trouver après vingt ans de
recherche ; tandis qu’il y a une définition explicite dans l’essai de
Anders et que cette définition, du fait de la mise en page, tombe immédiatement
sous les yeux de qui feuillette le livre ! Debord était un homme qui se
plaignait qu’il n’y eût pas de discussion dans l’Internationale situationniste
où l’on s’emmerdait ferme, selon lui. Voilà une bonne occasion de discussion
ratée.
Le Monde comme fantôme et
comme matrice
Considérations
philosophiques sur la radio et la télévision
7 avril 2004
« On a toujours
beaucoup plus de chance d’apprendre un événement extraordinaire par le journal
que de le vivre ; en d’autres termes, c’est dans l’abstrait que se passe
de nos jours l’essentiel, et il ne reste plus à la réalité que l’accessoire. »
Musil. L’homme sans
qualités.
Quels veinards, ces employés
de bureau des Twin Towers. Ils ont vécu un événement extraordinaire.
Sur cette
affaire Anders, on pourra désormais consulter les Artichauts de Bruxelles
n° 43, n° 55, n° 57, enfin en
ligne sur Internet.
Dans cet essai de Günther
Anders, publié il y a cinquante ans, « l’analyse critique de
l’organisation des apparences par les médias de la communication de
masse » n’est pas seulement « largement anticipée », comme le
prétendent ses imbéciles d’éditeurs. Elle est achevée. Tout ce que l’on peut
dire sur la radio et la télévision y est dit, et dit sans charabia, ce qui
n’empêche pas ses crétins d’éditeurs de taxer l’auteur de pédantisme. Anders
est limpide et précis ce qui n’a rien de commun avec l’obscurité fumeuse et
fumiste de Debord. Ce dernier n’a-t-il pas dit : plus nous serons fumeux,
plus nous serons obscurs ? Debord s’est contenté, par la suite de
prétendre que « son » spectacle n’était pas seulement la radio et la
télévision. Qu’est-il donc alors, imbéciles ?
Un petit exemple,
page 224 :
« Notre monde actuel
est "postidéologique" : il n’a plus besoin d’idéologie. Ce
qui signifie qu’il est inutile d’arranger après coup de fausses visions du
monde, des visions qui diffèrent du monde, des idéologies, puisque le cours du monde lui-même * est déjà un spectacle arrangé. Mentir
devient superflu quand le mensonge est devenu vrai. »
Autrement
dit, comme le relève Baudet dans son digest, Anders ne dit rien moins
que : le spectacle est une idéologie matérialisée, du pur Debord,
dix ans avant lui.
Loi de
l’image : l’image est appauvrissement, l’image est pauvre : on ne
peut voir ce qu’on ne voit pas dans l’image, l’image vous captive et vous
empêche de voir ce qu’on n’y voit pas. Contrairement à la littérature où le
lecteur est aussi important que l’auteur. Ce monde a en commun avec l’image cet
appauvrissement, mais c’est tout ce qu’il a en commun. On ne peut voir ce qu’on
ne peut voir. C’est donc un monde du spectacle, de l’image, seulement en ce
sens : on ne peut voir ce qu’on ne peut voir, ce qui ne signifie surtout
pas qu’il y a des spectacles dans le monde et encore moins une accumulation de
spectacles. Quand la ressource humaine sort de sa cage, elle voit le monde
comme les images du monde qu’elle voyait il y a peu dans sa cage, de façon
aussi pauvre. Elle voit le monde lui-même aussi pauvre q’une image. Capito ?
Alors qu’un Maori voit des trous de magie partout. C’est seulement en ce sens
que le monde est désenchanté. Il paraît aussi pauvre qu’une image. De même que
dans l’image on ne peut voir ce qu’on ne peut voir, dans ce monde, on ne peut
voir ce qu’on ne peut voir. Sauf les Arabes qui sont des visionnaires. Ce qu’on
ne voit pas n’existe pas. Ce que voient les Arabes n’existe plus !
Différence entre l’image, l’illustration et le tableau : le peintre lutte
contre l’image : ceci n’est pas une pipe, ceci n’est plus une tour.
Rappelons avec les situationnistes qu’il n’y a pas de monuments innocents.
Quand la ressource humaine sort de sa cage, le monde lui paraît aussi pauvre
qu’un spectacle arrangé. Voilà ce que veut dire Anders, libre penseur. Voilà ce
que Anders entend par "déshabillage" de l’image. Elle est pauvre en
qualités. Le jugement sera pauvre en prédicats. Plutôt qu’un jugement caché,
c’est une restriction cachée du jugement. L’investigation qui mène à la vérité
ne peut s’exercer librement, elle est limitée par le cadrage de l’image. Ce
monde a la même loi que le spectacle : on ne peut y voir ce qu’on y voit
pas, alors que la télévision donne à la ressource humaine, du fait de
l’abondance torrentielle des images, l’habitude de croire qu’il voit tout ce
qui existe, que le monde n’a plus de secrets pour lui. C’est aussi simple que
cela. Mais jamais la ressource humaine ne pourra voir ce qu’il y a derrière
la maison de M. Biswas tandis que Naipaul ne nous laisse rien ignorer
d’essentiel.
[ Die
Antiquiertheit des Menschen. Beck, page 195 : « da das
Geschehen der Welt selbst sich eben bereits als arrangiertes Schauspiel abspielt. » Il est amusant que Baudet écrive (Le sous-commandant
Martos se venge, Le fin mot de l’histoire, BP n° 274, 75866 Paris
Cedex 18, page 245 et suivantes), dans son abrégé du livre à destination
de Debord : « le spectacle [terme inexistant chez Anders, mais dont
le besoin se fait sans cesse ressentir] » (idem,
page 297). Or ce terme est présent chez Anders [C’EST
UN FAIT], page 195 (mais
aussi page 102 : « eine Schau für Viele
zugleich serviert »), et Baudet, craignant de commettre un
sacrilège, dédebordise le texte et traduit spectacle arrangé par idéologie
matérialisée (idem, page 298. Cela dit, cette traduction-résumé
est valable, mais celle-ci eût été meilleure : « Les idéologies, qui
sont des fausses visions du monde, ne sont plus nécessaires puisque c’est le cours du
monde lui-même qui est devenu un spectacle arrangé » étant
donné que c’est ce que Anders a effectivement écrit, totidem verbis. Les
jésuites n’ont pas changé depuis M. de Montalte). Ce qui n’empêchera
pas Debord olympien d’enfourcher sa grande jument « Foudre imminente »
(idem, page 251), car il sait bien, lui, qui a debordisé Anders et
quand. En effet, dans sa réponse à Baudet (idem, page 246), il
écrit [C’EST UN FAIT] : « le germano-américain qui
en 1956 ambitionnait, si j’ai bonne mémoire, de marier la métaphysique et
le journalisme ». Or, on peut lire, page 22 du livre d’Anders :
« J’entends par là quelque chose comme un hybride de métaphysique et de
journalisme » [C’EST UN FAIT et c’est la preuve absolue que Debord a eu
connaissance de la publication en allemand puisque cette phrase ne figure pas
dans la traduction anglaise, partielle, qui paraît la même année aux États-Unis]. Excellente
mémoire, après tant d’années, et soigneuse lecture. Debord reconnaît donc ainsi
avoir eu connaissance, il y a fort longtemps, de ce livre. [C’EST
UN FAIT. Ceci est une preuve et une preuve ad hominem puisque
je ne fais que citer les propres paroles de Debord : Debord reconnaît avoir eu connaissance
de l’ouvrage introuvable en France, il y a longtemps, peut-être en javanais, au
point d’être capable de citer de mémoire un passage insignifiant, mais qui a
particulièrement piqué sa vanité. Comment pourrait-on oser lui opposer une
sorte de journaliste ! Ensuite, la violence et l’absurdité de sa réponse
sont un aveu, il a senti passer le vent... du baudet. Allez, encore
une fois, cloportes : comment, en 1988, Debord peut-il citer de mémoire un
passage d’un livre dont il ignore l’existence et qu’il n’a pas lu, publié en
allemand en 1956 et jamais traduit en français avant 1988 ? Comment, en
1988, Debord peut-il parler des déboires, en 1961 aux États-Unis, de l’édition
américaine de Anders (qui date en fait de 1956), livre dont il ignore l’existence
et qu’il n’a pas lu, et dont personne ne se soucie, comme il l’affirme
triomphalement ? L’enquête débute à peine. A bientôt cloportes. Eh bien
voilà, elle continue l’enquête. Les incorruptibles collègues de Marlowe se
démènent : la revue Dissent publia dans son numéro d’hiver 1956,
volume III, n° 1, The
World as phantom and as matrix. Qui lisait, dans le monde entier,
cette fameuse revue, notamment le numéro d’hiver 1956 ? Cette revue,
volume VIII, n° 1, est citée dans le n° 6 de l’IS,
page 38 ! Debord est un plagiaire honteux et un dissimulateur.
Bientôt vous pourrez lire des révélations dans votre journal favori. Plusieurs
enquêteurs sont sur la piste. Comment Debord, qui est censé ne rien connaître ou
presque du livre de Anders peut-il dire que ce livre eut constitué une arme
pour les contestataires américains, tout en affectant un grand mépris à l’égard
de cette œuvre ? C’est à vous de répondre à ces questions, pas à moi. LES FAITS sont là :
Debord, en 1988, cite de mémoire un livre paru vingt huit ans plus tôt (et il
s’agit bien du livre en allemand puisque la phrase citée n’est pas reproduite
dans Dissent), qu’il n’a pas lu, écrit dans une langue qu’il prétend ne
pas connaître et, non content de cela, nous narre les aventures de l’édition
américaine dans Dissent en 1956 (rejetée dans l’ombre) et de la grande victoire de Boorstin sur
Anders, en 1961, preuve qu’il connaissait aussi l’existence de la publication
américaine. Enfin, Debord dit lui-même que dans la traduction de Baudet
figurent des termes pris au commentaires les plus modernes du spectacle or...
la traduction de Baudet est fidèle, sauf pour l’exemple que j’ai choisi !
Donc le livre de Anders comporte des termes pris aux commentaires les plus
modernes du spectacle. Voilà les faits reconnus par Debord lui-même. Malheureux
Bidet, toujours vivant et actif, qui écrit, page 247 : « je ne
m’amuse pas à interpréter cette réaction totalement injustifiée ».
Bien sûr que si, cette réaction est totalement justifiée : Bidet a
mis le sabot sur la plaie, c’est à dire là où le bât blesse. De toute la bande,
Baudet est le seul qui ne soit pas fou, c’est à dire le seul qui comprenne ce
qu’il lit. Ainsi donc, Debord ne connaîtrait pas assez l’allemand (ou le
javanais) pour lire chez Anders que le cours du monde est un spectacle arrangé
ou que le spectacle est une idéologie matérialisée (termes situés de plus en
tête de chapitre, après un titre éloquent en italiques), mais il en connaîtrait
assez pour avoir lu : « J’entends par là quelque chose comme un
hybride de métaphysique et de journalisme » [C’EST
UN FAIT] et surtout se souvenir vingt ans après de cet infime détail [C’EST
UN FAIT] ! Mais Debord dans une lettre du 26 octobre 1986 à Baudet,
se vante plaisamment : « mon ignorance de la langue allemande
dépasse tout ce qui est crédible... j’ai été dans cette matière, et quelques
autres, les plus mauvais lycéen de ma génération. » J’ai moi-même appris
l’anglais au collège et je fus certainement le plus mauvais collégien de ma génération
dans cette matière. Cependant, bien que ne sachant pas l’anglais, bien que ne
parlant pas l’anglais, bien que n’écrivant pas l’anglais, je le lis couramment.
J’en lis tous les jours, j’y suis bien obligé. Quant à l’anglais, Debord me
confia qu’il discutait en anglais avec les délégués japonais. On sait ce que
tout cela veut dire. De toute façon, Debord reconnaît avoir eu connaissance du
livre il y a fort longtemps [C’EST UN FAIT. C’EST UNE PREUVE AD
HOMINEM]. Peu importe que ce soit en allemand, en anglais ou en javanais.
En quelle langue discutait-il avec les situationnistes allemands ?
Ensuite, comment Debord, qui ne sait évidemment rien de l’obscur Anders,
sait-il, en 1988 [C’EST UN FAIT], que celui-ci
fut éclipsé par Boorstin quand ce dernier publia l’Image en... 1961
(Boorstin fut publié en vrounzais en 1963. En 1956, l’obscur philosophe
allemand Anders exilé à New York vivait depuis déjà cinq ans en Autriche. Notez en
passant : il est obscur donc c’est un mauvais, obscur c’est à dire
non célèbre, non médiatique. Frege fut parfaitement ignoré de son vivant et
quand Cantor le lisait, il ne le comprenait pas. C’est donc un mauvais. Anders
fut peut être obscur — huit éditions en Allemagne quand même — mais il écrivait
clairement. Debord est un célèbre obscur car il écrit obscurément de pompeux
non sens. N’a-t-il pas écrit : plus nous serons fumeux, plus nous
serons obscurs), ce qui signifie qu’Anders était déjà traduit aux Etats-Unis avant
1961 et que Debord le savait puisqu’il écrit [C’EST UN FAIT] :
« [le germano-américain] que le grand succès du livre de Boorstin a rejeté
dans l’ombre avant que les contestataires, dans les Etats-Unis des années
suivantes, aient pu s’en armer » ? Il est parfaitement au fait des
aventure du livre de Anders aux Etats-Unis en 1961 [C’EST
UN FAIT] et c’est la preuve qu’il était au courant vers 1961, car, pour
parler comme lui, de cette parution qui s’y intéresse... en 1988, soit vingt
sept ans après. Debord, précisément et lui seul. Le criminel revient sur les
lieux du crime. Comment Debord peut-il, en 1988, être au fait des aventures de
la traduction de Anders en 1961 aux Etats-Unis alors que personne ne se soucie
plus de ce livre en 1988 ? C’est la preuve qu’il a eu connaissance de ces
aventures quand elles avaient lieu. C’est la preuve qu’il connaissait la
traduction anglaise de deux essais de ce livre dans la revue Dissent et
le sort qui lui fut réservé en 1961 aux États-Unis. Comment Debord qui n’a au mieux,
évidemment, qu’une connaissance superficielle de Anders, peut-il dire que des
contestataires s’en arment ? Comment savait-il que le texte de Anders,
qu’il affecte pourtant de mépriser, était une arme ? D’une manière
générale, si Debord ne connaît pas le texte de Anders encore non publié en
français en 1988, ou s’il n’en a qu’une connaissance superficielle, comment
ose-t-il reprocher quoi que ce soit à Baudet et sur un tel ton péremptoire.
Comment peut-il savoir que ce texte n’est pas tel que Baudet le dit sans
manifester le moindre étonnement ? Un jour, je demandai à Debord où il
avait trouvé cette notion de spectacle. Nulle part, me répondit-il, je l’ai
inventée. Imposteur. Cette notion figure, totidem verbis, chez Anders [C’EST
UN FAIT] et Debord le savait. Il savait donc également, quand je lui
posais la question, qu’il y avait antériorité (chronologiquement, 1956 est
situé avant 1957, faut-il le rappeler. Mon hypothèse sur le cheminement de la
connaissance par les situationnistes allemands n’est qu’une hypothèse,
précisément. La connaissance du texte de Anders par Debord, dès 1961 est UN
FAIT
et LA PREUVE en est donnée par Debord lui-même que je cite. Les
historiens sauront bien trouver comment Debord a connu Anders. Une chose est
certaine car prouvée : il le connaissait dès 1961) et que Anders avait
déjà tout inventé et publié avant lui, avant même qu’il ne prononce le mot de
spectacle en 1957. Anders a donné une théorie complète en 1956, Debord fait une
simple allusion en 1957. Mais surtout, le sens du mot spectacle,
page 17 de la brochure Rapport sur la construction des situations
n’a pas du tout le sens qu’il a dans le livre d’Anders de 1956. Il ne s’agit
que du spectacle théâtral et cinématographique que les recherches les plus
valables dans la culture ont cherché à détruire en brisant l’identification du
spectateur avec le héros, pour entraîner le spectateur à l’activité, ce qui
conduit directement à la notion de construction de situation et non à celle de
cours du monde en tant que spectacle arrangé et de mise en spectacle de ceci ou
de cela. Chez Anders, il s’agit de rien moins que du cours du monde en tant que
spectacle arrangé. Excusez du peu. Il faut attendre 1962 pour que Debord parle
de consommation d’images de la consommation (il ne s’agit pas d’ailleurs de ses
termes, il parle de la mise en spectacle de la consommation). Il s’est trouvé
une foule de gens depuis quelques millénaires pour prononcer le mot de
spectacle dans toutes les langues. Évidemment, ce n’est pas le plagiat qui est
blâmable, comment le serait-il d’ailleurs chez des gens qui, après Lautréamont,
s’en faisaient un point d’honneur ; mais la dissimulation des sources,
puisque les réponses étaient chez Anders et qu’elle ne sont plus chez Debord
qui n’a fait qu’obscurcir ce qui était clair. Le plagiat est certes nécessaire,
le progrès l’implique, mais les textes de Debord sont une régression par
rapport à ceux de Anders comme on peut enfin s’en rendre compte en France
aujourd’hui. Le plagiat est nécessaire, mais il n’est pas suffisant. Si
seulement Debord s’était contenté de plagier platement, ce qui eût permis de
connaître les thèses de Anders, au lieu de faire de la phrase. Debord n’est pas
un plagiaire mais un mystificateur, c’est à dire un agent de désinformation qui
cache soigneusement ses sources dont le simple rapprochement anéantirait la
mystification. C’est un crime contre la connaissance. Bien sûr que Debord a le
droit de penser comme Anders (ce qui n’est pas vrai, il n’y arrive pas) mais il
n’a pas le droit de le cacher, précisément pour que l’on puisse comparer, ce
que l’on peut faire enfin aujourd’hui grâce aux crétins de l’Encyclopédie
des nuisances dont Anders flatte le péché mignon (la détestation des
techniques), dans son premier essai. C’est cela qui est en question. La
question n’est pas de savoir si Debord a inventé ou non le nom de spectacle en
1957, mais si Debord a connu ou non l’existence de l’œuvre de Anders et de ce
fait a caché sciemment son existence pendant des dizaines d’années, ce qui lui
a permis de charabiater à l’aise sur le sujet et de grimper sur sa grande
jument Foudre imminente quand un innocent lui mit ce lièvre dans les
pattes. L’année précédente, en 1956, Anders ne s’est pas contenté d’évoquer le
spectacle au sens classique dans une simple phrase, mais il a déjà publié
une théorie complète des mass media comme spectacle du monde et d’un
monde spectaculaire qui se conforme à son image. Excusez du peu. Il y a de
toute façon antériorité. Enfin, le rapprochement avec l’œuvre de Anders
désormais disponible en français est accablant : les démarquages de Debord
sont stupéfiants, jusque dans les tournures. Ce travail est facilité par le
rapport de Baudet (Copie du
résumé de Baudet et, Trois personnages en quête d’Hauteur
de Le Manach). Mais surtout, la question de savoir si
Debord ressemble à Anders est réglée par... Debord lui-même, puisqu’il réplique
à Baudet : « Il est certain que cet Anders gagne beaucoup d’actualité
si on lui fait employer quelques termes pris dans les plus récents commentaires
sur le spectacle. ». J’espère que nous sommes bien d’accord, lecteur hâtif
et désinvolte (cause à mon cul ma tête est malade) : Debord lui-même
reconnaît [C’EST UN FAIT] que la traduction d’Anders par Baudet
contient des termes pris dans les plus récents commentaires du spectacle. Il
reconnaît donc que si la traduction de Baudet est fidèle, des termes pris dans
les plus récents commentaires du spectacle sont déjà présents chez Anders. La
question qui demeure est donc de savoir si Baudet a employé quelques termes
etc... qui debordisent le texte. Baudet répond d’ailleurs à Martos :
« Je n’ai rien debordisé du tout, mon résumé est une quasi
traduction, et cela peut être prouvé avec une très grande
facilité. » (oui en effet, il suffisait de publier le livre en
français, ce qui est fait. La preuve est là. Merci.) Or, comme on le voit dans
l’exemple que j’ai choisi, c’est exactement le contraire : Baudet évite de
traduire « spectacle » là où il y a écrit « spectacle » [C’EST
UN FAIT] et affirme [C’EST UN FAIT] que le concept
de spectacle n’y est pas alors qu’il n’y a pas seulement écrit
« spectacle » mais : que le cours du monde est un spectacle
arrangé, mais que le spectacle est une idéologie matérialisée [C’EST
UN FAIT]. Qui dit mieux ! Il n’y a pas seulement le mot, mais le
concept [C’EST UN FAIT]. Et c’est pourquoi, entre tous les
nombreux exemples possibles, j’ai pris celui-là. La traduction de Baudet est en
deçà de la vérité : le texte original est encore plus debordien que ne le
laisse supposer sa traduction par Baudet [C’EST UN FAIT : il suffit
de lire Anders maintenant que c’est possible pour le lecteur français]. C’est
toujours la même histoire : c’est Cicéron qui ressemble à Marlon Brando.
« Qui s’y intéresse ? » demandait le cynique dissimulateur,
heureux d’avoir réussi son coup. Mais, il y a un cadavre dans le placard et
Philip Marlowe est sur l’affaire. Il en est à son quatre-vingt douzième coup de
matraque, la routine, quoi. Comme d’habitude, son chemin est encombré d’un
nombre impressionnant de cadavres, mais là encore c’est la routine, puisqu’on
le surnomme « un par jour » (c’est également ce qu’on dit de Bill
Microsoft, mais il s’agit d’un plantage et non d’un cadavre). Mais une chose
est certaine, il ne lâchera pas le morceau. Voilà une enquête qui commence bien
et qui présage de piquants développements. C’est un coup de pied du contra
Marlowe dans la fourmilière pro-situ. Il faut dégonfler les baudruches. Non
content de cela, Debord a voulu généraliser ce qui n’était pas généralisable
tout en cachant soigneusement ses sources, ce qui a rendu sa critique plus
difficile puisqu’elle consiste simplement a montrer qu’il s’est contenté de
rendre obscur, donc indiscutable, ce qui était clair, donc discutable. Effectivement
le livre de Debord fut écrit pour nuire... mais à qui ?
Conclusion : Debord
reconnaît avoir eu connaissance du livre de Anders, introuvable en France,
suffisamment pour citer des passages de mémoire, plus de vingt ans après, et il
reconnaît, en 1988, avoir eu connaissance des aventures du livre de Anders,
dont personne ne se soucie, aux États-Unis en 1961. Je ne me livre a aucune
interprétation, il s’agit d’un simple fait : Debord affirme avoir connu
Anders et le prouve en citant, exactement, de mémoire, plus de vingt ans après,
une phrase d’un livre introuvable. Où y a-t-il de l’interprétation ? Le
concept de spectacle existe dans le livre de Anders. La traduction de Baudet
est fidèle. La question n’est pas de savoir qui a employé le premier le mot
spectacle dans le sens qu’on voudra, ni combien de fois. La question est que
l’on sait maintenant que Debord connaissait l’existence d’Anders et a caché
cette existence. Ce n’est encore rien. En ce qui concerne « le
spectacle », la question est que : ce qu’en dit Anders a un sens — quel
qu’il soit — tandis que ce qu’en dit Debord n’en a pas ou que le peu
qui en a est déjà chez Anders ; c’est ce que montre la comparaison
désormais possible en français. Il est strictement impossible de confondre
Debord et Anders, puisque ce que dit Anders a un sens tandis que ce que dit
Debord n’en a pas. Oranges, citrons, pamplemousses ! Que celui qui
comprend ce que dit Debord me l’explique. ]
Tout le reste est de la même
veine. Étonnant, non ? J’ignorais que Debord lisait l’allemand. Cela ne
lui a servi à rien.
________________________
*. Il semble
que Anders commette ici la même faute que Debord : ce n’est pas le cours
du monde lui-même qui est spectacle arrangé, mais un flux d’images. Mais Anders
rectifie et précise dès la page suivante : il s’agit simplement d’une
interprétation du cours du monde par traitement des événements de ce monde et non par arrangement du
monde lui-même. L’arrangement du monde proprement dit a lieu, selon Anders, par
conformation de ce monde à ses images, ce qui ne fait pas pour autant du monde
un spectacle. Les trois mille employés morts dans les tours infernales en on
fait l’expérience (oui ! l’expérience, la chose même et non plus un mur
d’image. Cela les a changé un peu de CNN). Aux idéologies, qui sont
des interprétations du cours du monde, succède un autre type d’interprétation
qui consiste dans un flux d’images où l’on est censé voir le cours du monde, en
fait un cours du monde illusoire. « c’est le mensonge qui est
devenu réel [ qui est devenu une chose donc. Un
tableau de Rembrandt ou une image quelconque sont des choses, ce qui n’était
pas le cas des concepts des idéologies], et le fait que de
fausses interprétations du monde soient livrées à domicile a fini par rendre
inutile toute idéologie explicite. » Avec ce nouveau type
d’interprétation, la distinction entre le monde et la vision du monde, entre le
monde et l’interprétation du monde devient impossible car l’image, dans la
théorie de Anders, est d’emblée et constitutivement interprétation (cf
page 176). C’est également le spectacle de masse proprement dit, c’est à
dire consommé en masse, comme au cinéma, faute de moyens de diffusion, tel que
l’a connu Anders avec Hitler et Staline, qui est devenu inutile.
En fait, ce que dit Anders
est encore plus subtil : c’est en partie le cours du monde lui-même qui
est arrangé puisque ce cours du monde « devient le reflet de son image »,
ce que Anders appelle « le mensonge devenu vrai », le devenir
mensonge du monde, un monde qui se conforme à son image, qui se conforme à son
mensonge (page 205), « le réel comme reproduction de ses
reproductions » (page 216). Les Arabes se sont conformés, ont
conformé leur action, aux images des films catastrophe. Mais c’est alors la
négation de la négation, c’est à dire la vérité, la réconciliation dans la mort
pour la plus grande gloire d’Allah, c’est à dire pour la plus grande gloire de
la foi, par la stigmatisation d’un monde sans foi, un monde de patineurs à roulettes,
de pédés mariés, de cognitivistes et de libres employés de bureau, un monde du fun
comme le dit déjà Anders en 1956 : « Da die Behandlung sich als
"fun" gibt » (page 104). Le sérieux absolu de Mohammed Atta
se dresse contre le fun impie, de Manhattan à Youpi plage (La pensée de
Mohammed Atta était-elle dans la tête de Mohamed Atta ?) Voilà une bonne
définition du spectacle en tant que « la société même » : une
société qui se conforme à l’image qu’elle livre à domicile (cependant,
cette société n’est pas pour autant un spectacle, elle est seulement
spectaculaire. Et ce n’est pas « le spectacle » qui se présente comme
la société même, comme le monde même, mais seulement des images dans les cages.
Restons simples, s’il vous plaît. Et, bien que les images soient, comme le note
Anders, des marchandises, les autres marchandises ne se présentent pas pour
autant comme la société même, comme le monde même, mais seulement comme des
choses qui ont non seulement un nom, mais un prix. Là où les choses ont un
prix, les hommes sont totalement séparés et totalement solidaires). Tout est
simple chez Anders. Alors, le spectacle, ce n’est plus seulement la télévision,
la consommation d’images à domicile, c’est la société qui se conforme à son
image suite à la livraison à domicile de ces images, par la consommation à
domicile des ces images : « la radio, l’écran de télévision et la
consommation de fantômes sont eux-mêmes des réalités sociales si massives qu’ils peuvent triompher de
la plupart des autres réalités et déterminer eux-mêmes "ce qui est
réel", "ce qui arrive réellement" » (page 218.
A part ça, Debord n’a pas pompé Anders). En ce sens, le spectacle n’est pas un
instrument d’unification mais un instrument de conformation. Comme le dit très
justement Anders, « les représentations du "monde" que les
émissions nous livrent ne conditionnent pas que nous et notre image du monde,
mais le monde lui-même, le monde réel » (page 205), avec ses farouches
wahhabites qui crapahutent dans les montagnes désolées et qui, entre deux prières,
regardent aussi la télévision par satellite.
L’essentiel
ici est que : si le monde peut se conformer à l’image du monde, c’est que
l’image du monde est, de toute éternité, un moment essentiel du monde (jusqu’à
présent, ce moment avait pour nom : Dieu) et que c’est seulement
aujourd’hui que ce moment essentiel devient manifeste en prenant une stricte
forme d’image. Le monde contient le négatif comme image du monde (ici aussi
bien qu’à Kirivina. Ainsi donc Dieu est le négatif ! Sacrilège !), le
monde contient le négatif comme apparence, le monde contient le négatif comme
représentation du monde, comme réflexion dirait Hegel, l’athée et l’Antéchrist.
La représentation du monde est la condition d’existence d’un monde. Un monde
n’existe que s’il contient sa propre représentation. Ce n’est pas la
négation de la vie qui est devenue visible, c’est la condition d’existence
d’un monde, quel qu’il soit. Pas de représentation du monde, pas de monde.
C’est sur ce point précis, sur le terme de réflexion, qu’au cours d’une courte
discussion de dix minutes, Debord me demanda : « Me prends-tu pour un
imbécile ? » J’aurais dû.
« L’un
des caractères distinctifs des siècles démocratiques, c’est le goût qu’y
éprouvent tous les hommes pour les succès faciles et les jouissances présentes.
Ceci se retrouve dans les carrières intellectuelles comme dans toutes les
autres. La plupart de ceux qui vivent dans les temps d’égalité sont pleins
d’une ambition tout à la fois vive et molle; ils veulent obtenir sur-le-champ
de grands succès, mais ils désireraient se dispenser de grands efforts. Ces
instincts contraires les mènent directement à la recherche des idées générales,
à l’aide desquelles ils se flattent de peindre de très vastes objets à peu de
frais, et d’attirer les regards du public sans peine. [ Janvier 2005 : BHElle prépare un « livre »
sur Tocqueville, c’est à dire sur un homme qui l’a déjà jugé il y a cent
cinquante ans ! ]
» Et je ne sais s’ils
ont tort de penser ainsi ; car leurs lecteurs craignent autant
d’approfondir qu’ils peuvent le faire eux-mêmes et ne cherchent d’ordinaire
dans les travaux de l’esprit que des plaisirs faciles et de l’instruction sans
travail.
» Ces mots abstraits
qui remplissent les langues démocratiques, et dont on fait usage à tout propos
sans les rattacher à aucun fait particulier, agrandissent et voilent la
pensée ; ils rendent l’expression plus rapide et l’idée moins nette. Mais
en fait de langage, les peuples démocratiques aiment mieux l’obscurité que le
travail. [ Ce qui déplait au prositu dans le
travail du négatif, c’est le travail ; et il a un grand faible pour
l’obscurité, comme son mentor : « plus nous serons fumeux, plus nous
serons obscurs ». ]
» Chez tous les
peuples, les termes génériques et abstraits forment le fond du langage ;
je ne prétends donc point qu’on ne rencontre ces mots que dans les langues
démocratiques ; je dis seulement que la tendance des hommes, dans les
temps d’égalité, est d’augmenter particulièrement le nombre des mots de cette
espèce ; de les prendre toujours isolément [le spectacle, l’économie, la
marchandise, la liberté, la démocratie, le Bien, le Mal ] dans leur acception
abstraite, et d’en faire usage à tout propos, lors même que le besoin du
discours ne le requiert point [supprimez économie ou économique partout où ces
mots apparaissent et le sens du discours ne change pas]. »
Tocqueville. De la
démocratie en Amérique [ Ceci est écrit
en 1840. Elle est bien bonne ! Il n’y avait à l’époque ni télévision, ni radio,
ni cinéma, n’est ce pas ? Mais cela n’empêche pas Tocqueville, de son trait acerbe, de décrire ce qui se joue
alors et qui deviendra l’Amérique envahissant l’Irak. Tocqueville et Stendhal
méprisaient cordialement les Américains, ce qui n’est même pas mon cas. Je me
contente d’admirer les Arabes. Bandes de fous d’Allah ! Puissiez vous
vaincre. ]
Je montre, dans ce qui suit cette introduction, que Debord se
contredit sur la question de savoir si le spectacle est la société même, c’est
à dire si le spectacle est l’essence de la société. Il l’affirme une fois
(§ 3 : « Le spectacle se présente à la fois comme la société
même... comme une partie de la société, et comme instrument d’unification. »)
mais le dénie à de nombreuses reprises sans même s’en rendre compte, lui qui se
moquait des gens qui se contredisent plusieurs fois dans la même page.
Le verbe se présenter
a, entre autres, le sens de « être d’une certaine manière » (Petit
Robert). Je suis donc parfaitement fondé à comprendre « se
présenter » dans le sens d’être. L’usage m’y autorise. Quand on
dit : « La tour Eiffel se présente comme une grande structure
métallique », on dit en fait « La tour Eiffel est une grande
structure métallique ». Anders, quant à lui est parfaitement clair, à son
habitude, sur ce point. Page 188-189, il parle d’« une image
pragmatique du monde » (qui n’est plus rien de théorique,
d’idéologique, mais « un instrument pratique ») « un instrument
qui se présente déguisé en "monde" pour dissimuler sa vocation
instrumentale. » Tout est parfaitement clair chez Anders : qui se
présente déguisé en monde. Le faiseur de phrase Debord n’écrit que pour
rendre obscur ce qui était clair. Plus il devient fameux, plus il devient
obscur, en effet.
Je prouve que Debord a bien
écrit : le spectacle est la société même,
quels que soient les termes employés.
Je réponds ici aux
insinuations de petits merdeux
Grâce à la méthode des
variations de Bolzano je vais montrer l’obscurité créée par Debord (Bolzano ne s’en
servait pas pour démontrer l’obscurité de ses adversaires mais pour calculer la
probabilité de validité des propositions entre 0, toujours faux et 1, toujours
vrai). Une seule occurrence du verbe se présenter commande
« à la fois » trois prédicats. Je vais écrire la phrase sous
sa forme développée, non elliptique : « Le spectacle se présente comme la société même... se présente comme une partie de la société, et se présente comme instrument d’unification. »
Supposons que Debord veuille dire, dans la première des trois propositions qui
forment cette phrase, que le spectacle se présente, de façon trompeuse,
déguisée, comme le monde même. Voyons ce que ça donne si j’attribue au
mot-variable la valeur « se présente déguisé en » : « Le spectacle
se présente déguisé en la société même... se présente déguisé en
une partie de la société, et se présente déguisé en instrument d’unification. »
Cette phrase n’est pas satisfaite par cette valeur car la seconde proposition
« le spectacle se présente déguisé en une partie de la société » est fausse en
vertu même des hypothèses de Debord. En effet, Debord ajoute
aussitôt : « En tant que partie de la société, il est
expressément
le secteur qui concentre tout regard et toute conscience. » Donc
l’hypothèse de Debord n’est pas que, en tant que partie de la société, le
spectacle se présente déguisé en secteur qui... mais qu’il est expressément un secteur qui..., qu’il
est expressément une partie de la société (car un secteur de la société est une
partie de la société), qu’il se présente donc en toute franchise et sans
déguisement, qu’il se présente comme il est, comme la tour Eiffel. Être
expressément est tout le contraire de se présenter déguisé, oui ou
merde ? Donc le seul sens que puisse prendre le mot-variable sans contredire
les propres hypothèses de Debord est être expressément, c’est à dire être. La seule interprétation
correcte de la phrase de Debord est donc : « Le spectacle est la société même... est
une partie de la société, et est un instrument
d’unification. » Puisque se présenter, selon les propres
précisions de Debord, signifie être dans la seconde proposition, il
signifie être aussi dans la première et dans la troisième. Debord a donc
écrit, en fait : « Le spectacle est à la fois la société même... une
partie de la société, et un instrument d’unification. ». CQFD. Voilà ce que c’est que
d’écrire en charabia ampoulé et d’employer un terme recherché, pour faire
élégant, plutôt que le vulgaire verbe être. Si le phraseur Debord voulait dire
autre chose, il devait l’écrire autrement, comme l’a écrit Anders, par exemple.
Voilà sans doute ce que les imbéciles éditeurs de Anders nomment :
« complétée et développée par d’autres avec plus de rigueur. » On
voit la rigueur à l’œuvre.
J’avais d’ailleurs déjà
traité ce sujet dans une lettre à M. Bueno du 19 février
1998 :
February 19, 1998
Je vais
essayer s’être encore plus clair si possible, ce qui d’ailleurs semble être
peine perdue avec vous ; mais le monde est si vaste.
Debord
écrit que le spectacle se présente comme la société même, comme partie de la
société, et comme instrument d’unification (thèse 3).
Précisément,
il ne croit pas si bien dire : si le spectacle « se présente »
comme la société même, c’est bien qu’il n’est pas la société même mais
seulement une partie de la société qui veut se faire passer pour la société
ou qui se charge de représenter la société à elle-même. Dans les dictatures,
cette partie est la propagande, dans les sociétés commerciales, cette partie
est la pub et le journalisme (c’est à dire encore la propagande) ou, plus
généralement, l’industrie des loisirs.
Quand Debord dit que le spectacle
« se présente » c’est une façon chic de parler, plutôt une façon
chic de phraser. Ça lui ferait mal d’écrire, comme tout le monde, que le
spectacle est d’une part la société même et d’autre part une partie de la
société.
Debord
a toujours soutenu que le spectacle était la société elle-même (« Toute
la vie dans les sociétés... », thèse 1) et non pas seulement un
secteur séparé qui concentre tout regard et abuse toute conscience. Il n’a
cessé d’insister là-dessus faisant maintes remontrances à ceux qui
entendaient ce terme dans un sens restreint. Ces derniers méconnaissaient
ainsi le génie du grand homme et insultaient à ce génie. On a assez entendu
la chanson.
|
*
* *
Debord aurait
pu écrire, par exemple : « Le spectacle se présente
trompeusement comme le monde même alors qu’il n’est qu’un secteur du
monde et un instrument d’unification ». Mais cela est impossible quand on
sait avec quelle indignation il protestait quand quiconque prétendait que le
spectacle n’était qu’un secteur de la société, à savoir la télévision, la
radio, la pub, la presse. Debord voulait bien dire que le spectacle n’est pas
seulement un secteur du monde mais le monde même. C’est une sottise. La réponse
était chez Anders, depuis cinquante ans. Le monde n’est pas spectacle, il est
spectaculaire, ce qui signifie 1) qu’il contient le spectacle et
2) qu’il se conforme au spectacle (c’est le virtualisme de M. de Defensa : les
producteurs de bobard croient à leurs bobards), et le spectacle n’est
rien d’autre que la livraison à domicile d’images du monde, consommation à
domicile d’images du monde et notamment consommation d’images de la
consommation (définition de la pub). Cela dit, ce secteur est coextensif au
monde étant donné qu’il a lieu dans des milliards de cages, partout dans le
monde. Mais le spectacle est invisible puisqu’il a lieu dans les
cages.
Voilà le secret que Debord n’a jamais pu pénétrer alors qu’il était élucidé
depuis cinquante ans par Anders. Anders répond donc à toutes mes questions.
Anders dit aussi que le monde se conforme à ces images distribuées. Mais cela
ne signifie pas que le monde est de ce fait un spectacle. Au contraire il est bien
le monde réel. Ainsi, les Arabes volants ont conformé leur action aux films
catastrophiques, mais leur action est réelle, un peu trop même, ne trouvez-vous
pas ? Elle n’est pas un spectacle, elle est spectaculaire, c’est à dire
qu’elle résulte de l’image que le monde donne de lui-même et qu’elle est conçue
pour être diffusée à son tour à des milliards d’exemplaires dans des milliards
de cages et même sous les tentes et dans les grottes ; elle est conçue
selon les lois de la diffusion, ce qui ne l’empêche pas d’être réelle et pleine
de sens : c’est bien le cours du monde lui-même qui a pénétré dans les
cages où était parquée la ressource humaine des tours infernales. Que dit le
prositu : « C’est le spectacle intégré ». Qu’est-ce que le
spectacle intégré ? C’est l’économie qui poursuit son développement pour
lui-même. Tout est simple, donc, pourquoi se casser la tête ? Tocqueville
le dit bien, la science supérieure, la méditation, sied peu aux sociétés
démocratiques qui ont d’autres chats à fouetter. Le prositu est bien fils de
son temps. Les Arabes ont complètement maîtrisé les règles du spectacle pour
pouvoir s’exprimer. C’est compréhensible, puisque eux ne produisent
rien, ils récupèrent. Le triste universitaire tropical dirait : ce sont
des bricoleurs, ils utilisent ce qui se trouve là.
La définition
de Boorstin de pseudo-événement est encore meilleure car elle ne se
limite pas à la diffusion d’images ou même de fantômes. Dans le pseudo
événement, l’événement est la diffusion du pseudo-événement, ce qui est une
définition beaucoup plus générale et nous sort de la télévision etc… Le
Pentagone est le principal diffuseur de pseudo-événement, avec de nombreux
morts réels etc. Le Pentagone, c’est autre chose que la télévision. De ce point
de vue, la guerre d’Irak est une totale victoire car sa diffusion, dans tous
les sens du terme, est parfaitement réussie. Cela n’empêche pas que la société
n’est pas pour autant un pseudo-événement et elle le prouve, assez violemment.
Contrairement à ce que
prétend Debord : ce secteur ne concentre pas tout regard et toute
conscience ; tout ce qui est directement vécu (quels veinards ces employés
de bureau des Twin Towers), où que ce soit dans le monde, se rapproche
des spectateurs dans une représentation mais ce qui se rapproche ainsi n’en est
pas moins parfaitement réel. Au contraire de ce que prétend Debord, il y a
dispersion et rapprochement. De même que la pensée de Mohammed Atta n’était pas
dans la tête de Mohammed Atta, le spectacle n’est pas, ne réside pas dans les
officines de radio, télévision et pub, pas plus qu’il ne réside dans les
événements extraordinaires. Le spectacle a lieu dans les milliards de cages du
monde où il pénètre avec la pensée de Mohammed Atta. Salam aleikum. Wa
aleikum sa salam. Donc, c’est tout le contraire de ce que prétend Debord.
Tout ce qui a lieu effectivement dans le monde (Drucker et les plateaux de
télévisions sont réels, je les ai rencontrés.) se rapproche du spectateur dans
une représentation. La tromperie réside exactement ici, ainsi que le dit
parfaitement Anders : le spectateur croit assister à l’événement
alors qu’il a seulement connaissance de la seule existence de
l’événement. Il croit porter un jugement sur l’événement alors qu’il ne fait
que porter un jugement sur l’existence de l’événement (mais
c’est du Frege : le prédicat d’existence est un prédicat du second niveau
qui porte sur le concept et non sur l’objet qui tombe sous le concept) ;
de même que madame Verdurin devant sa tasse de café, son croissant dans une
main le Figaro dans l’autre, s’écrie : « Oh ! quelle
horreur ! » quand elle lit la nouvelle du naufrage de l’insubmersible
Titanic sans que cela lui coupe l’appétit pour autant. L’image se donne pour la
chose alors qu’elle n’est que connaissance, et connaissance biaisée, de
l’existence de la chose. Tout ce que sait le spectateur est que la chose est.
Comment est-elle ? Il l’ignore bien qu’il croie le savoir (contrairement
aux employés de bureau des Twin Towers et aux Irakiens qui, eux,
savent). C’est un ignorant qui se croit savant. Les employés de bureau sont
morts savants. Les Irakiens vont-il apprendre quelque chose aux
américains ?
Ce n’est pas le spectacle
qui apparaît comme le monde même, mais un flux d’images du monde. Le spectacle,
au contraire, ne paraît pas puisqu’il consiste dans la consommation
d’images et que cette consommation a lieu dans les cages. Telle est la leçon
d’Anders. Je découvre Anders, dissimulé depuis cinquante ans au lecteur
français (pas tous, c’est évident quand on le lit). Quelle heureuse surprise,
un homme qui pense, qui ne se paye pas de mots, qui ne pose pas, qui ne se
contente pas de régurgiter des banalités et des lieux communs. Quelle fraîcheur
après tant de boursouflure et de prétention. Les impostures vieillissent tandis
que Anders est toujours vert.
La définition d’Anders, page
176 est parfaitement claire et limpide : « L’intention de la
livraison d’images, de la livraison de l’image totale du monde, est précisément
de recouvrir le réel à l’aide du prétendu réel lui-même et donc d’amener le
monde à disparaître derrière son image. » Voilà qui nous change du
baragouin de Debord, l’homme qui se regarde écrire : le spectacle est la
livraison à domicile d’images qui se prétendent image totale du monde (et
non pas qui se prétendent le monde lui-même, notez bien la différence avec ce
que dit Debord. Les images ne se présentent pas comme le monde lui-même, comme
la société même ; mais seulement comme image totale, donc vraie, du
monde, de la société), ce qu’elles ne sont pas évidement comme le montre
minutieusement et clairement Anders. C’est pourquoi il y a seulement spectacle
ou fantôme. On ne peut être plus clair, la question est tranchée. Debord a défiguré l’original en s’employant à le rendre
sibyllin et confus tout en l’infectant de surcroît du plus grossier marxisme.
Notez que Anders emploie distanciation, là où j’emploie éloignement,
pour rendre aliénation dans son sens technique et pour le distinguer de son
sens étymologique qui, en allemand, signifie en fait le contraire de
l’acception technique soit, excusez moi, dé-étrangisation. Contrairement à
Debord, cet homme ne se payait pas de mots, il savait de quoi il parlait. Il
semble connaître non seulement Heildegger mais aussi la philosophie analytique.
La question est
magnifiquement réglée par Anders depuis sa publication chez Berk à Munich en
1956 (1959, conférence de Munich de l’I S. avec une forte présence
d’Allemands ; 1962, exclusion des Allemands et apparition du terme spectacle
dans le n° 6 de la revue de l’I. S. en 1961, comme légende d’une
photographie : « La consommation et sa mise en spectacle »,
c’est à dire consommation d’images de la consommation. Un jour, Debord me dit,
se plaignant du fait qu’on s’emmerdait ferme dans l’I. S. :
« Les Allemands étaient de sales cons, mais au moins on discutait. »
En effet) : nulle part on ne peut constater quelque chose qui soit un
spectacle et qui serait, qui se présenterait, qui apparaîtrait comme la société
même. Des images se présentent comme image totale de la société, comme image
totale et non pas comme la société même. Anders insiste bien : ces images
sont néfastes justement parce qu’elles demeurent des images : elles
transforment tout événement en bibelot, « c’est précisément en nous offrant
une image de l’événement [et non l’événement lui-même] que la télévision nous
trompe ». Il y a certains endroits, bien définis par Anders (le spectacle
a lieu à domicile et seulement à domicile, dans les cages. Tout
ce qui était directement vécu s’est éloigné dans une représentation. Oui,
où ça ? A domicile, imbéciles — nous verrons plus loin que ce n’est même
pas vrai —. Les images qui se sont détachées de chaque aspect de la vie
fusionnent dans un cours commun. Oui, où ça ? A domicile, imbéciles. Anders
vous l’avait bien dit, imbéciles), où se présente une image prétendument
totale, donc vraie, de la société, du monde. Une image et non pas la
société même, le monde même, imbéciles. On peut constater la bouillie que
Debord a su faire d’une chose si simple et si étonnante présentée en 1956 par
un homme qui a connu le nazisme, le stalinisme et les États-Unis d’Amérique
(comme Céline, donc). Quiconque lit Anders comprend aussitôt que la Société
du spectacle n’est que charabia dépourvu de sens.
Avec Anders, tout s’éclaircit, la supercherie est dévoilée. Il suffisait de
comparer l’original, soigneusement dissimulé pendant cinquante ans, avec la
copie. Anders répond notamment à une question que je me
posais. Puisque cette société était censée être une immense accumulation de
spectacles, où pouvait bien être cette accumulation puisqu’on ne voit en fait
aucun spectacle dans le monde, sinon, de temps en temps, une affiche avec une
femme nue ou bien le triste spectacle des esclaves désœuvrés raclant leurs
semelles sur l’asphalte. De même, je me demandais comment Debord pouvait soutenir avec Canjuers que ce monde est un désert
constitué de parkings et de dortoirs et soutenir que ce monde est un spectacle ou
du moins un monde du spectacle. Or le spectacle a lieu à domicile, dans les
cages et l’on ne voit pas ce qui se passe dans les cages. Donc, il n’y a pas
contradiction à affirmer que ce monde est un désert et que ce monde est sinon
un spectacle, du moins un monde spectaculaire, puisque le spectacle, invisible,
a lieu dans les cages des dortoirs. Et le monde est bien le triste spectacle
d’une immense accumulation de cages et de parkings. La consommation d’images de
l’unification heureuse par la consommation a lieu dans les cages solitaires
environnées de désolation et d’épouvante. On ne la voit jamais ailleurs. Si,
après tant de temps, je n’ai pas trouvé une idée aussi simple, c’est parce que
je tournais mon regard vers les lieux de production, comme
on peut le constater dans ce qui suit, vers les officines qui ne sont pas
si nombreuses que ça d’ailleurs au point de constituer une immense
accumulation, alors que le spectacle réside sur les lieux de consommation qui
sont aussi les lieux de réception, dans les milliards de cages. C’est justement
l’illusion dénoncée par Anders : je voyais seulement une image des lieux
de production réels, lieux que j’ai pris la peine de visiter d’ailleurs, et
j’avais l’impression que n’existaient que ces lieux de production alors
qu’existe également leur image reproduite à des milliards d’exemplaires, ce qui
est une chose sociale colossale et invisible. C’est sa consommation dans
l’isolement et le nombre immense des « solistes de la consommation »
qui font le spectacle. On sait que les acteurs de théâtre redoutent une salle
vide. Le monde est comme un théâtre éclaté en milliards de loges où l’on ne
jouerait inlassablement qu’une seule et unique pièce. Le spectacle réside dans
la consommation d’image à domicile, notamment dans la consommation d’images de
la consommation, dans l’isolement et la solitude. C’est tout.
Examinons la première thèse
de Debord à la lumière de Anders. « Toute la vie des sociétés dans
lesquelles règnent les conditions modernes de production s’annonce comme une
immense accumulation de spectacles. » Pas de chance, c’est
l’inverse : Une immense accumulation d’images s’annonce comme toute la vie
dans la société. Ensuite, cette accumulation est invisible car elle a lieu dans
les cages. Dans chaque cage, il n’y a pas accumulation mais un seul spectacle
et ce spectacle ne se « présente » pas « comme le
monde », mais comme le monde du spectateur, comme son monde
(c’est la carte forcée). L’idéaliste du Tractatus dit « Le monde
est mon monde » ce qui est la définition de l’idéalisme. Le spectateur
dans sa cage est un idéaliste. Le monde devient, par les images, son
monde. Esse es percipi. Le monde a disparu. Les troupeaux de patineurs à
roulettes ne patinent pas dans le monde mais dans leur monde.
Debord aussi patinait dans son monde et non dans le monde. Dantec
a un pied dans le monde et l’autre dans son monde. Il va devoir
choisir. Les Arabes vivent dans le monde d’Allah qui est le vrai monde. Depuis Durkheim,
nulle théorie n’a surpassé la religion. « Tout ce qui était directement
vécu s’est éloigné dans une représentation. » Pas de chance, c’est
encore l’inverse : tout ce qui est vécu au loin, à Manhattan, aux
antipodes si possible, fait irruption à l’intérieur des cages en tant que
bibelot familiarisé : « car ce qui désormais règne à la maison grâce
à la télévision, c’est le monde extérieur — réel ou fictif — qu’elle y
retransmet » (page 123). C’est le phénomène de la familiarisation.
Les Arabes l’ont parfaitement compris et s’en sont servi, depuis leurs
lointaines contrées désertiques, pour signifier leur message inouï (dites-le
avec des avions). Etc. Tout s’éclaire, l’original réfute sa copie.
Anders soutient que l’image
est un jugement caché, un préjugé, de même que toute marchandise. Il n’en est
rien, au contraire. Quand je lis : « La maison de M. Biswas
est petite. », je lis un jugement déjà effectué, que je puis croire ou
non, vérifier ou non. Je sais très bien que mon accès au monde, par ce jugement,
est médiatisé. D’ailleurs, il s’agit dans cet exemple d’un monde imaginaire.
Quand je regarde une image du film « Une maison pour M. Biswas »,
le jugement n’est pas effectué, je dois le former moi-même et dire, par
exemple, « La maison de M. Biswas est petite. ». Or ce
jugement n’est pas un jugement sur l’image (l’image est petite ou la maison
représentée est petite) mais un jugement sur le monde (la maison de
M. Biswas est petite) alors que je n’ai pas de contact direct avec le
monde. C’est la médiation qui est cachée et non le jugement. Je crois
porter un jugement sur le monde alors que je porte un jugement sur une image.
Voilà pourquoi il y a confusion entre le monde et sa représentation. Le
jugement porté en fait sur une image se croit jugement porté sur le monde.
C’est la méthode de la carte forcée : le joueur croit tirer une carte
quelconque, porter librement un jugement sur le monde, mais le tricheur, qui a arrangé
le jeu, lui fait tirer la carte de son choix.
Le 11 septembre 2001,
pour une fois, cette image fut enfin totale, donc vraie, pour des milliards
d’individus, puisqu’on vit sans équivoque, un monde frappé par quelques
bédouins, en son si bien nommé Centre du commerce mondial (c’est autre
chose que le Larzac, ça. Sur le Larzac, il n’y a que des bêlements), quelque
fut l’exiguïté des écrans de télévision. Ce qui est directement vécu par
dix-neuf bédouins et quelques milliers d’employés de bureau est le jugement
d’un monde. Ce qui est directement vécu est déjà un jugement et donc l’image
mondialement diffusée est l’image d’un jugement. Le jugement d’existence porté
par le spectateur est le jugement d’existence d’un jugement. Ce monde a été
jugé et le monde le sait puisque des milliards de spectateurs dans leur cage le
savent et le savent seulement (c’est pourquoi il ne s’agit que d’une
lueur d’espoir), Anders dixit. C’est une révélation. Pendant ce
temps, l’imbécile crapuleux Bové démontait une minuscule structure métallique.
C’est exactement ce que ben Laden nommait « signifier un discours ».
Il n’y a pas besoin d’entendre le discours, il suffit de savoir qu’il existe.
Les Arabes jouent cartes sur table : ils occupent la place du mort.
Le jugement du monde crève l’écran et fait irruption dans les cages. Partout
des cris d’allégresse retentissent. Le monde du tourisme est inquiet, mais il
ne tremble pas dans ses profondeurs puisqu’il n’en a pas. Alléluia.
Comme d’habitude, ce sont les réactionnaires, Bush le premier, qui ont le mieux
compris de quoi il s’agissait : oui c’était bien leur mode de vie qui
était attaqué grâce a ses propres produits pour parler comme Anders. Ils
avaient seulement la naïveté ou l’outrecuidance de croire que les Arabes
enviaient leur mode de vie. Les Arabes ne veulent pas devenir, eux aussi, une
foule solitaire de libres employés de bureau puisqu’ils communient encore. Dans
ce monde, pour se sentir bien, il faut être dans un abri anti-aérien, parmi des
Arabes, à Bagdad, pendant le guerre (Nabe, Printemps de feu). Comme le
dit Anders dans sa préface à la cinquième édition, en 1979, faisant allusion à
la guerre du Vietnam : « ...même s’il est apparu depuis lors que les
images télévisuelles nous livrent à domicile, dans certaines situations, une
réalité qui, sans elle, nous resterait étrangère... » donnant ainsi raison
à Naipaul. En effet les Arabes ne savent pas construire d’avions, mais ils
savent parfaitement s’en servir, ainsi que de la télévision. Ils ont compris la
leçon de ce monde. Ils ont conçu leur événement en vue de sa diffusion
mondiale, comme un vulgaire match de football, mais, contrairement aux matchs
de football et autre loft story, cet événement est unique, il n’est pas
reproductible, mais on peut en produire des milliards d’images. Pour le
reproduire, il faut être Arabe et mourir, comme mourut au Caire, en 1800,
l’assassin du général Kléber. Ces bédouins utilisent les produits destinés aux
consommateurs de masse mais cela ne fait pas d’eux, pour autant, des
consommateurs de masse, car ils les utilisent pour leur fins propres et pour la
plus grande gloire d’Allah, ce que l’on a appelé, il me semble, un
détournement. Eux sont parfaitement à la hauteur de ces produits qui, toujours
selon Anders, dominent le commun des mortels, précisément parce que les Arabes
ne produisent rien. Ils se contentent de prier et de mourir. Ils ignorent la
honte prométhéenne, autre concept de Anders. Ils savent se faire entendre en
toute clarté et donner à voir une réalité parfaitement étrangère et qui
le demeure en ce monde qui s’intitule effrontément libre. Ils livrent à
domicile et en personne : ils sont présents dans l’événement comme le
Christ l’est dans l’hostie lors du sacrifice. Même les Chinois comprennent. Les
gens bons sont impurs pour des musulmans. La bonté est cette immensité où tout
se tait. L’Islam est seul à s’opposer
à l’infamie marchande et il s’y oppose pour une raison fondamentale et non sur
des questions de détail. L’antique Islam est le conservatoire de la foi. Comme
dit Naipaul, il n’a que la foi alors que les autres ont le téléphone. Voyez ces
anges exterminateurs réels. Ils sont la critique fondamentale, sans phrase,
de l’économie politique. Ils ont signifié un message inouï : non, les
hommes ne sont pas des pourceaux, les pourceaux sont impurs, aux tours les
pourceaux. Attaque en règle de la porcherie. Feu sur la porcherie. Les mosquées
sont les seuls endroits, dans ce monde, où des hommes peuvent encore se parler.
Günther Anders. L’obsolescence
de l’homme. Editions Ivrea. 2002
Disponible
sur Amazon.com
« Le spectacle, comme
la société moderne, est à la fois uni et divisé. Comme elle, il
édifie son unité sur le déchirement. »
Le spectacle est « comme
la société moderne », « comme elle, il édifie... », donc le
spectacle n’est pas la société moderne, ce qui rentre en contradiction avec le
§ 3 : « Le spectacle se présente à la fois comme la société
même.... »
§ 57
« La société porteuse
du spectacle ... »
Même contradiction. Si la
société est porteuse du spectacle, c’est donc que le spectacle n’est pas
"la société même".
§ 11
« ...on passe sur le
terrain méthodologique de cette société qui s’exprime dans le
spectacle. » En contradiction avec le § 3. Si cette société s’exprime dans
le spectacle, elle n’est donc pas le spectacle lui-même et réciproquement le
spectacle n’est pas la société même.
§ 7
« La pratique sociale, devant
laquelle se pose le spectacle autonome, est aussi la totalité qui contient
le spectacle. »
Encore en contradiction avec
le § 3 : si la totalité de la pratique sociale contient le
spectacle, comment le spectacle pourrait-il être la société même?
§ 65
« Le spectaculaire
diffus accompagne l’abondance des marchandises ... » Accompagne, donc il n’est
pas l’abondance des marchandises. Le spectacle en est seulement « un
catalogue apologétique », c’est à dire en langage ordinaire, la pub.
§ 70
« L’imposture de la
satisfaction doit se dénoncer elle-même en se remplaçant... »
Voilà une définition possible
du spectacle (qui cependant n’est pas une définition du spectacle en général
mais une honnête définition du spectacle comme secteur particulier) : le
spectacle est l’imposture de la satisfaction. La question se pose
immédiatement : où a lieu cette imposture, où a lieu ce spectacle ?
Certainement pas directement dans le monde ou dans la société. Certainement pas
dans le métro bondé le matin, certainement pas dans le grouillement infâme des
employés de bureau dans les rues ou entre les tours, certainement pas sur les
autoroutes embouteillées, certainement sur les boulevards où les esclaves
désœuvrés raclent leurs semelles. Certes tout cela est un triste
spectacle ; mais ce n’est ce que voulait dire Debord.
Cependant on voit passer
dans le monde des agents imposteurs de la satisfaction, notamment les patineurs
à roulettes ou des pédés revendicatifs dont Houellebecq dit qu’ils ont l’air
d’avoir une vie passionnante. La Propagandastaffel trouve toujours
facilement des agents bénévoles, des agents qui par des actes concrets de
soumission ostentatoire entendent démontrer la satisfaction que procure la
soumission avec cependant une fière touche de révolte attitude. Tout est dans
la révolte attitude et il s’agit bien d’un spectacle. Mais tout ça n’est pas la
société même ou le monde même. La LVF n’était pas le monde même. M. Le Pen
dirait que c’est un détail.
§ 70
Dans ce même paragraphe
70 : « Chaque nouveau mensonge de la publicité est aussi l’aveu de
son mensonge précédent.... »
Donc, c’est bien ce que je
disais : l’imposture de la satisfaction, c’est le mensonge de la
publicité. L’imposture de la satisfaction réside dans le publicité. Debord
identifie lui-même dans un même paragraphe imposture de la satisfaction et
publicité. Donc le spectacle c’est la publicité. Voilà tout le concept de
spectacle. Debord a remplacé un mot simple que tout le monde comprend : la
publicité par un mot au sens mystérieux : le spectacle.
Ce concept aurait un intérêt
si Debord avait été capable de soutenir et de développer la première
proposition du § 3 : "Les spectacle se présente comme la société
même..." car la société serait alors un spectacle de la satisfaction. Et
on pourrait à juste titre alors parler de société du spectacle ou de société
spectaculaire-marchande. En fait, cette société spectaculaire-marchande est
seulement un société où existe la publicité, la réclame, où la propagande est
privatisée et l’imposture de la satisfaction n’existe que dans la publicité, la
réclame et la propagande, imposture soutenue pas ses nombreux agents bénévoles
et de nombreuses milices pride.
J’ai de bonne heure essayé
de donner un sens à cette première proposition "Le spectacle est la
société même..« ; mais je n’y suis pas parvenu. Et je ne connais personne
qui y soit parvenu. Je pensais alors que Debord, ce grand incompris, était
fondé de protester quand on interprétait ce prétendu concept de spectacle au
sens de mass media, publicité, télévision, propagande. Mais Debord a été
parfaitement bien compris par ceux auxquels il s’adressait en fait, et de
manière de plus en plus insistante et de plus en plus explicite à la fin.
§ 1
Ce n’est donc pas toute la
vie des sociétés ... qui s’annonce comme une immense accumulation de
spectacle ; mais seulement la publicité, l’enculture, l’idéologie, la
propagande. Quelle découverte ! « Toute la propagande des sociétés
modernes s’annonce comme une immense accumulation de spectacles et de
divertissements. » C’est la fun propagande. Voilà la vraie
proposition. Toute la propagande et certainement pas toute la vie ;
même si la propagande entend s’identifier avec toute la vie. La
proposition : « Tout ce qui était directement vécu s’est éloigné
dans une représentation » est fausse également. La fun propagande et
la publicité commerciale prétendent traiter effectivement de tout ce qui est
vécu et de tout ce qui pourrait être vécu. Mais ce n’est pas parce que la fun
propagande prétend que "tout ce qui est bon apparaît, tout ce qui apparaît
est bon" que tout apparaît et notamment tout ce qui est bon. Donc, puisque
tout n’apparaît pas, toute la vie non plus et donc toute la vie ne saurait
s’éloigner dans une représentation.
§ 2
« Les images qui se
sont détachées de chaque aspect de la vie fusionnent dans un cours
commun... » C’est bien vrai, ce cours commun est la publicité commerciale et la
propagande divertissante. Seulement le mot « chaque » est de trop.
Les images de la propagande se sont détachées de certains aspect de la vie mais
pas de tous. Sinon, la propagande serait la vérité. Ainsi la misère, bien
qu’endémique, demeure secrète et ne paraît jamais. Et quand elle paraît, c’est
une misère spectaculaire, tout spécialement élaborée pour la télévision.
Quant au « spectacle
en général », qui est censé être la société même, qui est censé être « l’inversion
concrète de la vie », il n’existe pas. L’inversion concrète de la vie
porte un nom depuis Hegel : c’est l’aliénation qui n’a rien à voir avec un
spectacle même si l’apparence y joue un rôle essentiel. Quoique la
nature selon Hegel n’est rien d’autre que l’idée qui se donne en spectacle
à elle-même, ne serait-ce que pour se connaître. En ce sens, selon Hegel,
l’aliénation serait essentiellement un spectacle, le spectacle de la nature.
Mais cela va bien au delà des trivialités de Debord maquillées en style fronde
et grand siècle.
§ 12
Ce n’est pas le spectacle
qui se présente comme une énorme positivité indiscutable et inaccessible, c’est
le monde. Le spectacle est peut-être indiscutable ; mais il suffit de
tourner le bouton du poste pour qu’il s’arrête (Anders : allumer et
éteindre le monde) tandis que le monde continue, lui. Et cette positivité
est indiscutable parce que les moyens de discussion ont été confisqués. Debord
a joué un rôle misérable dans cette confiscation.
Les moyens de discussion
sont bien connus. Les Grecs ont montré qu’il n’y a de démocratie qu’en armes,
que la démocratie c’est la guerre, que l’on peut discuter et agir puisqu’ils
délibéraient toujours avant de combattre. Montesquieu ajoute que là où l’on
voit une démocratie tranquille, ce n’est pas la démocratie.
Ce n’est pas le spectacle
(pas même au sens de pub) qui a le monopole de l’apparence, c’est l’argent.
L’argent paraît dans tout ce qui existe sous le nom modeste de prix. Le
spectacle, la propagande divertissante, est un tout petit territoire de
l’apparence.
§ 3
Ce n’est pas le spectacle
dont les moyens sont en même temps le but. C’est le commerce.
§ 6
Debord réaffirme que le
spectacle n’est pas un supplément au monde réel, qu’il est le cœur de
l’irréalité de la société réelle. Mais c’est du vent, c’est des paroles
verbales si le spectacle n’est pas la société même. Ce n’est pas la fun
propagande qui est le cœur l’irréalité de la société réelle. C’est l’irréalité
de la société réelle, le fait, comme le souligne Marx, que l’activité des
hommes leur est devenue une chose étrangère, qui permet et requiert l’essor de
la fun propagande et le pullulement des fun propagandistes bénévoles et de
milices pride. Ensuite Debord parle du spectacle « sous toutes
ses formes particulières, information ou propagande, publicité ou consommation
directe de divertissement ». Debord laisse donc entendre
subrepticement qu’il y aurait un spectacle sous sa forme générale. Mais s’il en
parle, on cherche en vain sous sa plume la définition de cette autre forme qui
serait générale et qui serait la société même ou le monde même. Ces formes
particulières (et qui ne sont pas particulières puisqu’il n’y a pas de forme
générale) sont bien affirmation omniprésente du choix déjà fait ailleurs
(ailleurs que dans la fun propagande), présence permanente de cette
justification etc. C’est bien ce que je disais : le spectacle n’est rien
d’autre que la propagande, l’enculture de masse, l’idéologie, c’est à dire
industrialisation de ce qui était la culture et privatisation de la propagande.
Ceci dit, oui, la propagande aujourd’hui a pris la forme d’une immense
accumulation de divertissements et de spectacles. Oui, c’est vrai, la
propagande, aujourd’hui, est divertissement et spectacle. Aujourd’hui, la
propagande est une fête. C’est vrai ; mais c’est tout. C’est la gaie
propagande, la gaie stapo, la gaie trottinette, de l’ère post-pédé, de l’ère
des milices prides. C’est tellement vrai que dès l’école les élèves sont
censés s’amuser et apprendre le jeune et non plus la lecture, l’écriture et le
calcul. La propagande, c’est le fun. C’est le devenir jeu de la soumission.
C’est la fête permanente de la soumission. Aujourd’hui, la soumission est
une fête, dans la propagande, évidemment, pas dans la vie. (Tandis qu’à
Kirivina, jardiner était une fête. A Kirivina on s’activait toujours, on ne
travaillait jamais. Je réponds en passant à tous ces crétins qui ont interprété
le célèbre ne travaillez jamais en farniente. Ne travaillez jamais signifie en
fait ne soyez jamais esclaves) Sous les anciens régimes, la culture
était la chose des maîtres, aujourd’hui elle est destinée à abreuver les
masses. Les maîtres n’ont d’ailleurs plus besoin de culture. Leur seule
culture, c’est l’argent. J’ai lu quelque chose d’assez intéressant (je ne me souviens
plus du nom de l’auteur) sur le rôle des avants gardes artistiques du début de
ce siècle : ces avant-gardes, en contribuant à détruire la culture, ont
comblé le projet des maîtres : ceux-ci ne voulaient plus de culture. Comme
on le voit tous les jours, ils sortent leur revolver à haute altitude.
§ 7
« Le langage du
spectacle est constitué par des signes de la production régnante, qui sont en
même temps la finalité dernière de cette production. » C’est donc bien ça, comme
je l’écrivais dernièrement : le spectacle, le capital devenu image, c’est
les images de marque qui sont effectivement un des buts des
multinationales, et donnent lieu à des luttes titanesques comme le relève le
journaliste Guillebaud. Si je n’avais pas lu ça ailleurs, jamais je n’aurais
pensé à une telle trivialité. Un but des multinationales est bien de s’assurer
une image ; mais en fait leur but essentiel est la domination, la
continuation et l’extension de la domination. L’image de marque est comme
l’asticot sur l’hameçon. Esclave est encore un trop beau nom pour
désigner le néo-esclave, surtout sous sa forme d’employé de bureau et de pédé
revendicatif. Bétail ou ressource humaine convient mieux car l’esclave sait
qu’il est esclave tandis que le bétail ne sait pas qu’il va être mangé. Le
néo-esclave gémit sur son sort et voudrait les avantages du capitalisme sans
les inconvénients, comme ces pédés garantis par le gouvernement qui veulent
convoler en justes noces. Pourquoi devrait-il être bien traité ? Malheur
au vaincu. Certes, les hoplites étaient pédés, notamment un certain bataillon
thébain. Mais ils n’en étaient pas moins hoplites tandis que les pédés
revendicatifs modernes ne sont que pédés et employés de bureau. J’ai lu une
étude intéressante dans le Bulletin du Mauss, de Gilles Changé, il me
semble, sur ce qu’il appelait la sociologie des dimensions. Le prétendu
individu de la société moderne est constitué de dimensions : parent
d’élève, hémophile, pédé, unijambiste, producteur de porc, pêcheur à la ligne,
copropriétaire, victime d’attentat, dimensions qui toutes ont leur groupe de
pression. Voilà donc ce prétendu individu unidimensionnel qui se révèle être
aussi peu individu et aussi peu unidimensionnel que l’atome s’est révélé peu
insécable.
§ 8
« Le spectacle qui
inverse le réel... »
Ce n’est pas le spectacle
qui inverse le réel, c’est l’aliénation de la reconnaissance et de la division.
L’activité des hommes leur est devenue étrangère. L’inversion consiste dans ce
que l’essence devient étrangère. Mais, hélas, invisible. Tout le contraire d’un
spectacle. Comme le note Weber, cette essence était encore visible pour les
sauvages. Elle est devenue invisible pour le moderne. C’est pour ça que la
place est libre pour les prides. Hitler et Mussolini étaient très fort
pour organiser des prides. Aujourd’hui, les prides sont
autogérées.
§ 10
Le concept de spectacle
n’unifie et n’explique rien du tout. Il pourrait le faire si le spectacle était
la société même, si ce concept avait un sens en tant que société même. Or il
n’a pas ce sens. "La critique qui atteint la vérité du spectacle le
découvre comme la négation visible de la vie ; comme une négation
de la vie qui est devenue visible." Ainsi donc, la négation de la vie
serait devenue visible et rien ne se passerait ! Karl Zéro n’est pas la négation
de la vie devenue visible. C’est seulement un histrion nihiliste, un fun
nihiliste. C’est comme ce docteur Bounan qui prétend que le principe de la
domination est connu depuis un siècle sans que cette mirobolante connaissance
ait la moindre conséquence connue et sans nous faire part évidemment de ses
lumières sur ce fameux principe si bien connu ! Quand la négation de la
vie devient visible, notamment à la télévision, c’est sida, vache folle,
poisons divers et, évidemment, chambres à gaz, toutes choses qui conviennent
parfaitement au néo-esclave et le confortent dans ses récriminations. C’est une
imposture de la négation de la vie, un spectacle de négation de la vie,
la négation de la vie facile pour néo-esclave abruti tandis que la
négation de la vie essentielle, cause de tout cela, qui fait d’ailleurs que les
choses progressent, par leur mauvais côté, demeure cachée. Hegel est mort du
choléra, mais le négatif n’est pas pour autant une maladie contagieuse. Si la
négation de la vie devenait visible, la question serait résolue immédiatement.
S’il y a un spectacle, c’est celui de la négation de la vie, ce secteur
spécialisé du secteur spécialisé de la propagande, tels que les épiciers
révoltés de Porto Alegre. Ce n’est que justice que la vie ainsi entendue soit
menacée d’extinction, ce n’est que justice qu’un monde peuplé de milliards de
prostitués (qu’est-ce qu’un roman de Houellebecq à côté de cela) soit menacé
dans son existence. Qu’il crève. La vie de l’estomac n’a que ce qu’elle mérite.
§ 20
Si la vie la plus terrestre
devient opaque et irrespirable, ce n’est certainement pas à cause du spectacle,
de la fun propagande ni à cause de l’échappement des moteurs diesel. La fun
propagande a un revers catastrophique et d’un sérieux répugnant tel qu’on peut
le voir dans les ceci en colère et les cela en colère. Toutes les propositions
de Debord qui auraient un sens si le spectacle en général en avait un sont
privée de sens du fait de l’inexistence d’un concept du spectacle en général.
Si la vie la plus terrestre devient opaque et irrespirable c’est du fait de
l’aliénation, du fait que l’activité humaine entendu au sens d’activité du
genre, devient de plus en plus étrangère, s’éloigne de plus en plus, comme le
souligne Max Weber, sans devenir plus visible pour autant, sinon la question
serait immédiatement résolue. De plus en plus le genre s’oppose à l’individu,
pour le malheur des deux, mais le genre n’en devient pas plus visible pour
autant et il n’y a nul spectacle du genre. Pour que la société même soit un
spectacle, il faudrait que le genre soit un spectacle.
§ 22
Ainsi, la puissance pratique
de la société moderne ne s’est pas édifié un empire indépendant dans le
spectacle, dans la fun propagande. On voit un peu mieux où se situe cet empire
indépendant avec les derniers avatars du monde.
Marx avait prévu le
dépérissement de l’Etat auquel on peut assister de nos jours. Mais il avait
également prévu la disparition des financiers, spéculateurs et rentiers, qu’il
haïssait au profit des seuls industriels, qu’il respectait. Le pauvre. On voit
ce qu’il en est. A toutes les questions tranchées par oui ou par non il y a une
chance sur deux de répondre juste, comme à pile ou face. C’est çà le socialisme
scientifique, c’est pile ou face. Le stalinisme, c’est pile et face.
Conclusion : le concept de
spectacle ne peut avoir un sens que « comme partie de la société »
(§ 3) et Debord ne parle jamais que de cette partie de la société qu’est
la propagande, cette industrie de l’éloge. Il n’a aucun sens, non plus « comme
instrument d’unification » (§ 3). Le seul qui soit est l’argent,
ce rapport social. Il n’agit, en tant qu’industrie de l’éloge, que comme
instrument d’interdiction de l’esprit critique. Du temps de Debord, il
produisait des porte-clefs, ces indulgences de la marchandise, aujourd’hui il
produit des troupeaux de patineurs à roulette, ce cheptel de la marchandise.
Debord a raison sur un point : ce serait vraiment perdre son temps que de
changer quoi que ce soit à une telle théorie puisqu’elle est sans intérêt.
La raison qui fait que
pendant longtemps je pensai que le concept de spectacle avait un sens
intéressant non trivial, est que j’estimais que le spectacle pouvait être la
société même et j’ai cherché à établir ce fait puisqu’on n’en trouve pas trace
chez Debord. Je n’y suis pas parvenu. Je continue d’ailleurs à penser que cette
proposition, que la société puisse être un spectacle, peut avoir un sens
intéressant, notamment parce qu’elle présuppose le rôle antiréductionniste de
l’apparence : le monde contient la science, la science ne contient pas le
monde. Il suffit simplement de trouver lequel. Musil dit « Le monde est
comme un théâtre, il faut supprimer la réalité, ce qu’on appelle la réalité
n’est le plus souvent que la routine » (je cite de mémoire).
Je profite de cette
communication pour remercier le Dr Weltfaust d’avoir fait ici mon
panégyrique, ce qui m’épargne le ridicule d’avoir à le faire moi-même.
Abrégé
Occurrences du terme image
En effet, le spectacle n’est
pas un ensemble d’images (§ 4), pas plus qu’une société des images
(§ 199). Selon la très simple définition d’Anders, il est la livraison à
domicile, dans les cages, d’images du monde et, notamment, d’images de la
consommation. La consommation de masse est solitaire, comme est solitaire
l’homme de masse, comme l’est la consommation de ces images par l’homme de
masse. Le rapport entre les personnes qui consomment ces images est la
solitude, pas seulement à domicile, mais partout (lonely crowd). Les
images de la consommation sont justement des images d’une consommation non
solitaire (ne serait-ce que parce que des milliards de spectateurs y assistent.
L’objet montré y est, de ce fait, un véritable objet d’adoration. Le spectateur
communie dans la solitude. La télévision est une messe où l’on peut aller en
restant chez soi) qui n’existe nulle part dans le monde. Comme l’image de la
maison de M. Biswas, les images de la consommation ne sont pas des images
du monde puisque cette consommation non solitaire n’existe nulle part dans le
monde mais des images d’un pseudo monde où aurait lieu la réconciliation. Les
marchandises sont exposées à l’adoration d’une foule solitaire et invisible
puisque dissimulée dans les cages. De là vient leur prestige. C’est le grand
nombre des adorateurs qui fait l’adoration. Tout le secret est là. D’où la
puissance de ces images. Il faut encore comprendre comment le consommateur
isolé à néanmoins la notion de ce grand nombre.
Comme on pourra le constater
ci-dessous dans cette sélection des occurrences du terme image, chez Debord aussi, quoi qu’il prétende, le
spectacle est la consommation d’images (§ 198 : consommation
sociale des images ; § 199 : une société de l’image).
Il a simplement oublié la partie importante de la définition de Anders : à
domicile (§ 172 : l’emploi généralisé [ dans
l’isolement ] des récepteurs du message spectaculaire,
[ autrement dit la radio et la télè. Anders emploie le mot fantômes
plutôt qu’image car il traite aussi de la radio, le robinet à culture, qui ne
transmet pas d’images ] images
qui par cet isolement seulement acquièrent leur pleine puissance). On
comparera avec profit le charabia de Debord avec l’original de Anders. Debord a
salopé à la fois Anders et Marx. Il a noyé le poisson dans le charabia.
CHAPITRE I. La séparation
achevée
« Et sans doute notre
temps... préfère l’image à la chose, la
copie à l’original, la représentation à la
réalité, l’apparence à l’être... Ce qui est
sacré pour lui, ce n’est que l’illusion, mais ce qui est profane, c’est la vérité.
Mieux, le sacré grandit à ses yeux à mesure que décroît la vérité et que
l’illusion croît, si bien que le comble de l’illusion est aussi pour lui le
comble du sacré. »
Feuerbach (Préface à la deuxième
édition de L’Essence du christianisme)
2
Les images qui se
sont détachées de chaque aspect de la vie fusionnent dans un cours commun, où
l’unité de cette vie ne peut plus être rétablie. La réalité considérée
partiellement se déploie dans sa propre unité générale en tant que pseudo-monde
à part, objet de la seule contemplation. La spécialisation des images du monde se retrouve, accomplie, dans le
monde de l’image autonomisé, où le
mensonger s’est menti à lui même. Le spectacle en
général, comme inversion concrète de la vie, est le mouvement autonome du non-vivant.
4
Le spectacle
n’est pas un ensemble d’images,
mais un rapport social entre des personnes, médiatisé par des images.
5
Le spectacle
ne peut être compris comme l’abus d’un mode de la vision, le produit des
techniques de diffusion massive des images.
Il est bien plutôt une Weltanschauung devenue effective, matériellement traduite. C’est une vision du monde
qui s’est objectivée.
7
La séparation fait elle-même
partie de l’unité du monde, de la praxis sociale globale qui s’est scindée en
réalité et en image. La pratique
sociale, devant laquelle se pose le spectacle autonome,
est aussi la totalité réelle qui contient le spectacle.
Mais la scission dans cette totalité la mutile au point de faire apparaître le spectacle comme son but. Le langage
spectaculaire est constitué par des signes de la production régnante, qui sont en même
temps la finalité dernière de cette production.
14
La société qui repose sur
l’industrie moderne n’est pas fortuitement ou superficiellement spectaculaire, elle est fondamentalement spectacliste. Dans le spectacle,
image de l’économie
régnante, le but n’est rien, le développement est tout. Le spectacle ne veut en venir à rien d’autre qu’à
lui-même.
15
En tant qu’indispensable parure
des objets produits maintenant, en tant qu’exposé général de la rationalité du
système, et en tant que secteur économique avancé
qui façonne directement une multitude croissante d’images
objets, le spectacle est la principale production de la société actuelle.
18
Là où le monde réel se
change en simples images, les simples images deviennent des êtres réels, et les
motivations efficientes d’un comportement hypnotique. Le spectacle, comme tendance à faire voir par différentes
médiations spécialisées le monde qui n’est plus directement saisissable, trouve
normalement dans la vue le sens humain privilégié qui fut à d’autres époques le
toucher ; le sens le plus abstrait, et le plus mystifiable, correspond à
l’abstraction généralisée de la société actuelle. Mais le spectacle n’est pas identifiable au simple regard,
même combiné à l’écoute. Il est ce qui échappe à l’activité des hommes, à la
reconsidération et à la correction de leur œuvres. Il est le contraire du
dialogue. Partout où il y a représentation indépendante,
le spectacle se reconstitue.
25
La séparation est l’alpha et
l’oméga du spectacle. L’institutionnalisation de
la division sociale du travail, la formation des classes avaient construit une
première contemplation sacrée, l’ordre mythique dont tout pouvoir s’enveloppe
dès l’origine. Le sacré a justifié l’ordonnance cosmique et ontologique qui
correspondait aux intérêts des maîtres, il a expliqué et embelli ce que la
société ne pouvait pas faire. Tout pouvoir séparé a donc été spectaculaire, mais l’adhésion de tous à une telle image immobile ne signifiait que la
reconnaissance commune d’un prolongement imaginaire pour la pauvreté de
l’activité sociale réelle, encore largement ressentie comme une condition
unitaire. Le spectacle moderne exprime au contraire
ce que la société peut faire, mais dans cette expression le permis s’oppose
absolument au possible. Le spectacle est la
conservation de l’inconscience dans le changement pratique des conditions
d’existence. Il est son propre produit, et c’est lui-même qui a posé ses
règles, c’est un pseudo sacré. Il montre ce qu’il est, la puissance séparée se
développant en elle-même, dans la croissance de la productivité au moyen du
raffinement incessant de la division du travail en parcellarisation de gestes,
alors dominés par le mouvement indépendant des machines ; et travaillant
pour un marché toujours plus étendu. Toute communauté et tout sens critique se
sont dissous au long de ce mouvement, dans le quel les forces qui ont pu
grandir en se séparant ne se sont pas encore retrouvées.
30
L’aliénation du spectateur au profit de l’objet contemplé (qui est le
résultat de sa propre activité inconsciente) s’exprime ainsi : plus il
contemple, moins il vit ; plus il accepte de se reconnaître dans les images dominantes du besoin, moins il comprend sa
propre existence et son propre désir. L’extériorité du spectacle
par rapport à l’homme agissant apparaît en ce que ses propres gestes ne
sont plus à lui, mais à un autre qui les lui représentent. C’est pourquoi le spectateur ne se sent chez lui nulle part, car le spectacle est partout.
34
Le spectacle
est le capital à un tel degré d’accumulation qu’il devient image.
36
C’est le principe du
fétichisme de la marchandise, la domination de la société par « des choses
suprasensibles bien que sensibles », qui s’accomplit absolument dans le spectacle, où le monde sensible se trouve remplacé par
une sélection d’images qui existe
au-dessus de lui, et qui en même temps s’est fait reconnaître comme le sensible
par excellence.
60
En concentrant en elle l’image d’un rôle possible, la vedette, la représentation spectaculaire de l’homme vivant, concentre donc cette
banalité. La condition vedette est la spécialisation de vécu apparent, l’objet
de l’identification à la vie apparente sans profondeur, qui doit compenser
l’émiettement des spécialisations productives effectivement vécues. Les vedettes
existent pour figurer des types variés de styles de vie et de styles de
compréhension de la société, libres de s’exercer globalement. Elles incarnent
le résultat inaccessible du travail social, en mimant des sous-produits de ce
travail qui sont magiquement transférés au-dessus de lui comme son but :
le pouvoir et les vacances, la décision et la consommation
qui sont au commencement et à la fin d’un processus indiscuté. Là, c’est le
pouvoir gouvernemental qui se personnalise en pseudo vedette ; ici c’est
la vedette de la consommation qui se fait
plébisciter en tant que pseudo pouvoir sur le vécu. Mais, de même que ces
activités de la vedette ne sont pas réellement globales, elles ne sont pas
variées.
63
C’est l’unité de la misère
qui se cache sous les oppositions spectaculaires.
Si des formes diverses de la même aliénation se combattent sous les masques du
choix total, c’est parce qu’elles sont toutes édifiées sur les contradictions
réelles refoulées. Selon les nécessités du stade particulier de la misère qu’il
dément et maintient, le spectacle existe sous
une forme concentrée ou sous une forme diffuse. Dans les deux cas, il n’est
qu’une image d’unification heureuse
environnée de désolation et d’épouvante, au centre tranquille du malheur.
64
Le spectaculaire
concentré appartient essentiellement au capitalisme bureaucratique,
encore qu’il puisse être importé comme technique du pouvoir étatique sur des économies mixtes plus arriérées, ou dans certains
moments de crise de capitalisme avancé. La propriété bureaucratique en effet
est elle même concentrée en ce sens que le bureaucrate individuel n’a de
rapports avec la possession de l’économie globale
que par l’intermédiaire de la communauté bureaucratique, qu’en tant que membre
de cette communauté. En outre la production
des marchandises, moins développée, se présente aussi sous forme
concentrée : la marchandise que la bureaucratie détient, c’est le travail
social total, et ce qu’elle revend à la société, c’est sa survie en bloc. La
dictature de l’économie bureaucratique ne peut
laisser aux masses exploitées aucune marge notable de choix, puisqu’elle a dû
tout choisir par elle-même, et que tout autre choix extérieur, qu’il concerne
l’alimentation ou la musique, est donc déjà le choix de sa destruction
complète. Elle doit s’accompagner d’une violence permanente. l’image imposée du bien, dans son spectacle, recueille la totalité de ce qui existe
officiellement, et se concentre normalement sur un seul homme, qui est le
garant de sa cohésion totalitaire. A cette vedette absolue, chacun doit
s’identifier magiquement ou disparaître. Car il s’agit du maître de sa non-consommation, et de l’image
héroïque d’un sens acceptable pour l’exploitation absolue qu’est en fait
l’accumulation primitive accélérée par la terreur. Si chaque Chinois doit
apprendre Mao, et ainsi être Mao, c’est qu’il n’a rien d’autre à être. Là où
domine le spectaculaire concentré
domine aussi la police.
69
Dans l’image de l’unification heureuse de la société
par la consommation, la division réelle est
seulement suspendue jusqu’au prochain non-accomplissement dans le consommable.
Chaque produit particulier qui doit représenter l’espoir d’un raccourci
fulgurant pour accéder enfin à la terre promise de la consommation
totale est présenté cérémonieusement à son tour comme la singularité décisive.
Mais comme dans le cas de la diffusion instantanée des modes de prénoms
apparemment aristocratiques qui vont se trouver portés par presque tous les
individus du même âge, l’objet dont on attend un pouvoir singulier n’a pu être
proposé à la dévotion des masses que parce qu’il avait été tiré à un assez
grand nombre d’exemplaires pour être consommé massivement. Le caractère
prestigieux de ce produit quelconque ne lui vient que d’avoir été placé un
moment au centre de la vie sociale, comme le mystère révélé de la finalité de
la production. L’objet qui était prestigieux
dans le spectacle devient vulgaire à l’instant
où il entre chez ce consommateur, en même temps que chez tous les autres. Il
révèle trop tard sa pauvreté essentielle, qu’il tient naturellement de la
misère de sa production. Mais déjà c’est un
autre objet qui porte la justification du système et l’exigence d’être reconnu.
83
Les courants utopiques du
socialisme, quoique fondés eux-mêmes historiquement dans la critique de
l’organisation sociale existante, peuvent être justement qualifiés d’utopiques
dans la mesure où ils refusent l’histoire — c’est-à-dire la lutte réelle en
cours, aussi bien que le mouvement du temps au delà de la perfection immuable
de leur image de société
heureuse —, mais non parce qu’ils refuseraient la science. Les penseurs
utopistes sont au contraire entièrement dominés par la pensée scientifique,
telle qu’elle s’était imposée dans les siècles précédents. Ils recherchent le
parachèvement de ce système rationnel général : ils ne se considèrent
aucunement comme des prophètes désarmés, car ils croient au pouvoir social de
la démonstration scientifique et même, dans le cas du saint-simonisme, à la
prise du pouvoir par la science. Comment, dit Sombart, « voudraient-ils
arracher par des luttes ce qui doit être prouvé » ? Cependant la
conception scientifique des utopistes ne s’étend pas à cette connaissance que
des groupes sociaux ont des intérêts dans une situation existante, des forces
pour la maintenir, et aussi bien des formes de fausse conscience
correspondantes à de telles positions. Elle reste très en deçà de la réalité
historique du développement de la science même, qui s’est trouvé en grande
partie orienté par la demande sociale issue de tels facteurs, qui sélectionne
non seulement ce qui peut être admis, mais aussi ce qui peut être recherché.
Les socialistes utopiques, restés prisonniers du mode d’exposition de la vérité
scientifique, conçoivent cette vérité selon sa pure image
abstraite, telle que l’avait vue s’imposer un stade très antérieur de la
société. Comme le remarquait Sorel, c’est sur le modèle de l’astronomie que les
utopistes pensent découvrir et démontrer les lois de la société. L’harmonie
visée par eux, hostile à l’histoire, découle d’un essai d’application à la
société de la science la moins dépendante de l’histoire. Elle tente de se faire
reconnaître avec la même innocence expérimentale que le newtonisme, et la
destinée heureuse constamment postulée « joue dans leur science sociale un
rôle analogue à ce lui qui revient à l’inertie dans la mécanique
rationnelle » (Matériaux pour une théorie du prolétariat).
87
La tendance à fonder une
démonstration de la légalité scientifique du pouvoir prolétarien en faisant
état d’expérimentations répétées du passé obscurcit, dès le Manifeste, la
pensée historique de Marx, en lui faisant soutenir une image linéaire du développement des modes de production,
entraîné par des luttes de classes qui finiraient chaque fois "par une
transformation révolutionnaire de la société tout entière ou par la destruction
commune des classes en lutte". Mais dans la réalité observable de
l’histoire, de même que « le mode de production
asiatique ", comme Marx le constatait ailleurs a conservé son
immobilité en dépit de tous les affrontements de classes, de même les
jacqueries de serf n’ont jamais vaincu les barons, ni les révoltes d’esclaves
de l’Antiquité les hommes libres. Le schéma linéaire perd de vue d’abord ce
fait que la bourgeoisie est la seule classe révolutionnaire qui ait jamais
vaincu ; en même temps qu’elle est la seule pour qui le développement de
l’économie a été cause et conséquence de sa mainmise
sur la société. La même simplification a conduit Marx à négliger le rôle économique de l’Etat dans la gestion d’une
société: de classes. Si la bourgeoisie ascendante a paru affranchir l’économie de l’Etat, c’est seulement dans la mesure
où l’Etat ancien se confondait avec l’instrument d’une oppression de classe
dans une économie statique. La bourgeoisie a
développé sa puissance économique autonome
dans la période médiévale d’affaiblissement de l’Etat, dans le moment de
fragmentation féodale de pouvoirs équilibrés. Mais l’Etat moderne qui, par le
mercantilisme, a commencé à appuyer le développement de la bourgeoisie, et qui
finalement est devenu son Etat à l’heure du "laisser faire, laisser
passer", va se révéler ultérieurement doté d’une puissance centrale dans
la gestion calculée du processus économique.
Marx avait pu cependant décrire, dans le bonapartisme, cette ébauche de la
bureaucratie étatique moderne, fusion du capital et de l’Etat, constitution
d’un « pouvoir national du capital sur le travail, d’une force publique
organisée pour l’asservissement social », où la bourgeoisie renonce à
toute vie historique qui ne soit sa réduction à l’histoire
économique des choses, et veut bien « être condamnée au même néant
politique que les autres classes ». Ici sont déjà posées les bases
socio-politiques du spectacle moderne, qui
négativement définit le prolétariat comme seul prétendant à la vie historique.
95
Le "marxisme
orthodoxe" de la II° Internationale est l’idéologie scientifique de la révolution
socialiste, qui identifie toute sa vérité au processus objectif dans
l’économie, et au progrès d’une reconnaissance de cette nécessité dans la
classe ouvrière éduquée par l’organisation. Cette idéologie retrouve la
confiance en la démonstration pédagogique qui avait caractérisé le socialisme
utopique, mais assortie d’une référence contemplative au cours de l’histoire :
cependant une telle attitude a autant perdu la dimension hégélienne d’une
histoire totale qu’elle a perdu l’image
immobile de la totalité présente dans la critique utopiste (au plus haut degré,
chez Fourier). C’est d’une telle attitude scientifique, qui ne pouvait faire
moins que de relancer en symétrie des choix éthiques, que procèdent les
fadaises d’Hilferding quand il précise que reconnaître la nécessité du
socialisme ne donne pas « d’indication sur l’attitude pratique à adopter.
Car c’est une chose de reconnaître une nécessité, et c’en est une autre de se
mettre au service de cette nécessité » (Capital financier). Ceux qui ont
méconnu que la pensée unitaire de l’histoire, pour Marx et pour le prolétariat
révolutionnaire, n’était rien de distinct d’une attitude pratique à adopter,
devaient être normalement victimes de la pratique qu’ils avaient simultanément
adoptée.
153
Le temps pseudo cyclique
consommable est le temps spectaculaire, à la fois comme temps de la consommation
des images, au sens restreint, et comme image de la consommation
du temps, dans toute son extension. Le temps de la consommation
des images, médium de toutes les
marchandises, est inséparablement le champ où s’exercent pleinement les
instruments du spectacle, et le but que ceux-ci
présentent globalement, comme lieu et comme figure centrale de toutes les consommations particulières : on sait que les
gains de temps constamment recherchés par la société moderne — qu’il s’agisse
de la vitesse des transports ou de l’usage des potages en sachets — se
traduisent positivement pour la population des Etats-Unis dans ce fait que la
seule contemplation de la télévision l’occupe en moyenne entre trois et six
heures par jour. L’image sociale de la consommation du temps, de son côté, est exclusivement
dominée par les moments de loisirs et de vacances, moments représentés à
distance et désirables par postulat, comme toute marchandise
spectaculaire. Cette marchandise est ici
explicitement donnée comme le moment de la vie réelle, dont il s’agit
d’attendre le retour cyclique. Mais dans ces moments même assignés à la vie,
c’est encore le spectacle qui se donne à voir et
à reproduire, en atteignant un degré plus intense. Ce qui a été représenté
comme la vie réelle se révèle simplement comme la vie plus réellement spectaculaire,.
172
L’urbanisme est
l’accomplissement moderne de la tâche ininterrompue qui sauvegarde le pouvoir
de classe : le maintien de l’atomisation des travailleurs que les
conditions urbaines de production avaient
dangereusement rassemblés. La lutte constante qui a dû être menée contre tous
les aspects de cette possibilité de rencontre trouve dans l’urbanisme son champ
privilégié. L’effort de tous les pouvoirs établis, depuis les expériences de la
Révolution française, pour accroître les moyens de maintenir l’ordre dans la
rue, culmine finalement dans la suppression de la rue. « Avec les moyens
de communication de masse sur de grandes distances, l’isolement de la
population s’est avéré un moyen de contrôle beaucoup plus efficace »,
constate Lewis Mumford dans La Cité à travers l’histoire. Mais le mouvement
général de l’isolement, qui est la réalité de l’urbanisme, doit aussi contenir
une réintégration contrôlée des travailleurs, selon les nécessités planifiables
de la production et de la consommation. L’intégration au système doit ressaisir
les individus en tant qu’individus isolés ensemble : les usines comme les
maisons de la culture, les villages de vacances comme les « grands
ensembles », sont spécialement organisés pour les fins de cette pseudo
collectivité qui accompagne aussi l’individu isolé dans la cellule
familiale : l’emploi généralisé des récepteurs du message
spectaculaire, fait que son isolement se
retrouve peuplé des images dominantes, images qui par cet isolement seulement acquièrent
leur pleine puissance.
198
Ceux qui dénoncent
l’absurdité ou les périls de l’incitation au gaspillage dans la société de l’abondance économique, ne savent pas à quoi sert le
gaspillage. Ils condamnent avec ingratitude, au nom de la rationalité économique, les bons gardiens
irrationnels sans lequel le pouvoir de cette rationalité
économique s’écroulerait. Et Boorstin par exemple, qui décrit dans l’Image la consommation
marchande du spectacle américain, n’atteint
jamais le concept de spectacle, parce qu’il
croit pouvoir laisser en dehors de cette désastreuse exagération la vie privée,
ou la notion d’« honnête marchandise ». Il ne comprend pas que la
marchandise elle-même a fait les lois dont l’application « honnête »
doit donner aussi bien la réalité distincte de la vie privée que sa reconquête
ultérieure par la consommation sociale des images.
Boorstin décrit les excès
d’un monde qui nous est devenu étranger, comme des excès étrangers à notre
monde. Mais la base « normale » de la vie sociale, à laquelle il se
réfère implicitement quand il qualifie le règne superficiel des images, en termes de jugement psychologique et
moral, comme le produit de « nos extravagantes prétentions », n’a
aucune réalité, ni dans son livre, ni dans son époque. C’est parce que la vie
humaine réelle dont parle Boorstin est pour lui dans le passé, y compris le
passé de la résignation religieuse, qu’il ne peut comprendre toute la
profondeur d’une société de l’image. La vérité de cette société
n’est rien d’autre que la négation de cette société.
200
La sociologie qui croit pouvoir
isoler de l’ensemble de la vie sociale une rationalité industrielle
fonctionnant à part, peut aller jusqu’à isoler du mouvement industriel global
les techniques de reproduction et transmission. C’est ainsi que Boorstin trouve
pour cause des résultats qu’il dépeint la malheureuse rencontre, quasiment
fortuite, d’un trop grand appareil technique de diffusion des images et d’une trop grande attirance des hommes
de notre époque pour le pseudo sensationnel. Ainsi le spectacle
serait dû au fait que l’homme moderne serait trop spectateur. Boorstin ne comprend pas que la
prolifération des « pseudo événements » préfabriqués, qu’il dénonce,
découle de ce simple fait que les hommes, dans la réalité massive de la vie
sociale actuelle, ne vivent pas eux-mêmes des événements. C’est parce que
l’histoire elle-même hante la société moderne comme un spectre, que l’on trouve
de la pseudo histoire construite à tous les niveaux de la consommation de la vie, pour préserver l’équilibre
menacé de l’actuel temps gelé.