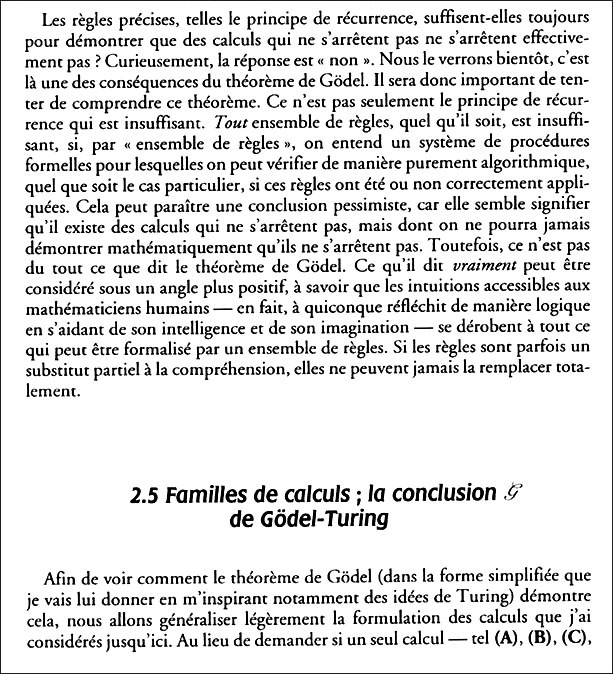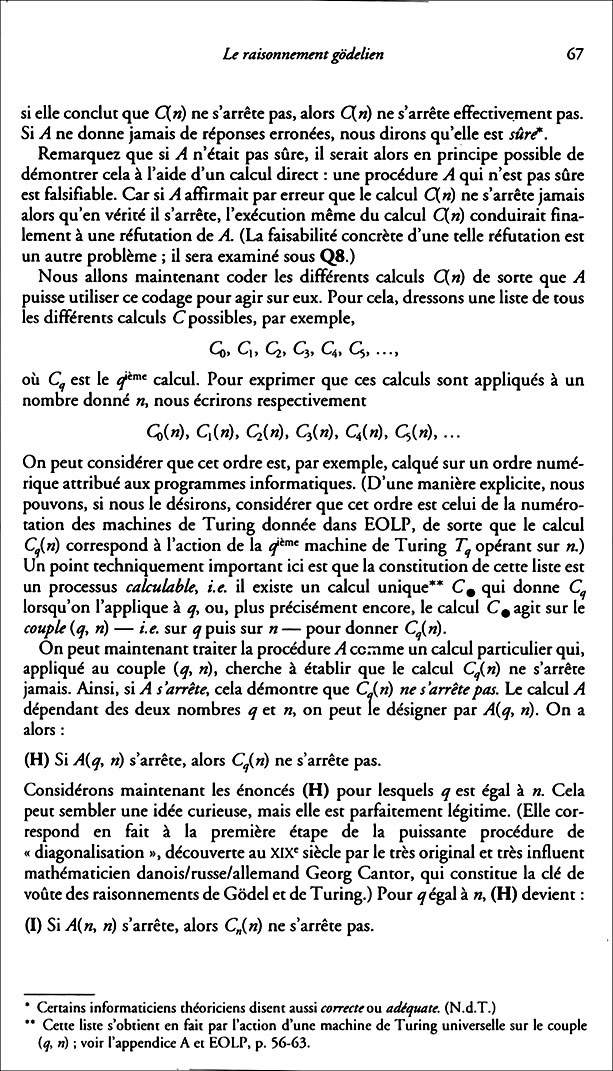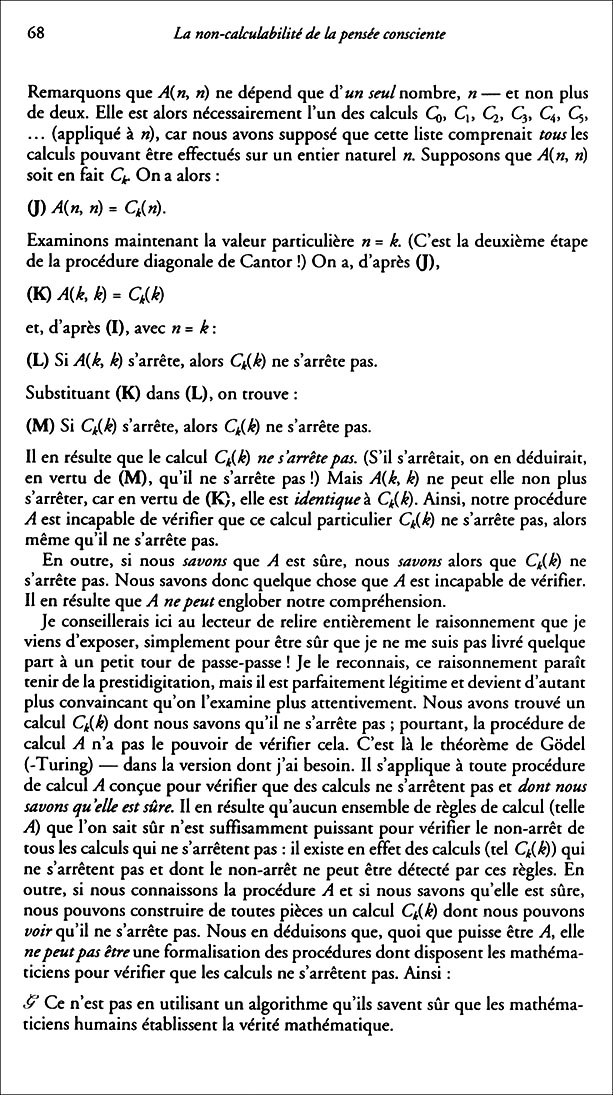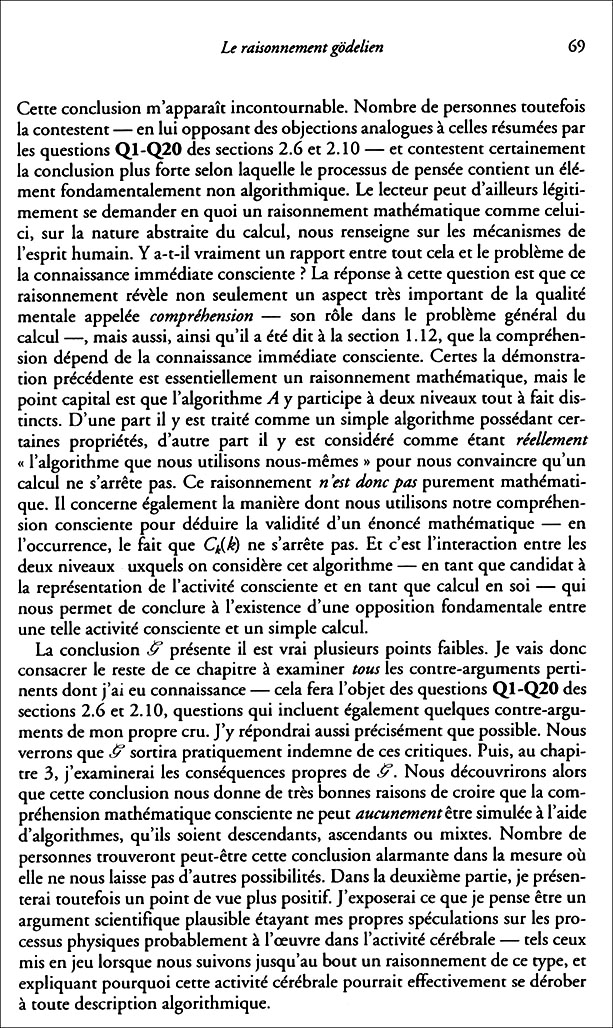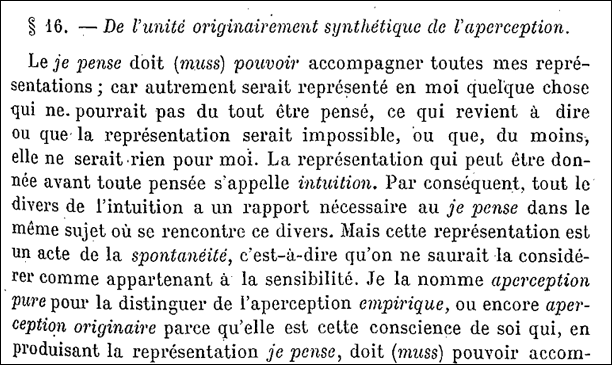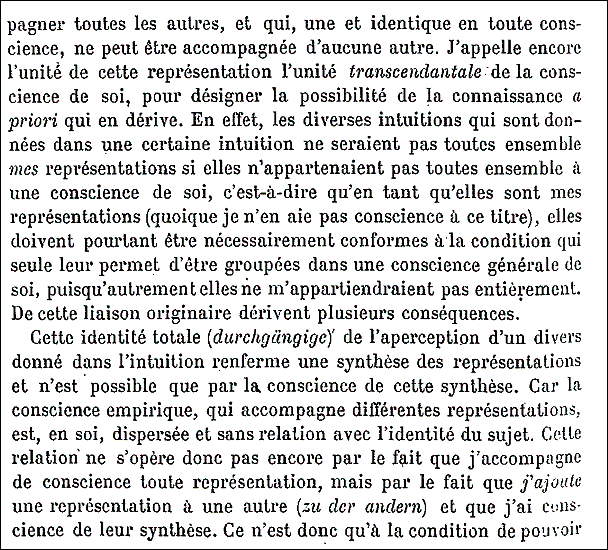NOTES 9
Pour imprimer réduire à
85 %
Penrose :
la non calculabilité de la pensée
Gaza :
tout ce qui est israélien est coupable
Commentaire de Valeur et Richesse de Fourquet
C’est
bien ce que je pensais : Husserl voulait voir la vision
Sartre :
la notion de sensation est une absurdité
Notez
bien que Schumpeter n’est pas le seul,
à quelques exceptions près, tous les économistes sont des cons. Ils ont tous appris les mêmes conneries dans les même écoles À l’adresse suivante http://2ccr.unblog.fr/2012/12/21/l-argent-sans-foi-ni-loi/ je lis :
Non, je regrette, ce n’est pas le cas. Lors d’un crédit, il y a bien « une simple écriture comptable » mais la contrepartie du crédit du compte courant du client par sa banque (que nous nommerons banque XYZ par la suite afin d’alléger le texte) n’est pas le débit d’un compte de trésorerie, ce qui serait le cas lors d’un dépôt d’espèces, mais le débit d’un compte d’actifs financier où sont enregistrées les créances. En créditant d’un trait de plume le compte courant de son client, la banque XYZ s’engage seulement à payer, à vue et à la place de son client, pour 200 000 euros de dépenses. Et pour ce faire, elle utilise l’argent scriptural de la Banque centrale qui est le seul argent ― avec, évidemment, l’argent fiduciaire qui consiste en billets de cette même Banque centrale. Quand son client tire un chèque de 100 000 euros sur la banque XYZ afin de payer son maçon par exemple, la banque XYZ n’a même pas à payer 100 000 euros car les croisements de règlements de banque à banque se compensent et à la fin de la journée la banque XYZ aura à payer, par exemple, un petit solde négatif de compensation de toutes les opérations de la journée de 227 euros seulement ou bien, elle pourra encaisser un petit solde positif de 2 367 euros. Du fait de la compensation des paiements, les banques bénéficient d’un énorme effet de levier dû à la grande vitesse de compensation, ce qui explique que leurs réserves légales soient si petites, ce qui n’est pas sans risque. Avec un tout petit solde négatif de 227 euros, la banque XYZ peut très bien avoir fait pour plusieurs millions de paiement parce qu’elle en a reçu elle-même à peu près autant et cela ne nécessite pas du tout de création monétaire. Si par malheur il se produit un gros déficit de compensation, par exemple 336 754 euros et que la trésorerie de la banque est un peu juste, elle cherchera de l’argent ― comment pourrait-elle être obligée de chercher de l’argent si elle en créait ? ― sur le marché monétaire interbancaire ou, pour les très grosses sommes, elle mettra des actifs en pension à la banque centrale qui, grâce à cette garantie, lui avancera l’argent qui fait défaut, d’un simple trait de plume qui créditera le compte courant de la banque XYZ à la banque centrale, la contrepartie de l’écriture étant le débit d’un compte d’actifs mis en pension. À part ça, où se trouve l’argent de la banque XYZ ? Non pas dans ses coffres (où il ya quelques espèces pour les guichets, 10 000 euros par exemple) mais dans les livres de la banque centrale. Or il est interdit pour les banques d’avoir un découvert à la banque centrale. C’est pour cela qu’elles doivent régler leurs déficits de compensation chaque jour. Seule la Banque centrale crée de l’argent, scriptural et central (Cf. ci-dessous ♦). La locution « argent central » est mal venue car elle laisse entendre qu’il y a un argent périphérique, alors que le seul autre argent consiste dans les espèces qui, de nos jours, sont des billets de la banque centrale. Il fut un temps où les espèces étaient l’or et l’argent. Qu’est-ce qui permet de dire que quelque chose est de l’argent ? 1) il éteint les dettes ; 2) on ne peut le refuser en paiement. Or il est bien évident que si l’on peut accepter en paiement un effet à ses risques et périls, on n’est pas du tout obligé d’accepter cet effet. Donc un effet n’est pas de l’argent. Il n’éteint pas une dette, on n’est pas obligé de l’accepter en paiement. Prétendre que des créances à trois mois, à deux ans, à cinq ans sont de l’argent est une sottise. On n’est pas obligé d’accepter une créance sur un tiers en paiement, et si on l’accepte, la dette n’est pas éteinte. Elle le sera seulement quand la créance sera honorée. ― Cela dit on peut vendre et acheter des créances, à ses risques et périls. ― Notez bien que je ne mets pas en cause les agrégats de créances qui sont peut-être d’utiles outils de pilotage. Cela je l’ignore. Mais appeler cela monnaie, argent ou masse monétaire, c’est un mensonge, c’est embrouiller le monde qui a déjà tellement de mal à se comprendre. Toute l’eau de la mer ne suffirait pas pour effacer une tache de sang intellectuelle. C’est une tache de sang intellectuelle. La création d’argent par les banques commerciale est un mythe soutenu par les économistes je me demande bien pourquoi. Les prouesses des économistes sont bien connues ainsi que les résultats de ces prouesses. Le véritable privilège des banques commerciales est le monopole des règlements, hors règlements en espèces évidemment. Les règlements se passent entre banques : ce n’est pas M. Chouard qui paye son maçon, c’est sa banque qui paye la banque du maçon et si le maçon et lui ont la même banque, cela ne change rien, évidemment. La banque est toujours là, entre M. Chouard et son maçon, comme un gros polochon. _________________ ♦ Comment la banque centrale crée-t-elle de l’argent ? Elle charge un courtier de lui acheter pour, disons, cent millions de bons du trésor non échus. Le courtier les achète sur le marché. Alors la banque centrale va tirer un chèque sur elle-même à l’ordre du courtier. Elle envoie ce chèque au courtier qui l’endosse à l’ordre de sa banque et le lui remet à l’encaissement. Cette banque va créditer le compte du courtier et débiter son propre compte de trésorerie de cent millions d’euros et va remettre ce chèque à l’encaissement… à la banque centrale… qui va passer l’écriture suivante, à réception du chèque : débit du portefeuille : cent millions ; crédit de la banque du courtier : cent millions. Voici donc cette fameuse écriture de création d’argent. Ce n’est pas du tout ce que vous pensiez. Notez bien que c’est la banque du courtier qui est créditée par la banque centrale et non pas le courtier. Le courtier est crédité par sa banque et non pas par la banque centrale. Où se trouve la trésorerie de la banque du courtier ? Dans les livres de la banque centrale. Où se trouve la trésorerie du courtier ? Dans les livres de sa banque. À la suite de quoi tout ce bel argent central va se répandre dans le système à partir de la banque du courtier car ce dernier, va, évidemment, payer ses créanciers etc. Ce procédé est dit, en bon français, open market. Quand les bonds viennent à échéance le Trésor paye la banque centrale qui passe une écriture qui annule celle de la création. Le montant des bonds rendus au Trésor à titre de pièces comptables est porté au crédit du Portefeuille ; l’argent qui revient au bercail est porté au débit du compte de trésorerie. L’argent créé sort de la circulation. Petit détail : ces bons du trésor rapportent un intérêt. Qui va les encaisser ? La banque centrale. Voilà donc l’État qui verse une rente à la banque centrale privée ! Du temps où la banque de France était nationale, elle partageait cet intérêt avec le Trésor. Aujourd’hui, c’est tout pour la poche des banquiers associés de la banque centrale privée. La comptabilité en partie double est très simple : le compte qui reçoit doit ce qu’il reçoit, on le débite donc ; quant au compte qui « donne », le compte qui reçoit lui doit ce qu’il lui donne. On crédite donc le compte qui donne. Ce dernier point est d’ailleurs la preuve que M. Chouard se trompe quand il pense que l’argent qu’il a déposé à la banque lui appartient. Le fait que son compte courant soit crédité indique que ce compte a donné quelque chose. Devinez quoi et à qui. Après cette transaction, M. Chouard n’a plus qu’une reconnaissance de dette entre les mains. On ne peut avoir le beurre et l’argent du beurre ; on ne peut avoir et l’argent et une reconnaissance de dette. Au début de la pratique de la partie double les écritures au journal étaient libellées ainsi : Dû par <nom d’un compte> XXX écus à <nom d’un compte> XXX écus. Comme Brasidas je dis : il ne faut pas se laisser impressionner par le nombre des ennemis. Il ne faut pas se laisser impressionner par le nombre de ces crétins d’économistes qui répètent tous la même sottise. Ils ont appris dans les mêmes écoles et ils sont payés pour ça. Moi, j’ai appris sur le tas, en tant que Коммерса́нтъ ♦♦. Je n’étais pas peu fier d’avoir un compte chez de Neuflize, chez Mallet et chez Louis-Dreyfus. _________________ ♦♦ Du
temps de Tourgueniev, dans les livres russes, les mots « en français
dans le texte » étaient composés en caractères cyrilliques. C’est
peut-être toujours le cas car beaucoup de Russes ne sauraient pas déchiffrer
les caractères latins et réciproquement les Français ne savent pas déchiffrer
les caractères cyrilliques. Le journal Kommersant
(créé en 1909) perpétue cette tradition car Коммерса́нтъ
ne veut rien dire en Russe. Je présume que ce journal est occidentaliste,
mais notez qu’il emploie un mot « en français dans le texte » et
non pas anglo-américain. Cocorico !
[zSchumpeter ] |
|
Penrose La
non-calculabilité de la pensée La
compréhension n’étant pas calculable signifie que les machines ne comprennent
pas Or
suivre une règle présuppose de comprendre la règle Donc
les machines sont incapable de suivre une règle De
ce fait, elle ne peuvent pas faire d’erreur, elles ont seulement des pannes L’erreur
est humaine Une
machine, jamais, n’abolira la compréhension Penrose prouve que la compréhension « se dérobe à tout ce qui peut être formalisé par un ensemble de règles ». (Penrose, Les Ombres de l’esprit. InterÉditions, 1995, pages 65 à 69). Pour imprimer, réduisez à 85 %
|
|
|
GAZA
Tout ce qui est israélien
est coupable
● Ce
n’est pas les Palestiniens qui ont envahi la Palestine mais les Juifs par Michel Collon. Donc, les Juifs sont les
agresseurs. Donc, ce sont les Palestiniens qui peuvent exercer des
représailles et non les Israéliens (les Juifs de Palestine) qui ne font que
poursuivre le nettoyage ethnique de la Palestine qui dure depuis
soixante cinq ans. L’invasion et l’occupation définitive de la Palestine par
les Juifs est un long crime tranquille et particulièrement vicieux, car les bourreaux se posent en
victimes : selon eux la dissolution finale des Palestiniens est
le crime le plus moral du monde, perpétré par l’armée la plus morale du
monde. Notez bien : ils ont envahi la Palestine en ne faisant rien
d’autre que se défendre et depuis, ils ne font rien d’autre que se défendre
(pauvres chous – chou vient de chéri et non du légume, je lui colle donc un
“s”). Au moins les Nazis assumaient leurs crimes et Hitler a su quitter la
scène dignement. Gandhi, en 1938 : « Je ne défends pas les excès
des Arabes. J’aurais souhaité qu’ils eussent choisi la voie de la
non-violence pour résister à ce qu’ils considèrent à juste titre comme une
intrusion inacceptable dans leur pays. Mais selon les critères reconnus du
bien et du mal, on ne
peut rien reprocher à la résistance arabe face à une adversité écrasante. »
Que dirait-il aujourd’hui ?
● Travaux
pratiques. Une séance de hasbaratin (le
débat Yahoo! du 20 novembre – 2/4)
Miss Lévy depuis la Komandantur : « Si Paris était à
portée de missiles venus du Luxembourg, nous ne nous poserions pas de
questions, nous riposterions ».
Stop ! j’arrête là, j’ai mon compte, ouf ! J’ignorais que le
Luxembourg était un territoire non souverain, soumis au blocus, peuplé
uniquement de réfugiés français qui d’ailleurs ont établi un
gouvernement ; j’ignorais que les Boches nous avaient envahi une
nouvelle fois mais, nouveauté par rapport à 1870, 1914 et 1940, avec pour but
de rester en France ad vitam aeternam et pour cela d’expulser et de
déporter les Français non seulement au Luxembourg, mais en Belgique, en
Suisse, en Italie, au Portugal, à Madagascar etc. ; enfin, j’ignorais
que miss Lévy fricotait avec l’occupant. En effet, dans ce cas il n’y a pas à
hésiter : les réfugiés français du Luxembourg sont parfaitement fondés à
envoyer des fusées Dupont (du nom d’un célèbre résistant fusillé par
l’envahisseur) sur les boches qui ont volé leurs terres, leurs villages et
leurs maisons et qui s’y pavanent. D’ailleurs, ces derniers viennent de
détruire, pour la seconde fois, la cathédrale de Reims et ils ont rasé ce qui
restait du donjon de Coucy pour y planter une forêt d’eucalyptus, car ils
veulent effacer toute trace de notre présence en France. Gandhi le dit bien : on ne peut rien reprocher à
la résistance française face à une adversité écrasante.
● Dans
un texte du 3 janvier 2009, Gilad Atzmon dit la même chose et de plus
explique pourquoi (traduit par Mounadil
al Djazaïri) Version
imprimable en français →
● Le
rabbin Brandt Rosen le dit aussi (deDefensa, traduction
Dominique Muselet ci-dessous) Plus on est de fous, plus on rit.
À part ça le président FAF Babar Flanby normal
socialiste poursuit
ses époustouflantes aventures, à Varsovie, où il déclare : « La
France peut parler et aux uns, et aux autres. Je ne parle pas du Hamas, je
parle des pays. » Cette précision, Babar Flanby normal socialiste
l’a réitérée quelques minutes plus tard : « La France peut
parler à tous, sauf à ceux qu’elle ne reconnaît pas. » (Cf. Christophe Oberlin) [zPalestine] |
|
Commentaire
de Valeur et Richesse
de Fourquet 26
septembre 2006 /138/ Théorie substantielle et théorie nominale de la valeur. — A partir de là, les choses se gâtent. De la valeur = mesure de la richesse, les économistes en sont venus à prendre la valeur pour la richesse elle-même, à abandonner la notion de richesse et, a fortiori, celle de puissance dont elle n’était que la traduction dans le discours économique. Ce glissement sera achevé par Ricardo et par Marx, qui démarre Le Capital par un exposé de la substance de la valeur, qui séduit l’intellect, mais qui met en scène des personnages conceptuels imaginaires, à l’existence desquels Marx croit dur comme fer. La valeur n’est pas une
mesure, la valeur est une représentation, au sens de Bolzano, mais à part ça,
bravo ! Personnages conceptuels imaginaires ! c’est la
ménagerie de Marx. A l’opposé de cette
théorie substantielle de la valeur, une théorie nominale : la valeur est
le nom donné à la mesure
commune de ces réalités physiques qu’on appelle biens, services,
marchandises, denrées, commodities, conveniences, ou collectivement
richesse. La valeur des
choses est leur mesure du point de vue de la richesse, comme la longueur, la surface,
le volume est leur mesure du point de vue de l’espace, la durée, leur mesure
du point de vue du temps, ou la pesanteur, leur mesure du point de vue de la
gravitation. Mesure de l’espace, mesure du temps et mesure de la force sont
les trois mesures de base de l’esprit. Les autres sont construites à partir
d’elles, car les phénomènes du monde sont des combinaisons de force, d’espace
et de temps. La richesse est le nom économique donné à la puissance ;
nous pouvons donc présumer qu’elle a une relation avec le concept de force. NON — La valeur n’est pas une
mesure. Une mesure est le rapport de deux grandeurs. Certes, la valeur est l’idée d’un
rapport. Mais, le rapport dont la valeur est l’idée est : un
échange et non pas : le rapport de deux grandeurs. Donc la
valeur n’est pas une mesure, ni l’idée d’une mesure. Pour parler comme
Bolzano : la valeur est la représentation d’un échange de même
qu’une proposition est une représentation d’un état des choses. Et, de même
qu’une proposition peut s’avérer fausse, l’échange représenté par la valeur
peut s’avérer impossible. Une grandeur est une partie
d’une grandeur. Une mesure est le rapport de deux grandeurs homogènes*. 1) La
valeur n’est donc pas une mesure parce qu’elle est l’idée d’un rapport.
2) Quoiqu’une mesure soit un rapport, la valeur n’est pas non plus
l’idée d’une mesure parce que le rapport dont elle est l’idée n’est
pas le rapport de deux grandeurs homogènes — ce qu’est toute mesure comme on
le sait depuis Euclide — mais un échange. *. Sont homogènes deux grandeurs
dont l’une peut être partie de l’autre. NON — La valeur n’est pas une
grandeur, car une grandeur doit pouvoir être partie d’une autre grandeur, or
la valeur ne peut être partie d’aucune grandeur. Euclide, Éléments,
livre V : ♦ Une grandeur est une partie d’une grandeur, la plus petite de la plus grande, quand elle mesure la plus grande. ♦ Une grandeur plus grande est multiple d’une grandeur plus petite, quand elle est mesurée par la plus petite. ♦ On entend par raison une certaine manière d’être de deux grandeurs homogènes considérées comme se contenant l’une l’autre. ♦ On dit que des grandeurs ont une raison entre elles lorsque ces grandeurs, étant multipliées, peuvent se surpasser mutuellement. ♦ On dit que ces grandeurs sont en même raison, la première à la seconde, et la troisième à la quatrième, lorsque des équimultiples quelconques de la première et de la troisième étant comparés à d’autres équimultiples quelconques de la seconde à la quatrième, chacun à chacun, les premiers équimultiples de la première et de la troisième sont en même temps plus grands que les équimultiples de la seconde et de la quatrième, ou leur sont égaux ou plus petits. ♦ On appellera proportionnelles les grandeurs qui ont la même raison. Comme
je le notais en 1976 dans mon Enquête, on ne peut additionner de
valeur. La valeur ne peut être plus petite, égale, plus grande, multiple,
sous-multiple d’une autre valeur. Ce qui peut l’être ce n’est pas la valeur,
c’est la quantité d’argent qui est représenté dans la représentation
d’un échange. L’argent est une grandeur [je ne dirais plus cela aujourd’hui, je n’avais lu
Lebesgue alors. C’est le prix qui est une grandeur de l’argent et non
pas du boudin. Théorème de
Voyer-Lebesgue : le prix du boudin n’est pas une grandeur pour
le boudin mais une grandeur pour l’argent].
Une quantité [OK, c’est une quantité d’argent qui est une grandeur et non pas
l’argent] d’argent peut être plus petite, égale, plus grande, multiple,
sous-multiple avec une autre quantité d’argent. Je le notais dans mes commentaires d’un manuscrit :
ce n’est pas la valeur qu’on additionne, c’est l’argent, plus exactement des
quantités d’argent. On additionne un francs, deux francs, trois francs qui
sont des quantités d’argent, fiduciaire ou réel, métallique, et non des
valeurs. La valeur est la représentation
d’un échange avec l’argent. L’argent est la représentation de la
richesse. Mais le terme « représentation » n’a pas le même sens
dans les deux cas. Dans le première il a le sens de Bolzano. Dans le second
il a le sens diplomatique, celui de représentant plénipotentiaire devant
lequel chacun s’incline. L’argent est la convention générale. L’argent est la
coercition générale. OUI — La richesse est une grandeur.
La richesse peut être une partie d’une autre richesse. La mesure de la richesse
est le rapport de deux richesses. L’unité de richesse est une grandeur.
L’unité de richesse est le dollar, car les États-Unis sont très puissants
(plutôt, c’est ce que tout le monde pense encore — sauf l’Émir de la Guerre
—, mais pour combien de temps ?) Je suis donc d’accord sur ce
point avec Fourquet qui dit plus bas : « La grandeur de
la richesse est donc incluse dans le concept même de richesse » de même
que chez Euclide la grandeur est incluse dans le concept même de grandeur
comme on peut le constater dans ses axiomes, ici même. Turgot dit de même. NON — La valeur n’est pas la
mesure de la richesse. L’opposition entre théories substantielle et nominale de la valeur rejoint le débat philosophique médiéval entre réalistes et nominalistes. Pour éviter toute ambiguïté, j’annonce ma couleur : nominaliste. Je le suis devenu : « valeur est le nom de la puissance sociale » (Cf. p. 125) est encore substantialiste. C’est pourquoi je /139/conserve le vieux mot de richesse pour désigner la réalité physique dont la valeur est la mesure. La valeur est la représentation quantitative de la richesse/puissance ; c’est un rapport. Les rapports entre valeurs donnent des informations d’ordre quantitatif, des proportions, des ordres de grandeur : c’est essentiel. Combien de fois, en lisant les historiens, ai-je pesté contre tel ou tel qui donnait un chiffre sans point de comparaison : autant ne rien dire ; le chiffre seul ne signifie rien. Pas la moindre information. L’information, c’est la relation à un autre chiffre. NON — Le vieux mot de richesse
ne désigne pas la réalité physique mesurée par la valeur, ne serait-ce que
parce que la valeur n’est pas une grandeur et qu’elle ne peut donc se
rapporter à rien, c’est à dire qu’elle ne peut pas être partie
[ Dedekind est l’inventeur de la partition qui permet de construire les
nombres irrationnels qui ont tourmentés des Grecs sublimes ] de quelque
chose, qu’elle ne peut donc mesurer quoi que ce soit selon les termes
d’Euclide. Les choses physiques
(pléonasme), certaines choses physiques, choisies par convention au sens de
Lewis, c’est à dire par general conforming (cette convention n’est pas
une convention car personne n’a convenu de rien), sont les représentantes de
la puissance. Chacun s’incline devant ces choses physiques comme devant les
représentants d’une grande puissance, comme devant les ambassadeurs d’une
grande puissance. Il était surtout connu pour sa grande notoriété. Chacun
s’incline devant ces représentants parce que chacun sait que chacun s’incline
devant ces représentant, brièvement dit : parce que la situation est
connue (Barwise). Ces choses physiques ne sont pas des mesures de la
puissance, mais des représentantes de la puissance. Elles représentent la
puissance devant chacun et chacun s’incline (Enzyclopädie, § 106
ou § 260). La puissance est une institution, c’est à dire une affaire
collective. La valeur aussi est une représentation,
mais au sens de Bolzano ou de Wittgenstein cette fois : elle est la
représentation d’un échange comme la proposition est une représentation d’un
état des choses. Et l’échange peut très bien s’avérer impossible, comme la
proposition peut s’avérer fausse. Mais le rapport de valeur ne donne jamais aucune information de causalité. C’est la limite absolue de la pensée économique. Pour établir des relations de causalité, nous devons sortir du monde homogène et uniforme de la valeur et « voir » le monde de la richesse dont elle n’était qu’une mesure. Mais la richesse elle-même n’étant qu’une réduction économique de la puissance, nous devrons « voir » les rapports de force, les réseaux, les circuits de captage, etc., bref: être généalogiste, et non comptable. La richesse implique conceptuellement la valeur. — Pourquoi les mercantilistes et Petty considéraient-ils que la richesse n’était qu’une partie de la richesse mondiale totale ? Parce que, dans le mot même de richesse, comme dans celui de puissance, est déjà inclus un rapport quantitatif entre ce dont on parle et l’ensemble de la richesse/puissance du monde. Quand on dit de quelqu’un qu’il est riche, c’est toujours par rapport à une échelle, fût-elle implicite, ou même oubliée. Une personne riche dans la France d’après guerre nous paraît pauvre aujourd’hui, etc. Dans la désignation « riche » et « pauvre », on sous-entend une quantité totale de richesse inégalement répartie. C’est parce que cette quantité est limitée ou rare qu’il y a égalité, ou inégalité. Si la quantité était infinie, le concept égal/inégal n’aurait pas de sens. Dans l’atmosphère abondante, « non mesurée », de la campagne, l’air qu’on respire n’est pas réparti à chaque individu : chacun y puise à volonté. Il n’y a répartition, donc égalité/inégalité, que s’il y a rareté. La grandeur de la richesse est donc incluse dans le concept même de richesse ; même chose pour la puissance. Il n’y a grandeur qu’à partir du moment où la pensée peut énoncer : « égal à », « plus grand que », « plus petit que ». Une grandeur déterminée suppose une grandeur totale à laquelle elle est implicitement rapportée. Quand je dis : « j’ai respiré une grande quantité d’air », j’entends : /140/ par rapport à mon maximum de capacité respiratoire, et non par rapport à la quantité totale de l’atmosphère, ce qui n’aurait aucun sens : le rapport serait infiniment petit. Quand j’écrivais que « le pourcentage est le mode privilégié de représentation de la quantité » [1980, p. 371], en vérité, je me trompais : il n’y en a pas d’autre. La quantité est, en soi, relation à un ensemble. Donc, le sens du mot richesse s’épuise dans son rapport à un ensemble, bien que nous ne sachions pas encore en quoi elle consiste physiquement. Dans le concept même de richesse réside le concept de valeur défini comme pure mesure de la richesse. Il n’y a pas d’un côté des choses qu’on appelle « richesses », et de l’autre une valeur mesure de ces choses. Non. Il y a des tas de choses qui ne sont « richesses » que si, implicitement, on les compare à un ensemble de choses analogues. De ce point de vue, il n’y a pas de différence entre richesse et valeur ; c’est pourquoi les économistes se sont si facilement laissés avoir par la conception substantielle. La richesse est une grandeur
et la valeur n’est pas sa mesure. La valeur n’est pas la mesure
de la richesse, la mesure de la richesse est, comme toute mesure, le rapport
d’une grandeur à l’unité de grandeur. C’est pourquoi « les »
richesses ne sont pas « des » richesses, mais des choses dans lesquelles
on ne voit que l’argent. Et on peut voir en elles l’argent parce qu’à chacune
d’elles est associée une valeur, c’est à dire l’idée d’un échange avec
l’argent. La valeur n’est pas une mesure mais une institution :
l’association à chaque chose de l’idée d’un échange. La seule différence
entre la valeur et le prix, c’est que la valeur peut-être l’idée d’un échange
avec n’importe quelle marchandise tandis que le prix est l’idée d’un échange
avec une certaine quantité d’argent. C’est aussi simple que cela. Mais la valeur en soi n’existe pas plus que la grandeur en soi. « Grandeur » n’a de sens que quand on précise : « grandeur de tel objet », c’est-à-dire son rapport à un autre objet, ou à l’ensemble des objets du même genre. Il en est de même pour la valeur « valeur » tout court n’a pas de sens, à moins de préciser : « valeur de telle marchandise », par quoi on mesure le rapport de cette marchandise à l’ensemble des marchandises considérées sous l’angle de leur valeur. Il en est de même de la puissance. Dire d’un pays qu’il est une « grande puissance » ne signifie rien d’autre que: il « peut » beaucoup par rapport à la moyenne, c’est-à-dire à l’ensemble de la puissance répartie entre les différents pays. En vérité, « puissance » est un concept vide ; il ne signifie rien d’autre qu’un pur rapport quantitatif à un ensemble. Dans le langage politique le plus chargé affectivement, le mot ultime, c’est « grandeur », un mot vide : la grandeur de la France fut le but ultime du général de Gaulle et des patriotes en général. Sous-entendu grandeur par rapport à la grandeur du monde, ou à la moyenne des grandeurs nationales. Même chose quand on dit que la France doit tenir son rang dans le monde. Quel rang? Le quatrième ou le dixième dans l’échelle des grandeurs mondiales. Grandeur a un sens même quand
on ne précise pas longueur, temps, masse, courant, moment, énergie, puissance
etc. Ce sens est, selon Euclide : ce qui peut être partie d’une autre
grandeur. En fait, la notion de grandeur en soi implique la notion de grandeur.
C’est pourquoi il fallut qu’Euclide axiomatisât. Par ses axiomes, il décrit le
comportement de la grandeur puisqu’il ne peut pas la définir. La question est différente
pour la valeur qui n’est ni une grandeur, ni la mesure d’une grandeur.
La valeur est l’idée d’un échange qui est associée à chaque chose qui devient
ainsi marchandise. C’est précisément la raison pour laquelle elle est
toujours valeur d’une marchandise particulière. L’institution
« valeur » consiste dans ce fait. Ce que permet l’institution
« valeur » c’est justement de pouvoir comparer différentes
marchandises sous l’angle de la richesse, qui elle est une grandeur. Seules
les grandeurs sont comparables. Ce qui est comparé grâce à la valeur, c’est
l’argent qui est représentant de la puissance. C’est l’argent que l’on
compare grâce à la valeur, ce n’est pas la valeur. Si la valeur n’existait
pas, on ne pourrait rien comparer sous l’angle de la richesse. Valeur ne contient rien de plus que le mot grandeur : une relation, une proportion. Il n’a de sens que dans un contexte sémantique où il est question de biens, services, marchandises, etc. A cette réserve près, il est aussi vide que lui, et il ne peut s’employer, dans le langage, qu’à sa place. Non, il y a confusion entre
grandeur, relation, proportion. Je me suis heurté aux même difficultés en 1975.
La valeur n’est pas une relation mais l’idée
d’une relation et cette relation n’est pas une proportion mais… un échange.
Il s’agit de la publication de la possibilité d’un échange. /141/ Une expression irrationnelle : la « mesure de la valeur ». — Si « valeur » est le nom donné à la mesure de la richesse, parler de « mesure de la valeur » paraît plutôt bizarre. Étant elle-même une mesure, la valeur n’a pas de mesure, pas plus que la longueur n’a de longueur, ou la pesanteur de pesanteur. On peut mesurer la longueur d’un champ ou la valeur d’une marchandise, mais pas la longueur ou la valeur tout court. La « mesure de la valeur » est donc une expression irrationnelle. Quand on parle de « mesure de la valeur », sans s’en rendre compte on substantialise la valeur, on la confond avec la réalité dont elle est la mesure, à savoir la richesse. 1. OUI — bravo ! L’expression
« mesure de la valeur » est une absurdité. 2. NON — la valeur n’est pas
elle-même une mesure. Bien au contraire, une mesure est le rapport de deux
longueurs, de deux masses, de deux forces. La mesure d’une longueur est le
rapport de deux longueurs, la mesure d’une masse est le rapport de deux
masses, etc., car une grandeur est toujours une partie d’une grandeur. Pour
parler comme Fourquet, la grandeur ne peut être envisagée que du point de vue
de la mesure. Une grandeur est ce qui est mesurable parce qu’une grandeur est
toujours partie d’une grandeur. La valeur n’est aucun rapport mais seulement
l’idée d’un rapport et d’un rapport qui n’a rien à voir avec une mesure, avec
le rapport de deux grandeurs. Le rapport dont il s’agit est une institution,
l’échange. Ce
n’est pas parce qu’elle serait déjà une mesure que la valeur n’a pas de
mesure, qu’elle n’est pas mesurable, mais parce qu’elle n’est pas une
grandeur. Ne sont mesurables que les grandeurs. Cette confusion n’est pas contingente : elle est constitutive de l’économie politique depuis Adam Smith. C’est d’ailleurs un expert en confusion : ayant déclaré que « le travail est la mesure réelle de la valeur », il parle dans la phrase suivante de « valeur du travail », autrement dit : la mesure de la mesure réelle de la mesure... de quoi ? De la richesse, sans doute ! [WN, I, 5.] En revanche, ce qui n’est pas irrationnel, c’est la détermination de l’unité de mesure, de l’étalon, du langage de cette unité. Le poids s’exprime en grammes, l’espace en mètres, etc. L’unité est généralement conventionnelle. Quelle est l’unité de la valeur ? Ce problème fut un vrai casse-tête pour les anciens, comme en témoigne les écrits de Petty, de Turgot et de Smith. OUI — Ça c’est bien
vrai ! Effectivement Smith entend par « valeur du travail » la
valeur, le prix, de l’obéissance pendant un certain temps. La fameuse
« valeur du travail » n’est que le prix de la soumission (Dockès).
Il faut appeler les choses par leur nom. Ce n’est pas la « force de
travail », pur mythe, que le fabricant achète, mais l’obéissance de
l’ouvrier, chose très concrète. Ce n’est pas non plus « du
travail » que les fabricants veulent supprimer afin d’accroître leurs
bénéfices ou simplement d’en faire, c’est du temps d’obéissance d’ouvrier,
parce qu’un ouvrier ça mange et ça boit et qu’il faut donc bien lui
« donner » de l’argent — de l’argent, notez bien, pas de la valeur
— pour ce faire. Ce n’est pas le travail que veulent supprimer les fabricants
mais les ouvriers. Il n’y a pas d’unité de
valeur, il n’y a qu’une unité de richesse et cette unité est le dollar ;
la richesse n’étant que la représentante de la puissance. La comptabilité nationale ne se pose pas ces problèmes métaphysiques sur la nature de la valeur et son étalon. Elle appelle prix ce que nous venons d’appeler valeur et se borne à compter ou comptabiliser ( = enregistrer sous forme de comptes) les prix tels qu’ils s’inscrivent sur les documents sociaux, mercuriales, factures, comptabilités d’entreprises ou d’administrations, indices de prix, etc. Elle dispose d’une unité de compte propre à chaque monnaie, le franc, le dollar, etc. Autrefois, on mesurait en livres, une unité de compte elle-même mesurée par une unité de poids — car une nouvelle unité de mesure prend appui sur un autre système de mesure déjà existant. Ainsi le joule ou le kilogrammètre est la combinaison d’une unité de poids et d’une unité de longueur, etc. Voici enfin une
représentation, ne la ratez pas. L’unité de compte n’est pas mesurée par
une unité de poids mais représente une autre unité de richesse qui consiste dans un certain
poids d’un certain métal. Quant aux monnaies entre elles, il me semble que
Turgot montre qu’elles sont entre elles comme de simples marchandises et
l’euro possède alors une cote en dollar et réciproquement selon que
l’on cote le certain ou l’incertain. Dans chaque pays, la monnaie nationale
est comme le proxène des monnaies étrangères, elle les représente toutes. Il
ne s’agit pas du tout de combinaison d’unités mais d’unités de système
différent : MKSA, cgs, MKpS, etc. unités convertibles, comme le sont les
monnaies. C’est une question de conversion. On dit : « combien le
pouce anglais vaut-il de millimètres ? » 25,4. Dans ce cas, on a
bien une mesure. On peut mesurer le pouce avec le millimètre. On effectue le
rapport du pouce et du millimètre. On rapporte deux longueurs.
[zFourquet] |
|
Husserl prétend percevoir le percevoir, voir la vision, entendre l’audition, toucher le toucher. Or la perception est imperceptible, la vision invisible, le toucher intangible, l’audition inaudible [j’ajouterai : la compréhension est incompréhensible]. L’apparition n’apparaît jamais, cependant elle a lieu et on ne peut douter qu’elle a lieu, qu’elle soit fallacieuse ou non. Husserl a beau tortiller du cul, il chie droit pour finir. La perception est imperceptible car il peut y avoir perception de vert, mais la perception ne peut pas être verte. Si la perception était perceptible, il y aurait seulement perception de perception et jamais perception du monde. (Frege – et Sartre : le sens est insensible)
● Pourquoi l’arbre perçu ne peut pas brûler ? Parce que le prétendu arbre perçu n’est pas une espèce d’arbre mais une espèce de perception et que les perceptions ne brûlent pas. « Perçu » n’est pas un attribut déterminant de l’arbre mais un attribut modificatif de la perception (Bolzano). Quant à l’arbre qui brûle, il ne s’agit pas d’une espèce de perception mais d’une espèce d’arbres : les arbres qui brûlent. Ainsi « brûlant » n’est pas un attribut déterminant de la perception mais un attribut modificatif des arbres. Si l’on tient le participe « perçu » (ou « vu ») pour une qualité de l’arbre, cela conduit au paradoxe suivant : l’arbre est perçu quand il n’est pas perçu. Ou bien on soutient que « perçu » n’est pas une qualité de l’arbre. Dans ce cas l’arbre n’est pas perçu quand il est perçu. Notez que les perceptions ont lieu dans le monde. L’arbre est perçu dans le monde, à sa place et comme il est. J’aime assez la détermination négative de « l’intérieur » par Bolzano. Qu’est-ce que « être dehors » ? C’est être dans l’espace. Donc, qu’est-ce qu’être à l’intérieur ? C’est être hors de l’espace (et non pas à l’intérieur du corps, que ce soit dans le cerveau ou le trou du cul). Donc à l’intérieur il n’y de place pour rien du tout et c’est pour cela que les arbres paraissent où ils sont. Je suppose que ce sont ces considérations qui ont poussé Leibniz à son étonnante expérience de pensée du moulin (Monadologie, § 17) et à conclure que les perceptions avaient lieu dans des points logiques, qui n’occupent aucun espace et sont sans porte ni fenêtres : les monades ou substances simples. Husserl s’est pris les pieds dans le tapis. Cf. LE CONSENSUS HUMAIN DÉCIDE-T-IL DU VRAI ET DU FAUX ?
(Descombes) ● Ideen I,
§ 41 :
Husserl regarde une table. Il dit : « Je ferme les yeux. (…) Je
n’ai plus d’elle [la table] aucune perception. J’ouvre les yeux et la
perception reparait de nouveau ». Certainement pas, c’est la table
qui reparaît. La perception n’a pas cessé ; elle s’est modifiée, la
table non. D’ailleurs Husserl l’admet ailleurs. il dit à peu près :
« Je ferme les yeux, la perception ne cesse pas, je vois la lumière
rosée de mes paupières ». Il n’y a qu’un caractère qui n’est pas
modifié, qui est constant, dans la perception : elle est imperceptible. ● Ideen I,
§ 97 :
Husserl dit : « Une seule perception peut de cette façon
englober dans son unité une grande multiplicité de modifications ; tant
que notre contemplation reste conforme à l’attitude naturelle, nous
attribuons tantôt ces modifications à l’objet réel, comme étant ses
altérations ; … » qui peut, à part Husserl, attribuer à l’objet
réel les modifications de la perception ? Husserl s’invente des
obstacles imaginaire afin de justifier ses kilomètres de charabia. Plus
loin : « Il faut alors
apercevoir avec une clarté totale que le vécu de perception pris en lui-même
comporte bien dans son essence “l’arbre perçu comme tel” » c’est à
dire l’arbre, non pas en tant qu’il brûle, mais en tant qu’il est
perçu. Or « est perçu » n’est pas une qualité de l’arbre,
l’arbre ne peut jamais avoir pour qualité « le perçu », on
ne peut dire : l’arbre a le perçu ou l’arbre a la perception. L’arbre
perçu n’est pas une espèce d’arbre mais une espèce de perception. Donc, il
n’y a pas besoin de réduction machin-truc pour comprendre ça. [zHusserl] |
56 000
signes