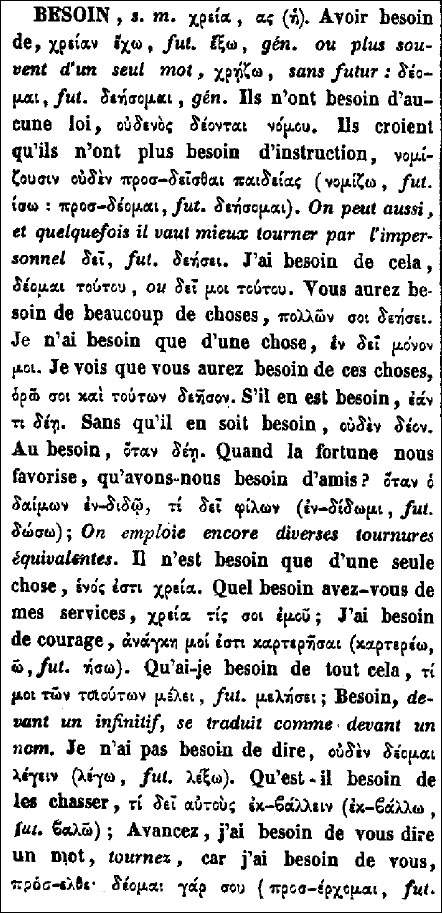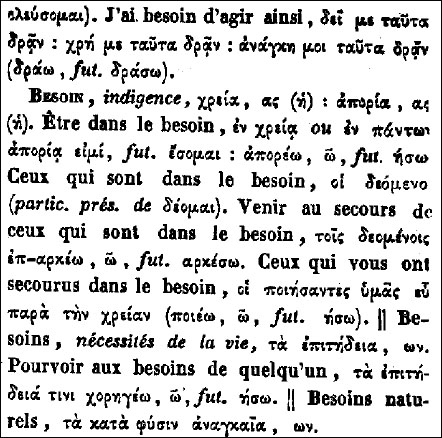Marx
lit Aristote
Éthique à Nicomaque
Livre V
Traduction Gauthier-Jolif
Une propriété de la langue, néfaste pour la
fiabilité de l’action de penser, est sa propension à créer des noms propres auxquels
nul objet ne correspond. (…) Ainsi, une grande part du travail du philosophe
consiste — ou devrait du moins consister —
en un combat avec la langue.
Frege. Écrits posthumes
Édition Tricot, format .DOC, Académie de Montpellier →
|
Quel est le sujet ? J’applique à Aristote ce que j’ai appris dans La Mesure des grandeurs du Pr Henri « Tarababoum »
Lebesgue. Je montre que le nombre longueur
du boudin est bien une grandeur pour le boudin mais que le nombre « prix du boudin »
n’est pas une grandeur pour le boudin. Il est une grandeur seulement pour les
corps en or ou en argent, car il viole l’unique théorème de La mesure des
grandeurs du Pr Lebesgue. La conséquence est que l’argent n’est pas la
mesure de toute chose et que cette expression est un pur non sens répété
par des perroquets. Meuh ! Autre conséquence, le problème n’est pas que
les marchandises doivent devenir commensurables, ni égales (ni receler
quelque chose d’égal ou qui les rend égales) ; mais… échangeables.
Le problème est donc : qu’est-ce qui rend les marchandises échangeables,
car les marchandises ne deviennent pas commensurables, ni égales, mais bien échangeables.
Ce problème n’a jamais été traité quoi qu’ait pu en penser Marx. Le seul
rapport dans le rapport marchand, c’est l’échange. Dans l’échange, il n’y
a ni égalité, ni équation, ni rapport au sens de quotient, ni mesure. Il n’y
a que des prix. C’est la thèse de Jorion (spécialiste de la formation des
prix). Aristote n’a jamais traité de la valeur comme le croit Marx, mais
seulement des prix. La valeur chez Marx est une vertu dormitive. Le prix du boudin n’étant pas une grandeur pour le boudin, le prix ne
peut pas être une mesure d’une grandeur du boudin ; cependant le prix du
boudin est bien un nombre attaché au boudin, mais par une étiquette !
tandis que le nombre prix du boudin est attaché à un corps en or par une
mesure. Plus simple, tu meurs. C’est ma troisième
découverte palmaire, la première étant que « Le
phénomène comme phénomène n’est pas un phénomène, mais le supra sensible
et le seul supra sensible. Autrement dit : l’apparition comme apparition
ne parait jamais (1959) et la deuxième étant : « La
valeur est un échange effectué en pensée » (1975). |
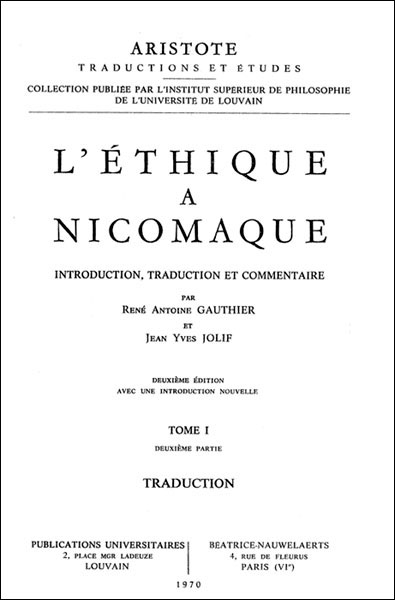
Chapitre 6
<PREMIÈRE ESPÈCE DE JUSTICE PARTICULIÈRE
LA
JUSTICE DISTRIBUTIVE>
<La
justice implique à la fois égalité et milieu.>
[1131 a 9] Si 1’homnme injuste, c’est
l’inégal, et si d’autre part la notion d’injuste correspond à celle d’inégal,
il saute aux yeux qu’il existe aussi un certain milieu par rapport à l’inégal,
et c’est précisément I’égal ; car en toute action où il y a du plus et du
moins il y a aussi de l’égal.
[12] Donc, s’il y a correspondance, entre les
notions d’injuste et d’inégal, il en va de même pour les notions de juste et
d’égal. C’est là justement ce que l’on admet communément, sans avoir besoin de
recourir au raisonnement.
[14] Mais si, par ailleurs, la
notion d’égal implique celle de milieu, le juste doit être, lui aussi, un
certain milieu.
<La notion de
juste implique un certain rapport, car elle requiert quatre termes...>
[14] Or,
la notion d’égal ne peut se réaliser que s’il y a au moins deux termes. Mais il
est nécessaire, — cela ne fait pas de doute, — que le juste soit à la fois milieu et égal, d’une
part, et, d’autre part, relatif, c’est-à-dire juste pour certains individus.
[16] Pour autant qu’il est milieu, il
se situe entre certaines choses /129/
(qui représentent le plus et le moins), et, en tant qu’égal, il implique deux
choses.
[18] Pour autant qu’il est juste,
d’autre part, il suppose certaines personnes,
[18] Le juste requiert ainsi
nécessairement quatre termes au moins, car les personnes pour lesquelles le
juste est juste sont au nombre de deux, et les choses en quoi le juste se
concrétise [les objets
distribués] sont
aussi au nombre de deux.
<...
entre
lesquels se réalise une certaine proportion>
<Cette
proportion peut être induite des contestations qui surgissent dans les partages
mal faits>
[20] Il faut de plus que la même
égalité soit réalisée entre les personnes d’une part et les objets d’autre
part ; autrement dit, le rapport qui existe entre les premières doit se
retrouver entre les seconds : si les individus ne sont pas égaux, ils ne
recevront pas des parts égales. C’est bien de là que viennent les querelles et
les récriminations, quand des individus égaux possèdent ou se voient attribuer
des parts inégales, ou que des individus qui ne sont pas égaux reçoivent des
parts égales.
<C’est
elle aussi qui est à la base du principe du mérite>
[24] Que cette proportion doive
exister, c’est ce qui ressort aussi du principe de la distribution conformément
au mérite. Tout le monde reconnaît en effet que, dans les distributions, la
motion de ,juste doit se définir par rapport à un certain mérite, encore que
tous ne définissent pas de la même façon ce mérite : pour les membres
d’une démocratie, c’est la condition libre ; pour les membres d’une oligarchie, c’est la
richesse (ou pour certains d’entre eux, la bonne naissance) ; pour les
membres d’une aristocratie, c’est la vertu.
[29] Concluons donc que la
justice réalise un certain type de proportion. Conclusion légitime, car le fait
d’être proportionnel n’est pas un caractère propre au nombre abstrait, mais une
propriété du nombre en général.
<NATURE DE LA PROPORTION
QUE DOIT RÉALISER LA JUSTICE DISTRIBUTIVE>
<La
notion, de proportion en général>
[31] La proportion est une égalité de rapports, qui ne requiert pas moins de quatre
termes. /130/
[32] Que la proportion discrète comporte
quatre termes, cela saute aux yeux. Mais il en va de même pour la proportion
continue elle-même : dans ce
dernier cas, eu effet, un
terme unique joute le rôle de deux et apparaît deux fois. Exemple :
la longueur A est à la longueur B comme la longueur B est à la longueur
C ; la longueur B, on le voit, apparaît deux fois de sorte que, en posant deux
fois cette longueur B, on obtient quatre termes proportionnels.
<Application
de ces notions à la justice
distributive>
[1131 b 3] Or, la notion de juste
implique elle aussi quatre termes et quatre au moins, et le rapport est le même dans chaque
groupe de deux termes ; en effet les longueurs représentant les personnes et les parts sont
divisées de façon semblable ♦. Par suite, le terme A est au
terme B comme le terme C est au terme D ; en permutant, on obtient
A est à C comme B est à D, et par conséquent : la
somme A + C et la somme B + D sont encore dans le même rapport. {2/4 = 3/6 ; k = 0,5 ;
2= k4 ; 3= k6 ;
2+3/4+6 = 5/10 ; k = 0,5 ; 5 = k10}
[7] Mais c’est précisément cette
sommation que réalise la distribution, et la combinaison est juste si les
termes sont ainsi réunis. [Chapitre 7] C’est donc l’accouplement du
terme A au terme C et du terme B au terme D qui représente
le juste dans la distribution, et le juste ainsi entendu est un milieu par rapport aux
extrêmes qui violent 1a proportion (le proportionnel est en effet milieu, et le
juste, d’autre part, est proportionnel).
<Cette
proportion est une proportion géométrique>
[12] C’est à ce type de proportion
que les mathématiciens donnent le nom de proportions géométrique. Dans la
proportion géométrique, rappelons-le, la somme du premier et du troisième
termes est à la somme du deuxième et du quatrième comme un terme de l’un des
deux rapports est à
l’autre terme. .
{2/4 = 3/6 ;
2+3/4+6 = 5/10}
<Elle
ne peut être une proportion continue>
[15] La proportion qui caractérise
la justice distributive n’est pas une proportion continue. On ne peut en effet
avoir un terme
numériquement un { « un terme
unique » cf. supra [32] } pour désigner la personne
qui reçoit et la part qui est distribuée ♦.
|
♦ La version
donnée par Jorion et parfaitement claire : « … la justice
distributive n’est pas une proportion continue, car son deuxième et son troisième
terme, le bénéficiaire d’une part et une part en soi, ne constituent pas un
terme unique. » |
<Conclusion
sur la justice distributive>
[16] Tout cela nous permet de
conclure que le juste, — au sens où nous l’entendons ici, — c’est le proportionnel,
et que l’injuste, à l’inverse, c’est ce qui détruit la proportion. Dans
l’injustice, /131/ l’un des termes
devient donc trop grand et l’autre, trop petit. Et c’est bien ce qui se passe
en fait : s’il s’agit du bien, celui qui commet l’injustice possède une
part trop grande, et celui qui la subit, une part trop petite. Inversement s’il
s’agit du mal (comparé à un mal plus grand, le moindre mal prend raison de
bien, car on choisit le moindre mal de préférence au plus grand ; or, ce
qui est digne de choix, c’est le bien, et il est un bien d’autant plus grand
qu’il est plus digne de choix).
Fin de l’examen de la première espèce de justice.
<seconde
espèce de justice particulière :
la justice
corrective>
[25] Reste une seconde espèce de
justice, la justice corrective, qui trouve place dans les rapports mutuels,
qu’ils se réalisent de plein gré ou contre le gré de l’une des parties.
<Dans
la justice corrective, le juste correspond à la proportion arithmétique,
différant ainsi du juste distributif>
[26] Ce type de justice est une
espèce différente de celle dont nous venons de parler. En effet, le juste qui
préside à la distribution des biens communs est toujours conforme à la
proportion susdite, — car
à supposer même que la distribution porte sur les bénéfices d’une société
commerciale, elle se fera encore selon le rapport des capitaux engagés {que voilà des termes bien modernes},
— et l’injuste opposé à ce type de juste, c’est ce qui viole la proportion.
[32] Par contre, dans les rapports
entre individus, le juste est sans doute un certain type d’égal, et l’injuste,
un certain type d’inégal ; mais, au lieu. de se déterminer selon la
proportion que nous avons mentionnée, il se détermine selon la proportion arithmétique. Peu importe, en
effet, que ce soit un honnête homme qui ait 1ésé un coquin, ou un coquin
qui ait fait tort à un honnête homme, qu’un adultère ait été commis par un
honnête homme ou par un coquin : la loi n’a d’égard qu’à la nature du
dommage ; elle
regarde les parties comme égales et ce qui l’intéresse, c’est de savoir
si celui-ci a commis une injustice et si celui-là l’a subie, si celui-ci a
causé un dommage et si celui-là a été
lésé. /132/
<NATURE DU JUSTE CORRECTF>
<Un
exemple concret : la façon dont
procède le juge>
[1132 a 6] C’est parce que l’injuste est ici identique à l’illégal {l’ill-égal dirait le crétin Lacan, c’est
l’effet yau d’poële auquel recourt aussi l’illustre Aristote, cf. infra [30]}
que le Juge s’efforce de rétablir
l’égalité. Même dans le cas, en effet, où un tel reçoit une blessure que provoque un tel, où
un tel donne la mort et un tel succombe, il s’ensuit, encore, de l’action
accomplie par l’un et subie par l’aube, une division inégale ; et le juge,
lui, tente de rétablir l’égalité en faveur du perdant, et, pour ce faire, il
enlève quelque chose au gagnant.
<Remarque
sur l’emploi des termes « perte » et « gain »>
[10] On peut, en pareils cas,
parler en général, — même si les mots ne
s’y appliquent pas au sens propre, — de gain (par exemple pour celui qui
porte les coups) et de perte (par exemple pour celui qui les reçoit). Encore
est-il que c’est seulement quand le dommage a été apprécié {de precium, « prix »} que le résultat de
l’action est appelé perte, d’une part, et gain, de l’autre.
<Définition
du juste correctif>
[14] Ainsi, c’est l’intermédiaire
entre le plus et le moins ; le gain et la perte, au contraire, sont à la fois et
en sens opposés plus et moins : plus de bien et moins de mal, c’est un gain ;
inversement, moins de bien et plus de mal, c’est une perte. Or, l’égal, — que
nous posons identique au juste, — c’est, disions-nous, l’intermédiaire. Par
conséquent, le juste correctif est l’intermédiaire entre [1132 a 19] le perdant et le gagnant.
|
(autre rédaction) [1132 b 11-20] <Origine
des termes « perte » et « gain »> [1132 b
11] Ces
ternes de perte et de gain ont leur origine dans l’échange fait de plein gré. En effet,
posséder plus qu’il ne nous revient, c’est ce qu’on appelle faire un gain,
tandis que posséder moins qu’on n’avait en commençant, c’est subir une
perte. Ainsi en va-t-il
dans l’achat et dans la vente et dans toutes les autres opérations où
la loi laisse aux individus la possibilité de régler les termes de
l’échange. Par contre, quand les parties n’ont ni plus, ni moins mais exactement
ce qu’elles avaient en commençant, on dit que l’on a sa part et que l’on ne
gagne ni ne perd. /133/ <Définition du juste correctif> [1132 b 18] Par conséquent, le juste dans les rapports qui ne sont pas établis de plein gré, c’est l’intermédiaire entre ce que l’on peut appeler un gain et une perte ; il consiste à posséder après l’échange un bien égal à celui que l’on possédait auparavant. <La
définition proposée peut être confirmée par la conception que l’on se fait couramment du
juste> [1132 b 19] Voilà pourquoi, lorsque
surgit une contestation, on a recours juge. Aller devant le juge, c’est se
mettre en face de la notion même de juste, car l’idéal du juge, c’est d’être
le juste personnifié. Et de plus on recherche le juge comme un intermédiaire,
et certains font appel à des médiateurs, montrant par là qu’en parvenant à
l’intermédiaire on croit parvenir au juste. On peut donc conclure que le
juste est en quelque sorte un intermédiaire, s’il est vrai que le juge, lui
aussi, en est un. [29a] |
<LA NOTION DE JUSTE CORRECTIF
IMPLIQUE ELLE AUSSI UNE PROPORTION>
<Examen plus
approfondi de l’opération accomplie par le juge>
[24] Le juge, donc, restaure
l’égalité. Ce faisant, il agit comme si, une longueur donnée étant divisée en
segments inégaux, il ôtait au plus grand segment pour l’ajouter au plus petit
la longueur dont le premier dépasse la moitié. Et c’est lorsque la longueur
totale est divisée en deux parts égales que l’on dit que l’on a sa part, —
c’est-à-dire lorsqu’on a obtenu l’égal.
<Remarque
sur
l’étymologie dit mot « dikaion » (juste)>
[30] Telle est aussi la raison
pour laquelle on emploie le mot « dikaion » (juste) : c’est qu’il signifie dicha {étymologie fantaisiste, mais jeu de mot burlesque.
Dika : règle, usage, coutume ; dicha : doublement ;
dichê : en deux (Bailly), d’où dichotomie. Ainsi, le jugement de Salomon
qui propose de couper l’enfant en deux serait injuste parce que l’enfant n’est
pas coupable} (division en deux parts égales) c’est comme si on disait « dichaion » ;
de même le juge
(dikastès) est un diviseur en moitiés (dichastès).
<Le
juge ne fait donc que prendre la proportion arithmétique>
[29b] Or, l’égal est intermédiaire
entre le plus grand et le plus petit selon la proportion arithmétique.
[32] Soient en effet deux longueurs
égales. Si on enlève à la
première un segment que l’on ajoute à la seconde, celle-ci dépasse l’autre de deux fois la longueur de ce
segment (cela se comprend facilement, /134/
car si l’on enlève à la première un segment sans
l’ajouter à la seconde, la différence entre les deux sera égale à un seul segment). La seconde longueur
dépasse donc la moitié
d’une longueur
égale à un segment, et la moitié à son
tour dépasse d’une longueur égale à un segment la longueur à laquelle
on a ôté ce
segment.
<L’application de la proportion
arithmétique permet de résoudre
les problèmes posés par la notion de juste correctif>
[1132 b 2] Ainsi donc saurons-nous à la
fois ce qu’il. faut enlever à celui qui a trop et ce qu’il faut ajouter à celui
qui n’a pas assez : à celui qui a en moins, il faut ajouter la quantité
dont la moitié dépasse sa part ; à celui qui a la plus grande part, nous
devons enlever la quantité dont cette part dépasse la moitié.
Soient AA, BB et CC trois longueurs égales entre elles. Enlevons à AA le segment AE et ajoutons à CC le segment CD, de telle sorte que la longueur totale DCC dépasse EA d’une longueur CD + CZ ; il s’en suit que DCC dépassera BB de la longueur CD.
{d’après
la note des traducteurs : passage [1132 b
11] à [1132 b 19] reporté plus haut dans le cadre jaune soutenu. Il s’agit d’un doublet
du passage 1132 a 10-18}
Chapitre 8
<Le juste et le réciproque>
<Ce qui a
été dit sur les deux sortes de justice, à savoir qu’elles impliquent une proportion,
se heurte à une opinion courante>
[21] Il semble aller de soi, pour
certains, que le réciproque à lui seul épuise purement et simplement la notion
de juste, ainsi que l’affirmaient les Pythagoriciens ; ceux-ci en effet
définissaient le juste, sans plus, comme le fait de subir en retour ce que l’on
a fait subir.
<CETTE OPINION EST FAUSSE,
car la justice ne se ramène pas à la réciprocité>
[23] En fait, cette définition du
juste par le réciproque ne s’applique ni au juste distributif ni au juste correctif,
encore que 1’on veuille interpréter en faveur de cette identification la
justice de Rhadamante : « Que l’on souffre ce que l’on a fait, ce sera bonne
justice ». /135/
<Deux preuves de la distinction nécessaire entre juste
et réciproque>
[28] En bien des cas en effet le
juste et le réciproque sont en désaccord par exemple si c’est le détenteur d’une
magistrature qui donne des coups, il ne doit pas être frappé en retour ;
mais si l’on a frappé un magistrat, on doit non seulement être frappé, mais encore
recevoir une punition.
[30] Ajoutons à cela que la
différence est grande entre celui qui agit de son plein gré et celui qui ne le
fait que malgré soi.
<CETTE OPINION RECÈLE POURTANT UNE
PART DE VÉRITÉ :
LA réciprocité bien comprise est
UN TYPE DE JUSTICE>
<Toute
communauté suppose une certaine réciprocité>
[31] Il n’est est pas moins vrai
que dans les associations d’échanges, ce qui maintient la communauté, c’est ce
type de juste, le réciproque, entendu il est vrai selon la proportion et non
sur la base d’une stricte égalité. Car ce qui fait subsister la cité, c’est que
chacun rend l’équivalent
de ce qu’il a reçu : nous a-t-on fait du mal ? on cherche à le rendre
et, si l’on n’y peut mais, on se sent dans la situation d’un esclave ; est-ce
du bien ?si on ne le rend pas, il n’y a plus d’échange, et pourtant c’est
l’échange qui nous lie inébranlablement les uns aux autres.
<Le symbole des Grâces>
[1133 a 2] Voilà, aussi pourquoi on
élève un temple des Grâces en un lieu où il soit bien en vue : c’est pour apprendre à rendre les bienfaits
reçus. C’est cela le propre de la grâce : il faut, non seulement payer de
retour celui qui a fait preuve de gracieuseté, mais encore prendre soi-même
l’initiative d’un geste gracieux.
<La réciprocité bien comprise doit
réaliser une égalité proportionnelle>
[5] Ce qui fait cet échange
conforme à la proportion, c’est l’addition des termes diamétralement opposés.
|
♦ Ce passage
est clairement expliqué par Jorion |
[7] Prenons un exemple ;
soient A un architecte, B un cordonnier, C une maison et
D une paire de chaussures. Le problème est donc celui-ci :
l’architecte doit recevoir du cordonnier le travail de celui-ci et lui donner en échange son propre travail. En
établissant /136/ d’abord l’égalité proportionnelle de ces différents produits {ici travail=produit, j’aimerai bien voir le texte grec. Cf. plus bas} et en
réalisant ensuite la
réciprocité, on obtiendra le résultat susdit. Sinon le marché ne sera pas égal et la communauté ne
subsistera pas. Rien n’empêche en effet que le travail de l’un ait plus de
valeur que le travail de l’autre, et, dans ce cas, i1 faut les ramener à
l’égalité.
[14] (Ceci vaut aussi bien pour
les autres arts : ils périraient si ce que le consommateur consomme n’était pas, en quantité et
en qualité, ce que le producteur produit.)
[16] Car ce ne sont pas deux
médecins qui constituent une communauté, mais un médecin et un cultivateur, —
disons en général des individus différents et non égaux ; et c’est
justement ces individus qu’il faut ramener à l’égalité.
<La
monnaie est une mesure qui permet de comparer
commodément la valeur relative des marchandises
et d’établir la réciprocité proportionnelle>
<Les
marchandises échangées doivent être commensurables>
[19] Aussi tous les biens qui sont
matières à échanges {un mot
comparable à « marchandises » paraît-il dans le texte
d’Aristote ?} doivent-ils être comparable, d’une façon ou d’une
antre.
<Cette
nécessité a fait inventer la monnaie>
[20] C’est pour cela qu’a été mise
en circulation la monnaie, qui est devenue en quelque sorte un moyen
terme : elle mesure
en effet toutes choses♦ et aussi, par
conséquent, l’excès et le défaut ; elle permet ainsi d’établir combien de
paires de chaussures sont nécessaires pour faire l’équivalent ♦♦ d’une maison ou d’une
quantité donnée de nourriture.
|
♦ Cf. plus bas. ♦♦ Il s’agit en fait de l’équivalence des
prix et non pas de l’équivalence d’une maison ou d’une quantité de
nourriture. |
<Comment il faut égaliser les différents produits
échangés>
[22] Il faut donc que 1e
rapport qui existe entre un architecte et un cordonnier ♦ se retrouve entre tant de paires de chaussures et une maison [ou une quantité donnée de nourriture] :
sinon, en effet, il n’y aura ni échange ni communauté. Or cela ne pourra avoir
lieu que [1133 a 25] si les
produits sont égaux d’une certaine manière ♦♦.
|
♦ Il n’y a
d’autre rapport entre l’architecte et le cordonnier que l’échange, dans ce
cas. L’architecte et le cordonnier ont à part ça un statut différent, statut
qui peuvent être identiques ou différents. Mais ces statuts n’ont aucun
rapport numériques. L’un peut être supérieur à l’autre mais cette supériorité
n’est pas quantifiable. ♦♦ Non,
pas les produits mais les prix des produits. Les prix sont là pour ça. |
(3ème rédaction)
<Les marchandises échangées doivent être commensurables>
[1133 b 14] Il faut donc que toutes choses
soient appréciées ♦ : c’est par là qu’on
rendra possible en tout temps l’échange, et, par suite, l’association,
|
♦ Exactement,
bien vu : c’est seulement quand les choses ont un prix, qu’elles sont
appréciées, stricto sensu, que leur échange devient possible en tout
temps. |
<Cette
commune mesure, c’est le besoin>
[18] À la vérité, il est
impossible, de rendre commensurables des choses aussi différentes ♦ ; mais on peut le faire convenablement si l’on a égard au besoin.
|
♦ Exactement,
il est impossible de rendre commensurables, non seulement des choses
différentes mais des choses semblables. Seules les grandeurs attachées à ces
choses peuvent être commensurables et même incommensurables. |
<La monnaie,
représentation fictive du besoin>
[20] Il nous faut donc une
certaine unité, et cette unité ne peut être établie que par convention. Aussi
l’appelle-t-on monnaie (nomisma). La monnaie rend toutes choses commensurables ♦, étant donné que l’on mesure tout [23a] en
fonction de la monnaie ♦♦.
|
♦ La monnaie ne rend pas les
choses commensurables, ni égales, mais échangeables. ♦♦ On ne mesure pas tout en
fonction de la monnaie |
[16] La monnaie peut donc tout égaliser ♦♣, comme une mesure
qui rend toutes choses
commensurables ♦♦♣. Pas d’association en effet sans échanges ; pas d’échanges sans
égalité ♦♦♦♣ ; pas d’égalité sans commensurabilité ♣.
|
♦ La monnaie ne peut pas tout égaliser, elle ne peut pas
tout rendre égal, mais seulement
les prix puisque les prix, précisément, sont des quantités de monnaie
et que la valeur est la mention de ces prix, la mention de ces quantités de
monnaie. Seuls les prix peuvent être égalisés dans le cas où l’on voudrait
échanger directement deux marchandises entres elles, cas qui n’est pas la
règle générale, mais qui a lieu cependant entre commerçants. ♦♦ Du temps d’Aristote : une
commune mesure. Seule une commune mesure permettait de rendre toutes
choses commensurables (impropre) du temps d’Aristote. (Voir plus bas symmetrias). Mais là n’est pas la
question cf. plus bas : ça me troue
le cul. ♦♦♦ Aristote ne considère ici que
l’échange direct de marchandises qui n’est pas la règle de l’échange
marchand, mais une exception. La règle de l’échange marchand est au contraire qu’il peut y avoir échange sans
égalité des prix. Pour qu’il y ait échange, il suffit qu’il y ait un
prix et un seul et non pas l’égalité de deux prix puisque la règle de
l’échange marchand est que l’on n’échange pas directement les choses entre
elles mais les choses et l’argent et l’argent et les choses. Les erreurs de
Marx sont déjà présentes chez Aristote. Deux marchandises équivalentes sont
deux marchandises qui ont le même prix. Il est absurde de dire qu’une
marchandise et son prix sont équivalents car c’est dire qu’une marchandise et
son prix ont le même prix. ♣ Cf. plus
bas : ça me troue le cul. |
<Comment il faut égaliser les produits échangés>
[23b] Soient A une maison,
B dix mines ; C un lit. A est la moitié de B, si nous supposons que la maison
est d’une valeur de
cinq mines, c’est-à-dire égale à cinq mines, et le lit,
C est le dixième de B. Combien faut-il de lits pour obtenir une
valeur égale à celle de la maison ? I1 saute aux yeux qu’il en faut cinq. Il est manifeste que c’est de
cette façon que s’opérait l’échange avant que ne fût instituée la monnaie ♦. De fait, donner contre [1133 b 28]
une maison cinq lits ou le prix que valent cinq lits, cela revient
au même).
|
♦ Absurdité.
C’est le fait que les choses ont un prix qui permet d’égaliser les prix afin
d’échanger directement les choses sans passer par l’échange intermédiaire
avec l’argent. Remarquons en passant que la maison « n’est pas d’une
valeur » de cinq mine, « elle a une valeur » de cinq mines.
L’usage est de demander : « Quelle est la valeur de la
maison » et non pas « De quelle valeur est la maison ? »
La métaphysique commence avec la réflexion sur l’usage, usage qui va, lui,
très bien tout seul. Quant à Lebesgue, il dit que les mathématiques sont une
science expérimentale et que les définitions doivent être effectuée à partir
de ce qui a lieu dans la pratique qui les précède. Lui aussi regarde l’usage
à sa manière. Une définition qui ne suit pas bien ce qui est fait
pratiquement est une mauvaise définition, pire, elle est fausse. |
Comparaison
de six traductions et du grec
|
Traduction de J. Voilquin et un grand merci à M. Remacle [Traduction Thurot / Texte grec]. Quand j’ai commencé cette étude, le chapitre V de l’Éthique n’était pas encore disponible sur son site. [1133b] C’est lorsqu’ils viennent à échanger leurs produits que ce rapport doit s’établir sous la forme de proportion [analogia] : autrement, l’un des extrêmes pécherait par un double excès (20). Mais quand chacun d’eux obtient ce qui lui appartient, alors il y a égalité, et il peut y avoir commerce entre eux, parce qu’il dépend d’eux que cette égalité puisse s’établir. Soit A le laboureur, C la quantité d’aliments, [5] B le cordonnier, D la quantité de son travail égale à la quantité d’aliments ; [il faudra que B soit à A, comme D est à C]; au lieu que, s’il n’était pas possible de régler ainsi la réciprocité, le commerce ne pourrait pas avoir lieu. Ce qui prouve que le besoin est comme le lien unique qui maintient la société, c’est que, quand deux hommes n’ont aucun besoin l’un de l’autre, ou au moins l’un des deux, ils ne font point d’échange ; il en est de même lorsque l’un ne manque pas de ce que l’autre possède, par exemple, de vin, ce qui donnerait la possibilité à l’autre de proposer son blé. [10] Il faut donc qu’il s’établisse une sorte d’égalité, [entre les besoins comme entre les produits]. Mais en supposant qu’aucun besoin ne se fasse sentir actuellement, l’argent est pour nous comme un garant que l’échange pourra se faire à l’avenir, si l’on est dans le cas d’y avoir recours: car il est permis à celui qui le donne, de prendre ce dont il a besoin. Au reste, l’argent lui-même est sujet aux mêmes vicissitudes [que la denrée] ; car il n’a pas toujours une égale valeur : cependant il en conserve ordinairement une plus uniforme. // //Voilà pourquoi il convient que toutes [15] les choses aient un prix déterminé : car de cette manière les échanges [allaghé] pourront toujours avoir lieu ; et ce n’est que dans ce cas qu’il y a commerce et société [koinomia]. La monnaie, étant donc comme une mesure [métron symmetra] qui établit un rapport appréciable entre les choses, les rend égales [isothétos]. car il n’y aurait point de société sans échange; point d’échange, sans égalité [isothès] ; point d’égalité, sans une commune mesure [symmetrias]. A la vérité [alhéteia], il est impossible de rendre commensurables [symmetra] des objets entièrement différents [bravo : exactement ! alors pourquoi s’entêter à vouloir le faire ? pourquoi s’entêter à chercher sous le réverbère sous prétexte qu’il y fait plus clair ?] ; mais on y réussit assez exactement pour les besoins [chreian] de la pratique. Il faut donc [20] qu’il existe quelque mesure commune [symmetra] ; mais elle ne l’est que par supposition ou convention. Voilà pourquoi on donne à la monnaie le nom de νόμισμα [de νόμος, usage, convention] ; c’est elle qui rend tous les objets commensurables [symmetra] ♦ puisqu’ils peuvent être évalués en monnaie [nomisma metreitai]. ♦ Soit A une maison, B une somme de dix mines, C un lit : il est évident que A sera la moitié de B, si la maison est du prix [axia] de cinq mines, ou égale à ce prix. Supposons que le lit, ou C, soit la dixième partie de B ; on voit dès-lors combien [25] de lits feront une valeur égale à celle de la maison, c’est-à-dire qu’il en faudra cinq. Il est même facile de voir que c’est ainsi que se faisaient les échanges [allaghè], avant que la monnaie existât ; car il importe peu qu’on échange les cinq lits contre la maison, ou contre toute autre chose qui aura la même valeur que cinq lits. |
|
♦ « c’est la monnaie qui rend tous les objets commensurables ♦ puisqu’ils peuvent être évalués en monnaie. » Toute l’erreur est là, cette erreur qui a deux mille cinq cents ans d’existence : les objets ne deviennent pas commensurables parce que… évaluer n’est pas mesurer. Merde à la fin. Meuh ! Pour savoir ce qu’est « mesurer », direction professeur Lebesgue, SVP. Les objets ne deviennent pas commensurables, parce qu’ils deviennent… échangeables. Et pour devenir échangeables, ils n’ont pas du tout besoin de devenir commensurables, et c’est tant mieux parce que commensurables ils ne peuvent le devenir. Cette pathologie métaphysique provient d’une mécompréhension de la grammaire du mot mesure. Chercher à résoudre l’énigme de la valeur tel que cela fut fait pendant deux mille cinq cents ans c’est ce que fait l’ivrogne qui cherche sa clef perdue, il ne sait où, sous un réverbère parce qu’il y fait plus clair. S’il pouvait vivre deux mille cinq cents ans, il ne la trouverait jamais si elle n’a pas été perdue sous le réverbère. Vous ne trouverez pas la solution si vous regardez du côté de la mesure. Comprendre la grammaire, ce n’est pas regarder où il fait clair prétendument, c’est regarder ou il faut, c’est regarder l’usage : et l’usage de la mesure, et l’usage de l’évaluation. Il me semble qu’en grec est écrit : « mesurés », mais le bon sens du traducteur a parlé : il a corrigé faisant apparaître toute l’absurdité de la chose. Cela m’étonnais de ne pas avoir remarqué cette contradiction qui me permet de mieux formuler ma pensée : les marchandises ne sont pas mesurées mais évaluées. Une évaluation n’est pas une mesure. Merci. J’ai étendu cette citation par rapport aux autres pour
monter combien périlleuse est la traduction qui abouti au mot français besoin.
Il y a deux occurrences dans le texte grec du mot chreia. Il y a six occurrence
du mot besoin dans le texte français. Dans le paragraphe qui précède
et que je n’ai pas reproduit, c’est encore pire. Notez l’habileté du
traducteur : « quand deux hommes n’ont aucun besoin l’un de l’autre, ou au moins l’un
des deux, ils ne font point d’échange ». Voyez
donc ma remarque plus bas. |
|
[1133b] (1) Εἰς σχῆμα δ’ ἀναλογίας οὐ δεῖ ἄγειν, ὅταν ἀλλάξωνται (εἰ δὲ μή, ἀμφοτέρας ἕξει τὰς ὑπεροχὰς τὸ ἕτερον ἄκρον), ἀλλ’ ὅταν ἔχωσι τὰ αὑτῶν. Οὕτως ἴσοι καὶ κοινωνοί, ὅτι αὕτη ἡ ἰσότης δύναται ἐπ’ αὐτῶν γίνεσθαι. Γεωργὸς α, τροφὴ γ, (5) σκυτοτόμος β, τὸ ἔργον αὐτοῦ τὸ ἰσασμένον δ. Εἰ δ’ οὕτω μὴ ἦν ἀντιπεπονθέναι, οὐκ ἂν ἦν κοινωνία. Ὅτι δ’ ἡ χρεία συνέχει ὥσπερ ἕν τι ὄν, δηλοῖ ὅτι ὅταν μὴ ἐν χρείᾳ ὦσιν ἀλλήλων, ἢ ἀμφότεροι ἢ ἅτερος, οὐκ ἀλλάττονται, †ὥσπερ ὅταν οὗ ἔχει αὐτὸς δέηταί τις, οἷον οἴνου, διδόντες σίτου ἐξαγωγήν.† (10) Δεῖ ἄρα τοῦτο ἰσασθῆναι. Ὑπὲρ δὲ τῆς μελλούσης ἀλλαγῆς, εἰ νῦν μηδὲν δεῖται, ὅτι ἔσται ἂν δεηθῇ, τὸ νόμισμα οἷον ἐγγυητής ἐσθ’ ἡμῖν· δεῖ γὰρ τοῦτο φέροντι εἶναι λαβεῖν. Πάσχει μὲν οὖν καὶ τοῦτο τὸ αὐτό· οὐ γὰρ ἀεὶ ἴσον δύναται· ὅμως δὲ βούλεται μένειν μᾶλλον. Διὸ δεῖ πάντα (15) τετιμῆσθαι· οὕτω γὰρ ἀεὶ ἔσται ἀλλαγή, εἰ δὲ τοῦτο, κοινωνία. Τὸ δὴ νόμισμα ὥσπερ μέτρον σύμμετρα ποιῆσαν ἰσάζει· οὔτε γὰρ ἂν μὴ οὔσης ἀλλαγῆς κοινωνία ἦν, οὔτ’ ἀλλαγὴ ἰσότητος μὴ οὔσης, οὔτ’ ἰσότης μὴ οὔσης συμμετρίας. Τῇ μὲν οὖν ἀληθείᾳ ἀδύνατον τὰ τοσοῦτον διαφέροντα σύμμετρα (20) γενέσθαι, πρὸς δὲ τὴν χρείαν ἐνδέχεται ἱκανῶς. Ἓν δή τι δεῖ εἶναι, τοῦτο δ’ ἐξ ὑποθέσεως· διὸ νόμισμα καλεῖται· τοῦτο γὰρ πάντα ποιεῖ σύμμετρα· μετρεῖται γὰρ πάντα νομίσματι. Οἰκία α, μναῖ δέκα β, κλίνη γ. Τὸ α τοῦ β ἥμισυ, εἰ πέντε μνῶν ἀξία ἡ οἰκία, ἢ ἴσον· ἡ δὲ κλίνη δέκατον (25) μέρος, τὸ γ τοῦ β· δῆλον τοίνυν πόσαι κλῖναι ἴσον οἰκίᾳ, ὅτι πέντε. Ὅτι δ’ οὕτως ἡ ἀλλαγὴ ἦν πρὶν τὸ νόμισμα εἶναι, δῆλον· διαφέρει γὰρ οὐδὲν ἢ κλῖναι πέντε ἀντὶ οἰκίας, ἢ ὅσου αἱ πέντε κλῖναι. Τί μὲν οὖν τὸ ἄδικον καὶ τί τὸ δίκαιόν ἐστιν, εἴρηται. (30) Διωρισμένων δὲ τούτων δῆλον ὅτι ἡ δικαιοπραγία μέσον ἐστὶ τοῦ ἀδικεῖν καὶ ἀδικεῖσθαι· τὸ μὲν γὰρ πλέον ἔχειν τὸ δ’ ἔλαττόν ἐστιν. |
Copiez collez un mot grec ci-dessus. Hélas, la mise en
ligne n’est pas terminée.
|
Traduction Gauthier-Jolif Sans doute est-elle elle-même sujette à des
fluctuations, en ce sens qu’elle ne
possède pas toujours le
même pouvoir d’achat ♦ ; du moins tend-elle à une plus grande
stabilité. Il faut donc que toutes
choses soient appréciées ♦ :
c’est par là qu’on rendra possible en tout temps l’échange, et, par suite,
l’association. À la vérité, il est impossible, de rendre
commensurables des choses aussi différentes ; mais on peut le faire
convenablement si l’on a égard au besoin ♦. Il nous faut donc une certaine
unité, et cette unité ne peut être établie que par convention. Aussi
l’appelle-t-on monnaie (nomisma).
La monnaie rend
toutes choses commensurables, étant donné que l’on mesure tout en fonction de
la monnaie. La monnaie peut donc tout égaliser, comme une mesure qui rend
toutes choses commensurables. Pas d’association en effet sans
échanges ; pas d’échanges sans égalité ; pas d’égalité sans
commensurabilité. Soient A une maison, B dix mines ; C un lit. A est la moitié de B, si nous supposons que la maison est d’une valeur ♦ de cinq mines, c’est-à-dire égale à cinq mines, et le lit, C est le dixième de B. Combien faut-il de lits pour obtenir une valeur ♦ égale à celle de la maison ? I1 saute aux yeux qu’il en faut cinq. Il est manifeste que c’est de cette façon que s’opérait l’échange avant que ne fût instituée la monnaie. De fait, donner contre une maison cinq lits ou le prix ♦ que valent cinq lits, cela revient au même). |
|
Certes, la
monnaie subit aussi la même fluctuation que les besoins. Elle n’a pas en
effet toujours un égal
pouvoir d’achat ♦. Mais
malgré tout, elle tend à plus de stabilité. C’est pourquoi tout doit avoir un prix établi ♦, car c’est la condition pour qu’il y ait
toujours possibilité d’échange et, partant, d’association. La monnaie donc constitue une sorte d’étalon qui rend les choses commensurables et les met à égalité. Sans échange en effet, il n’y aurait pas d’association, ni d’échange sans égalisation, ni d’égalisation sans mesure commune. À la vérité donc, il est impossible de rendre les choses commensurables vu qu’elles sont tellement différentes, / [20] mais en fonction du besoin ♦, on peut y arriver de façon satisfaisante. Aussi doit-on disposer d’une certaine unité qui soit fixée par hypothèse (d’où l’appellation de monnaie), car c’est elle qui rend tout commensurable. Tout peut en effet se mesurer en monnaie : si une maison correspond à A, dix mines à B et un lit à C, A est la moitié de D si la maison est évaluée à cinq mines, autrement dit, il est égal à cinq mines, tandis que le lit, c’est-à-dire C, est la dixième partie de B. On voit pourtant combien il faut de lits pour égaler une maison, c’est-à-dire cinq. Or de toute évidence, c’est ainsi que l’échange s’opérait avant l’existence de la monnaie car il n’y a aucune différence entre échanger cinq lits contre une maison et offrir pour elle le prix ♦ de cinq lits. |
|
Sans doute celle-ci éprouve-t-elle aussi des modifications ; car elle n’a pas toujours un pouvoir [d’achat] égal ♦ ; mais cependant elle tend à être plus stable. C’est pourquoi il faut que toutes les choses aient été évaluées ♦ ; car ainsi l’échange existera toujours (et), si ceci est, la communauté (aussi). Dès lors la monnaie, comme un instrument de mesure qui rend les choses commensurables, égalise ; car la communauté n’existerait pas si l’échange n’était pas, ni l’échange si l’égalité n’était pas, ni l’égalité si la commensurabilité n’était pas. Sans doute en vérité il est impossible que des choses qui diffèrent autant deviennent commensurables, mais par rapport au besoin ♦ cela est possible suffisamment. Il faut, dès lors, un(e) unité) quelconque, mais ceci par fondement ; c’est pourquoi elle est appelée « monnaie » ; en effet, celle-ci rend toutes les choses commensurables ; car toutes les choses sont mesurées en monnaie. Soient une maison A, dix mines B, un lit C. Alors A est la moitié de B, si la maison vaut, ou est égale à cinq mines ; le lit C est la dixième partie de B combien de lits est égal à une maison est alors évident, soient cinq. Qu’ainsi l’échange ait existé avant que la monnaie existe est évident ; car cinq lits contre une maison ou contre autant que cinq lits ♦ ne diffèrent en rien. |
|
La monnaie, il est vrai, est soumise aux mêmes fluctuations que les autre marchandises (car elle n’a pas toujours un égal pouvoir d’achat ♦; elle tend toutefois à une plus grande stabilité. De là vient que toutes les marchandises doivent être préalablement estimées en argent ♦, car de cette façon il y aura toujours possibilité d’échange, et, par suite communauté d’intérêts entre les hommes. La monnaie, dès lors, jouant le rôle de mesure, rend les choses commensurables entre elles et les amène ainsi à l’égalité : car il ne saurait y avoir communauté d’intérêts sans échange, ni échange sans égalité, ni enfin égalité sans commensurabilité. Si donc, en toute rigueur, il n’est pas possible de rendre les choses par trop différentes commensurables entre elles, du moins, pour nos besoins courants ♦, peut-on y parvenir d’une façon suffisante. Il doit donc y avoir quelque unité de mesure, fixée par convention, et qu’on appelle pour cette raison νόµισµα, car c’est cet étalon qui rend toutes choses commensurables, puisque tout se mesure en monnaie. Appelons par exemple une maison A, dix mines B, un lit Γ. Alors A est moitié de B si la maison vaut cinq mines, autrement dit est égale à cinq mines ; et le lit Γ est la dixième partie de B : on voit tout de suite combien de lits équivalent à une maison, à savoir cinq. Qu’ainsi l’échange ait existé avant la création de la monnaie cela est une chose manifeste, puisqu’il n’y a aucune différence entre échanger cinq lits contre une maison ou payer la valeur en monnaie ♦ des cinq lits. |
|
Now the same thing happens to money itself as
to goods — it is not always worth the same ♦; yet it tends to be steadier. This is why all goods must have a price set on them ♦ [une
étiquette] ; for then there will always be exchange, and
if so, association of man with man. Money, then, acting as a measure, makes goods commensurate and equates them; for
neither would there have been association if there were not exchange, nor
exchange if there were not equality, nor equality if there were not
commensurability. Now in truth it is impossible that things differing so much
should become commensurate, but with reference to demand ♦ they
may become so sufficiently. There must, then, be a unit, and that fixed by
agreement (for which reason it is called money); for it is this that makes
all things commensurate, since all things are measured by money. Let A be a house, B ten minae, C
a bed. A is half of B, if the house is worth five minae or
equal to them; the bed, C, is a tenth of B; it is plain, then,
how many beds are equal to a house, viz. five. That exchange took place thus
before there was money is plain; for it makes no difference whether it is
five beds that exchange for a house, or the money value ♦ of
five beds.
|
Marx lit Aristote
Éditions socialiniennes, 1959
|
Livre premier Première section
La marchandise et la
monnaie
Chapitre premier
La marchandise /72/ (…) Troisième particularité de la forme
équivalent : le travail concret qui produit l’équivalent, dans notre exemple,
celui du tailleur, en servant simplement d’expression au travail humain
indistinct, possède la
forme de l’égalité ♦ avec un autre travail,
celui que recèle la toile,
et devient ainsi, quoique travail privé., comme tout autre travail productif
de marchandises, travail sous forme sociale immédiate. C’est pourquoi il se
réalise par un produit
qui est immédiatement échangeable avec une autre marchandise ♦.
Les deux
particularités de la forme équivalent, examinées en dernier lieu, deviennent encore
plus faciles à saisir, si nous remontons /73/ au grand penseur qui a
analysé le premier la forme valeur, ainsi que tant d’autres formes, soit de
la pensée, soit de la société, soit de la nature nous avons nommé Aristote. D’abord
Aristote exprime clairement que la forme argent de la marchandise n’est que
l’aspect développé de la forme valeur simple, c’est-à-dire de l’expression de
la valeur d’une marchandise dans une autre marchandise quelconque ♦, car il dit : « 5 lits = 1
maison » « ne diffère pas » de : « 5 lits = tant et
tant d’argent ». Il voit de plus que le rapport de valeur ♦ qui contient cette expression de valeur ♦♦ suppose, de son côté, que
la maison est déclarée égale
au lit ♦♦♦ au point de vue de la qualité,
et que ces objets, sensiblement différents, ne pourraient se comparer entre
eux comme des grandeurs commensurables sans cette égalité d’essence. « L’échange,
dit-il, ne peut avoir lieu sans l’égalité, ni l’égalité sans la commensurabilité ». Mais ici il hésite et
renonce à l’analyse de la forme valeur. « Il est, ajoute-t-il,
impossible en vérité que des choses si dissemblables soient commensurables
entre elles », c’est-à-dire de qualité égale ♦♦♦♦. L’affirmation de leur égalité ne peut être que
contraire à la nature des choses ; « on y a seulement recours pour
le besoin pratique ».
Ainsi, Aristote nous dit
lui-même où son analyse vient échouer, — contre l’insuffisance de son concept
de valeur ♦. Quel est le « je ne
sais quoi d’égal », c’est-à-dire la substance commune que représente la maison
pour le lit dans l’expression de la valeur de ce dernier ?
« Pareille chose, dit Aristote, ne peut en vérité exister [1]. » ♦♦ Pourquoi ? La maison représente vis-à-vis du lit quelque chose d’égal ♦♦♦, en tant qu’elle représente ce
qu’il y a de réellement égal dans tous les deux. Quoi donc ? Le travail
humain.
Ce qui empêchait Aristote
de lire dans la forme
valeur des marchandises ♦, que tous les travaux
sont exprimés ici comme travail humain indistinct et par conséquent égaux,
c’est que la société grecque reposait sur le travail des esclaves, et avait
pour base naturelle l’inégalité des hommes et de leurs forces de travail. Le
secret de l’expression
de la valeur ♦♦, l’égalité et
l’équivalence de tous les travaux, parce que et en tant qu’ils sont du
travail humain, ne peut être déchiffré que lorsque l’idée de l’égalité humaine
a déjà acquis la ténacité
d’un préjugé populaire. Mais cela n’a lieu que dans une société où la forme
marchandise est devenue la forme générale des produits du travail, où, par
conséquent, le rapport des hommes entre eux comme producteurs et échangistes
de marchandises est le rapport social dominant. Ce qui montre le génie
d’Aristote, c’est qu’il
a découvert dans l’expression de la valeur des marchandises un rapport
d’égalité ♦♦♦. L’état particulier de la
société dans laquelle il vivait l’a seul empêché de trouver quel était le
contenu réel de ce rapport.
1. Ethique à Nicomaque, I. V, chap. v, p. 5, 13. (N. R.). |
Le Capital
Éditions socialiniennes, 1959
Zambèze
de non sens
|
Livre premier Première section
La marchandise et la
monnaie
Chapitre premier
La marchandise
/69/ (…) 3. La forme équivalent et ses particularités. On
l’a déjà vu : en même temps qu’une marchandise A (la toile) exprime sa valeur ♦ dans la valeur d’usage d’une marchandise
différente B (l’habit), elle imprime à cette dernière une forme
particulière de valeur, celle d’équivalent ♦♦. La toile manifeste son propre caractère de valeur ♦♦♦ par un rapport ♦♦♦♦ dans lequel une autre
marchandise, l’habit, tel qu’il est dans sa forme naturelle, lui fait équation ♦♦♦♦. Elle exprime donc qu’elle-même vaut quelque chose ♠, par ce fait
qu’une autre marchandise, l’habit, est immédiatement échangeable ♠♠ avec elle.
En tant que valeurs, toutes les marchandises sont des expressions égales d’une même unité ♦, le travail humain, remplaçables les unes par les autres. Une marchandise est, par conséquent, échangeable avec une autre marchandise, dès qu’elle possède une forme, qui la fait apparaître comme valeur ♦♦.
Une marchandise est
immédiatement échangeable avec toute autre dont elle est l’équivalent ♦, c’est-à-dire : la place qu’elle occupe dans le rapport de valeur ♦♦ fait de sa forme naturelle la forme valeur de l’autre marchandise ♦♦♦. Elle n’a pas besoin de revêtir une forme
différente de sa forme naturelle pour se manifester comme valeur à l’autre
marchandise, pour valoir comme telle et, par conséquent, pour être
échangeable avec elle. La forme équivalent est donc pour une marchandise la forme sous
laquelle elle est immédiatement échangeable avec une autre.
Quand une marchandise,
comme des habits, par exemple, sert d’équivalent ♦ à une autre marchandise,
telle que la toile, et acquiert ainsi la propriété caractéristique d’être immédiatement
échangeable avec celle-ci ♦♦, la proportion ♦♦♦ n’est pas le moins du monde donnée dans laquelle
cet échange peut s’effectuer. Comme la quantité de valeur ♦♦♦♦ de la toile est donnée,
cela dépendra de la
quantité de
valeur ♦♦♦♦ des habits. Que dans le rapport de valeur ♠, l’habit figure comme équivalent et la toile comme valeur relative ♠♠, ou que ce soit l’inverse,
la proportion ♦♦♦, dans laquelle se fait l’échange, reste la même. La quantité de valeur ♦♦♦♦ respective des deux marchandises, mesurée ♠♠♠ par /70/ la durée comparative du travail nécessaire
à leur production est, par conséquent, une détermination tout à fait
indépendante de la forme de valeur.
La marchandise dont la valeur
se trouve sous la forme relative est toujours exprimée comme quantité de valeur,
tandis qu’au contraire il n’en est jamais ainsi de l’équivalent qui figure toujours dans l’équation ♦ comme simple quantité d’une chose utile. 40 mètres de toile,
par exemple, valent
— quoi ?
2 habits. La marchandise habit jouant ici le rôle d’équivalent, donnant ainsi un corps à la
valeur ♦♦ de la toile, il suffit d’un certain quantum d’habits pour exprimer le quantum de valeur qui appartient à la
toile. Donc, 2 habits peuvent exprimer la quantité de valeur de 40 mètres de
toile, mais non la leur propre ♦♦♦. L’observation
superficielle de ce fait, que, dans l’équation de la valeur ♦♦♦♦, l’équivalent ne figure jamais que comme simple quantum d’un objet d’utilité, a induit
en erreur S. Bailey ainsi que beaucoup d’économistes avant et après lui.
Ils n’ont vu dans l’expression de la valeur qu’un rapport de quantité ♥. Or, sous la forme équivalent une
marchandise figure comme simple quantité d’une matière quelconque précisément
parce que la quantité de sa valeur n’est pas
exprimée ♥♥.
Les
contradictions que renferme la forme équivalent exigent maintenant un examen plus
approfondi de ses particularités. Première
particularité de la forme équivalent :
la valeur
d’usage devient la
forme de
manifestation de son contraire la, valeur. {Je
ne commenterais même pas cette chose} La forme naturelle des
marchandises devient leur
forme de valeur ♦. Mais, en fait, ce quid pro quo n’a lieu pour une
marchandise B (habit, froment, fer, etc.) que dans les limites du rapport de valeur,
dans lequel une autre marchandise A (toile, {vierges}
etc.) entre avec elle, et seulement dans ces limites. Considéré isolément,
l’habit, par exemple, n’est qu’un objet d’utilité, une valeur d’usage,
absolument comme la toile ; sa forme n’est que la forme naturelle d’un
genre particulier de marchandise. Mais comme aucune marchandise ne peut se
rapporter à elle-même comme équivalent ♦♦, ni faire de sa forme
naturelle la forme de sa propre valeur ♦♦, elle doit nécessairement
prendre pour équivalent
une autre marchandise dont la valeur d’usage lui sert ainsi de forme valeur ♦♦.
Une mesure appliquée aux marchandises
en tant que matières, c’est-à-dire en tant que valeurs d’usage, va nous
servir d’exemple pour mettre ce qui précède directement sous les yeux du
lecteur. Un pain de sucre, puisqu’il est un corps, est pesant et, par conséquent, a du
poids ; mais il est impossible de voir ou de sentir ce poids rien qu’à
l’apparence ♦. Nous prenons maintenant divers morceaux de fer de poids connu ♦♦. La forme matérielle du fer, considérée en
elle-même, est aussi peu une forme de manifestation de la pesanteur que
celle du pain de sucre ♦♦♦. Cependant, pour exprimer que ce dernier
est pesant, nous le plaçons en un rapport de poids avec le fer ♦♦♦♦. Dans ce rapport, le fer
est considéré comme un
corps qui ne /71/ représente ♣ rien que de la pesanteur.
Des quantités de fer employées pour mesurer le poids du sucre représentent donc
vis-à-vis de la matière sucre une simple forme, la forme sous laquelle la
pesanteur se manifeste ♣♣. Le fer ne peut jouer ce rôle qu’autant que le
sucre ou n’importe quel autre corps, dont le poids doit être trouvé, est mis en rapport avec lui à
ce point de vue ♣♣♣. Si les deux objets n’étaient pas pesants, aucun rapport de cette
espèce ♣♣♣♣ ne serait possible entre
eux, et l’un ne pourrait point servir d’expression ♣♣♣♣ à la pesanteur de l’autre.
Jetons-les tous deux dans la balance et nous voyons en fait qu’ils sont la même chose comme
pesanteur ♥, et que, par conséquent, dans une certaine proportion ♥ ils sont aussi du même poids. De même que le corps fer, comme mesure de poids ♥♥, vis-à-vis du pain de sucre ne représente que
pesanteur, de même, dans notre expression de valeur, le corps habit vis-à-vis de la
toile ne représente que valeur ♥♥♥.
Ici cependant cesse l’analogie. Dans l’expression de poids ♦ du pain de sucre, le fer représente ♦♦ une qualité naturelle commune aux deux corps, leur pesanteur, tandis que dans l’expression de valeur de la toile, le corps habit représente une qualité surnaturelle des deux objets, leur valeur, un caractère d’empreinte purement sociale. Du moment que la forme relative exprime la valeur d’une marchandise, de la toile, par exemple, comme quelque chose de complètement différent de son corps lui-même et de ses propriétés, comme quelque chose qui ressemble à un habit, par exemple, elle fait entendre que sous cette expression un rapport social est caché ♦♦♦.
C’est l’inverse
qui a lieu avec la forme
équivalent ♦. Elle consiste précisément en ce que le corps d’une marchandise, un habit, par
exemple, en ce que cette chose, telle quelle, exprime de la valeur ♦, et, par conséquent, possède naturellement forme de valeur ♦. Il est vrai que cela n’est juste qu’autant qu’une autre
marchandise, comme la toile, se rapporte à elle comme équivalent*♦♦. Mais, de même que les propriétés matérielles
d’une chose ne font que se confirmer dans ses rapports extérieurs avec
d’autres choses au lieu d’en découler, de même, l’habit semble tirer de la nature, et non du rapport de valeur de la toile, sa forme équivalent, sa propriété d’être
immédiatement échangeable, au même titre que sa propriété d’être pesant
ou de tenir chaud ♦♦♦. De là, le côté
énigmatique de l’équivalent,
côté qui ne frappe les yeux de l’économiste bourgeois que lorsque cette forme
se montre à lui tout achevée, dans la monnaie. Pour dissiper ce caractère
mystique de l’argent et de l’or, il cherche ensuite à les remplacer sournoisement
par des marchandises moins éblouissantes ; il fait et refait avec un
plaisir toujours nouveau le /72/ catalogue de tous les articles qui, dans leur
temps, ont joué le rôle d’équivalent ♠. Il ne pressent pas que l’expression
la plus simple de la valeur, telle que 20 mètres de toile valent un habit,
contient déjà l’énigme et que c’est sous cette forme simple qu’il doit
chercher à la résoudre. * Dans un
autre ordre d’idées il en est encore ainsi. Cet homme, par exemple, n’est roi
que parce que d’autres hommes se considèrent comme ses sujets et agissent en
conséquence. Ils croient au contraire être sujets parce qu’il est roi. {Le bon individualiste méthodologique se manifeste.
Y z’ont qu’à être cesser d’obéir, ces cons, et ils seront libres — non,
y peuvent pas, à cause des rapports de production, bla bla. Autrement
dit, pour qu’ils ne se noient plus, il suffit de les guérir de l’idée de
pesanteur. La Boëtie, que j’ai lu depuis, n’est guère mieux. La contradictoire
est la vie exemplaire de Mesrine : il a cessé d’obéir, il en est mort.
Il n’y a pas plus idéaliste qu’un individualiste méthodologique}
Deuxième
particularité de la forme équivalent :
le travail
concret devient la forme de manifestation de son contraire, le travail humain
abstrait. Dans
l’expression de la valeur d’une marchandise, le corps de l’équivalent figure
toujours comme matérialisation du travail humain abstrait, et est toujours le
produit d’un travail particulier, concret, et utile. Ce travail concret ne
sert donc ici qu’à exprimer du travail abstrait. Un habit, par exemple,
est-il une simple réalisation, l’activité du tailleur qui se réalise en lui
n’est aussi qu’une simple forme de réalisation du travail abstrait. Quand on
exprime la valeur de la toile dans l’habit, l’utilité du travail du tailleur
ne consiste pas en ce qu’il fait des habits et, selon le proverbe allemand,
des hommes, mais en ce qu’il produit un corps, transparent de valeur {funny !
Ne s’agit-il pas d’une coquille}, échantillon d’un travail qui ne se
distingue en rien du travail réalisé dans la valeur de la toile. Pour pouvoir
s’incorporer dans un tel miroir de valeur,’il faut que le travail du tailleur
ne reflète lui-même rien que sa propriété de travail humain. Les deux
formes d’activité productive, tissage et confection de vêtements, exigent une
dépense de force humaine. Toutes deux possèdent donc la propriété commune
d’être du travail humain, et, dans certains cas, comme, par exemple,
lorsqu’il s’agit de la production de valeur, on ne doit les considérer qu’à
ce point de vue. Il n’y a là rien de mystérieux ; mais dans l’expression
de valeur de la marchandise, la chose est prise au rebours. Pour exprimer,
par exemple, que le tissage, non comme tel, mais en sa qualité de travail
humain en général, forme la valeur de la toile, on lui oppose un autre
travail, celui qui produit l’habit, l’équivalent de la toile, comme la forme expresse
dans laquelle le travail humain se manifeste. Le travail du tailleur est
ainsi métamorphosé en simple expression de sa propre qualité abstraite. (…suite :
Marx lit Aristote) |
Un extrait de Lebesgue
La
Mesure des grandeurs
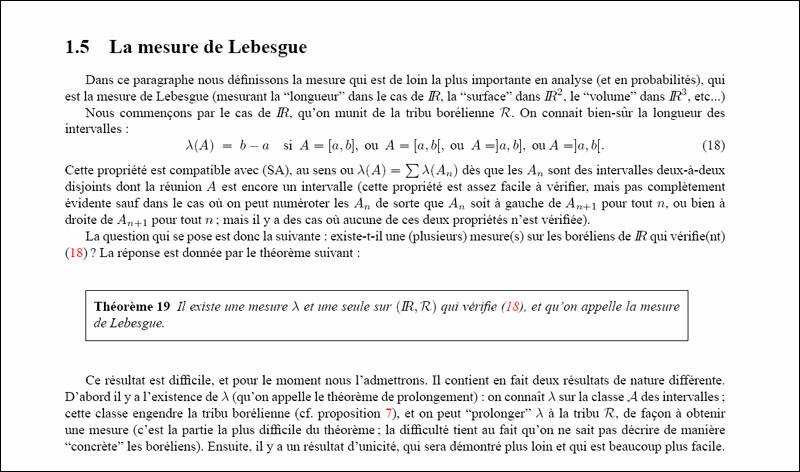
Théorie de
l’intégration — Jean Jacod
(Cette mesure n’a pas de
rapport avec notre démonstration,
il s’agit d’une simple
illustration)
|
La Mesure des grandeurs < Un
peu d’histoire > /92/ 63. —
Auparavant, un court résumé historique nous renseignera sur les difficultés à
éviter et fera comprendre la nécessité de certaines précautions. Pour les
Anciens, les notions de longueur, d’aire, de volume étaient des notions
premières, claires par elles-mêmes sans définitions logiques. Les axiomes,
presque tous implicites, qu’ils utilisaient pour les évaluations n’étaient
pas, à leurs yeux, des définitions de ces notions. Il s’agissait toujours
pour eux de la place occupée par la ligne, la surface ou le corps dans
l’espace. La difficulté ne commençait que lorsqu’il s’agissait de mesurer
cette place, de lui attacher un nombre et cette difficulté est uniquement
l’existence des incommensurables. D’où l’aversion pour les nombres, les
efforts faits pour ne les utiliser que le plus tardivement possible, les
habiletés étranges de présentation employées, qui ont déjà été signalées, par
exemple aux § 14 et 20. Cauchy, le
premier, fournit une définition logique de ces notions ; il le fit
incidemment et en quelque sorte sans le vouloir. On a vu dans
les deux chapitres précédents comment on peut élucider les notions d’aire
d’un domaine plan et de volume d’un corps en les dépouillant de leur sens
métaphysique, en les considérant comme des nombres et en construisant ces nombres par la
répétition indéfinie des opérations mêmes qui étaient considérées auparavant
comme fournissant approximativement les mesures des aires et volumes à cause
d’axiomes, de postulats non énoncés explicitement et dont l’énonciation
explicite, ou la démonstration, fournit la définition logique cherchée. On
sait que Cauchy construisit, par un procédé analogue, l’intégrale définie des
fonctions continues et démontra ainsi l’existence des fonctions primitives. Ce faisant,
Cauchy définissait logiquement non seulement l’aire d’un domaine plan, le volume
d’un corps, mais, puisqu’il donnait la définition logique de : ⌠ (x’2 + y’2 + z’2) ½ dt
⌡ et de : ⌠⌠ (1 + p2 + q2) ½ dx dy ⌡⌡ il inaugurait le mode de définition de la longueur
que je signalais tout à l’heure, § 62, et suggérait une définition analogue
pour l’aire. /93/ Du point de
vue logique la question est entièrement traitée ; fixons bien ce qui a
été atteint. On dit
souvent que Descartes — il conviendrait au moins d’ajouter au nom de
Descartes celui de Fermat - a ramené la Géométrie à l’Algèbre ; ceci
pourtant n’était pas vrai tant qu’il fallait faire appel aux notions
géométriques : longueurs, aires, volumes. Ce n’est qu’après Cauchy que
le rattachement des notions géométriques à des opérations de calcul a été
effectué. Alors la Géométrie a bien été réduite à l’Algèbre, c’est-à-dire,
puisque le nombre en
général résulte de la mesure des longueurs (chapitre II), que la géométrie du plan et
celle de l’espace ont été ramenées à la géométrie de la droite. Pour arriver
à ce qu’on appelle l’arithmétisation de la géométrie, il ne restait plus qu’à définir le nombre en général
à partir des entiers sans parler de mesures, d’opérations effectuées sur la
droite et c’est ce que permet l’emploi d’une coupure, c’est-à-dire ce qu’on
obtient en utilisant une fois de plus le procédé de Cauchy consistant à prendre comme définition les
opérations mêmes qui permettent l’évaluation approchée du nombre à
définir. Car la donnée d’une coupure n’est pas autre chose, cela a déjà été
dit, que l’exposé en termes abstraits du résultat d’une mesure de longueur. 64. —
Nous voici donc parvenus à la forme la plus abstraite, la plus purement
logique d’exposition par l’emploi constant de cette sorte de renversement qui
servit d’abord à Cauchy. Et pourtant, ni le Géomètre, qui voudrait comprendre
quels liens géométriques unissent les lignes, surfaces ou corps à leurs longueurs,
aires et volumes, ni le Physicien, qui voudrait savoir pourquoi il faut
assimiler les longueurs, aires et volumes physiques à telles intégrales
plutôt qu’à d’autres, ne sont satisfaits. Des études s’imposaient. (…) < Définition > /131/ (…) La
notion que nous préciserons n’englobera pas toutes celles auxquels
s’appliquent les différents sens donnés au mot grandeur ; nous savons
qu’il faut savoir se restreindre et nous ne nous proposons nullement
d’atteindre la plus grande généralité possible, mais seulement une extension
qui ne diminue pas la portée qu’on entend actuellement donner au chapitre sur
la mesure des grandeurs. 86. —
Examinons donc quelles sont les parties communes aux diverses définitions des
chapitres précédents et, puisque les masses physiques sont aussi considérées
comme des types parfaits de grandeur, nous retiendrons celles de ces parties
qui peuvent être transposées au cas des masses. La longueur d’un segment ou
d’un arc de cercle, l’aire d’un polygone ou d’un domaine découpé dans une
surface, le volume d’un polyèdre ou d’un corps ont été définis comme des
nombres positifs attachés à des êtres géométriques et parfaitement définis
par ces êtres, au choix de l’unité près ; c’était la condition α ♦. Le cas des masses nous
conduit à poser cette première partie de la définition, qui sera composée de
deux parties a) et b). /132/ a) Une famille de corps étant donnée,
on dit qu’on a défini pour ces corps une grandeur G si, à chacun d’eux et
à chaque partie de chacun d’eux, on a attaché un nombre positif déterminé. On rappellera
le procédé qui a permis de déterminer le nombre en donnant un nom à ce
nombre, à cette grandeur : longueur, volume, masse, quantité de chaleur,
etc. ; on dit aussi que l’on a mesuré la longueur, le volume, etc. Le
procédé physique de détermination ne permet en réalité d’atteindre un nombre
qu’à une certaine erreur près ; il ne permet jamais de discriminer un
nombre de tous ceux qui en sont extrêmement voisins. On imagine donc, comme
nous l’avons fait dans le cas du procédé de mesure de la longueur d’un
segment, que le procédé est indéfiniment perfectible jusqu’à conduire à un
seul nombre, entièrement déterminé. La famille
des corps envisagée variera d’une grandeur à une autre ; tous ces corps
pourront, être assimilables à des segments de droite dans certains cas, dans
d’autres à des arcs de courbes, dans d’autres encore à des domaines superficiels,
dans d’autres à des parties de l’espace ; même, dans les enseignements
moins élémentaires, on pourra considérer des portions d’espaces à plus de
trois dimensions ou de variétés plongées dans de tels espaces. 87. — Le
cas des masses montre que nous ne devons pas songer à généraliser la
condition γ) ♦ des chapitres
précédents ; à deux corps géométriquement égaux pourront correspondre
deux nombres différents comme mesure de la grandeur G pour ces corps.
Par contre, la condition β) ♦ est généralisable et elle
est essentielle : b) Si l’on divise un corps C en un certain nombre de corps partiels C1, C2,..., Cn, et si la grandeur G est, pour ces
corps, g d’une part, g1, g2, ..., gp d’autre part, on doit
avoir : g = g1 + g2 + … + gp Cette condition précise
celle que nous avons critiquée plus haut : on doit pouvoir parler de la somme de deux grandeurs ♦. Dans tout ce qui précède
nous avons laissé au mot corps un caractère imprécis analogue à celui donné
auparavant au mot /133/ domaine ; il est clair que,
en géométrie ou en physique théorique, on pourrait préciser le sens logique
donné à ce mot. En géométrie, en particulier, on pourra donner au mot corps
un sens plus ou moins large, par exemple celui d’ensemble ou de figure ;
seulement il faudra, dans chaque cas, avoir défini ce qu’on appellera un
partage de la figure totale en parties. Même, la grandeur pourrait ne pas
être attachée à des données de nature géométrique mais à des données de
nature plus variée. Ici, l’examen des corps assimilables géométriquement à
des domaines découpés dans l’espace, ou sur des surfaces, ou sur des courbes
nous suffira.
La famille
des corps est d’ailleurs assujettie à une condition qu’on peut laisser sous-entendue
dans l’enseignement élémentaire, mais dont la nécessité, au point de vue
logique, va apparaître à l’occasion de la démonstration de l’unique théorème
qui, avec la définition posée, constitue toute la théorie des grandeurs. /133/
(…) La famille des corps est d’ailleurs assujettie à une condition qu’on peut
laisser sous-entendue dans l’enseignement élémentaire, mais dont la
nécessité, au point de vue logique, va apparaître à l’occasion de la
démonstration de l’unique théorème qui, avec la définition posée, constitue
toute la théorie des grandeurs. 88. —
Lorsque deux grandeurs G et G1
sont définies pour la même famille de corps si, pour tous les corps pour
lesquels G
a une
même valeur quelconque g, G1 a une même valeur g1, entre g et g1 existe la relation g1 = kg, k étant une constante. Pour démontrer la propriété précédente (…)
< Conséquences > /136/ (…) Voici maintenant des observations qu’il conviendrait de faire noter
aux élèves : la longueur de la hauteur de la pyramide n’est pas une
grandeur attachée à la pyramide, mais est une grandeur attachée au segment
hauteur ; l’aire de la surface d’un polyèdre n’est pas une
grandeur définie pour la famille des polyèdres, mais l’aire d’une partie de
la surface d’un polyèdre est une grandeur définie pour les parties de la
surface considérées comme corps ; la hauteur suivant ox d’un parallélépipède
rectangle dont une arête est parallèle à ox n’est pas une grandeur attachée au polyèdre, mais
elle en serait une si tous les polyèdres étaient découpés par des plans
perpendiculaires à ox dans un même prisme rectangle indéfini. Ainsi, un nombre
est ou non une grandeur suivant le
corps auquel on l’attache ; il n’y a pas identité nécessaire entre la
famille des corps pour lesquels il est défini et la famille de ceux pour qui
il est une grandeur ♦.
91. — Lorsque deux grandeurs satisfont aux conditions
du n° 88, c’est-à-dire quand elles sont définies pour la même famille de
corps et que la valeur de l’une g détermine l’autre g1, les deux grandeurs sont
dites proportionnelles. Le théorème démontré
prouve que du fait que g1 est fonction de g, g1 = f (g), cette fonction a la forme g1 = kg. Il n’existe donc pas de
grandeurs inversement proportionnelles avec le sens /137/ précis que nous avons
donné au mot grandeur, ni de grandeurs dépendant l’une de l’autre d’une autre façon que
proportionnellement. Bien entendu deux nombres
peuvent être liés autrement que proportionnellement, mais alors l’un au moins
d’entre eux n’est pas une grandeur ; si tous deux sont des
grandeurs, la relation se réduit à la proportionnalité. Or la famille des
grandeurs est vaste ; elle comprend, nous l’avons vu, des nombres
intéressant la géométrie, la physique et aussi des nombres relatifs à des questions économiques, comme le prix d’une marchandise ♦, le temps nécessaire à sa fabrication,
etc. ; d’où le grand-nombre de proportionnalités qu’on rencontre.
On remplacera des raisonnements un peu douteux [Oui il est temps] ou franchement inadmissibles par des raisonnements corrects en
démontrant que l’on a affaire à des grandeurs. Pour nous borner à des notions purement
mathématiques, énumérons les grandeurs suivantes : longueurs des
segments d’une droite, longueurs des arcs d’une courbe, aires des domaines
d’un plan, aires des portions d’une surface, volumes des parties de l’espace,
mesures des angles, mesures des arcs d’une circonférence, mesures des angles
solides, mesures des parties d’une sphère, temps pris par un mobile à parcourir les segments de sa
trajectoire [NB :
c’est un temps que l’on mesure après avoir mesuré une base, et temps et
longueur de la base demeurent proportionnels à vitesse constante. Temps et
longueur sont attachés à l’arc-trajectoire et non au mobile. La vitesse, quoique
définie pour le mobile, ne peut pas être une grandeur attachée au mobile
parce que le mobile et la base sont des corps différents, indépendants,
tandis que la vitesse dépend de ces deux corps. Elle est relative dirait
Galilée],
variations de la vitesse d’une extrémité à l’autre d’un tel segment. Que ces nombres soient des
grandeurs, cela est évident pour les deux derniers et nous l’avons démontré
pour les premiers ; les seuls qui exigeraient des raisonnements, que
j’omets, sont les mesures, vérifiant les conditions α), β), γ)
[définies page 44 ♦], d’angles solides et de
parties d’une sphère.
Les proportionnalités entre ces grandeurs, quand
elles existent, sont alors de preuve facile. D’abord il peut arriver qu’elles
soient affirmées par la question : mouvement dans lequel le mobile
parcourt des espaces égaux dans des temps égaux ; alors la longueur
parcourue et le temps de parcours sont deux grandeurs proportionnelles
attachées aux arcs parcourus ; de même, dans le mouvement pour lequel la
vitesse croit de quantités égales dans des temps égaux. L’accroissement de
vitesse est proportionnel à l’accroissement du temps. (Henri Lebesgue, La
mesure des grandeurs, Librairie scientifique et technique Albert
Blanchard, rue saint Jacques, après le croisement de la rue Soufflot et le la
rue Saint-Jacques, en montant, trottoir de gauche)
|
Notes préparatoires. Traduction Tricot
Notes
préparatoires. Traduction anonyme